
Violences faites aux femmes: tous ces facteurs qui poussent au crime (analyse)

Huit femmes sur dix auraient subi des violences genrées au cours de leur vie. De l’insulte au viol. Malgré toutes les avancées en matière d’égalité, en dépit des dénonciations toujours plus nombreuses, pourquoi les agressions ne cessent-elles pas ? A cause de l’alcool, du porno, des stéréotypes de genre, de la précarité… Décryptage d’un phénomène multifactoriel, à l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, ce jeudi 25 novembre.
Marianne Lejeune est la dernière magistrate du pays à avoir obtenu une condamnation à une peine de mort. Affaire Lecrenier, dossier Cools, assassinat d’Ihsane Jarfi, disparition des petites Stacy et Nathalie… Le pire, durant sa carrière d’avocate générale, elle l’a jaugé sous toutes ses formes. Lorsqu’est arrivé l’âge de la retraite, et qu’elle n’a pas voulu la prendre, la Liégeoise a été envoyée en renfort au parquet de la province de Luxembourg, qui manquait d’effectifs. Elle y est restée quatre ans, entre 2015 et 2019. Au moment de tirer le bilan de cette parenthèse arlonaise, elle avait raconté avoir été étonnée de la présence des trafics de drogues dans cette région ceinturée par trois frontières, mais aussi surprise par l’ampleur des violences conjugales.

Même là, dans cette province comptant sans doute davantage d’arbres que d’habitants, aux jolies fermettes et villas quatre façades, bien loin de la précarité des centres urbains. Certes moins qu’ailleurs : il y a eu, en 2020, 1 155 dossiers pour violences au sein du couple (physiques, sexuelles, psychiques ou économiques) ouverts en province de Luxembourg, contre 3 457 à Bruxelles ou 4 572 à Liège. Mais même là, donc. Partout, en fait.
Ces statistiques de la police fédérale (qui recensent 37 736 dossiers de ce type, soit 103 ouverts chaque jour !) ne mentionnent pas les viols (sauf les collectifs : 170 en 2020), les attentats à la pudeur, le harcèlement, les féminicides… Ni toutes celles qui ne portent pas plainte. C’est le fameux « chiffre noir », la partie immergée de l’iceberg ou qu’importe l’appellation : les violences faites aux femmes sont un phénomène sous-estimé. Un seul exemple : chez SOS Viol, 71 % des personnes faisant appel à l’association n’ont pas déposé de plainte.
Une femme sur cinq violée ?
Les données manquent pour connaître l’ampleur exacte de ce fléau. Certaines études offrent des bribes de réponses. En 2019, Amnesty International Belgique publiait les résultats d’un sondage selon lequel 20 % des sondées déclaraient avoir été violées au cours de leur existence. Une femme sur cinq. En juin dernier, les universités de Liège et de Gand ont présenté les résultats d’une étude d’envergure, selon laquelle 16 % des femmes (et 5 % des hommes) ont été violés, tandis que 81 % ont subi des violences sexuelles au cours de leur vie. Pour deux femmes sur cinq, il s’agissait de violences impliquant un contact physique.
Autre étude, autres chiffres, même constat inquiétant : selon les estimations de l’OMS (diffusées en mars dernier), 35 % des femmes, « soit près d’une femme sur trois », indiquent avoir été « exposées à des violences physiques ou sexuelles de la part de leur partenaire intime ou de quelqu’un d’autre au cours de leur vie ». Si les violences étaient un virus, il s’agirait indubitablement d’une pandémie.
Tenace. Virulente. Le travail des mouvements féministes, les avancées sociétales et législatives, la récente libération de la parole n’ont pas (encore ?) créé d’immunité collective. Telle une maladie héréditaire, la violence semble même se transmettre de génération en génération. L’OMS classe le fait d’y avoir été exposé durant son enfance bien en haut de la liste des facteurs explicatifs récurrents (lire l’encadré ci-dessous). Donc avoir vu papa battre maman étant gosse, ou avoir été soi-même frappé, n’empêche pas, un jour, de taper sa conjointe. Que du contraire. Une chaîne sans fin.
Être victime augmente les chances de le devenir à nouveau
Cela vaut aussi pour les victimes, selon l’OMS et Fabienne Glowacz, docteur de psychologie à l’ULiège. « Avoir été victime est l’un des plus importants facteurs de risque de l’être à nouveau, détaille-t-elle. Car ça affaiblit la personne, affecte sa confiance en elle, ses forces, ses ressources… Et donc l’expose. Ça diminue également l’assertivité, le fait de pouvoir reconnaître des gestes qui sont adéquats ou pas. » D’où son « plaidoyer » pour une prise en charge précoce et adaptée des victimes.
Mais la violence genrée ne s’explique pas seulement par un « héritage ». « C’est un phénomène multifactoriel, résume Yamina Zaazaa, directrice du Centre de prévention des violences conjugales et familiales. Il est rare qu’un élément unique explique à lui seul une situation. » Des traits individuels (troubles de la personnalité antisociale, narcissisme exacerbé, schémas abandonniques…) s’entremêlent à des facteurs sociétaux. L’OMS souligne, par exemple, le faible accès des femmes à des emplois rémunérés, ce qui peut les placer en situation de dépendance économique et affective, donc favoriser le phénomène d’emprise.
Le faible niveau d’éducation, tant chez les auteurs que les victimes, se révèle aussi un facteur de risque, selon l’OMS. Fabienne Glowacz confirme, mais nuance : « Les études démontrent que la violence traverse tous les milieux, même si certains sont davantage protégés que d’autres, décrit-elle. Concernant le statut socio-économique, il s’agit surtout des nombreux stress qui peuvent y être liés : problèmes financiers, de santé physique, détresse psychologique, manque de ressources sociales, exiguïté des logements qui entraîne une promiscuité… » Vivre dans des conditions difficiles peut exacerber les risques de violences, « mais affirmer que les milieux défavorisés sont plus exposés est une mauvaise traduction ».
La consommation d’alcool traverse aussi toutes les couches de la population, et est un autre élément problématique. C’est la célèbre petite phrase, « quand il n’a pas bu, il est doux comme un agneau« , tant entendue dans les tribunaux. C’est aussi, par exemple, une constante dans quasiment tous les témoignages de #balancetonfolklore, ce mouvement de dénonciations qui traverse actuellement plusieurs universités belges. Sur les réseaux sociaux, les étudiantes qui dénoncent leurs agressions mentionnent neuf fois sur dix une consommation excessive d’alcool, sans laquelle il ne se serait probablement rien passé. « L’alcool a un effet désinhibiteur, un effet excitant, c’est évident, pointe Fabienne Glowacz. Mais on peut aussi proposer une autre lecture, qui me semble intéressante : des personnes ne s’alcooliseront-elles pas volontairement pour pouvoir passer à l’acte ?«
Les stéréotypes coulent à flots
La société ne baigne pas seulement dans l’alcool. Elle est aussi imbibée de stéréotypes de genre. Serge Garcet, professeur au département de criminologie de l’ULiège, en énumère plusieurs : « L’incontrôlabilité, le fait qu’il serait normal pour un homme de ne pas contrôler ses émotions. La violence qui serait acceptable pour un homme. L’objectification des femmes ; si elles sont des objets, des animaux (des chiennes, par exemple), elles sortent du cercle fermé de l’humanité. La sexualité incontrôlable côté masculin, ce qui alimente le « mythe du viol ». Etc. »
Bref, reprend celui qui intervient aussi comme expert auprès des tribunaux, « il est indéniable que nous vivons dans une société sexiste et machiste« . Façonnée par tous ces stéréotypes selon lesquels l’homme serait supérieur à la femme. Et aurait donc certains droits sur elle, de celui de lui coller la main aux fesses à celui de la tuer. Le féminicide, ce droit de propriété ultime : « Puisque je ne peux pas l’avoir, personne d’autre ne l’aura. »
La persistance de lois inégalitaires, au sein des pays, renforce ces « normes collectives qui privilégient l’homme ou lui assignent un statut supérieur à celui de la femme », pour reprendre les termes de l’OMS. Congé de parentalité inégal, statut de cohabitant, pension… Des lois en vigueur qui font du tort aux femmes, il en existe plusieurs, en Belgique. Mais quand bien même le plat pays deviendrait régi par des textes parfaitement égalitaires, subsisteraient les mentalités, tellement imprégnées de clichés, et qu’aucune loi ne peut forcer à changer.
« Nos croyances, nos stéréotypes, tout ça est construit depuis la plus petite enfance« , commente Serge Garcet. Et de citer ces mamans qui habillent leurs gamins en vestes en jeans, bandanas et bottines genre loubard. Les jouets genrés : petite cuisine et planche à repasser pour les filles, pistolet et voiture pour les garçons. Les cours de récréation, toutes agencées avec un terrain de football au centre, reléguant les écolières à la périphérie. Les sports choisis pour les enfants : individuels et amusants pour elles (danse, gym…), collectifs et compétitifs pour eux (foot, basket…).
Les ravages du porno
Puis déboule l’adolescence et ses premiers émois. Combien de parents évoquent la question de la sexualité avec leur progéniture ? Combien d’écoles dispensent un véritable Evras (cours d’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle) ? Souvent laissés seuls à leur apprentissage, beaucoup de jeunes se tournent vers le porno, qui n’a jamais été aussi facilement accessible. Une catastrophe, en termes de clichés genrés. « La pornographie donne d’abord à voir une sexualité masculine, qui obéit à des codes cinématographiques, où la femme apparaît comme désireuse d’être soumise, humiliée, violentée, donnée à des partenaires multiples… », énumère Serge Garcet. Sans parler de son plaisir propre, complètement absent des « intrigues ». « Pour des jeunes qui manquent de recul, il est facile de confondre une sexualité « normale » avec des stéréotypes de genre qui sont ceux de la pornographie. »
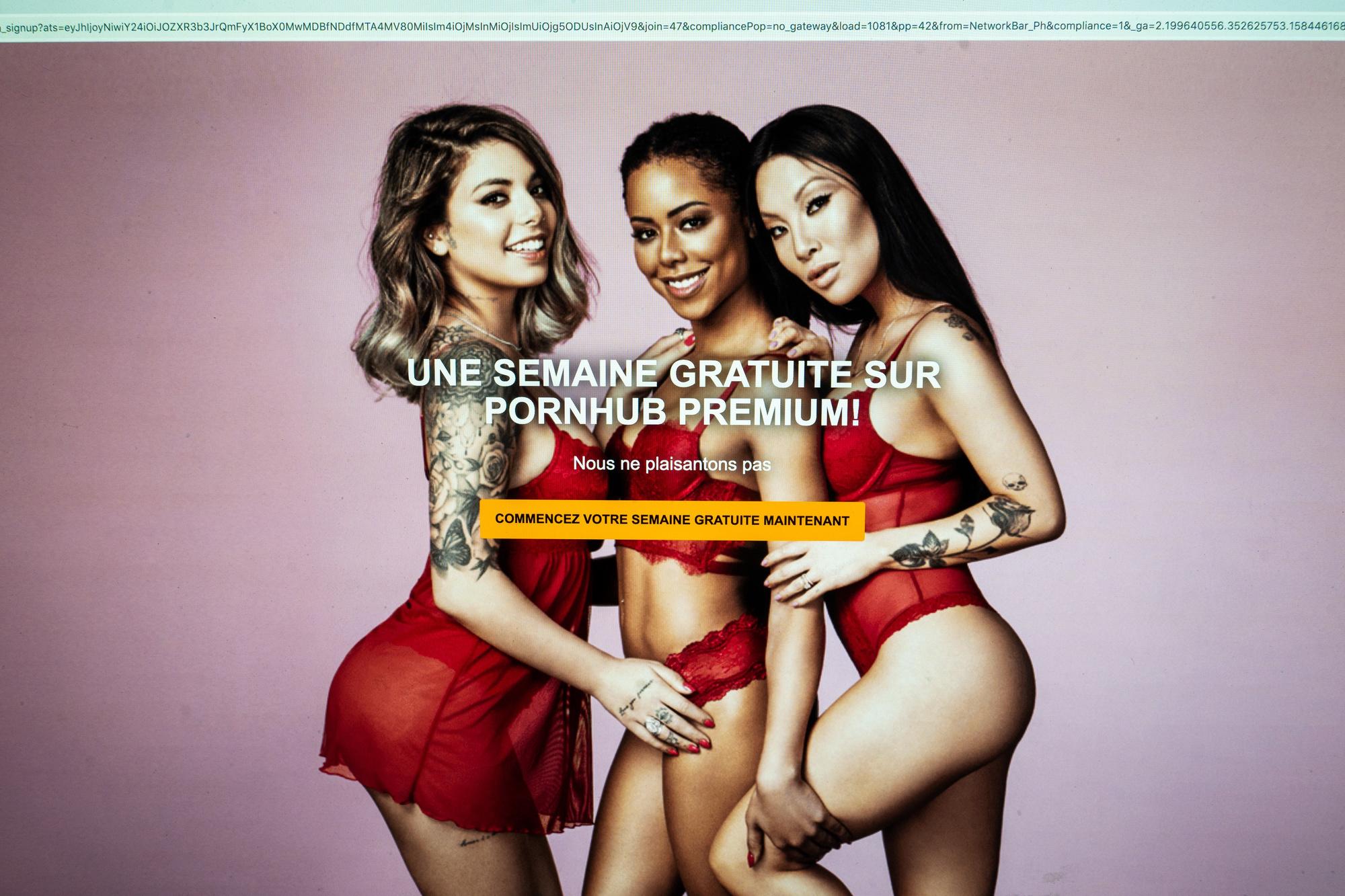
L’idée selon laquelle « le sexe serait un dû pour l’homme« , qui traverse toute l’industrie des films X, est l’un des facteurs « spécifiquement associés à la perpétration d’actes de violence sexuelle », selon l’OMS. Qui ajoute, par ailleurs, dans la même liste, les « croyances relatives à l’honneur familial et à la pureté sexuelle ». Délicat sujet que celui de la religion… « C’est peut-être devenu politiquement incorrect de le signaler, mais c’est aussi une réalité, observe Serge Garcet. A l’échelle des expertises, on a évidemment des « bons belges », mais aussi des femmes qui subissent des violences en raison d’un contexte culturel. » Le catholicisme n’est certainement pas un modèle en matière d’égalité des sexes. D’autres religions le sont encore moins. Une société de plus en plus multiculturelle rend d’autant plus complexe la déconstruction des stéréotypes de genre. Qui sont certes véhiculés par la la famille, « mais aussi les cercles amicaux, les réseaux sociaux, les médias, les films et séries… », cite Fabienne Glowacz. Bref, difficile d’y échapper, d’une manière ou d’une autre. « Cette socialisation patriarcale, tout le monde la reçoit, épingle Yamina Zaazaa. Mais ce n’est pas pour ça non plus que tout le monde devient violent envers des femmes ! C’est un phénomène multifactoriel, nuancé selon les parcours personnels et l’état de santé mentale. »
Pour en sortir, les solutions devront donc nécessairement être multiples. Education, législations, rémunération, alcoolisation, instruction, religion… Et déconstruction, de tous les stéréotypes de genre qui façonnent encore la société. « C’est un sacré boulot, il faut carrément remonter à Adam et Eve ! », s’exclame Serge Garcet. Il faut ce qu’il faut…
Facteurs associés aux violences envers les femmes, selon l’OMS
– Faible niveau d’instruction (auteurs et victimes).
– Exposition à la maltraitance durant l’enfance et à la violence familiale (auteurs et victimes).
– Troubles de la personnalité antisociale (auteurs).
– Usage nocif de l’alcool (auteurs et victimes).
– Comportements masculins préjudiciables (infidélité, cautionner la violence… / auteurs).
– Normes collectives qui privilégient l’homme ou lui assignent un statut supérieur à celui de la femme.
– Faible accès des femmes à des emplois rémunérés.
– Grandes disparités entre les sexes (lois discriminatoires…).
Le viol et ses mythes
« T’as vu comment elle était habillée ? » « Elle avait les yeux qui disaient oui ! » « Elle l’a ramené chez elle, qu’est-ce qu’elle croyait ? » « Fallait pas qu’elle marche seule la nuit » Autant d’idées reçues persistantes, en matière de violences sexuelles, qui tendent à minimiser la responsabilité de l’auteur pour la reporter sur la victime. Selon les résultats d’un sondage publiés en mars 2020 par Amnesty International, 38 % des hommes belges et 43 % des femmes estiment que les hommes ont des besoins sexuels incontrôlables et irrépressibles. Tandis que 27 % des jeunes considèrent que les femmes ne savent pas ce qu’elles veulent sexuellement. « Elles disent non, mais elles pensent oui. » Fabienne Glowacz (ULiège) confirme que ces mythes autour du viol restent très présents. Et « qu’ils influenceront fortement le passage à l’acte », en matière de violences sexuelles.
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici