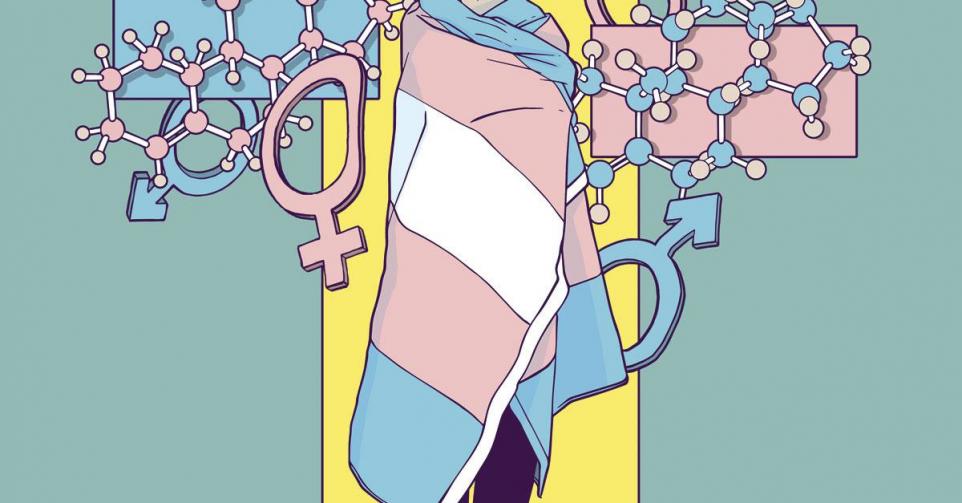
Transgenre: ado et déjà en transition

Né fille, Nathaniel, 24 ans, est devenu un garçon. Née garçon, Lou se sait fille. Comme eux, de plus en plus d’adolescents et de jeunes adultes disent qu’ils ne sont pas nés dans le bon genre et entament leur transition de plus en plus tôt, dès l’adolescence.
Nathaniel – mais il préfère Nath – a toujours ressenti une forme de différence. « Je n’ai jamais correspondu à l’image classique des filles, indique-t-il. Petit, on ne savait pas si j’étais une fille ou un garçon. J’ai eu les cheveux courts très vite. J’étais très androgyne. » Plus tard, il ne comprend pas que ses camarades le traitent de « pédale » et de « gouine », parce qu' »on pensait que j’étais un garçon et que j’étais trop efféminé, ou que j’étais trop « garçon manqué » et que j’étais une fille ». Avec le temps, sa confusion s’est transformée en douleur et la puberté a été dramatique. « J’ai compris que mon corps était en train de choisir pour moi, de m’imposer que je devais porter des soutiens-gorge, me changer avec toutes les autres filles. Je n’étais pas bien dans ma peau, j’étais très désagréable parce que je ne m’aimais pas et, dès lors, je n’aimais pas les autres. Je luttais contre les dépressions. »
Aucun parcours de transition ne se ressemble.
D’abord, le jeune homme a cru être lesbienne. A 12 ans, il se sent attiré par les filles. « Dans mes journaux intimes, j’ai retrouvé des passages écrits à l’époque, où j’affirmais que je n’étais pas dans le bon corps et que j’étais un garçon. Mais je n’avais pas envie que ça soit ça. » Puis, à l’âge de 14 ans, il découvre la dysphorie de genre et la transidentité. « Je connaissais des femmes trans, mais pas des hommes trans. J’ai vu un film dans lequel un personnage tout à fait secondaire était un homme trans. J’ai alors compris que c’était éventuellement possible pour moi. » Il explore des blogs, lit des articles, regarde des vidéos YouTube sur le sujet et trouve des témoignages similaires, des informations et des conseils. « J’ai réalisé qu’il existait des mots pour expliquer pourquoi j’étais mal, pourquoi j’étais bloqué dans un carcan », raconte Nathaniel.
« Au bout de ma transition »
Il a fait son coming out trans auprès de ses parents il y a six ans, l’été de ses 18 ans. A partir de ce jour-là, il a demandé qu’on le genre au masculin et s’est choisi un nouveau prénom, s’habille et se coiffe comme un jeune homme. En 2016, il franchit une nouvelle étape avec la prise d’un traitement, des hormones du genre « désiré » pour activer le développement des attributs masculins. Il y a eu quelques erreurs. « Je me souviens d’une prof qui posait une question, j’ai levé la main. Elle m’a dit: « Oui, jeune homme » en me pointant du doigt. J’ai commencé à parler, je n’avais pas encore mué. Du coup, elle s’est corrigée en disant « Oh, pardon, mademoiselle ». J’ai répondu: « Non, non, c’est jeune homme ». Moi, je n’étais pas gêné parce que ça arrivait encore souvent et que ça m’était arrivé toute ma vie, mais la prof était embêtée et trois cents étudiants l’étaient aussi pour l’enseignante et pour moi. »
A 24 ans, étudiant en master de psychologie, il vit aujourd’hui dans un corps d’homme et a changé d’état civil. « Je pense que je suis au bout de ma transition. J’ai fait les opérations que je voulais et je suis à l’aise avec les hormones. C’est un traitement hormonal à vie. On peut toujours arrêter mais il peut y avoir le retour des règles, par exemple. » Même si Nathaniel se sent « en paix », il traverse encore parfois des périodes difficiles. « Quand je me regarde dans le miroir, ce n’est pas le corps d’un homme qui est né homme. Je trouve qu’il n’est pas assez musclé. Je pourrais améliorer mon corps, mais cela ne relève plus de la chirurgie. Cela passe par apprendre à s’aimer, à accepter ses défauts, comme toutes les autres personnes cisgenres. »
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.
Lou, elle, est né garçon voici treize ans et, il y a un an à peine, elle en avait encore l’apparence. Elle qui ne s’est jamais sentie en phase avec son « assignation masculine » a découvert ce terme en suivant d’autres adolescents trans sur YouTube. « Je me suis rendu compte que je vivais la même chose. » Lou a commencé à rejeter son identité, vers l’âge de 11 ans. Elle n’était à l’aise que dans ses jeux sur Internet, où elle se dit fille et a laissé pousser ses cheveux. Mais elle n’en parle pas tout de suite. Ce n’est qu’un an plus tard qu’elle laisse une lettre à ses parents, juste avant de partir au camp scout. Désormais, sa garde-robe est féminine, jusqu’à ses lunettes. « Je ne veux pas me déguiser en fille, je veux être une fille. D’ailleurs, j’en suis déjà une! »
Je ne veux pas me déguiser en fille, je veux être une fille. D’ailleurs, j’en suis déjà une! » Lou
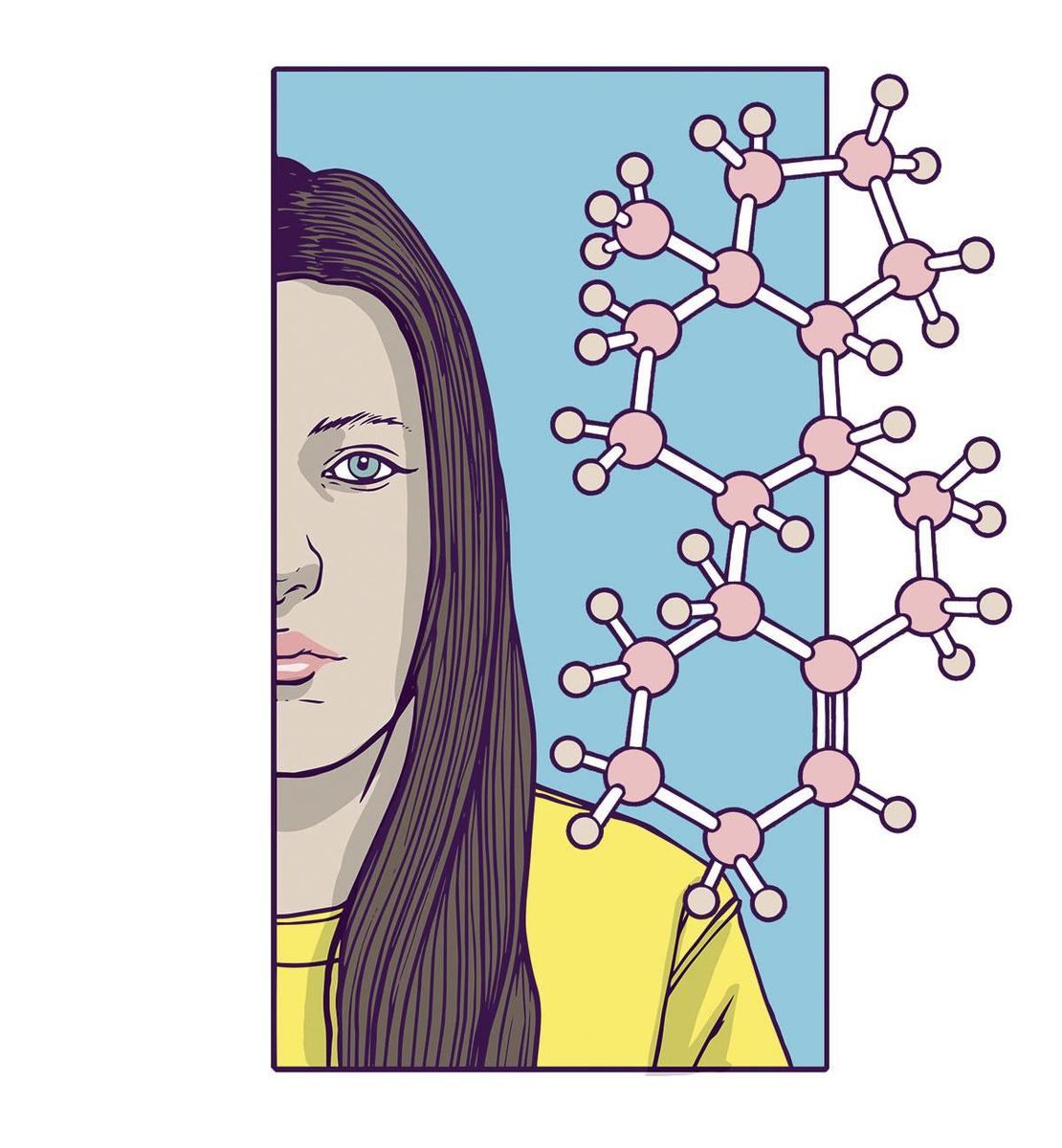
Récemment, un pédopsychiatre l’a aidée à mettre un mot sur son « sentiment d’oppression », sa « dysphorie de genre », une « identité de genre qui diffère du sexe d’assignation », qui serait partagée par 1% de la population, selon les études internationales. La réalité est qu’il n’existe pas de chiffres précis. Ce flou n’est pas qu’une question de chiffres, mais aussi de « définition ». Longtemps, seuls étaient visibles dans les médias des profils marginaux (des prostituées, par exemple) ou des personnes relativement âgées qui effectuaient leur transition dans la solitude. Aujourd’hui, l’acception est plus large, et le terme recouvre une infinité de situations. Pour les personnes les moins sensibilisées à la question , il se réduit à la transition physique vers un sexe différent de celui de naissance. Les autres veulent y inclure tous ceux qui vivent sous un genre différent de celui d’origine, qu’ils prennent ou non des hormones, qu’ils entament ou non un processus clinique.
Une visibilite nouvelle
Les films de fiction comme Girl, de Lukas Dhont, ou Lola vers la mer, de Laurent Micheli, l’histoire de Sasha dans Petite fille de Sébastien Lifshitz, diffusé sur Arte en décembre dernier – meilleure audience de l’année pour un documentaire proposé en prime time -, mais aussi la médiatisation de parcours d’autres jeunes ont donné de la visibilité aux transidentités. Au-delà du cinéma, le transgenre traverse toute la société, dans les séries, sur les podiums de mode, sur les terrains de sport, dans la politique. Outre cette visibilité, ces jeunes évoluent dans une société où la parole est plus libre, parce qu’il y a aujourd’hui plus d’accès à l’information sur ces questions. Ils peuvent mettre des mots sur leur ressenti, échanger, se questionner entre eux, créer des réseaux plus confidentiels grâce à Internet. Surtout, l’essor des études de genre et l’appropriation de la pensée féministe chez les personnes trans ont contribué à leur médiatisation.
Les experts sont unanimes: l’adolescence est le test pour affirmer son identité de genre.
En décalé
Même s’il est impossible de savoir précisément combien d’adolescents sont concernés en Belgique, on observe depuis quelques années une hausse du nombre de coming out chez les mineurs d’âge. Ainsi, les équipes médicales qui leur sont dédiées – deux en Belgique, à Gand et à Liège – reçoivent de plus en plus de demandes. Les listes d’attente peuvent s’allonger jusqu’à six mois. « On accompagne actuellement environ une soixantaine d’adolescents », détaille Alain Malchair, pédopsychiatre au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Liège. Face à l’afflux, son service a doublé ses capacités de consultation. Toutes déjà complètes. Pour lui, l’augmentation de ses consultations reflète également une hausse de l’écoute parentale. Le service a été créé en 2019 pour éviter « la prise d’hormones sauvage, achetées sur Internet par exemple, ou leur prescription très rapide par des médecins, source potentielle de surdosage, de retards de croissance et de diverses perturbations biologiques ».
Le premier rendez-vous se fait souvent avec un pédopsychiatre et un endocrinologue. Il s’agit de faire un premier état des lieux: l’incongruence de genre persiste-t-elle? Comment l’adolescent accepte-t-il son corps? Comment se sent-il? Ses frères et ses soeurs? Ses parents? Les médecins établissent un bilan biologique. Ils essaient également de cerner son état d’esprit général et de déterminer s’il existe chez lui des troubles psychologiques sans rapport avec la transidentité. « Ceux qui viennent nous consulter le savent et l’acceptent: nous avons besoin de temps. Il n’est pas question de sortir avec une ordonnance à la première consultation. Mon but n’est pas de décourager. Je suis là pour accompagner et comprendre la démarche, pas pour la juger ni la freiner. Il faut être sûr de ne pas commettre d’erreur et que le processus doit suivre son cours », souligne Alain Malchair, qui rapporte que chez un nombre non négligeable d’adolescents la situation est en « stand-by », « suspendue ».
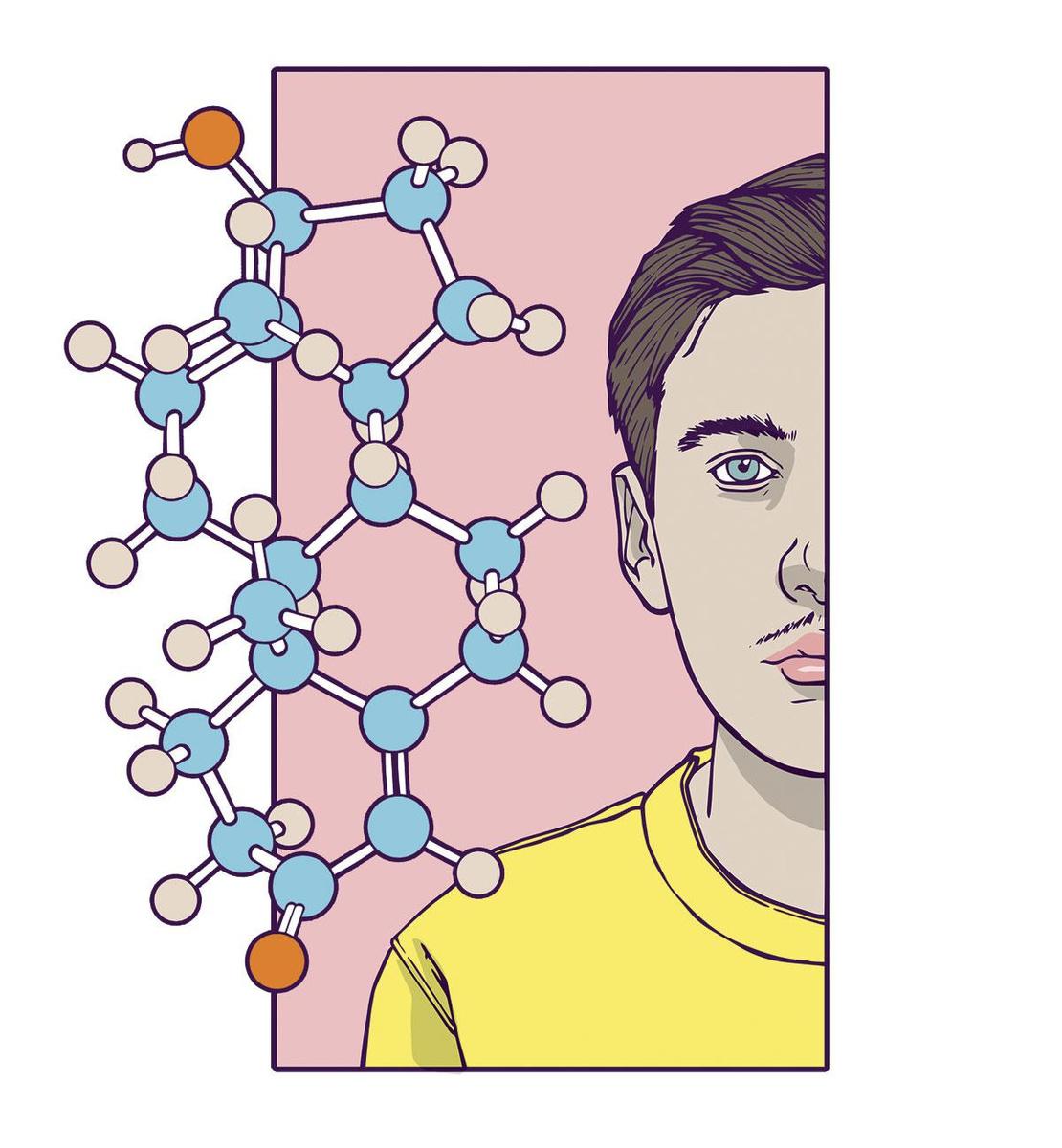
Pour les plus jeunes – la moyenne d’âge se situe entre 13 ans et 16 ans au CHU de Liège -, la transition sociale, publique, constitue souvent le premier pas. La personne adopte un nouveau prénom (dans un premier temps, sans que celui-ci soit forcément inscrit à l’état civil), des pronoms correspondants et, souvent, modifie son apparence. « Il s’agit des marqueurs de genre les plus forts socialement et ce sont les plus courants, note Daphné Coquelle, présidente et cofondatrice de l’association Transkids. Il est ensuite conseillé aux jeunes enfants, qui restent rares en consultation, de laisser la transition sociale se faire et d’attendre la puberté. Aucun traitement médical ne leur est proposé. Les médecins observent qu’une partie d’entre eux, une grande majorité selon de rares études, retourne au genre assigné à leur naissance. « L’enfance est un terrain de jeu, ça veut dire qu’on peut jouer à porter des robes, à se laisser pousser les cheveux, à se mettre du vernis à ongles et, pourquoi pas, à changer de prénom, sans dramatiser, écrit Serge Hefez, psychiatre, auteur de Transitions. Réinventer le genre (Calmann-Lévy, 2020), qui reçoit de nombreux enfants et adolescents transgenres en consultation. L’enfance est une phase où l’identité de genre est en construction.
Si la société évolue sur la dichotomie homme/femme, les personnes trans se heurtent à l’administration et aux institutions.
Lou évoque les difficultés de son père, au début, à intégrer la nouvelle, à l’appeler par le prénom qu’elle a choisi, à utiliser le genre féminin pour s’adresser à elle. « Il restait persuadé que c’était une phase. » Quelques mois et de grosses disputes plus tard, sur fond de portes qui claquent et de crises de larmes, les changements de prénom et de pronoms ont été entérinés. Nathaniel fait aussi partie des chanceux: ses parents, ses soeurs et ses grands-parents le soutiennent. « La manière dont je l’ai dit à mon père ressemble à un arrachement de pansement. En revanche, je lui ai demandé de le dire lui-même à ma mère. J’ignore comment elle a réagi sur l’instant. Puis, deux semaines plus tard, elle m’a dit: « Il faut qu’on parle. » Ils étaient inquiets. C’étaient des questions difficiles. Ils ne savaient pas comment les aborder. Mais ça n’a jamais été un problème. »
Pour les parents et les proches, la transidentité se révèle évidemment un bouleversement. La personne trans et son entourage avancent en décalé. « Alors que le jeune a déjà réfléchi, mûri sa décision, pour les parents, c’est quelque chose de nouveau. Il faut notamment essayer de combiner l’impatience du jeune et la stupéfaction des parents », ajoute Daphné Coquelle.
En pause
« Je veux prendre des hormones pour me sentir moi-même, plus féminine, plus fière », poursuit Lou. Mais ses parents et les médecins sont encore réticents. Dans un cas comme celui-ci, les cliniciens proposent d’abord un traitement qui inhibe la puberté. Utilisée depuis plus de trois décennies en Belgique en cas de puberté précoce, l’injection de ce type d’hormone empêche l’apparition des règles, la mue de la voix, le développement des seins, de la pilosité ou encore de la mâchoire. Elle permet surtout d’acheter du temps, un temps supplémentaire pour maturer la décision, confirmer l’identité de genre et évaluer au mieux les effets irréversibles de l’étape suivante. Cela permet aussi de réduire le nombre de chirurgies esthétiques plus tard, tout en facilitant le changement de genre.
Le traitement est toutefois réversible: dès son arrêt, la puberté reprend son cours dans les mois qui suivent. « Cela suppose d’intervenir fort tôt, à 10, 11, 12 ans… Il existe des équipes, aux Pays-Bas ou à Gand, qui interviennent sans trop d’états d’âme. Nous, nous en avons. On bloque une fois ou l’autre. Mais on se fixe 15, 16 ans. On le fait plus tôt, cependant, avec des jeunes qui ont eu le temps de réfléchir, qui sont déjà au milieu du chemin. J’ai conscience qu’il s’agit d’un débat. D’un point de vue biologique, c’est mieux. D’un point de vue éthique, toutes les hésitations, toutes les complications, tous les mouvements psychiques, on les by-pass. Car une fois le processus lancé, c’est fini, on réfléchit beaucoup moins », souligne Alain Malchair.
Les bloqueurs ne peuvent pas être pris toute la vie: au bout d’un an, il faut les arrêter et prendre, à la place, des hormones de destination, celles du genre désiré. Pour les garçons trans, comme Nathaniel, il s’agit de testostérone, et, pour les filles trans, d’oestrogènes. Les effets varient d’un individu à l’autre: pour les premiers, le développement de la masse musculaire, la voix devient plus grave, la barbe apparaît ; pour les secondes, le développement de la poitrine, la modification de la distribution des graisses… Au sein du corps médical, les praticiens se montrent très prudents quand ils prescrivent des hormones de substitution. Aucun traitement ne sera lancé avant 16 ans, sauf avis contraire des médecins. La prise d’hormones pose néanmoins des questions éthiques. Ceux et celles qui y recourent risquent de faire un voyage sans retour, car le traitement peut altérer la fertilité de façon irréversible. Par précaution, les médecins belges font signer un document aux mineurs, attestant qu’ils ont conscience d’éventuels effets. Ainsi se pose la question de la conservation des cellules sexuelles. Si les jeunes trans le souhaitent, il est possible de les laisser avancer suffisamment dans la puberté pour prélever du sperme ou des ovules. Les adolescents, très souvent, demandent de les jeter. « Je savais que, jamais, je ne voudrais porter un enfant. Génétiquement, je n’ai pas de problème à l’idée qu’un enfant ne soit pas de moi. Et je n’ai jamais supprimé l’idée d’être parent », répond Nathaniel.
Il n’y a pas un début et une fin dans une transition, pas de check-list à cocher. » Nathaniel
Tentative de contrôle?
Ces jeunes peuvent-ils vraiment consentir à une procédure de changement de genre? A 16 ans peut-on se projeter dans une future parentalité? Pour les associations trans, cette très grande vigilance du corps médical s’apparente à une tentative de contrôle. Alors, pour alléger le parcours de ces jeunes, certains collectifs tiennent un carnet d’adresses de médecins, de pédiatres, d’endocrinologues jugés « safe », c’est-à-dire bienveillants et formés pour les accompagner.
Mais toute demande ne débouche pas sur un destin transgenre. Les experts sont unanimes: l’adolescence est le test pour affirmer son identité de genre. Les sentiments éprouvés face à la puberté ne sont pas les seuls éléments. Comment le jeune vit-il sa transition sociale, son nouveau prénom, son apparence? Sa dysphorie persiste-t-elle? Certains font marche arrière après un moment clé, par exemple une transition sociale ou une prise d’inhibiteurs. Des jeunes qui montrent constance, insistance et persistance dans leur conviction de ne pas appartenir au genre qu’on leur attribue sont des indices scrutés de très près par le pédopsychiatre.
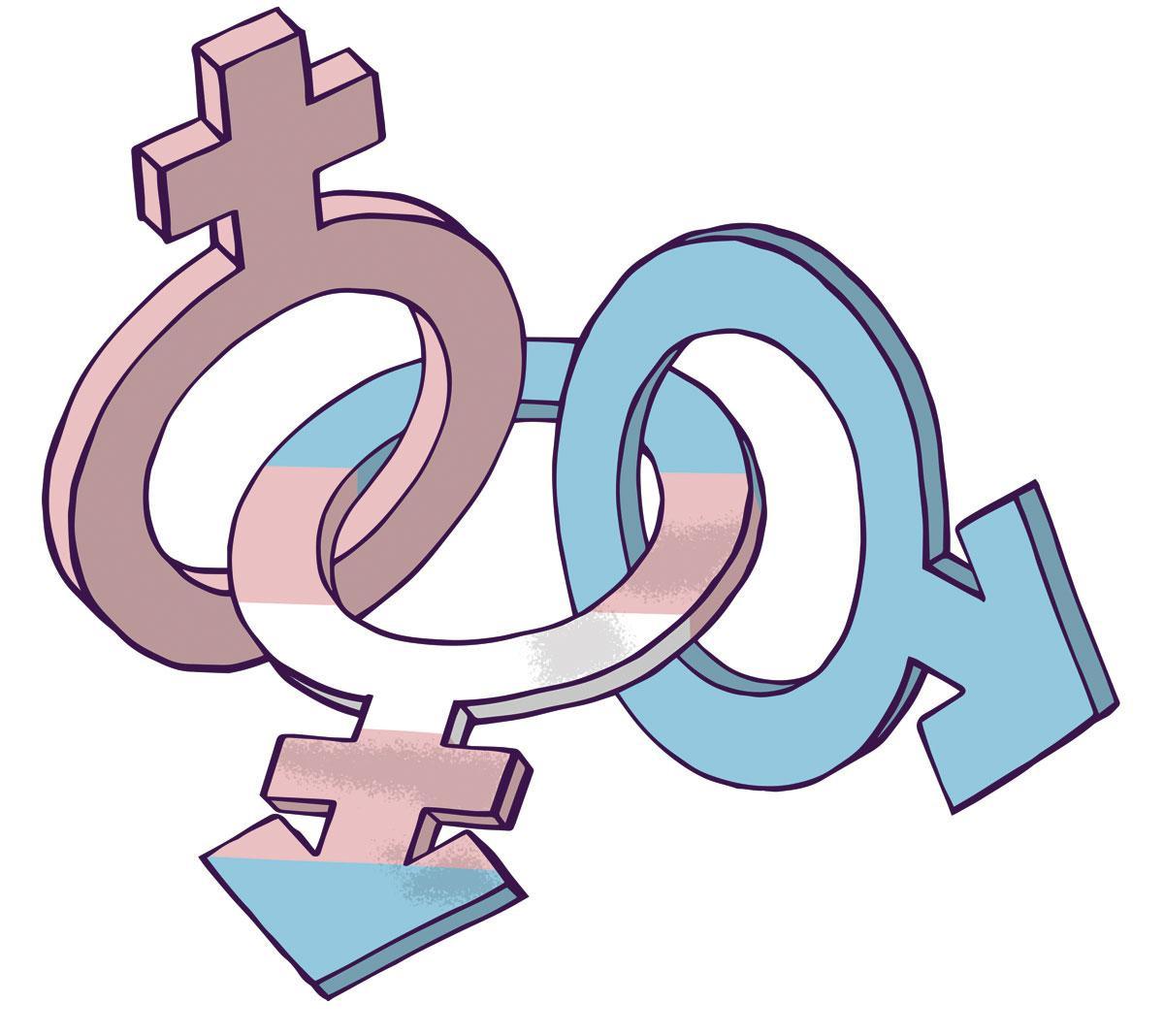
Aucun parcours de transition ne se ressemble. Certains jeunes transgenres se contentent de changer leur façon de s’habiller ou de changer de prénom, d’autres seront plus heureux avec des hormones ou ont vraiment besoin d’une chirurgie. Cela ne modifie pas non plus et nécessairement leur orientation sexuelle. « Il n’y a pas un début et une fin dans une transition, pas de check-list à cocher », affirme Daphné Coquelle, qui précise que la transidentité a toujours existé et que le phénomène n’a rien d’anormal. « Ce n’est pas une épidémie. »
Des histoires de « détransition » – le fait de retourner à son genre assigné après avoir fait une transition – servent d’épouvantail à ceux qui affirment qu’il s’agit d’un effet de mode. Les détransitions existent mais, selon les spécialistes, elles restent très rares. Des études estiment que 1% à 5% des personnes trans rebroussent chemin. « J’ai des hésitants, mais je n’ai pas de « regretteurs », signale Alain Malchair. On les perd un peu après, avec l’âge, puisqu’à un moment notre suivi s’arrête. On fait tout pour que cela n’arrive pas, mais je ne peux pas l’exclure. »
Sans doute parce qu’ils abordent la question du genre avec plus de fluidité, les jeunes feraient moins appel à des opérations génitales que leurs aînés – elles ne sont réalisées que sur des majeurs. Il n’est plus obligatoire, depuis 2018, d’avoir suivi un traitement médical pour changer son sexe à l’état civil. Dès 12 ans et avec l’accord de ses parents, le mineur peut modifier son prénom. Dès 16 ans, il peut changer le sexe sur son état civil, avec l’accord d’un pédopsychiatre. Si la société évolue sur la dichotomie homme/femme, les personnes trans se heurtent à l’administration et aux institutions. Des associations militantes aimeraient retirer la mention de genre sur les cartes d’identité. Et parce que la société est structurée autour de la différenciation du masculin et du féminin, ces jeunes bousculent, déstabilisent. « Oui, je suis maniéré, mais cela appartient-il aux femmes? C’est cela qu’il faut remettre en question, conclut Nathaniel. J’ai toujours été maniéré. Adolescent, je détestais ça. Mais si j’ai envie de mettre du vernis, de me maquiller, est-ce que cela fera de moi moins un homme, plus une femme? Si quelqu’un porte une jupe, a les cheveux longs, est maquillé et se présente à moi en me disant qu’il est un homme, c’est OK. Et j’utiliserais les pronoms masculins. C’est vraiment dans cette direction qu’il faut aller. »
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici