
Plus de 33 000 Belges en burnout: « On se casse en petits morceaux, l’un après l’autre »

En Belgique, ils sont environ 33 400, retirés du milieu professionnel pour épuisement, sur ordre d’un médecin. Le burnout frappe 7% des personnes en incapacité de travail de longue durée. Leur nombre augmente d’année en année. Ces forçats du repos seraient-ils des lanceurs d’alerte
Avez-vous d’autres questions?
– Une seule: suis-je en dépression?
– Non. Vous n’avez pas d’idées noires et vous avez toujours l’appétit de vivre. Mais vous êtes en épuisement, ça, c’est sûr. En burnout. Je vous mets en arrêt maladie tout de suite, pour minimum un mois. Sinon, la dépression, vous n’y échapperez pas.
En sortant du cabinet médical, elle a un peu le tournis. C’est donc comme cela que tout bascule? On vit sa vie en picorant les pochettes-surprises qu’elle nous réserve, sucre ou harissa, avec, parfois, de longues périodes où le piment écrase les bonbons. Certains jours sont interminables mais on tient bon. « Comme tout le monde. » « Il n’y a pas des raisons. » « Dans notre famille, on ne tombe jamais malade. » « Je ne suis pas à plaindre. » « Il suffit de vouloir. » Un jour, vouloir ne suffit plus. Les insomnies qui s’étirent depuis des mois et la charge mentale dopée par les années en sont venues à bout. Le désir est là, tapi, mais l’énergie s’est fait la malle. Il n’y a plus de force, plus de patience, plus de souffle.
Le burnout peut être une opportunité. Pas nécessairement un échec.
Dans sa voiture, elle reste longuement immobile, derrière son volant. Burnout. Le mot lâché tient de la condamnation en même temps que du soulagement. « Si l’on me gomme provisoirement du monde du travail, ce baromètre si dominant, c’est donc plus grave que je le pensais », se dit-elle. La voilà devenue inutile, transparente, estampillée hors jeu par le cachet du médecin. C’est, à ce moment précis, tout ce qu’elle ressent. En plus de la culpabilité.
Lorsque la pharmacienne lui tend la boîte de somnifères qu’elle est venue acheter, celle-ci la regarde droit dans les yeux. « Ça passera, vous verrez, l’encourage-t-elle. Vient un moment où on recommence à dormir. Et la vie reprend. Ayez confiance. » En quittant l’officine, les larmes lui montent aux yeux. Soudain, elle n’a plus la force de porter, de supporter, quoi que ce soit de plus. Pas même l’empathie. A ce stade d’épuisement physique et psychique, pense-t-elle, une plume qui lui caresserait les cheveux la ferait trébucher.
A 57 ans d’une vie pourtant enviable aux yeux de beaucoup, elle trébuche donc. Comme Simon, Angélique, Julie, Pierre, Amina et tant d’autres (prénoms modifiés pour la plupart). Tous en burnout. Brûlés de l’intérieur. Par le travail, considèrent nombre de spécialistes pour qui le burnout se cantonne strictement à la sphère professionnelle. Par tout le reste aussi, nuancent d’autres voix. « Un jour, vous ouvrez votre frigo et vous découvrez qu’il n’y a plus rien dedans, illustre Angélique, 43 ans. Vous puisez dans vos réserves jusqu’il n’y ait plus le moindre surgelé: tout est vide. » « On ne se rend pas compte que l’on se casse en petits morceaux, l’un après l’autre », confirme Simon, infirmier trentenaire en arrêt maladie depuis février dernier.
Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.
Sans se connaître, ceux que les médecins forcent un jour au repos obligatoire de longue durée pour burnout ont des points communs: ils sont souvent perfectionnistes, hypersensibles, en quête de reconnaissance, peu prompts à demander de l’aide, indisposés par le conflit, férus de justice, hyperinvestis dans un travail qu’ils idéalisent. Ils s’identifient aussi fortement à leur entreprise. Le portrait-robot est grossier. Mais quand on le présente aux concernés, ils éclatent souvent de rire: « C’est tout moi, ça! » Dans les rangs syndicaux, on renâcle. « Nous sommes contre l’idée d’un profil type, insiste Laurent Lorthioir, attaché au service entreprises de la CSC. Cela revient à considérer ces personnes comme trop faibles pour supporter les conditions de travail qu’on leur impose. »
« Abimé »
Tous tiennent pourtant, au-delà du supportable. Jusqu’à ce que le corps craque, puisqu’il n’y a que lui que l’on écoute. « Je travaillais toujours autant mais mes migraines ne faisaient qu’augmenter », témoigne Véronica. « C’est comme une mérule, glisse Julie, ça ronge de l’intérieur. » « J’avais des crises d’angoisse, du mal à respirer. Je ne supportais plus mes enfants et m’emportais sur eux tout le temps, se souvient Simon. C’est ma femme qui m’a conseillé d’aller voir le médecin. Je n’étais plus un père et j’avais du mal à être un mari. Mon travail d’infirmier, que j’adore, m’a abîmé. Abîmé, c’est un mot que j’ai mis des mois à trouver. Mais c’est exactement ça. » Au point de ne plus se reconnaître… La Belgique comptait, en 2020, 33 400 personnes en arrêt maladie de longue durée pour burnout – salariés, indépendants et demandeurs d’emploi confondus. Ils étaient 25 000 en 2016. Encore ne s’agit-il que des cas diagnostiqués. « Il y a de plus en plus de burnout longs, constate la Dr Danièle Pirenne, médecin du travail chez Mensura. Notamment à cause des nouvelles technologies, qui imposent de s’adapter sans cesse et font fi des horaires de travail classiques. »
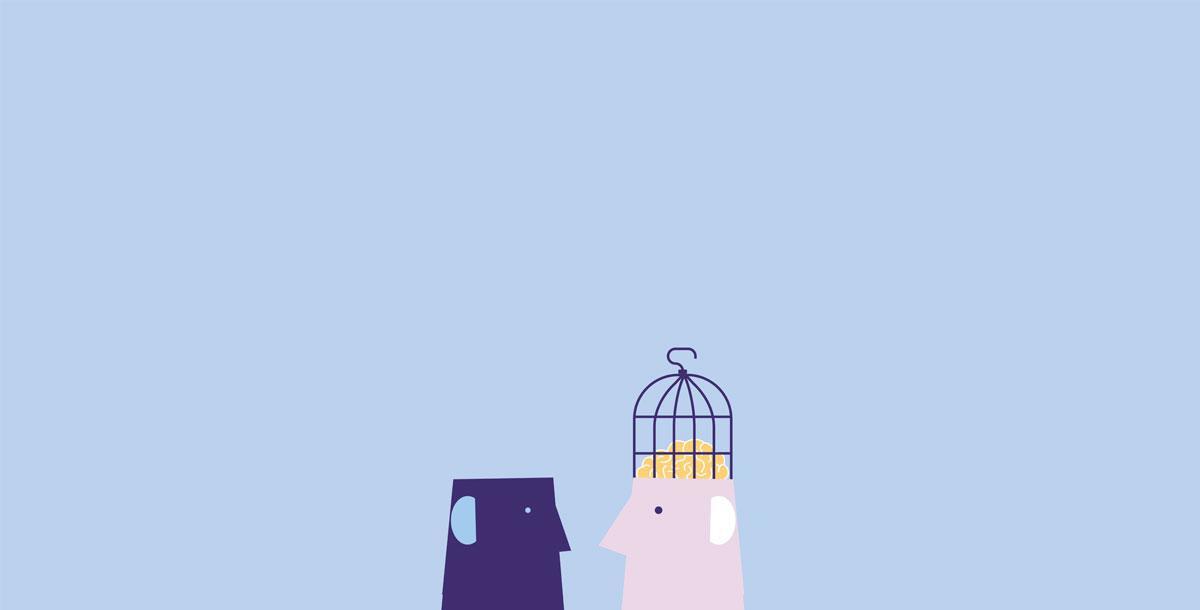
Ordre de ne rien faire
Le burnout touche désormais tout le monde, même si, dans l’ensemble, les femmes sont surreprésentées. On voit aujourd’hui des jeunes, qui n’ont que deux ans d’expérience professionnelle, débarquer dans les cliniques du stress. Surinvestis dans leur travail, ils vivent presque 24 heures sur 24 avec une frontière très floue entre leurs vies professionnelle et personnelle. Le tout dans une atmosphère d’insécurité d’emploi et de contrats précaires. « Toutes les classes sociales sont touchées », confirme la Dr Maryam Bastan, psychiatre et responsable de la clinique du stress au CHU Brugmann, à Bruxelles. Et plus seulement les classes supérieures qui étaient les plus promptes à se faire diagnostiquer. Sans doute une partie du monde ouvrier en est-il plus protégé: « La franchise y est plus de rigueur que chez les employés, note Olivier Nyssen, cogérant de l’entreprise de coaching Happiness Consult. Et pour ceux qui s’activent dans des métiers en pénurie, il est facile de quitter un employeur au profit d’un autre, si quelque chose ne leur convient pas. »
Mon métier me manque mais je dois m’en préserver.
C’est moins simple pour les autres… « Demander à quelqu’un qui est en burnout comment il va est la pire des questions à lui poser, soupire Amina, anciennement active dans le secteur public: parce qu’il ne va pas bien et qu’il ne sait pas pourquoi… Quand je me suis rendue à la clinique du stress pour établir un bilan clinique, j’étais à 6 sur une échelle de 7. J’ai demandé ce que je devais faire pour aller mieux. On m’a répondu: « Rien, précisément ». »
Ainsi et alors commence une lente reconstruction, émaillée de questions, de colères, de sentiments d’injustice, de découragement, d’incompréhension. Puis vient, à petits pas, l’acceptation. La prise de distance avec le milieu professionnel. Et la (re)connaissance de ses vulnérabilités. Dans les cliniques du stress, on propose aux patients des ateliers de discussion en groupe et de gestion du stress, du travail thérapeutique, de la danse, du yoga… Certains se tournent vers la sophrologie, le travail de la terre, la préparation de bons petits plats. Pour d’autres encore, la reconstruction passera par les mains dans la terre, façon de se reconnecter au corps, ce grand oublié pourtant sacralisé au XXIe siècle, et à la nature. Les balades en forêt, les puzzles interminables ou les séances de peinture constituent d’autres astuces pour empêcher le cerveau de gamberger. Et puis dormir, forcément. Tout cela prend du temps, un temps fou.
« Un an, c’est la durée minimale pour un burnout, affirme la Dr Danièle Pirenne. Cela va parfois jusqu’à deux. Recharger des batteries quand on a tellement puisé dans ses réserves ne se fait pas en quelques semaines. » Quand le temps s’écoule de cette façon, concentré qu’il est sur l’art d’apprendre à ne rien faire, il file à la fois très vite et bien trop lentement. « Quand j’étais en arrêt maladie, j’allais parfois à des soirées où je croisais des collègues, raconte Amina. J’avais l’air normale mais en fait, je ne l’étais pas… »
Selon les chiffres de l’Inami pour 2020, 24% des personnes en incapacité de travail depuis plus d’un an souffraient de dépression et de burnout. C’est une augmentation de 35% en quatre ans. Quelque 17% étaient victimes de dépression et 7% d’un burnout.
1 000%, c’est trop
« Souvent, mes copains me disaient que j’avais l’air bien », se souvient-elle, annonçant ainsi leur inévitable question: « Alors, tu reprends quand? » « J’ai presque eu envie de me casser une jambe, ajoute Julie. Pour que « ça » se voie. » Dès lors que le mal est invisible, il y a comme un soupçon qui traîne: certains ne tireraient-ils pas sur la corde en restant en arrêt maladie pendant des mois, voire des années, sans que plus rien ne le justifie? Non. Mais rejeter toute la faute sur « les employeurs » ou sur « le système » serait un peu court.
« Dans le cadre d’un burnout qui arrive après 50 ans, on ne peut pas faire l’économie d’une remise en question sur son projet de vie professionnelle et personnelle, en rejetant simplement toute la responsabilité sur l’employeur », avance Maryam Bastan. Or, on a beau aimer son travail, le fait de s’y impliquer à 1 000% et ne plus vivre que pour lui est excessif et questionnant. « Les salariés nient souvent leur burnout et leur inconfort au travail, confirme Olivier Nyssen. L’idée de ne plus être dans les clous est, pour eux, plus douloureuse que ce qu’ils endurent à leur poste. Leur responsabilité, c’est de ne pas voir lucidement ce qui se passe. Je reçois parfois des gens qui trouvent normal de travailler sept jours et sept nuits de suite, quasi sans interruption. » Avec une certaine fierté, même. « Ça tournait moins bien quand je n’étais pas là, confie Véronica. Je me sentais indispensable. » A ce type de patient, les accompagnants renvoient systématiquement la seule question: qu’est-ce qui est grave, en fait, si vous ne le faites pas? Ainsi, pas à pas, s’interroge le rapport de chacun au travail, sa place et ses enjeux fondamentaux.

Responsabilité de l’entreprise
Cela ne dispense pas les entreprises, ni les directions, de devoir se livrer à un solide exercice d’introspection. « L’entreprise doit prendre au moins 50% des responsabilités dans la survenance des burnout, estime Olivier Nyssen. Un responsable d’équipe devrait voir qu’une hyperimplication d’un employé dans son travail est anormale. Même si ce salarié représente une aubaine pour lui: un très bon esclave, en fait. »
L’entreprise devrait aussi interroger ses pratiques, ses modes de fonctionnement, le type de relations professionnelles qu’elle induit. Car il existe bien des profils d’entreprise propices à l’émergence d’un burnout: leur organigramme n’est pas clair, pas plus que leurs consignes ; la communication y est hasardeuse ; le personnel travaille dans l’urgence, avec peu de moyens ; on y observe parfois des tâches répétitives ; certaines sont en lien avec le public ; le manque de reconnaissance pour le travail accompli y est patent et les relations avec la direction, tendues.
Depuis quelques années, la majorité des directions, surtout si elles sont occupées par des plus jeunes, ont pris la mesure du risque de burnout pour leurs troupes. On en parle davantage, sans doute plus dans les entreprises de plus de cent personnes que dans les PME. Tout dépend de la qualité managériale des directions en place.
Quand il s’agit de réintégrer un membre du personnel longtemps absent pour burnout, dans le cadre d’une procédure concertée entre l’employé, la médecine du travail et l’employeur, on voit vite si l’humain est, ou non, pris en compte. Dans certaines entreprises, une véritable collaboration peut se mettre en place. « Dans d’autres, on sait que rien ne changera jamais, soupire Danièle Pirenne. Je délivre parfois des certificats d’inaptitude définitive pour ce motif. »
Pour certains employeurs, un malade, c’est un emmerdeur.
« Certaines directions croient toujours que leur seul job, c’est d’obtenir des résultats, embraie Olivier Nyssen. Quand on les questionne sur ce qu’elles mettent en place pour éviter le burnout au sein du personnel, elles jurent qu’elles ont déjà tout essayé, que rien ne fonctionne ou que ce n’est pas leur affaire. On sait qu’avec certains patrons, rien ne se passera bien: dans leur esprit, un malade, c’est un emmerdeur. » Sourds qu’ils sont à toute prise de responsabilité dans ce qui advient entre leurs murs. Il arrive, certes, que des entreprises s’interrogent sur le comportement de leurs managers quand les cas de burnout se multiplient dans leur service. Parfois licenciés, tout porte à croire qu’ils exporteront leurs méthodes dans leur nouveau lieu de travail…
Dans les rangs syndicaux, on prône une approche collective des responsabilités dans le burnout. « Or, très peu d’entreprises prennent la peine de discuter de prévention des risques psychosociaux, regrette Laurent Lorthioir (CSC). Nous voudrions plus d’incitants en faveur d’une vraie politique de prévention contre ces risques. Avec des sanctions à la clé pour les entreprises qui ne feraient rien. »
Changements impératifs
Après un long burnout, Gaston a définitivement raccroché son tablier de cuistot. Aujourd’hui, il est agent de sécurité. Naïma a quitté le secteur bancaire pour diriger une crèche. Et Ryan a revendu ses parts à son associé pour se former à l’ébénisterie. Il n’est pas rare que ces brusques arrêts débouchent sur de vrais changements de vie. Mais souvent, le salarié qui reprend le travail souhaite retrouver « son » entreprise. Gare à reprendre trop tôt: le cycle infernal risque de se reproduire. « Même si le moment choisi est le bon, sans changements, la reprise est généralement vouée à l’échec », tranche la Dr Pirenne. Des changement de poste, d’équipe, d’horaire, ou mieux encore, de méthodes de fonctionnement, s’imposent donc.
Au-delà de l’entreprise particulière, les bouleversements enregistrés dans le monde du travail depuis les années 1980 sont en cause aussi dans la survenance d’un burnout. « Ces mutations économiques, sociétales et technologiques ont conduit les entreprises à se focaliser bien plus sur le rendement et le résultat que sur la qualité de leur production« , pointe Céline Leclercq, doctorante en psychologie du travail à l’ULiège. Ce qui heurte frontalement la valeur du travail bien fait, à laquelle tant de patients en burnout – et d’autres – sont attachés. Désormais, le travail doit être impeccablement accompli tout de suite, quand ce n’est pas pour hier, dans un souci de performance constante.
Lire aussi | Stress et burnout, comment on s’en sort ?
Le système en burn-out?
« Dans les entreprises, les relations sont plutôt basées sur l’utilité, l’efficacité et la performance, relève la Dr Maryam Bastan. Alors qu’auparavant, on privilégiait davantage la stabilité, la loyauté et la confiance. » Le burnout serait-il le symptôme d’une société qui va mal? « Le système lui-même est en burnout, tranche Véronica. Nous, qui sommes retirés du monde du travail pour épuisement, sommes comme les canaris de la mine: on alerte de la catastrophe à venir. »
Pense-t-il aux canaris de la mine, Simon, lorsqu’il passe devant « son hôpital », le coeur tordu, incapable d’aller saluer ses collègues? Est-ce la culpabilité qui l’anime, sachant que les soins qu’il ne prodigue plus doivent être assumés par d’autres? Ou autre chose? « Mon métier me manque, assure-t-il. Mais je dois m’en préserver. Jamais ce métier n’a été aussi dur à exercer. Je ne suis même pas sûr de vouloir y retourner un jour tant j’ai peur de le repratiquer. J’ai étudié pour prendre soin des gens, pas pour devenir un technicien de soins. Or, c’est ça qu’on nous demande, et de plus en plus. »
Il m’arrive encore de tomber dans le piège, sourit une troisième, mais moins profondément et moins souvent qu’avant.
Dix mois après avoir été mis en arrêt maladie, Simon se dit toujours « en reconstruction ». Les blessures sont profondes et tardent à guérir. Ceux qui sortent d’un burnout assurent n’avoir pas changé leur nature profonde. Mais ils ont appris pas à pas, dans ce long tunnel de souffrances et de questionnement, à vivre avec leurs fragilités. « Je ne travaillerai plus de 6 heures à minuit chaque jour, jure l’une. Je couperai mon téléphone et mon ordinateur à une certaine heure. Je mettrai des limites, même si je prendrai mon nouveau travail à coeur. » « C’est mon repère, maintenant, embraie une autre: ne pas être tout le temps dans le rush et la pression. » « Il m’arrive encore de tomber dans le piège, sourit une troisième, mais moins profondément et moins souvent qu’avant. Alors, je me réajuste. Je n’ai pas encore trouvé toutes les clés. Juste une façon d’aborder la vie qui est différente. » Il faut, insistent tous les témoins, que la société comprenne l’impact du burnout sur les individus et sur le système en général: « Nous avons besoin collectivement de modes de fonctionnement plus doux. »
Ceux qui accompagnent ces blessés du travail sont formels: leur traversée du désert les engage dans un processus positif. « Le burnout peut être une opportunité et pas nécessairement un échec, résume la Dr Bastan. L’objectif du traitement est de permettre à la personne de redéfinir ses priorités, de retrouver confiance dans ses capacités et de mettre en place des stratégies adaptées pour gérer son stress. »
Derrière le comptoir de son officine, la pharmacienne tend une boîte de somnifères à un jeune homme, 30 ans peut-être, qui hésite à s’en emparer. « Vous verrez, ça passera, lui dit-elle. Un jour, vous en sortirez. »
La longue liste d’attente de la clinique du stress
La clinique du stress du CHU Brugmann, à Bruxelles, a accueilli 639 nouveaux patients en 2019 et 2020. Soit une moyenne de six à sept par semaine. Ils sont persévérants: il faut compter deux mois et demi pour un premier rendez-vous. Leur âge moyen: 43 ans. « Ces nouveaux patients présentent souvent des symptômes de burnout depuis moins de six mois, éclaire la médecin responsable de la clinique, Maryam Bastan. Ils se sentent stressés et, par rapport à leurs symptômes, ils veulent savoir ce qui leur arrive. Notre rôle consiste à déterminer si le patient est en burnout, en dépression, ou s’il présente un trouble anxieux. Il y a souvent un lien entre le burnout et la dépression. » Selon les chiffres de l’Inami pour 2020, 24% des personnes en incapacité de travail depuis plus d’un an souffraient de dépression et de burnout. C’est une augmentation de 35% en quatre ans. Quelque 17% étaient victimes de dépression et 7% d’un burnout. « Un burnout de longue durée n’est pas nécessairement un burnout sévère », cadre la Dr Bastan. Ce dernier se caractérise par l’intensité et la sévérité des symptômes tels que la fatigue avec une perte importante d’énergie, une baisse de la performance, une diminution de la motivation et une perte de sens au travail, une humeur labile allant de la tristesse à l’irritabilité. On note également une anxiété importante avec des ruminations en lien avec des préoccupations professionnelles ainsi que des somatisations (mal de dos ou de tête), un sommeil perturbé, des troubles de l’attention et de la concentration et, parfois, une consommation accrue de tabac ou d’alcool. « Un burnout se maintient lorsqu’aucun traitement n’est mis en place, poursuit Maryam Bastan. Plus on attend pour intervenir et moins il est facile d’en guérir. Une incapacité de travail ne représente pas un traitement en soi, elle doit être impérativement associée à une prise en charge spécialisée. »
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici