
Donna Haraway, philosophe des sciences: complexifier plutôt que détruire
A 75 ans, la théoricienne du féminisme cyborg, la penseuse des espèces de compagnie, publie Vivre avec le trouble. Un livre essentiel, explorant toutes les facettes de l’Anthropocène – rebaptisé du nom inquiétant de Cthulhucène.
Depuis la fin des années 1970, la théoricienne américaine Donna Haraway a introduit dans notre vocabulaire un nombre considérable de nouvelles idées décentrant nos points de vue. Mêlant souci pour la vie animale, féminisme viscéral mais accueillant, et intérêt pour les manières de voir le monde autres qu’occidentales, son travail a inspiré les plus grandes figures de la philosophie contemporaine, de Bruno Latour à nos compatriotes Isabelle Stengers et Vinciane Despret.
Après s’être battue contre la pensée de l’identité, ou pour une perception plus fine de la coexistence entre humains et non-humains, elle tente aujourd’hui, dans Vivre avec le trouble (1), de comprendre la spécificité de la nouvelle ère dans laquelle nous sommes entrés, et que les géologues ont nommée » Anthropocène « . A l’avènement de l’espèce humaine comme force géologique, Donna Haraway en oppose toutefois une autre : celle du » Cthulhucène « .
Pourquoi refusez-vous de parler d' » Anthropocène « , comme tout le monde ?
J’ai toujours eu des objections à l’encontre de ce mot. D’abord, parce qu’il met au centre l' » anthropos « , l’humanité, comme si l’espèce humaine était à l’origine de la situation que nous vivons. Or, ce n’est pas le cas. Ce sont des individus spécifiques, identifiables, qui se trouvent à la source de l’exploitation de la Terre, de la promotion de la logique de l’extraction, des génocides, de la quête effrénée de profit, de la lutte contre sa redistribution, du récit de la croissance illimitée. Il s’agit d’un système qui a près de 550 ans, mais que nous continuons à raconter de travers. Le mot » Capitalocène « , que certains utilisent pour le désigner, serait peut-être meilleur. Mais je pense que toutes les catégories de ce genre ont pour seul effet d’ôter l’air de la pièce. Elles deviennent trop vite trop grandes, trop grosses, et barrent toutes les possibilités d’imagination, de création. Je refuse de travailler par soustraction, de formuler des tabous. Je préfère travailler par addition. C’est-à-dire en complexifiant les récits, en rajoutant des acteurs, des noms, des liens, des métaphores, dans le but d’interrompre les narrations en cours et d’en proposer des alternatives nouvelles. Plutôt qu’effacer ou détruire, je préfère souligner à quel point il se produit davantage de choses que ce que nous imaginons. Il s’agit de faire entendre davantage certaines voix, et un peu moins d’autres.
Il y a d’autres cultures du temps possibles, d’autres formes d’action dans le temps.
Pourquoi alors avoir choisi de parler de » Cthulhucène » ?
Au départ, il s’agissait d’une blague. Ce qui m’importait était de réintroduire dans le débat une sorte de souci, de préoccupation pour le chtonique, pour ce qui vient de la terre. Je suis un prototype de l’individu trop éduqué, né du contexte de la guerre froide : j’ai été nourrie de la sensibilité grecque pour l’histoire des mots, leur étymologie, mais aussi le plaisir qui s’y attache. Pour moi, les mots sont vivants, ils possèdent plein de tentacules. Ils sont comme les êtres chtoniens, qui ne tiennent jamais en place et ne cessent de produire des possibilités qui comptent, qui témoignent d’à quel point ils sont réels. Ils nous permettent de nous apercevoir que tout ce que nous faisons, nous le faisons avec d’autres, dans ce que les biologistes appellent une » sympoïèse « . En parlant de Cthulhucène pour décrire notre présent, j’ai donc voulu ramener au premier plan une certaine pensée biologique, par contraste avec la centralité qu’y occupe la discussion de la technologie et des solutions qu’elle est supposée fournir.
Vous insistez beaucoup sur l’importance du présent, par opposition à l’obsession pour le passé et le futur. Pourquoi ?
Pour le dire de manière caricaturale, le modèle dominant d’histoire qui continue à structurer la pensée politique est uni- linéaire. Dans cette histoire, le présent n’existe presque pas, à cause du poids des déterminations du passé, et l’importance que prend sa projection dans le futur. Mais ce modèle n’est pas le seul qui existe. Il y a d’autres cultures du temps possibles, d’autres formes d’action dans le temps. L’anthropologue Deborah Bird Rose, par exemple, a raconté celle qu’elle avait apprise des aborigènes d’Australie. Ceux-ci se considèrent comme les héritiers d’une obligation, envers leur environnement, qui n’a de sens que transmise à ceux qui suivent. Le temps, pour eux, est ce qui peut être re-raconté, rappelé. Il est le présent de la manière dont chacun prend soin de cet héritage. Chez les Occidentaux aussi, il existe différentes formes de temps. Il y a le temps du deuil, de la mémoire ou de la rêverie, qui n’est pas le même que le temps officiel. Le tourisme anthropologique est une tentation trop facile. Ce qu’il s’agit de voir est combien » notre » propre tradition est riche, et combien celle-ci réclame aussi de connecter ensemble toutes les dimensions du temps qui la constituent.

Mais, le présent, c’est aussi être présent…
Oui. Etre présent au présent, c’est y cultiver la capacité à répondre, plutôt qu’une liste de responsabilités. Moi-même, je souhaite être présente pour pouvoir répondre de cette capacité, et tenter de penser comment faire pour raconter le présent d’une autre manière. L’autre jour, j’ai publié un texte sur Facebook où j’essaie d’en faire saillir trois pointes. Il y a d’abord la pandémie de Covid-19. En réalité, ce n’est ni la première, ni la seule. Dès que vous vous intéressez aux plantes, aux animaux, les extinctions massives sont partout. Nous devons penser la pandémie dans des termes qui n’impliquent pas seulement un danger pour nous, mais aussi pour d’autres, qui peuvent être non-humains. Puis, il y a l’explosion remarquable d’action et de savoir autour des injustices raciales. Elle réclame de comprendre l’histoire de façon neuve. Si l’on pense à la manière dont l’accumulation de richesses dans le temps a été rendue impossible pour les Afro-Américains, on ne peut que constater que cela constitue toujours une réalité, qui se traduit par des inégalités d’accès à l’enseignement, aux emplois, au logement. Pour comprendre les brutalités policières, il faut prendre en considération l’importance du rapport au temps, donc aussi au deuil et à la mémoire, qu’impliquent ces impossibilités. Pendant longtemps, les Blancs ne s’en sont pas souciés. Mais, aujourd’hui, c’est la mémoire blanche qui se trouve reconfigurée par les combats des Noirs. Soudain, se pose la question de savoir comment hériter d’un passé qu’on ignorait posséder. Enfin, il y a la crise climatique. Cette crise est à la source d’injustices criantes. Tout le monde ne vit pas la situation de la même façon : certains se contentent de voir le prix de l’essence monter, mais, pour d’autres, par exemple les habitants des atolls du Pacifique ou ceux de la forêt amazonienne, c’est la totalité du territoire, du sol, qui est en train de disparaître. Tout cela est lié. Le problème est qu’il est du destin des mots et des phrases de ne permettre de ne parler que d’un sujet à la fois. C’est pour ça que nous avons toujours davantage besoin des autres : pour compléter le récit, la description, de ce qui est enchevêtré, et y être enfin présent.
Je décris des enchevêtrements complexes impliquant sciences, mathématiques, féminisme, colonialisme, écologie, etc.
Afin de susciter le trouble, d’où le titre du livre ?
Il y a un chapitre de Vivre avec le trouble dans lequel je décris une série de pratiques qui trouvent leur source dans la biologie, mais impliquent une multitude d’autres gestes. J’y parle des combats des Indiens Navajo pour faire reconnaître le passé colonial dont ils ont été la victime. J’évoque les liens qui existent, à Madagascar, entre les activités de certains scientifiques, la lutte pour le droit à l’eau et la survie des lémuriens. Dans tous ces cas, je décris des imbroglios, des enchevêtrements complexes impliquant sciences, mathématiques, féminisme, colonialisme, écologie, etc. Au contraire du multiculturalisme, qui pense une juxtaposition d’identités, je tente de raconter le présent pour mettre en avant les formes de la solidarité par lesquelles s’invente une évolution, contre les dévastations liées à l’Anthropocène. L’anthropologue Anna Tsing parle de l’art de vivre sur une planète endommagée. Je partage son point de vue. La dénégation est inutile : plein de choses ont été perdues pour toujours. Une nappe aquifère qui s’est effondrée, entraînant avec elle les sols cultivés dont une population dépendait pour sa survie, ne peut pas être reconstruite. Le trouble, c’est ça. Vivre avec le trouble, c’est vivre avec un héritage qu’aucun techno-solutionnisme ne pourra annuler. Nous avons besoin d’une guérison possible, mais elle ne peut prendre la forme que de nouvelles alliances.
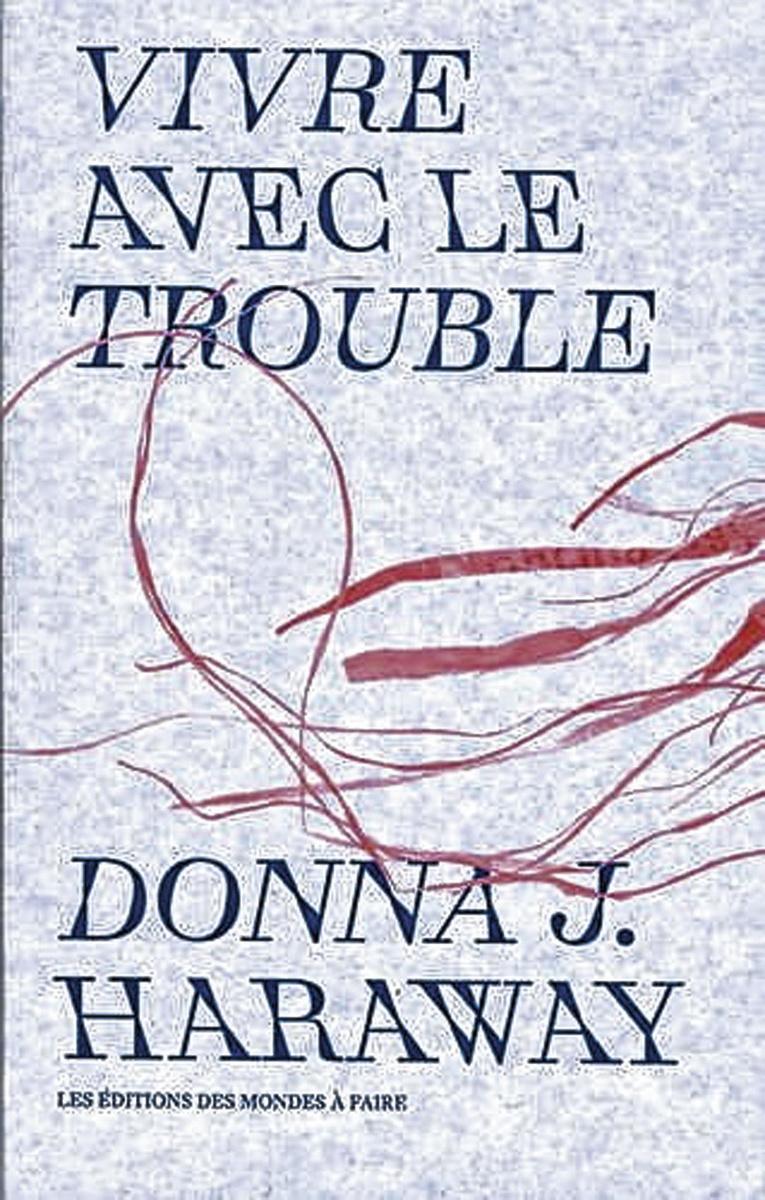
C’est ce que vous appelez » parenté » ?
Oui. Pour le comprendre, il faut se rappeler que l’anglais n’est pas une langue romane. Quand j’étais au lycée, j’ai appris en lisant Shakespeare la possibilité du jeu de mots entre » kin » et » kind » – entre être » parent » et être » gentil « . Plus tard, j’ai aussi appris de Marilyn Strathern ce qu’implique la parenté d’un point de vue anthropologique. En anglais, la parenté est une place, mais qu’il est toujours possible de déplacer, de recréer, comme l’ont par exemple fait les communautés LGBTQ+. L’importance est le type de connexion entre les uns et les autres. C’est elle qui définit la capacité à répondre, en particulier pour les générations suivantes. Il est possible de construire une parenté, ou de la quitter, mais il n’en demeure pas moins que, pour le meilleur et pour le pire, les parents le sont les uns pour les autres. Ce n’est hélas pas le cas dans toutes les langues. En espagnol, par exemple, le mot pour dire parent implique toujours les pères. Avoir des parents, c’est avoir des pères. Le patriarcat est construit dans nos dents et dans nos langues. Utiliser un mot comme » parent « , c’est s’inscrire dans une manière de mener les luttes politiques, et dans les conséquences qu’il est possible d’en tirer. En particulier, la question qui me préoccupe est celle de savoir comment faire parentèle lorsqu’on vit sur une planète où la population pèse si lourd. Pour cela, je n’utilise jamais le mot » surpopulation « , qui évoque l’histoire des programmes de contrôle des populations à la fois eugénistes et antiféministes. Je préfère proposer des formes de fictions spéculatives, comme celle qui raconte l’histoire d’une petite Camille, dans un monde où chaque individu possède trois parents, et non deux. Dans ce monde, chaque enfant possède aussi un » symbiôme « , un être non-humain avec lequel il vit en symbiose. Mon histoire évoque le destin des différentes générations de Camille, confrontées à l’extinction de leur symbiôme, le papillon Monarque. Ce n’est pas parce que le papillon disparaît que la symbiose s’éteint. Au contraire, le papillon continue à exister dans le souvenir, dans les récits, dans les manières de prendre soin du fait qu’il a existé. C’est cela, vivre avec le trouble. C’est accepter que la capacité à répondre de la sympoïèse qui nous lie à d’autres êtres ne se perde jamais, mais qu’elle ne cesse de se réorienter.
Bio express
1944 Naissance à Denver, Colorado.
1972 Docteure en biologie de Yale.
1985 Publication originale du Manifeste cyborg, qui la rend célèbre.
2000 Reçoit le prix J. D. Bernal pour l’ensemble de son oeuvre.
2003 Publication originale du Manifeste des espèces de compagnie, dont sa chienne, Cheyenne, est le personnage principal.
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici