
La violence est-elle intrinsèque aux religions? Il y a débat

Le philosophe Rémi Brague et l’historien Pierre Conesa dénoncent le radicalisme religieux et exonèrent les textes sacrés de la responsabilité de la violence.
«La religion produit de la violence», expliquait, à l’occasion de la sortie de son livre Après Dieu (Stock, 2025), l’avocat et militant laïque Richard Malka. Réunis par le Collège des Bernardins, lieu catholique de rencontre et de formation à Paris, le philosophe Rémi Brague et l’historien et ancien haut fonctionnaire Pierre Conesa ont échangé sur ce thème, et le résultat de leur dialogue, publié en livre, l’aborde sous une autre perspective: Les Religions font-elles plus de bien que de mal? (1).
Les deux auteurs ne nient pas l’existence de violences religieuses. Mais ils les attribuent à «une idéologisation de la religion» (Rémi Brague) et à «une poussée du radicalisme religieux» (Pierre Conesa). La religion ne serait donc pas porteuse de violence par nature. «Il faut vraiment cesser de dire, globalement, qu’il y a de la violence dans les textes sacrés, et procéder à des examens un petit peu plus nuancés et un petit peu plus précis», soutient le philosophe. «L’interprétation exclusive des textes religieux, à l’origine imprégnés de bonté, conduit aux massacres de ceux qui n’adhèrent pas à cette même lecture et donc s’opposent au projet « voulu » par Dieu», juge l’historien qui en voit des illustrations dans l’islam et dans le christianisme évangélique.
«Pratique philosophique qui donne un sens à la vie, la religion peut être un facteur de “paix sociale”.»
Pour les auteurs, les religions peuvent au contraire être sources de paix. Elles «sont une pratique philosophique qui donne un sens à la vie et qui, ainsi, peuvent être des facteurs de « paix sociale »», estime Pierre Conesa. Le Christ, complète Rémi Brague, en a montré la voie, lui qui a décidé de ne pas transmettre la violence qu’il avait subie, qui en a payé le prix, mais qui, de la sorte, a montré comment la contrer.
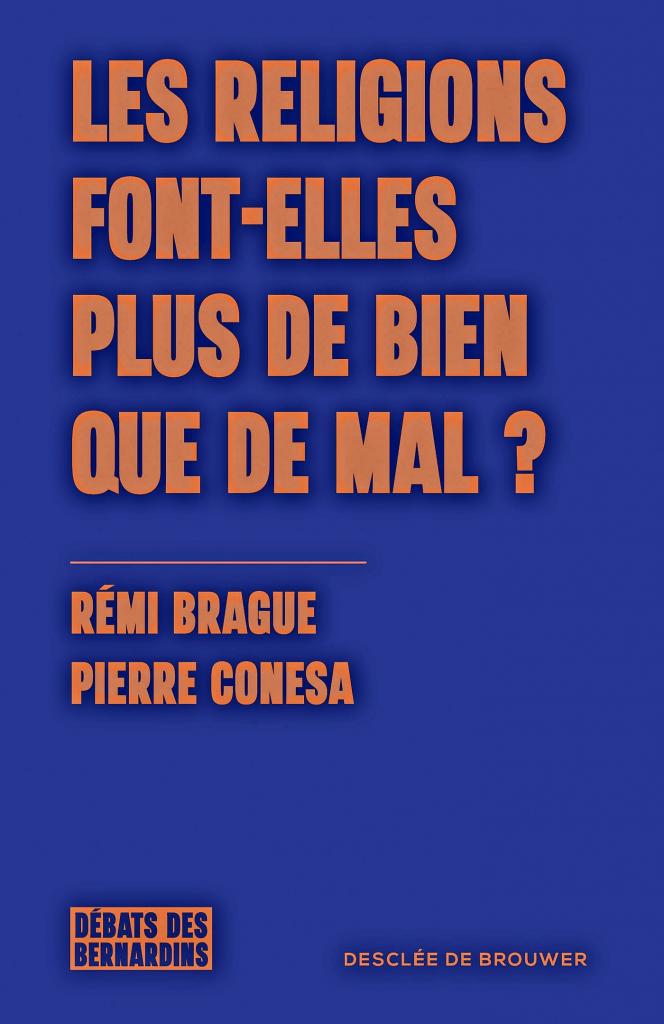
Cette philosophie est-elle applicable aujourd’hui? De plus en plus difficilement en ces temps où «il n’y a plus que les cinémas et les églises où les différences se côtoient», suggère Alexandre Wirth, le directeur de la communication et du développement du Collège des Bernardins et modérateur du dialogue. Plus de bien que de mal, les religions? Le livre n’offre pas de réponse définitive. Mais il nous enseigne, dans la bouche de Rémi Brague, que contre la violence, religieuse ou autre, le meilleur rempart, c’est d’apprendre à lire parce que le livre permet de «prendre de la distance».
(1) Les Religions font-elles plus de bien que de mal?, par Rémi Brague et Pierre Conesa, Desclée de Brouwer, 132 p.
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici