
Comprendre les addictions: pourquoi la consommation n’est pas le problème

Pour Infor-Drogues, qui multiplie les formations dans les écoles, les centres d’accueil et même les maisons de repos, ce n’est pas la consommation le problème. Et cette approche fonctionne.
Au début, c’est presque toujours pareil: «Allô? Bonjour. Voilà, on a un problème de consommation. On ne sait plus quoi faire. On a pourtant tout essayé.» Un «problème de consommation»? Des élèves éméchés après la pause de midi, du cannabis au travail, des résidents qui sniffent, des asthmatiques qui fument, une utilisation «hors de contrôle» d’Internet, une consommation massive d’antidouleurs… Des comportements qui «perturbent le bon déroulement des choses». Alors allô Infor-Drogues.
«On est souvent une sorte de dernier recours, résume Antoine Boucher, chargé de la communication de l’asbl. L’institution a appliqué la procédure classique de son règlement interne: au bout des x avertissements prévus, C4 ou renvoi. Si on nous appelle, c’est qu’elle commence à réaliser que cette méthode est inefficace, n’aide personne, divise son équipe, augmente la précarité. Bref, elle se sent dépassée et impuissante.»
Alors l’équipe Prévention/Promotion de la santé d’Infor-Drogues, créée en 1992, entre en scène. Auprès d’écoles, IPPJ, centres d’accueil pour réfugiés ou SDF, hébergements pour handicapés… Même des maisons de repos. Elle rencontre le personnel, pour comprendre les problèmes, les solutions tentées et les objectifs. S’il y a adéquation, elle propose un accompagnement, in situ: deux journées de réflexion, proches, puis deux de suivi, trois et six mois plus tard. «Réfléchir, c’est bien, mais il faut que des changements puissent être réalisés, concrètement. C’est pour accompagner ces changements que le processus est long.»
Lire aussi | Dépendance: êtes-vous à risque ?
«Le symptôme d’un besoin»
«En matière de drogues, reprend Antoine Boucher, les actions prévues sont dans l’urgence et presque toujours répressives. Or, c’est très difficile d’en sortir sans compréhension et soutien des collègues et de la hiérarchie. L’efficacité de nos accompagnements augmente considérablement quand toute l’équipe et la direction y participent. Ça permet d’instaurer une cohésion quand elles devront traduire tout cela en actions.»
«Tout cela», c’est l’approche d’Infor-Drogues face aux dépendances ou accoutumances: s’attaquer à l’origine du problème, à sa cause, la plupart du temps très enfouie. Parce qu’en réalité, pour le consommateur, le problème n’est pas la consommation ; la consommation, c’est la réponse au problème. Sa dépendance, qu’elle soit à l’alcool, à des substances, au jeu, aux jeux vidéo, est le symptôme d’un besoin, d’un manque ou d’une souffrance. Partant de là, l’asbl propose aux équipes d’établir des hypothèses sur la base de leurs connaissances de la situation personnelle du consommateur: «A quel quels besoins répondrait en fait l’addiction?»
Ces besoins sont pour l’essentiel de trois ordres: un, créer du lien (en se désinhibant) ; deux, avoir une identité, être reconnu comme rebelle, caïd, boute-en-train, plus productif ou plus créatif ; trois, pouvoir gérer mes émotions, «comme le stress, l’angoisse, la colère, l’ennui, la peur de craquer, donc de risquer l’exclusion, à l’école, au travail, en communauté…»
La dépendance, selon Infor-Drogues, c’est donc «devoir toujours passer par une même pratique en cas de situation difficile émotionnellement. Ne pas avoir d’autre solution que consommer un produit ou adopter un comportement. On aura beau jeu de rétorquer “moi aussi j’ai des problèmes et je n’ai pas pour autant besoin de boire, de fumer ou de sniffer’’, très bien, tant mieux et bravo. Mais nous sommes tous différents. Et ceux qui ne savent pas gérer leurs émotions adopteront par ailleurs des moyens très différents pour les y aider: drogue, sport, méditation, yoga, nettoyer son intérieur, etc. Pénaliser ou punir ceux qui ne savent pas le faire autrement qu’en consommant une drogue ne servira pas à ce qu’ils n’en aient plus besoin, au contraire!»
On a mis d’autres lunettes, pour ne plus se focaliser sur l’addiction, mais sur sa cause.
«La clé: modifier les conditions»
Dès lors, la réflexion à laquelle pousse l’asbl se déplace de l’axe «que faire pour qu’il ne consomme plus en nos murs?» à l’axe «pourquoi consomme-t-il en nos murs?». Elle invite l’institution à se pencher sur ses propres règles, peut-être déclencheuses de consommation, par exemple si elles renforcent une identité de rebelle, de courage, de transgression, recherchée (souvent inconsciemment) par le consommateur. Et de prendre en considération, autant que possible, l’entourage et l’itinéraire de celui qui consomme, de discuter avec lui de son état de bien-être au sein de l’institution. Bref, de tenter de cerner si son accoutumance correspond à l’un des trois besoins majeurs: création de lien, recherche d’identité, gestion des émotions. L’institution pourra alors échafauder des pistes pour soutenir le besoin du consommateur: le valoriser, faciliter son intégration dans le groupe, anticiper et échanger sur des situations émotionnellement délicates, etc.
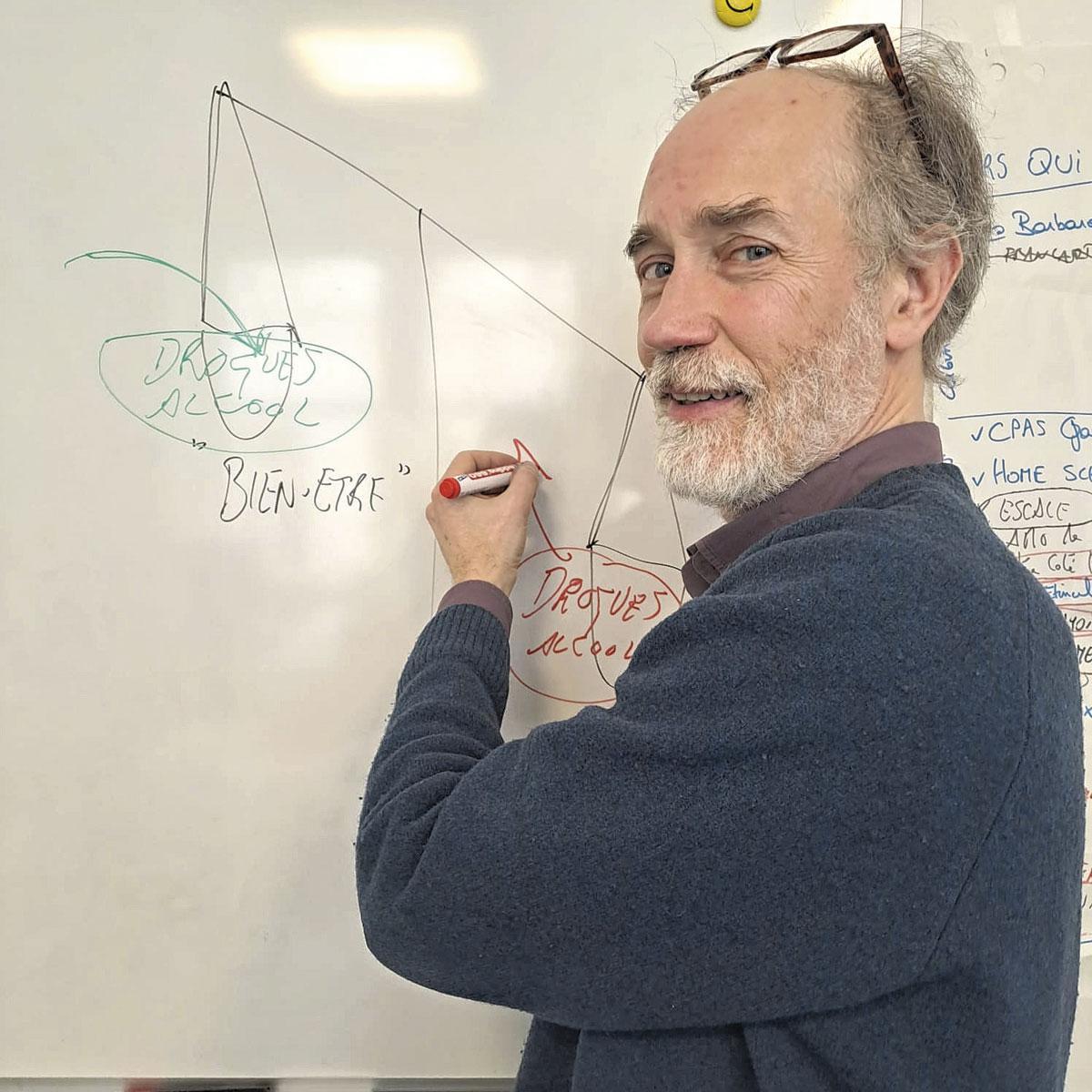
«La clé, c’est de modifier les conditions créant les besoins qui eux-mêmes incitent à la consommation. Exemples: dans une entreprise d’assemblage de voitures, les travailleurs chargés de réceptionner les véhicules sortant des ateliers pour les conduire au parking fumaient du cannabis. En réfléchissant au contexte, l’encadrement a constaté qu’ils étaient longtemps inactifs, parce qu’il y avait un très long battement entre chaque véhicule à garer et n’avaient quasiment aucun contact avec les autres équipes. L’entreprise a alors pu émettre l’hypothèse qu’ils se sentaient inutiles, ce qui pouvait motiver la consommation. La chaîne des tâches a été modifiée, les temps morts réduits et la consommation a disparu. Dans une école, des élèves revenaient régulièrement ivres après la pause de midi. L’équipe éducative a noté que c’était, au fil des ans, toujours en 4e secondaire et le jeudi ; or les horaires prévoyaient cet après-midi-là un test oral et individuel, au hasard et devant la classe. Des émotions fortes et difficiles à gérer? L’école l’a transformé en test par groupe, avec dates annoncées. La consommation d’alcool du jeudi midi a fondu.»
Le processus demande de passer du «tout est la faute de l’individu» à «j’admets qu’une partie du problème réside dans mon propre fonctionnement». C’est un renversement de perspective. Dans une majorité de cas, ça fonctionne.
«Une réflexion collective»
De fait, les formations débouchent souvent sur «la remise en cause de notre façon de faire». «On essaie de se questionner davantage sur ce qu’on met, ou pas, en place, face aux besoins des jeunes. Maintenant, on voit leurs consommations comme une façon de dire quelque chose», résume un intervenant psycho-éducatif d’une équipe bruxelloise d’accompagnement de jeunes ayant commis des infractions. «On mène désormais une réflexion collective, pour limiter les risques de mal-être des élèves, surtout ceux en décrochage scolaire, mal-être qui les pousse au cannabis, et ça commençait avec la cocaïne, et les orienter vers d’autres solutions», se félicite une directrice d’athénée en province de Luxembourg. «Le personnel a changé de regard, donc d’attitude. Les résidents se sont sentis plus soutenus, mieux compris, et les comportements problématiques sont tombés», affirme la responsable d’une maison de repos en Région de Bruxelles-Capitale. «On a mis d’autres lunettes, pour ne plus se focaliser sur l’addiction aux produits ou aux jeux en ligne, ou sur le comportement, mais sur le pourquoi, en écoutant, en étant moins prohibitifs et on a compris que l’isolement était souvent la cause de la consommation», expose une tutrice d’une antenne pour mineurs non accompagnés d’une ONG. «On leur a fait comprendre qu’on avait besoin d’eux, et c’est vraiment le cas, donc ils se sont sentis valorisés et n’ont plus besoin de subterfuges pour exister», sourit une animatrice d’un service d’Action en milieu ouvert, dans la capitale.
Un boulot de fourmi et de titan, à la fois. Qui répond à une nécessité: rien qu’en 2022, à Bruxelles et en Wallonie, il y a eu 34 formations sur les lieux mêmes du «problème de consommation», soit le double de 2019. «Si on ajoute les professionnels qui sont preneurs à titre personnel, et pas avec leur équipe, ça fait 75 formations l’année dernière.» Chaque fois, après ce fameux «Allô? Alors voilà, on a un problème de consommation. On ne sait plus quoi faire».
Patatras!
Fin mars, Barbara Trachte, ministre-présidente du Collège de la Cocof, chargée notamment de la Promotion de la santé, a annoncé la suppression du subside (90 000 euros espérés) alloué jusque-là à l’équipe Prévention/Promotion de la santé d’Infor-Drogues. Sans ce budget, c’est la fin de son travail en Région de Bruxelles-Capitale. Sa décision, justifie le cabinet, «ne préjuge en rien de la qualité du travail réalisé par Infor-Drogues» mais celui-ci «ne s’inscrit pas dans les cinq axes et priorités du plan de promotion de la santé 2023-2027»: promouvoir la santé et les stratégies de promotion de la santé dans toutes les politiques, renforcer la participation des publics et l’action communautaire, promouvoir et soutenir des actions visant des environnements et des milieux de vie favorables à la santé, promouvoir et favoriser des aptitudes favorables à la santé et réorienter les services.
«On ne comprend pas, notre équipe remplit toutes les conditions et n’a jamais eu autant de travail sur le terrain ni autant de demandes d’aide», déplore l’asbl. Sept accompagnements devaient démarrer à Bruxelles et 19 sont en cours. L’administration de la Cocof et le cabinet Trachte recherchent, «en bonne entente avec Infor-Drogues, d’autres pistes pour que la mission bruxelloise de l’équipe Prévention/Promotion de la santé de l’asbl puisse se poursuivre».
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici