
Qui sont les « transclasses », ces personnes aux trajectoires de vie fascinantes

Témoignages et enquêtes se succèdent sur ceux qui ont changé de classe sociale. Les transclasses fascinent dans une Belgique qui reproduit les inégalités.
«Longtemps, je n’ai pas su de quel milieu je venais.» Ainsi commence le livre de Gérald Bronner, sociologue et membre de l’Académie de médecine, Les Origines. Pourquoi devient-on qui l’on est? (éd. Autrement, 2023). Il y raconte sa trajectoire familiale, sociale et scolaire. Celle d’un élève fort en classe qui a grandi dans un quartier populaire de Nancy, fils d’une femme de ménage et d’un beau-père livreur de nuit, ayant réussi à devenir «professeur des universités». Celle aussi faite de quantité de petits riens. Chez ses condisciples mieux nantis, vêtements, décoration, habitudes et attitudes n’étaient pas comme chez lui, qui fut le premier à obtenir le bac. Les odeurs non plus n’étaient pas les mêmes. Chez les pauvres, le tabac et la Javel dominent. Au lycée, en fréquentant les enfants de milieux aisés, il a compris que sa famille était pauvre. «Je n’en ai pas souffert. En revanche, j’avais l’impression que les autres avaient une histoire, et que nous, on n’avait rien à raconter, à part les pique-niques, la belote, la télévision, la radio.»
Le moteur initial qui amorce la fusée, c’est l’envie d’une autre vie.
L’ouvrage de Gérald Bronner s’inscrit parmi d’autres essais, nombreux et récents, de voyage entre classes sociales. Bernard Fusulier, Journal de bord d’un transclasse. Récit d’une improbable traversée des classes sociales (La Boîte à Pandore, 2020), Annabelle Allouch, Mérite (LHS Editions, 2021), Rose-Marie Lagrave, Se ressaisir. Enquête autobiographique d’une transfuge de classe féministe (La Découverte, 2021), Paul Pasquali, Héritocratie (La Découverte, 2021), Norbert Alter, Sans place ni classe. L’improbable histoire d’un garçon qui venait de nulle part (PUF, 2022), Chantal Jaquet et Jean-Marie Durand, Juste en passant (PUF, 2021)… Les récits intimes sont, eux aussi, légion: Edouard Louis, Changer: méthode (Seuil, 2021), Sébastien Le Fol, «Reste à ta place…!» (Albin Michel, 2021) ou Adrien Naselli, Et tes parents, ils font quoi? Enquête sur les transfuges de classe et leurs parents (JC Lattès, 2021), dans lequel le journaliste analyse le rapport entre de jeunes diplômés «transclasses» et leur famille.
Etudié par les chercheurs, recherché par les maisons d’édition, valorisé dans les médias… Tout se passe comme si le «transclasse», selon le néologisme créé, en 2014, par la philosophe et sociologue Chantal Jaquet (La Fabrique des transclasses, PUF, 2018), était devenu un héros, une super-star, ou presque. L’époque est au «coming out social généralisé», au dire de Didier Eribon, lui aussi philosophe et sociologue, auteur de Retour à Reims (Fayard, 2009), où il revient sur sa propre traversée de l’espace social.

Devenu étudiant à l’Ecole polytechnique, en 1993, Pascal (1) n’a pas eu besoin de faire son «coming out social». Pas besoin, car, dit-il, ce sont toujours les autres qui vous renvoient à votre origine modeste, ethnique, géographique. «Je me suis retrouvé avec des personnes dont les habitudes, les manières de s’amuser, de se détendre n’étaient pas les miennes. Aller boire un verre après les cours et organiser des fêtes dans des appartements, c’est quelque chose qu’on ne faisait pas dans mon milieu. D’abord parce que cela coûte cher», raconte ce fils d’un cheminot et d’une mère au foyer, aujourd’hui quinquagénaire et chef de projet dans une entreprise de construction. A ces difficultés de trouver ses marques et à s’adapter à son nouvel environnement peut s’ajouter le sentiment de ne pas totalement mériter sa place. «Certains étudiants avaient un mépris énorme pour toute personne qui n’était pas issue du même milieu qu’eux, notamment les boursiers.» Arrivé en fac, il a tout de suite eu l’impression de ne pas être légitime.
Tous évoquent des rencontres «décisives», des «alliés d’ascension» qui font la courte échelle.
Ce malaise, Eline, 35 ans, l’a connu elle aussi. Fille d’ouvriers en usine, ayant réussi à entrer en médecine, puis à décrocher une spécialité parmi les plus prisées, l’ophtalmologie, elle a compris qu’elle appartenait à la classe des gens de peu quand elle a mis un pied au sein de l’élite. Un sentiment qu’elle a ressenti d’autant plus fortement que chez elle, «personne ne vient du biotope médical». «Le décalage avec mon athénée était énorme. Il y avait beaucoup de jeunes bien nés. Ils parlaient bien, partaient au ski. Pour certaines soirées, je n’étais pas invitée. Là, de façon très subtile, on devine que… Moi, je sentais fort la province, très fort Arlon. Il y avait comme une frontière invisible.»
L’entrée dans l’enseignement supérieur représente, en effet, un révélateur, une véritable ligne de fracture pour beaucoup. Un moment où naissent les incompréhensions, les vexations, les non-dits avec les parents, la fratrie, les gens qui les ont vu grandir. Ainsi, la trajectoire d’Eline est parfois source de tensions. Du bout des lèvres, elle parle de «reniement» pour décrire ce qui, aux yeux de tant d’autres, passe pour la vie normale d’une étudiante ou d’une jeune adulte: des appels et des visites à la famille qui se raréfient, au profit des études, des amis, de la découverte de soi. «Ce type de scolarité les contraint à traverser l’espace social. Ils doivent fournir un gros effort pour acquérir les codes sociaux du milieu qu’ils rejoignent», rapporte Paul Pasquali, sociologue, dont les recherches portent sur les mobilités sociales.

Déjà inquiets de ne pouvoir guider leur progéniture, ignorant le milieu où elle évolue désormais, les parents craignent en plus de ne plus rien partager avec elle, ni valeurs ni langage commun. Faute de savoir l’exprimer, cette angoisse sonne parfois comme un reproche, difficile à entendre pour leurs enfants en pleine émancipation. Ainsi le cinglant «Tu n’es pas sortie de la cuisse de Jupiter!» que ses parents lancent à Eline jugeant qu’elle a changé. Ou ce «On n’est plus assez bien pour toi?» prononcé par sa mère à Pascal lorsqu’il refuse de l’accompagner au camping pour partir en vacances avec deux camarades de polytechnique. «Il m’est arrivé de les entendre dire que j’avais un air pompeux, même en dormant. De mon côté, je culpabilise de m’ennuyer quand je vais les voir, de trouver leurs conversations insignifiantes. Tout prétexte est bon pour ne pas y aller», livre Eline.
Lire aussi | Où la confrontation prend corps
Désirer davantage, c’est souvent désavouer les valeurs familiales. Les proches ont en effet un discours ambivalent sur le transclasse: ils sont fiers, mais le regardent aussi comme un étranger qui a «renié» sa famille. Celui qui a «trahi» sait bien, lui, qu’il ne pouvait pas faire autrement.
Pour autant, on ne devient pas transclasse par hasard. Ce n’est pas une loterie. «Le moteur initial qui amorce la fusée, c’est l’envie d’une autre vie», note, a posteriori, Pascal. Une vie qui ne serait pas le monde des appartements de la «barre Etrimo» et de la télé allumée du midi au soir, le monde des collections de verres à bière et de peu de livres, sinon les recueils Artis Historia. Et qu’il a voulu fuir. «Au fond, qu’avaient-ils comme projet pour moi? Que je puisse choisir mon métier, finir les fins de mois et fonder une famille, pas nécessairement plus, poursuit Pascal. J’ai grandi avec l’idée que tout n’était pas accessible. “Tout le monde ne peut pas devenir ingénieur ou médecin”, répétait ma mère. On ne dirait pas ça dans une famille bourgeoise…»
Les transclasses montent mais n’emportent pas leur famille avec eux. Leur ascension est solitaire.
Spinoza et la théorie des affects
«On ne quitte pas un milieu social si on en est pleinement satisfait», analyse Chantal Jaquet. Pour comprendre ce qui arrache un individu de sa classe, la philosophe passe en partie par Spinoza et sa théorie des «affects»: quelque chose qui nous affecte, une stimulation à laquelle nous réagissons. Ce sont souvent des affects négatifs (la haine, la rage, le sentiment d’injustice). Mais ces affects tristes peuvent être positifs, en donnant une énergie pour combattre. L’expérience de la honte et du mépris peut ainsi se transformer en ressort d’action, en puissance d’agir. Au départ, ce peut tout autant être des affects positifs (l’amitié, l’amour, l’admiration pour des êtres différents de soi). Cependant, selon Chantal Jaquet, ceux-là seraient moins puissants.

Le processus ne se fait pas forcément sur le rejet. Il peut avoir été souhaité et soutenu par la famille. En bref, le transclasse est soit propulsé par son milieu, soit il l’expulse. Ainsi Eline, dont les parents ont financé des cours de soutien, des cours intensifs et une chambre en résidence universitaire. «Ils se sont saignés et travaillaient dans des conditions pénibles pour que je puisse étudier tout le temps, confortablement.»
Les affects, ces sentiments et ces émotions qui résultent des rencontres avec l’extérieur, ne sont pas suffisants pour rendre ce qui est désirable en acte. La mobilité sociale n’est pas uniquement conditionnée par un tempérament volontaire ou une exceptionnelle ténacité. Pour l’experte, il n’y a aucune cause décisive à elle seule mais un faisceau de causes concordantes, qu’elle nomme «complexion, c’est-à-dire un ensemble de déterminations économiques, sociales, familiales, affectives, qui se nouent et se dénouent, un entrelacement compliqué de fils». Tous ces éléments s’imbriquent et concourent à faire du transclasse ce qu’il est.
Parmi ces déterminations figurent des rencontres. «Dans mon cas, cela a été celle d’un prof de maths, à l’âge de 15 ans. Il m’a montré qu’on pouvait garder son humour tout en faisant de la trigono et m’a donné des cours gratuitement. Surtout, il savait écouter, conseiller, simplement être là pour dire “Continue”», se rappelle Pascal.
Tous évoquent des rencontres «décisives», des «alliés d’ascension» selon le terme de Paul Pasquali, qui font la courte échelle. «Dans les rencontres, certaines paroles peuvent assigner à résidence ou, au contraire, agir comme des bonnes fées», détaille Chantal Jaquet. Pour se détacher – c’est une constante –, il faut également des figures d’identification, des modèles autres que ceux présents dans l’entourage et qui deviennent désirables. Chez le nomade social, le mimétisme demeure par ailleurs fondamental. Il ne s’agit pas d’imiter ce qui se présente d’emblée comme un exemple à reproduire, mais de s’inspirer d’exemples alternatifs: des frères, des cousins, évidemment, mais aussi des «pairs», des tantes, des familles généreuses, des héros. L’identification se fait en cas de points d’accroche forts. Eline raconte le rôle déterminant de la mère de son amie, architecte, mariée à un dentiste, auprès de qui elle découvre les livres, les musées, le goût de la conversation. «A 16 ans, Aurélie est devenue ma meilleure amie. Quand j’allais chez elle, je voyais qu’il y avait une forme d’innocence et de légèreté, quand chez moi régnait la peur de ne pas payer toutes les factures.» Cette femme fut un repère, incarnant immédiatement un modèle d’excellence, d’élégance, de perfection, jusqu’alors jamais rencontré. «Elle me fascinait et j’aspirais à lui ressembler. L’influence qu’elle a eue sur moi et les désirs qu’elle a éveillés ont été déterminants.»
Ces trajectoires exceptionnelles s’appuient également sur des conditions économiques et politiques favorables. Au XIXe siècle, avec l’industrialisation, les classes populaires, paysannes ont évolué vers des métiers qualifiés. «Même chose dans les années d’après la Seconde Guerre mondiale, où il y avait une possibilité de sortir de sa condition sociale à travers la démocratisation de l’enseignement et une économie en développement nécessitant d’accueillir dans les fonctions dirigeantes des jeunes issus des milieux populaires, souligne Bernard Fusulier, professeur de sociologie à l’UCLouvain. L’image de l’ascenseur social était alors utilisée.»
Le phénomène varie aussi géographiquement. Les Etats-Unis, considérés comme le pays du self-made-man, ont en réalité une très faible mobilité sociale, contrairement aux pays scandinaves. «En Belgique, les chemins sont moins balisés, ce qui n’empêche pas aux enfants de trouver les voies de la reproduction sociale, poursuit le sociologue. Les moins nantis ont, à la fois, plus d’opportunités et peu de chances de changer de conditions, puisqu’ils n’ont pas de boussole pour les guider.»
Enfin, s’ajoutent les politiques éducatives liées au système d’aides financières, comme les bourses et les dispositifs (comme la discrimination positive dont bénéficient certains établissements scolaires). «Sans bourse, pas d’études. Etre boursier, c’était une condition matérielle nécessaire pour envisager l’université et pouvoir résister aux injonctions promptes à me diriger vers une professionnalisation rapide», confirme Pascal.
Tout cela montre donc que l’ambition n’est pas la cause première qui motive le passage d’une classe à l’autre. Elle n’est pas en première ligne, en tout cas. «Elle n’est que la partie visible de l’iceberg, en ce que l’ambition est moins la cause que la conséquence de toutes sortes de facteurs», pointe Chantal Jaquet. Tout cela montre aussi que leur parcours n’est pas le fruit d’un mérite intrinsèque. C’est pourquoi les sociologues inversent la fameuse formule: «C’est quand on peut, qu’on veut.» L’expression «quand on veut, on peut» fait d’ailleurs blêmir Pascal. Que sa «réussite» puisse servir d’alibi «pour ne rien changer au sort de tous les autres». Rien ne l’énerve plus que d’être «une exception».
Des «anomalies statistiques»
Ils sont des «anomalies statistiques», au dire du sociologue Jules Naudet. Ceux qui parviennent à défier les pronostics bien connus demeurent rares tout en les masquant un peu. Une publication de l’Université libre de Bruxelles, réalisée par l’Institut de sociologie, souligne qu’«en Belgique, un enfant d’ouvrier peu qualifié a 53 fois moins de chance qu’un enfant de cadre supérieur de devenir cadre supérieur». Et «ces enfants ne représentent que 20% des élèves dans l’enseignement général secondaire». Les enquêtes Pisa ciblent aussi la Belgique comme l’un des pays les plus inégalitaires de l’OCDE, c’est-à-dire l’un de ceux où la classe sociale de naissance a le plus d’impact sur le parcours scolaire.
Les «nomades sociaux» représentent «des alibis parfaits pour le mythe de la méritocratie».
Les «nomades sociaux» représentent des «allégories vivantes d’une société qui se rêve sans classe, des alibis parfaits pour le mythe de la méritocratie», déclare Jules Naudet. Car cette petite musique qu’on entend est celle du mérite. C’est-à-dire l’idée qu’après tout, rien n’est impossible, pourvu qu’on s’en donne les moyens. Preuve en seraient ces trajectoires contre vents et marées. En fait, un leurre, parce que la méritocratie place le talent, le don, la niaque au cœur de la réussite et minimise le rôle des inégalités de départ. C’est aussi faire l’impasse sur la responsabilité des dirigeants qui ont mené des politiques de désindustrialisation, la crise économique et un droit du travail insuffisamment protecteur. «Une notion couperet qui rend les individus responsables de leur destin et transforme l’injustice en prétendue justice, puisque si des individus peuvent s’en sortir, c’est que cet ordre est juste», commente Chantal Jaquet. Un concept que les sociologues, et nombre de transclasses eux-mêmes, estiment nocif. Il met d’ailleurs sous le tapis sa contrepartie, sa dose d’humiliation et de culpabilité: les non-diplômés, les sans-travail ne doivent s’en prendre qu’à eux-mêmes ; au fond, ils l’ont bien mérité. «Une société qui célèbre la réussite personnelle juge sévèrement ceux qui échouent», tranche Chantal Jaquet.
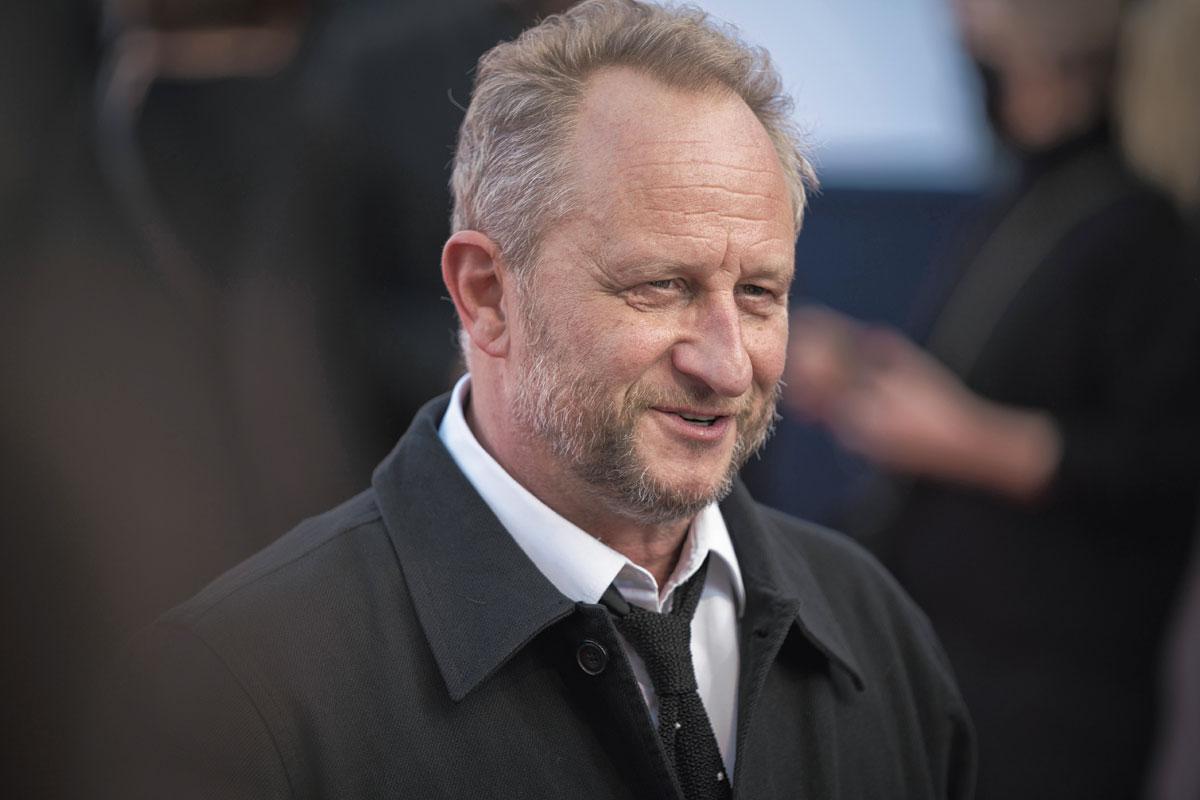
Du point de vue des plus privilégiés, il y a également un trompe-l’œil. Eux aussi en viennent à croire qu’ils ne doivent leur réussite qu’à leur talent et à leurs efforts, alors qu’en réalité les statistiques, encore, démontrent que les dés sont pipés. L’université accueille 5% d’enfants issus de milieu ouvrier et près de 80% d’enfants de cadres. Résultat: convaincus qu’ils méritent leur place, ils estiment n’avoir aucun devoir de solidarité et de redistribution.
Bien qu’ils soient des anomalies statistiques, les transclasses, pour qui tout se joue en une seule génération (quand il en faut trois pour qu’une personne née dans une famille pauvre se rapproche du revenu moyen), fascinent. Il y a une forme d’attraction à l’égard de ces «parvenus» autrefois méprisés. C’est parce que leur parcours singulier rassure, prenant un air de berceuse, en alimentant le champ des possibles. C’est aussi un sujet politique, qui touche aux divisions très actuelles, celles sur l’égalité des chances, la mobilité, le mérite, le travail… Enfin, cette fascination, selon Bernard Fusulier, est «le symptôme de l’absence d’un projet politique fédérateur de transformation sociale».
Une dette à vie
Que devient-on après avoir franchi la frontière? «On reste un déplacé toute sa vie», répond Pascal, qui entretient aujourd’hui des rapports distants mais pacifiés avec sa famille. «Je sais d’où je viens même si je n’ai plus d’amis issus de mon milieu d’origine.» Les transclasses montent mais n’emportent pas vraiment leur famille avec eux. Leur ascension est solitaire. Malgré des allers-retours réguliers entre ses proches, restés à Arlon, et les élites qu’elle fréquente, Eline concède que le fossé s’est creusé. «Vos parents vous donnent les moyens de les trahir… et après, quelque part, ils vous le font payer.»
La réussite ne libère pas de tout. Nombre de transclasses ont en commun la conviction d’avoir une dette à vie. Beaucoup mettent leur argent, leurs compétences et leur carnet d’adresses au service de leur famille ou de leur milieu d’origine – par des associations, par exemple. Les uns veulent effacer une faute originelle, les autres veulent se montrer à la hauteur des sacrifices de leurs parents. Cette dette ne semble s’alléger qu’avec l’âge, l’accès aux postes plus élevés ou le fait de devenir parent à son tour, sans jamais disparaître pour de bon. «Je sais ce que je leur dois. Ils m’ont transmis ces valeurs de travail et de solidarité», clôt Pascal.
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici