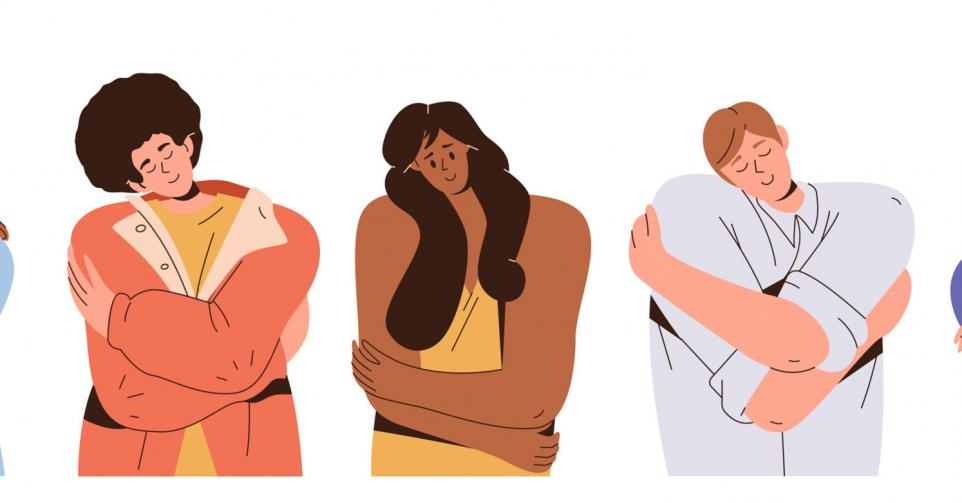
Pourquoi il faut devenir (plus) égoïste: «Bah non, je ne décore pas le sapin de Noël, je n’aime pas ça»
A contre-courant des traditionnelles injonctions à la bienveillance, l’autrice Corinne Maier défend une forme d’égoïsme du vivre pour soi, libérateur pour les femmes, révélateur pour les autres.
Corinne Maier est la première arrivée au rendez-vous, alors elle n’hésite pas à se commander un thé au gingembre. L’économiste, écrivaine et psychanalyste d’origines suisse, française mais aussi belge, choisit arbitrairement la table de l’entretien, à côté d’une fresque composée de boules aux couleurs changeantes qui lui fait penser à «certains trucs d’art moderne». La jeune sexagénaire n’a pas attendu l’aval de son interlocuteur. Une attitude sans aucune gravité, mais qui peut être qualifiée d’égoïste. Ça ne la dérange pas. Entre les lignes des différents ouvrages qui lui ont valu le surnom d’«héroïne de la contre-culture» par le New York Times, elle revendique même l’adoption d’un égoïsme du vivre pour soi: «Un recentrage sur ce que l’on est et ce que l’on aime faire, précise-t-elle. Une façon de se réapproprier le fait de vivre comme on en a envie.»
D’après vous, pourquoi a-t-on tant de mal à s’autoriser à être égoïste?
Déjà, il y a une question de politesse, dont les formules permettent de camoufler un peu notre égoïsme pour feindre qu’on veut faire passer les autres avant soi. Il y a aussi un héritage des mécanismes de survie qui remontent à des millénaires, quand l’homme devait vivre en groupe, et puis, bien entendu, l’influence de certaines religions qui nous poussent à nous occuper des autres. Notez que le terme possède plusieurs définitions. Je distingue personnellement trois formes d’égoïsme. La première, c’est l’accaparement, qui consiste à passer avant les autres, à toujours vouloir davantage que le voisin; ce que je trouve assez moche, en fait. Ensuite, il y a l’égoïsme du repli, quand il n’y a que moi qui compte, mon appartement, mes proches, mon chien, et que tout le reste n’existe pas; ce que je trouve un peu triste. Et puis, il y a l’égoïsme du vivre pour soi. Il implique bien sûr d’être ouvert à soi-même, mais aussi aux autres: on ouvre grand les fenêtres et malgré tout, on ne se fait pas bouffer par les autres, par les obligations, etc. Il existe un véritable art de l’égoïsme sans nuisance ni repli sur soi.
«Faire preuve d’égoïsme positif est une manière de ne pas se faire cadenasser.»
L’égoïsme sain que vous célébrez se situe donc entre les égoïsmes de l’accaparement et du repli et, à l’inverse, «l’échoïsme», cette tendance extrême à faire passer les besoins des autres en priorité?
On peut aussi nuancer en précisant que dans certaines circonstances, quand on s’en fiche, c’est plutôt pas mal de laisser les autres décider, comme par exemple le choix des vacances en Picardie ou en Autriche si ce qui compte, c’est d’être avec ses proches. Pour revenir à l’égoïsme que je défends, il s’agit plus d’une affirmation de ce que l’on veut vraiment faire et de qui l’on est. Ça ne se traduit pas forcément par des envies absolues à des moments précis: on peut faire preuve de souplesse pour des choses qu’on ne juge pas très importantes. Cet égoïsme est une sorte d’art de vivre plus qu’un point à l’ordre du jour.

Comprenez-vous que ce concept puisse être mal vu en ces temps de triomphe de l’individualisme et du succès personnel?
Bien sûr. Evidemment, cela s’ajoute aux injonctions –disons d’ordre économique– qui nous poussent à être meilleurs que le voisin, plus performants au travail, etc. Maintenant, l’idée consiste juste à faire comprendre par son attitude qu’il y a des choses très importantes que l’on veut vraiment faire, au travail ou à l’extérieur. Cela peut se faire de manière simple et pas forcément agressive. Ce n’est pas un égoïsme décomplexé, plutôt ferme et ouvert: «Moi, ce week-end, je n’aurai pas le temps de m’occuper des enfants parce que j’ai un truc à finir, donc il va falloir s’organiser. Comment fait-on?» Ça permet aux autres de savoir à quoi s’attendre, d’où la nécessité d’une bonne communication.
Lire aussi | A quoi reconnaît-on un ego surdimensionné?
Sans risquer de renforcer cette société de l’individualisme?
Je suis prudente avec cette histoire d’individualisme. Il existe peut-être dans les comportements, mais en même temps, j’ai l’impression que l’on est tous poussés à rentrer dans des moules… Faire preuve d’égoïsme positif est une manière de ne pas se faire cadenasser. Au boulot, c’est par exemple rappeler les tâches pour lesquelles on a été embauché et remettre en question la pertinence de participer à 26 réunions sur des sujets divers. Mais j’ai conscience que ce que je défends est très difficile à mettre en place. Parce que ça casse les codes et peut parfois ressembler à une révolte contre l’ordre établi.
Le sociologue américain Nicholas Christakis, spécialiste des déterminants du bien-être humain, estime que l’homme possède en lui cette propension à céder aux intérêts du groupe avec le potentiel effet pervers de trop s’y identifier et donc de diaboliser les autres groupes. L’égoïsme positif a-t-il le pouvoir de réduire ces influences?
Certainement. L’égoïsme positif peut rendre plus individualiste, mais pas forcément dans un mauvais sens. Le tout est de ne pas devenir complètement captif d’une seule identification, mais de circuler entre les groupes et les identités (la famille, la religion, l’origine, le travail) sans en être prisonnier. Et puis, on peut également s’identifier autrement, comme dans un cadre associatif, en se consacrant à des choses qui ont du sens sans attendre un retour personnel.
L’égoïsme sain permettrait une meilleure gestion de ses émotions. C’est-à-dire?
On se sent plus responsable parce que, d’une certaine façon, on est en contact avec ce qu’on veut vraiment, plus équilibré face aux événements et pas tout le temps à la botte des autres. Cet état d’esprit ne permet pas d’atteindre le «bonheur» –je me méfie de ce mot parce que les gens s’imaginent toujours un truc incroyable, une vie parfaite comme on en voit parfois sur Instagram– mais de mener une existence plus conforme à ce que l’on veut; ce qui est, selon moi, la vraie définition du bonheur.
Il n’y a évidemment pas de procédure type à suivre… Vous, comment êtes-vous devenue égoïste?
C’est en cheminant dans la vie que je me suis dit que j’en faisais trop. C’est venu progressivement par la colère parce que dans certaines circonstances, je ne parvenais pas à exprimer ce que je ressentais, donc je me sentais irritée. Il faut pouvoir interroger sa colère et se demander ce qui ne va pas: pourquoi y a-t-il autant de choses qui m’énervent et comment pourrais-je faire pour me réapproprier moi-même?
«Le fait de ne pas faire est très fort. Il ne s’agit pas d’abandonner, mais de susciter une prise de conscience.»
Tout en prenant soin de fixer une limite pour ne pas tomber dans l’autre extrême, le je-m’en-foutisme?
Tout à fait, c’est un fin dosage. Quoique… Le fait de tout lâcher peut aussi avoir son effet. En Grande-Bretagne, une certaine Miss Potkin, mère de famille, a documenté sa grève des tâches domestiques sur les réseaux sociaux. Un matin, elle a arrêté de faire à manger, de ranger, de faire la vaisselle. Soudainement, tout s’est déréglé… Puis après plusieurs jours, les poubelles ont été descendues et la vaisselle faite. Il y a quand même quelqu’un dans la famille qui s’est dit qu’il fallait agir.
Certains jeunes retraités décident de prendre du temps pour eux plutôt que de s’occuper de leurs petits-enfants. Que dit cette attitude de l’évolution de la famille?
Deux tendances coexistent. Il y a ces grands-parents qui s’occupent énormément de leurs petits-enfants en allant les chercher à l’école, en les prenant le week-end ou en vacances, etc. Et puis, les autres qui n’ont pas envie de ça, qui veulent garder leur liberté. Il y a 20 ou 30 ans, quand les rôles étaient un peu plus traditionnels, la question d’une relève de garde permanente ne se posait pas, elle est apparue avec l’évolution du statut des femmes. Aujourd’hui, elles ont un diplôme, sont plus indépendantes et aspirent à encore plus d’autonomie. Les jeunes en particulier sont très exigeantes et elles ont raison. C’est une sorte d’affirmation de ce qu’elles veulent, et puis, de leur pré carré, de leurs loisirs, de tout ce qui s’ensuit.
C’est ce que vous appelez dans votre livre «l’égoïsme libérateur». Par quoi passe-t-il?
Par le quotidien. Par le fait de refuser de faire certaines choses, de sorte que les autres –compagnon, enfants ou frères– s’y mettent. La majorité des gens qui s’occupent des parents une fois vieux sont des femmes, c’est quasiment tout le temps sur elles que repose la charge des enfants, des courses… Et on présente ces choses comme si elles étaient normales, mais cela peut changer! Pourquoi faudrait-il que je passe l’aspirateur? S’il y a des miettes au sol, elles peuvent rester là, ce n’est pas dramatique. Pourquoi dois-je forcément me sentir investie de la responsabilité de surveiller les devoirs et qu’est-ce qui peut arriver si je ne fais rien? Le fait de ne pas faire est très fort. Il ne s’agit pas d’abandonner, mais de susciter une prise de conscience. En fait, ce n’est pas suffisant d’accuser la société ou les hommes, les femmes doivent aussi se demander en quoi elles sont responsables de la situation. C’est une sorte de réflexion individuelle à mener.
L’égoïsme, même sain, ne risque-t-il pas de fabriquer des êtres antipathiques?
Pas forcément. Ça dépend de comment c’est fait et vécu par l’entourage. Mais effectivement, ça peut attirer des critiques, notamment des belles-mères qui ont tendance à vivre dans un monde ancien, avec l’idée que les femmes doivent faire beaucoup à la maison. Le plus difficile est donc d’assumer sa non-action ou sa contre-action et de dire: «Bah non, je ne décore pas le sapin de Noël parce que je n’aime pas ça.» Mais il faut prendre ces retours comme autant de preuves que vous avez changé… qui amèneront peut-être les autres à penser que l’on peut faire autrement.

Comme vous, le psychiatre Christophe André a longtemps prêché la nécessité de s’écouter soi, mais en est revenu, estimant qu’on est tombé dans une épidémie de narcissisme. Il favorise désormais l’ouverture aux autres pour nourrir l’estime de soi. Qu’est-ce que cela vous inspire?
Ça m’inspire que je ne suis pas d’accord. Je pense que s’écouter soi-même permet aussi de s’ouvrir aux autres, je ne vois pas en quoi c’est antagoniste. Si on fait des choses qui ne nous intéressent pas ou qu’on estime avoir une vie de merde, ça ne pousse pas à aller vers les autres. Au contraire, si on s’épanouit grâce à des passions et plus généralement une façon de vivre qui nous convient, on se sentira mieux et on sera plus ouvert aux rencontres.
«S’écouter soi-même permet aussi de s’ouvrir aux autres.»
Vingt ans après la publication de Bonjour paresse (Michalon, 2004), livre dans lequel vous insistez sur la nécessité d’en faire le moins possible en entreprise, trouvez-vous que le travailleur se permet plus cette forme d’égoïsme?
Je pense que les pressions sont encore plus fortes: la pression au comportement, la pression sur «l’être» et non sur le «faire»… En réalité, les choses évoluent de manière paradoxale parce qu’en même temps, de plus en plus de gens revendiquent le fait d’en faire le minimum, alors qu’avant c’était vraiment un tabou. Maintenant, on sait que ça existe parce que des travaux récents et des bloggeurs le prouvent. Il y a même un terme anglais pour qualifier cette attitude: le quiet quitting, soit se désengager de son entreprise et faire uniquement ce pour quoi on est payé.
Vous prônez l’idée d’aller vers un «moins»: moins de contraintes, moins de vitesse, moins de consommation… pour apprendre à vivre autrement. Mais si on s’intéresse à soi, ne risque-t-on pas de consommer plus?
Effectivement, c’est difficile de laisser parler son envie de faire le tour du monde tout en faisant ce qui est bon pour la planète. Maintenant, on peut considérer que si on a une vie intéressante, agréable, en harmonie avec ses proches et qu’on fait les choses qui nous amusent, on aura peut-être moins besoin de combler un manque en enchaînant les vols en avion ou en achetant les derniers objets à la mode pour trouver son bonheur.
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici