
Judith Butler, philosophe : «Le genre a été interprété comme une force destructrice» (entretien)
La philosophe américaine Judith Butler déconstruit les notions de genre et même de sexe biologique. « La déstabilisation du monde n’est pas le fait de certaines communautés plus vulnérables », insiste-t-elle.
L’intellectuelle la plus influente auprès des jeunes ; l’autorité morale des mouvements de jeunesse ; la philosophe contemporaine la plus célèbre ; la papesse de la «théorie du genre». Le nom de Judith Butler se décline souvent en superlatifs. En anathèmes, parfois.
Cette philosophe a des ennemis à la mesure de sa notoriété. Son aura internationale, l’Américaine la puise principalement dans sa remise en cause radicale des assignations identitaires de sexe et de genre dans son ouvrage Trouble dans le genre, paru en 1990 aux Etats-Unis, mais longtemps toisé dans le monde francophone avant d’être traduit (éd. La Découverte) plus de quinze ans plus tard.
Une révolution copernicienne culturelle et anthropologique: l’hétérosexualité n’est plus la norme, pas plus que l’évidence de la distinction biologique entre les sexes, plaide l’autrice. Il faut parfois forcer le trait pour se faire entendre. Quitte à amender plus tard son propos initial.
Il est plus facile de diaboliser le “genre” que de s’occuper des problèmes structurels produits par les inégalités.
Bien que droite dans ses bottes, comme l’illustre notre entretien, Judith Butler reconnaît quelques approximations dans la traduction française de son œuvre, source de déplorables malentendus et, parfois, de virulentes polémiques. En témoignent celles provoquées récemment, chez nous, par le projet Evras (éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle).
«Les débats sont complexes et intéressants», commence par nous confier la philosophe. Et de poursuivre: «La salle de classe est un lieu où les élèves peuvent commencer à se poser des questions sur leur vie, sur les présupposés qu’on leur a demandé d’accepter et à trouver leur propre voie.»
Généreuse en publications, mais avare en interventions médiatiques, elle s’épanche longuement sur ses thèmes de prédilection, la situation au Proche-Orient et son dernier ouvrage, Dans quel monde vivons-nous? Phénoménologie de la pandémie (1), une réflexion rétrospective sur la pandémie.
Qu’est-ce qui vous a amenée à revenir sur la période de la pandémie alors que nombre d’ouvrages et travaux ont déjà été publiés? Quelle est la particularité de votre approche?
Je n’ai pas particulièrement cherché à établir une approche singulière ou unique. Ce qui m’a amenée à réfléchir sur la pandémie, c’est la pandémie elle-même, le sentiment partagé de souffrance qu’elle implique, les inégalités radicales qu’elle a mises en évidence.
Votre étude s’appuie sur la notion centrale de «vies pleurables» («grievability», en anglais). De quoi s’agit-il?
Quand on dit qu’une vie est «pleurable», cela signifie simplement que si cette vie devait être perdue, elle serait reconnue et endeuillée. Lorsque des vies sont vues comme «impleurables», soit elles ne sont pas vraiment considérées comme des vies, soit leur perte est à peine remarquée.
Pendant la pandémie, les travailleurs qui veillaient à ce que nous soyons nourris et que les biens de première nécessité nous parviennent, ont souvent dû œuvrer dans des conditions où, pour la gagner, ils risquaient leur propre vie. C’était une situation intenable, rendue possible par le manque de conditions de travail décentes sous le capitalisme.
Lire aussi | Personnel soignant épuisé, patients en danger
Lorsque les vaccins ont finalement été mis au point, nous avons remarqué que de nombreux pays riches y avaient eu accès en premier, tandis que les plus pauvres, où les vies étaient considérées comme moins «pleurables», ont dû attendre. Même aujourd’hui, les sociétés pharmaceutiques réalisent des profits de manière étonnante alors qu’il est clair que le brevet des vaccins aurait dû devenir la propriété commune du monde.

Vous dites que la «pleurabilité» est une condition de l’égalité. Qu’entendez-vous par là? En d’autres termes, quel est le lien entre ce que vous appelez «pleurabilité» et égalité?
La plupart des discours sur l’égalité portent sur les différences salariales ou la discrimination, ou sur les différentes façons inégales dont les gens sont traités. En réalité, très souvent, l’inégalité de traitement, ou la discrimination, repose sur certaines considérations tacites sur qui a de la valeur et qui n’en a pas.
Le racisme s’appuie sur ce genre de distinctions et les reproduit. Dès qu’une vie est considérée comme moins précieuse qu’une autre, ou lorsque la vie de ceux qui appartiennent à un groupe est considérée comme moins précieuse qu’une autre, un traitement inégal devient justifié. Il est donc logique de s’interroger sur cette manière dont la valeur est inégalement répartie. La pleurabilité est en lien direct avec la valeur d’une vie.
En d’autres termes, si le fait qu’un certain nombre de vies soient perdues n’a pas d’importance, si la perte de ces vies ne laisse pas de trace, alors les pratiques et les politiques qui conduisent à la mort deviennent soit acceptables, soit invisibles. Nous voyons comment cela fonctionne lorsque les travailleurs, les handicapés et les personnes «racisées» sont traités comme non humains. Si tout le monde était considéré comme également susceptible d’être «pleuré», différents types de politiques suivraient et exprimeraient plus clairement l’égalité.
En 2013, vous avez publié Qu’est-ce qu’une vie bonne?. Quelle réponse donneriez-vous à cette question aujourd’hui, dix ans plus tard?
A mon avis, nous devons garder la question ouverte. Dans le livre auquel vous faites référence, j’avais suggéré que la question de la «vie bonne» pouvait être posée d’un point de vue individuel: comment puis-je mener une telle vie? Il peut aussi s’agir d’une question «arendtienne» (NDLR: en référence à la philosophe allemande Hannah Arendt, 1906 – 1975): comment pouvons-nous, en tant que société, définir et chercher à réaliser la vie bonne?
Le philosophe Theodor Adorno a posé une question toujours d’actualité aujourd’hui: comment vivre une vie bonne dans un monde mauvais? En d’autres mots, étant donné le nombre considérable de vies humaines endommagées par la guerre, la précarité, la pauvreté, par des formes systémiques d’oppression, étant donné à quel point notre cadre de vie a été endommagé et à quel point les perspectives de surmonter la destruction climatique sont faibles, comment peut-on vivre d’une manière que nous pourrions encore qualifier de «bonne»?
Nous savons qu’il existe une appropriation économique et commerciale de la question. Selon cette conception, la vie bonne serait la prospérité, le pouvoir du consommateur, la croissance, etc. Mais si nous reformulons cette question morale dans le contexte actuel, nous devons jongler avec l’histoire, la politique et l’éthique, afin de trouver un chemin vers des valeurs à la fois réparatrices et affirmatives: l’interdépendance, le soin, l’égalité, la liberté sans préjudice, la justice au-delà (et contre) la vengeance, la non-violence comme mode de vie.
Justement, pendant la pandémie, nous avons beaucoup utilisé l’expression «monde d’après». On a également beaucoup nourri l’espoir que «plus rien ne serait plus comme avant». Trois ans plus tard, quel bilan faites-vous de cet espoir d’un «monde d’après»?
Nombreux sont ceux qui, pendant le confinement, ont commencé à nourrir des rêves utopiques lorsque toutes les industries ont cessé leurs activités et lorsqu’ils ont commencé à entendre le chant des oiseaux à l’extérieur. A ce moment-là, peut-être avons-nous pensé que tout s’arrêterait et que tout pourrait être refait, sans la souffrance et les inégalités institutionnalisées.
On s’est assez vite aperçu que lorsque les gens appelaient à «la réinvention du monde», ils considéraient «le monde» comme une sorte de boutique, de magasin. Cela trahissait une conception marchande du monde, régie par l’économie de marché. Le marché est devenu le moyen prédominant d’appréhender le monde. Pourtant, si nous voulons être honnêtes, nous devons nous demander de quoi cette conception du monde comme marché est-elle le nom, le signe ou le symptôme.
Je ne suis pas les débats sur le wokisme car le terme “woke” n’est utilisé que comme une caricature humiliante.
Ce dernier ouvrage, comme les précédents, s’inscrit dans votre réflexion sur des questions éthiques, comme le deuil, la vie bonne, la violence, l’égalité. On vous entend moins sur les questions de genre qui ont pourtant fait votre renommée. Pourquoi?
Oh, mais ne vous inquiétez pas car j’ai récemment terminé un manuscrit portant sur le sujet et intitulé Qui a peur du genre? ; il devrait paraître au printemps 2024 en plusieurs langues, en français notamment (Flammarion). Dans ce travail, je m’intéresse à la construction de «fantasmes» de genre par ceux qui souhaitent fermer les départements universitaires d’étude de genre, nier les droits parentaux des lesbiennes et des gays, nier le droit des gens de changer de sexe légalement ou médicalement, nier les diverses formes de sexualité humaine et de formation de parentalité.
Je crains que le mouvement «contre le genre» ait interprété le genre comme une force destructrice. Pourtant, ce sont ces mouvements très antigenres qui cherchent avant tout à priver les gens du droit fondamental de vivre et d’aimer librement, sans crainte de punition ou de violence.

Votre travail sur le genre continue de susciter des débats animés. Dans le monde francophone, ses détracteurs parlent de wokisme. Quel regard portez-vous sur cette notion et les controverses qu’elle suscite?
Eh bien, mon ouvrage Trouble dans le genre a maintenant près de 35 ans, il est donc antérieur à tout discours sur le wokisme. Je ne suis pas les débats sur le wokisme, car d’après ce que je constate, le terme «woke» n’est utilisé que comme une caricature humiliante.
Personne ne dit «je suis woke». Il me semble également que ceux qui cherchent à restreindre les changements dans la langue et à supprimer les libertés de genre soupçonnent de «censure» ceux qu’ils cherchent eux-mêmes à censurer. Je suppose que c’est une des raisons pour lesquelles il m’est difficile de suivre ce discours, car il me semble contradictoire.
Vous l’avez souligné, dans certains pays, les facultés où sont enseignées les questions de genre sont parfois menacées de fermeture, ou du moins pointées du doigt. Quel regard portez-vous sur ce climat général?
Un certain nombre de dirigeants mondiaux ont pris position contre le «genre» – Vladimir Poutine, Viktor Orbán, Giorgia Meloni, Rishi Sunak. Lorsque cela se produit, le «genre» est traité comme un raccourci désignant une force qui porte atteinte à la famille naturelle ou à la famille nationale (Orbán et Meloni ont tendance à considérer la famille nationale comme naturelle).
Très souvent, les attaques contre les études de genre visent à arrêter les mouvements sociaux dédiés aux droits féministes, gays, lesbiennes et trans, mais elles ont aussi tendance à s’opposer aux migrants et sont presque toujours nationalistes. Bien sûr, il y a des raisons pour lesquelles les gens ont le sentiment que leur monde est en train de se déstabiliser. L’économie en ruine, les guerres et le désastre climatique sont trois de ces raisons.
Il est peut-être plus facile de diaboliser ce qu’on appelle le «genre» ou de l’assimiler à des forces démoniaques que de s’occuper des problèmes structurels omniprésents produits par d’énormes inégalités économiques et l’exploitation continue des pays du Sud. Ceux qui cherchent à mettre un terme aux études sur le genre visent à profiter de la persistance des arrangements sociaux patriarcaux et homophobes, ou bien ils cherchent à rejeter la responsabilité du triste état du monde sur les communautés vulnérables et les voix critiques.
En Belgique, des animations scolaires sur l’éducation à la vie sexuelle et affective (Evras) ont fait l’objet d’une campagne de désinformation de la part de groupements conservateurs. Ces fake news ont suscité de vives réactions de parents craignant que des enfants soient initiés à la théorie du genre dès l’école primaire. Quel regard portez-vous sur ces débats?
Soyons clairs: il n’existe pas de «théorie du genre». Le domaine des études de genre est complexe et comprend une variété d’approches du sexe et du genre – ainsi que de leurs interrelations. Quand quelqu’un parle de «théorie du genre» comme s’il s’agissait d’une idéologie singulière, c’est qu’il n’a pas vraiment étudié le domaine.
Ceux qui le font contribuent à construire un fantasme, ignorant des décennies de recherches et de débats sur ce que pourrait être le genre et comment nous devrions le penser. Les cadres psychanalytiques, intrinsèquement divers, ne concordent pas toujours avec les cadres matérialistes, et les biologistes du développement ne sont pas toujours d’accord avec les déterministes génétiques.
Les débats sont complexes et intéressants. La salle de classe est un lieu où les élèves peuvent commencer à se poser des questions sur leur vie, sur les présupposés qu’on leur a demandé d’accepter, et à trouver leur propre voie. La salle de classe doit être un lieu où un jugement éclairé et autonome peut être cultivé.
Parmi les propos qu’on vous reproche, on retrouve la remise en question de la réalité biologique de la distinction entre les sexes. Simone de Beauvoir soutenait que le genre est une construction socioculturelle mais admettait néanmoins la réalité naturelle de la distinction sexuelle. Tandis que vous, vous allez plus loin: vous soutenez que même le sexe est une construction sociale.
En fait, je m’intéresse aux modèles dits «coconstructionnistes», qui montrent comment la biologie et la culture s’informent et se transforment mutuellement. Je pense que nous devons réfléchir plus attentivement à la manière dont cette interaction se produit et aux conséquences que cela entraîne pour ceux d’entre nous qui instaurent trop facilement une frontière entre nature et culture. Je poursuis cela dans mon prochain livre.
Vous avez signalé par le passé quelques approximations dans la traduction de la version française de Trouble dans le genre. Est-ce une des raisons de certains malentendus?
Malheureusement, la réception francophone se réduit souvent à une lecture individualiste du genre. Les lecteurs francophones ont souvent supposé que tout était une question de choix individuel. Cela dit, personnellement, je prends très au sérieux l’idée de «situation» de Simone de Beauvoir. A savoir, quels que soient nos choix, ils sont conditionnés et limités par l’histoire, les normes historiques, et le changement peut souvent être difficile, car il implique des luttes à la fois psychiques et sociales.
Les changements historiques dans les normes et pratiques de genre sont entrepris par de nombreuses personnes de toutes langues et régions, liées les unes aux autres par l’espoir d’une vie plus vivable. L’idée selon laquelle le genre est «construit» peut être interprétée de plusieurs manières. Dans la réception française sceptique, il a été considéré comme «inventé» plutôt que comme quelque chose de «complexe». Si c’est «inventé», alors c’est une envolée de fantaisie, quelque chose de fictif ou de faux. S’il est «créé» par une interaction complexe de nombreuses forces, alors il s’agit de quelque chose qui demande un peu plus de patience pour y réfléchir et le comprendre dans le cadre d’une réalité vécue.
Il a fallu attendre quinze ans avant que Trouble dans le genre soit traduit en français. En Allemagne, par exemple, il a été traduit dès l’année suivant sa parution. Comment expliquez-vous cet accueil tardif dans le monde francophone? Selon vous, que révèle-t-il?
J’ai travaillé avec différents types et différentes sources de textes théoriques, sauf que la plupart dans le monde francophone s’attendent à ce qu’un auteur représente une seule école de pensée. L’ouvrage va à l’encontre de certains modèles de «différence sexuelle» et ne correspond pas aux paradigmes existant de la vie intellectuelle francophone (même s’il s’inspire en partie de penseurs français).
Les mouvements sociaux et de jeunesse qui revendiquent vos théories sont souvent critiqués pour avoir pris un virage identitaire dans leurs revendications et représentations. D’ailleurs, on parle souvent d’«identité de genre». Pourtant, dans Trouble dans le genre, vous insistez sur le «devenir», sur la pluralité des identités, sur le fait que l’identité n’est pas figée. Y a-t-il ici également une mauvaise interprétation ou un détournement de votre pensée?
En fait, je n’ai jamais été très intéressée par l’identité. D’ailleurs, le sous-titre de Trouble dans le genre est «la subversion de l’identité». Je m’intéresse aux subversions qui se produisent lorsqu’on est appelé ou assigné à une certaine identité, mais que finalement on se définit d’une autre manière.
Le changement historique peut se produire à travers ces formes fécondes de réappropriation. Pour trouver notre chemin dans la vie, nous nous appuyons souvent sur des catégories que nous n’avons jamais créées. Cela ne veut pas dire que nous les recréons, mais que nous luttons avec leur histoire.
Le féminisme intersectionnel a eu un rôle important dans la réflexion sur le droit.
Que ce soit dans le monde universitaire ou au sein de certains mouvements politiques, la question du genre est désormais liée à celle de la «race» et de la «classe sociale». On parle d’«intersectionnalité». Cette approche est parfois critiquée pour son manque de cohérence intellectuelle: par exemple, selon ses détracteurs, les luttes des femmes ne vont pas forcément de pair avec celles des travailleurs précaires. Que vous inspirent ces critiques?
Le féminisme intersectionnel a eu un rôle important dans la réflexion sur le droit. Comment les femmes victimes de discrimination sexuelle peuvent-elles intenter une action en justice alors qu’elles subissent en même temps une discrimination raciale? Trop souvent, ces catégories sont considérées comme distinctes les unes des autres, mais elles travaillent constamment ensemble.
En Europe, j’ai parfois entendu «intersectionnel» comme un raccourci pour «race», mais le domaine des études ethniques et raciales comprend un large éventail de méthodologies. L’approche intersectionnelle, bien que très importante, n’est qu’une de ces théories. Bien sûr, il existe de nombreuses tensions sur le terrain. Ces tensions sont au centre du travail universitaire de nos jours.
Parfois, les critiques viennent de votre «propre camp idéologique». Certains regrettent que les questions sociétale, de sexe et de genre, aient pris le pas et relégué les questions sociale et économique et celle, disons, de la lutte des classes. Que répondez-vous à cela?
Je pense que nous devons réfléchir ensemble aux questions économiques et de genre. J’ai l’impression que de nombreuses femmes victimes de discrimination fondée sur leur sexe se retrouvent dans des situations économiques précaires.
On peut se demander, avec le penseur Stuart Hall, comment on vit sa situation de classe. Cela se vit différemment selon la sexualité, le sexe et la race. Peut-être que certains de mes critiques qui prétendent que la question sociale est primordiale et que tout le reste est secondaire ont raison d’être frustrés par mes opinions. Je m’intéresse à la façon dont ces questions se rejoignent dans l’histoire d’une vie d’une histoire et d’un monde. Je considère les idéaux socialistes comme étant au cœur de mes idées d’égalité et de liberté.
Venons-en à la situation au Proche-Orient. Vous avez publié un article, très remarqué et commenté, «Condamner la violence». Qu’entendez-vous par cette formule?
Il est important de réfléchir à nos premières réponses, les plus spontanées et les plus viscérales. Je suis juive et j’ai réagi avec horreur au meurtre de civils israéliens. J’ai condamné cela, mais j’ai dû me demander si, dans le feu de l’action, j’omettais de voir l’horrible violence infligée aux Palestiniens, dans le passé et à l’heure actuelle.
Ma tâche dans cet article était de montrer comment une compréhension (NDLR: son insistance sur cette notion lui a été reprochée) plus large de la violence est possible et d’avancer des hypothèses sur l’avenir de la non-violence face à l’assaut militaire israélien et à la résistance armée.
Ici, mais aussi dans l’article, vous insistez sur la notion de «compréhension». Comprendre ne veut pas dire justifier, insistez-vous…
Nous pouvons étudier l’histoire d’Israël en tant que nation coloniale, avec ses formes de violence, et nous pouvons également étudier la dépossession des Palestiniens et l’histoire de la violence qu’ils ont endurée. Nous devons comprendre une situation historique afin de développer une position à la fois éthique et politique.
Sinon, nous nous appuyons sur nos réactions instinctives, nos impulsions ou tout autre sentiment organisé pour nous par les médias. Je suis favorable à une réflexion éclairée sur ces questions, en prenant le temps d’apprendre l’histoire de la Palestine. Autrement, nous basons nos jugements sur des idées préconçues et mal informées, et cela ne créera pas un avenir meilleur.
Vous écrivez que nous devons «savoir quelles sont les formes de vie qui pourraient libérer la région de violences comme celles-ci». Justement, lesquelles selon vous?
Je pense qu’il est évident que maintenir des millions de personnes dans des conditions d’occupation militaire n’est pas un arrangement qui peut, ou doit, être normalisé. La fin de l’occupation et le début de l’autodétermination politique palestinienne sont, à mon avis, les conditions d’un avenir non violent dans la région.
«Personnellement, je défends une politique de non-violence», écrivez-vous encore. Que pourrait être une politique de «non-violence» dans le contexte du conflit au Proche-Orient? N’est-ce pas une position difficile à soutenir dans le contexte actuel?
Je crois que nous devrons nous attaquer aux racines du problème dans le sionisme, dans l’occupation, dans le déplacement forcé de millions de personnes pour que les gens qui vivent sur ces terres puissent commencer à construire un nouvel avenir – une forme politique de cohabitation qui ne pourra se produire que lorsque les relations coloniales prendront fin complètement.
Lire aussi : plus sur le conflit Israël-Hamas
Bio express
1956
Naissance à Cleveland, dans l’Ohio.
1984
Docteure en philosophie à l’université Yale (Connecticut).
1990
Publie son ouvrage majeur Gender Trouble.
1993
Professeure de philosophie à l’université Berkeley (Californie).
2015
Docteure honoris causa de l’ULiège.
2024
Publie Qui a peur du genre? (Flammarion).
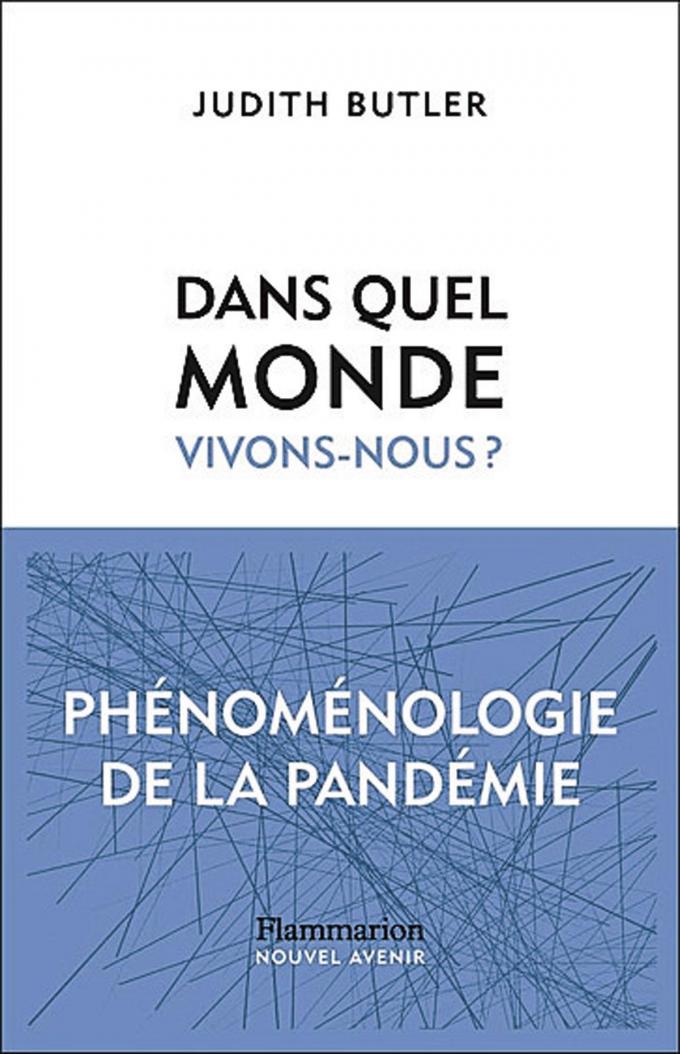
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici