
Frédérique de Vignemont: «Arrêtons d’accommoder le corps à toutes les sauces!» (entretien)
Alors qu’il est l’objet de toutes les attentions, la philosophe Frédérique de Vignemont alerte : « Il faut laisser le corps tranquille! » Et le laisser se gérer lui-même.
Le corps est à la mode. C’est tendance. Pour s’en convaincre, il suffit de pointer les abondantes palabres dont il fait l’objet. Magazines féminins, manuels de développement personnel et influenceurs s’en emparent à souhait. Au milieu de cette unanimité, et à rebours de cette fétichisation ambiante du corps, la philosophe Frédérique de Vignemont détonne. «Il faut laisser le corps tranquille», fustige-t-elle et dégonfle, sans se payer de mots, les mythes entourant le corps et le dévoiement de pratiques méditatives qui confinent parfois à un marketing du bien-être corporel.
Le ton est sec, mais dans Désenchanter le corps (Odile Jacob, 2023), son propos est solidement argumenté et étayé. Puisant au meilleur de la philosophie de l’esprit et des sciences cognitives, de Descartes à Maurice Merleau-Ponty, c’est à un remarquable effet d’éclairage sur notre rapport au corps que parvient cette philosophe discrète mais dont l’essai est salutaire par les temps qui courent.
Vous vous proposez dans cet ouvrage de «désenchanter le corps» et de «le laisser tranquille». Qu’entendez-vous par là?
J’avoue qu’avec le recul, je ne suis plus aussi convaincue par le titre du livre. Il trouve son origine dans les propos du sociologue Max Weber au début du XXe siècle pour décrire le recul des croyances religieuses face à la science. Dans mon ouvrage, je m’appuie en effet sur les sciences cognitives pour remettre en question un certain nombre de mythes sur le corps. Mais ce n’est que dans la maladie que le corps est littéralement «désenchanté». A l’inverse, on peut aussi voir dans les sciences cognitives une manière de le réenchanter, en montrant qu’il est bien plus qu’un morceau de chair et de sang. La richesse des expériences que nous en avons, sa relation unique à la conscience de soi et sa malléabilité pour s’adapter ne sont que quelques-unes de ses fascinantes facettes.
Vous insistez sur la capacité de notre corps à s’autogérer…
Je montre avec quel talent le corps se gère lui-même la plupart du temps sans avoir besoin de nous, qu’il s’agisse d’autoréguler son rythme cardiaque ou de descendre des escaliers. Prêter attention à notre corps en pleine action peut, par contre, nous rendre maladroit. Si notre intervention consciente est requise, le corps nous le fait comprendre à travers la fatigue ou la douleur, mais s’il reste silencieux, alors ne perturbons pas cette machinerie bien huilée.
C’est lui que nous blâmons pour notre mal-être et c’est à lui que nous nous adressons pour nous sauver.
Quel a été le point de départ de votre réflexion? Y a-t-il eu un déclic précis? S’agit-il de votre rapport, un peu maladroit comme vous le confessez, à votre propre corps ou s’agit-il d’une volonté d’analyse de la place prééminente qu’il occupe dans les guides de développement personnel?
Lorsque j’étais étudiante en philosophie, j’avais envisagé de recommencer mes études pour faire médecine. J’étais attirée en particulier par la psychiatrie et la complexité de l’esprit humain. Mon incapacité à me détacher de la souffrance des autres m’avait fait hésiter, mais je suis toujours restée fascinée par la multitude des troubles possibles du psyché qui remettent en cause tout ce que nous prenons pour évident. Or, s’il existe une chose que nous tenons pour acquise, c’est «ce bon vieux corps toujours là», comme le formulait le psychologue américain William James au XIXe siècle. En lisant des études de cas en neurologie et en psychiatrie, j’ai découvert qu’il pouvait nous devenir totalement étranger. Ainsi, les patients souffrant de somatoparaphrénie ne reconnaissent plus leur propre main comme la leur et l’attribuent à une tierce personne ; ceux souffrant d’héminégligence oublient la moitié de leur corps, ne se coiffant, rasant ou maquillant que d’un côté. Dans l’autotopoagnosie, ils ne savent plus où se situe leur coude, genou ou oreille. Comment est-il possible de se perdre dans son propre corps? J’avais besoin de comprendre.
Lire aussi | Ces parties du corps… vouées à disparaître?
Que ce soit dans les magazines ou les manuels de développement personnel, le corps suscite aujourd’hui un large engouement et intérêt. De quoi cette «corps mania» est-elle le signe?
Que cela soit à travers la diététique, les livres de «self-help», les applications de méditation en dix leçons ou qui mesurent notre consommation de calories, le corps est accommodé à toutes les sauces. Je pense que cela reflète un mal-être général face à de trop nombreuses crises mondiales, qu’elles soient écologiques, financières ou géopolitiques. Un besoin de contrôle sur la seule chose qui nous appartient véritablement dans un monde où l’on se sent globalement impuissant. Ou encore une population qui vieillit avec bien plus de temps libre à occuper. Peut-être est-il aussi plus facile de réguler sa respiration que de chercher à comprendre l’origine de ses inquiétudes et angoisses.

Justement, vous portez un jugement sévère sur un certain nombre de pratiques à la mode qui visent le bien-être du corps comme le «balayage corporel» (body scan), le yoga et d’autres formes de méditation. Que leur reprochez-vous précisément?
Je ne reproche rien aux pratiques elles-mêmes, je suis simplement critique du discours qui les entoure. Alors que, pour beaucoup, elles trouvent leur origine dans une quête spirituelle, elles sont devenues un produit de consommation grand public auréolé de mille promesses. J’oppose à ce marketing une approche scientifique, telle qu’elle est mise en valeur par les conférences Mind and Life avec le dalaï-lama, par exemple. Cette approche vise à évaluer les effets réels et à comprendre les mécanismes sous-jacents. Ce qu’on constate alors, c’est que chaque pratique a ses spécificités et, alors que certaines se focalisent sur le corps, c’est loin d’être le cas pour toutes. Si on limite notre champ de recherche aux plus incarnées, qui sont probablement celles les plus mises en avant dans notre société occidentale, on réalise vite qu’elles ne sont pas une panacée universelle, contrairement à ce que certains affirment. Les résultats d’études à grande échelle montrent, en effet, qu’elles permettent d’améliorer notre faculté de concentration, pas notre capacité à nous mettre à la place d’autrui. Quant à leur rôle pour la régulation émotionnelle, les résultats sont mitigés. Certes, les personnes disent ressentir moins de stress, mais physiologiquement, tous les indicateurs associés à l’anxiété restent présents. L’effet paraît donc n’être que superficiel. Des formes de méditation plus cognitives, reposant sur un travail interne mental, semblent plus efficaces.
Revenons aux mythes sur le corps dont vous parliez précédemment. Vous dites que chaque époque crée les siens, et que la nôtre a érigé le corps en héros. En quoi consiste la mythologie actuelle autour du corps?
Nous sommes constamment victimes de modes passagères pour notre bien-être. Elles ne laissent que peu de traces et, surtout, demeurent superficielles. Un mythe, au contraire, est un récit fondateur qui touche à l’essentiel, à savoir qui nous sommes. Il fut un temps où nous cherchions des réponses dans les dieux. De nos jours, notre regard ne se tourne plus vers les étoiles, mais vers notre propre corps. C’est lui que nous blâmons pour notre mal-être et c’est à lui que nous nous adressons pour nous sauver. Car c’est lui qui permettrait d’expliquer tant nos émotions que nos pensées. Il existe ainsi, depuis une trentaine d’années, un courant de pensée dit de la cognition incarnée, proclamant que chacune des capacités de l’esprit dépend de notre corps. La cause de notre agressivité ne serait plus Arès, le dieu de la guerre dans la mythologie grecque, mais nos signaux viscéraux. Si le corps peut tout expliquer, s’en occuper devient la clé de tous nos problèmes. Mais pas plus que les dieux grecs, nos organes internes suffisent à rendre compte de notre vie mentale.
Mais vous écrivez également que «paradoxalement, nous semblons aussi montrer un certain mépris pour notre corps».
Notre mode de présence au monde est devenu de plus en plus désincorporé et virtuel. On peut ici, bien entendu, citer les jeux vidéo, où l’on incarne avec grande facilité des avatars qui n’ont que peu de points communs avec notre corps physique. Mais les gamers sont-ils pires que les autres? On voit ainsi des collègues s’envoyer des e-mails plutôt que frapper à la porte du bureau d’à côté, des enfants passer des coups de fil à leurs parents âgés plutôt que d’aller leur rendre visite, des lecteurs souscrire des abonnements numériques plutôt que d’acheter leur journal chez le libraire, et ainsi de suite. Sans parler du télétravail de plus en plus apprécié et des réseaux sociaux… Ce qui est paradoxal, c’est que pendant la pandémie, nous avons souffert de cette désincarnation. Est-ce parce qu’elle nous était imposée, et non librement choisie? Ou parce qu’il existe un seuil à ne pas dépasser? Dans mon livre, je retrace l’origine de notre frustration à l’époque du confinement dans la perte du sentiment de présence d’autrui. Je défends l’idée que ce n’est qu’à travers le sens du toucher, la possibilité du contact physique, que l’on fait l’expérience de la réalité de l’autre.
A propos du rapport à autrui: en quoi cette attention soutenue au corps peut-elle provoquer un repli sur soi, sur son propre nombril, et provoquer ainsi une carence dans l’attention à l’autre et l’ouverture sur l’altérité?
On pourrait répondre que prendre soin de soi permet de mieux prendre soin des autres. Une étude en psychologie sociale a montré que si une personne vous sourit dans la rue juste avant qu’une autre vous demande de financer une action humanitaire, vous êtes plus susceptible de donner de l’argent. En bref, si vous êtes épanoui, vous pouvez vous tourner vers les autres. Le problème est qu’à partir du moment où on se focalise sur son corps, on risque de ne jamais s’arrêter. Notre cerveau reçoit un nombre incalculable de signaux qui doivent normalement rester inconscients. En dirigeant notre attention sur eux, nous pouvons mal les interpréter, leur donner une importance exagérée et partir dans une quête vouée à l’échec pour atteindre un corps «parfait». Le souci de son propre corps devient alors une fin en soi. On entend ainsi certains discours qui revendiquent l’égoïsme comme un droit inaliénable: «Il faut bien que je m’occupe de moi!» Mais rappelons ici qu’une manière de s’occuper de soi-même est en fait de s’occuper des autres. Il ne s’agit plus de voir un passant nous sourire, mais de lui sourire nous-même. Une méthode très efficace pour se sentir mieux.

Dès lors, comment se connecter avec son corps sans se déconnecter du monde extérieur?
Le problème trouve son origine dans les limites fondamentales de notre esprit. Un des enjeux principaux de notre vie mentale est celui de l’attribution de ressources cognitives, car nous ne pouvons faire attention qu’à un certain nombre de choses à la fois. La conséquence est immédiate: si nous nous focalisons sur une dimension de notre vie, cela doit se faire aux dépens d’une autre. Il existe donc un risque que le temps et les ressources mentales investis pour s’occuper de son corps se fassent au détriment d’autres préoccupations potentielles. Mais cela n’est le cas que si le corps est une fin en soi. Or, c’est oublier là que le corps est avant tout un moyen, et non une fin. Un medium qui nous permet de percevoir et d’agir sur le monde. Prenez le simple exemple de jouer d’un instrument de musique ou de pratiquer un sport. Si vous n’êtes pas connecté avec votre corps, il y a peu de chance que vous soyez doué. Pour autant, votre corps reste à l’arrière-plan car ce qui comptera à la fin, ce sera le plaisir de la musique ou la camaraderie avec les autres joueurs.
Emprisonner un corps ne permettra plus de priver l’esprit de tout contrôle.
Dans quelle mesure cette attention soutenue au corps est corrélée à l’individualisme qui caractérise notre modernité?
On peut envisager que l’individualisme de notre époque nous pousse vers le corps. En tout cas, il nous pousse vers une conscience aiguë de nous-même, et de là, il n’y a qu’un pas pour qu’elle se transforme en conscience de notre corps. Mais il ne faut pas oublier que la méditation trouve son origine dans une philosophie orientale qui affirme que le soi n’existe pas, qu’il n’est qu’une illusion. Comme le formulait le philosophe écossais David Hume – qui faisait appel seulement à l’introspection – en se concentrant sur son flux de conscience, on ne trouve jamais qu’un ensemble de sensations, jamais le soi en tant que tel. Ce bref rappel historique nous montre que l’attention au corps ne nous condamne pas à une forme d’individualisme. De fait, dans la tradition bouddhiste, les pratiques méditatives s’accompagnent d’un entraînement à la compassion: la conscience de soi s’efface pour laisser place à une pleine conscience de l’autre.
Il y a un peu plus d’un demi-siècle, le corps fut porteur d’espoir et de promesses d’émancipation: on pense aux mouvements féministes, par exemple, à quelques aspirations et slogans de Mai 68 («Jouir sans entraves»). Quel regard portez-vous, quelques décennies plus tard, sur ces espoirs?
Des décennies plus tard, le corps des femmes est malheureusement toujours victime d’oppression, et même si dans nos sociétés occidentales les enjeux politiques ne sont plus exactement les mêmes, ce n’est pas le cas partout. Dans mon livre, j’ai essayé de dépouiller le corps de toutes les strates de croyances auxquelles chaque époque a donné naissance, afin de retrouver un rapport atemporel et apolitique à notre dimension incarnée. Je défends ainsi l’idée qu’il existe un niveau fondamental où nous nous représentons notre corps de la même manière, qu’il s’agisse de la femme du XIXe siècle, de celle de Mai 68 ou de moi-même. Une telle approche a nécessairement ses limites, nous ne pouvons jamais être assurés que notre regard n’est pas influencé par la société dans laquelle nous vivons. Mais nous avons toutes mal, faim ou soif. Nous nous nourrissons, dormons, marchons. Nous voyons notre réflexion dans un miroir, frissonnons de froid, sentons le contact de nos vêtements. Et nous devons protéger notre corps pour survivre. Vous pourriez m’objecter que ce sont là les aspects les plus triviaux, mais j’estime que ce sont au contraire les éléments fondateurs sur lesquels se construit la conscience de soi.
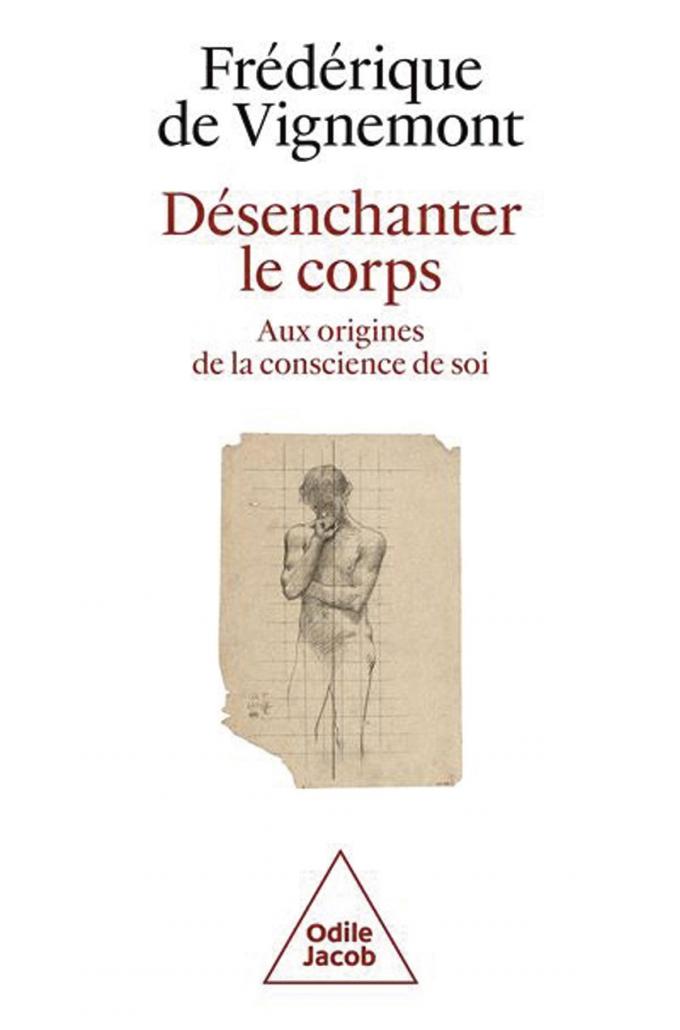
En parlant de politique, dans quelle mesure le corps peut-il être l’objet d’enjeux politiques? On pense, notamment, aux travaux du philosophe Michel Foucault qui a démontré l’importance pour les gouvernements de discipliner et contrôler les corps.
Chez Foucault, c’était surtout l’idée de contrôler la capacité à agir de l’individu, plutôt que le corps lui-même. Cela s’appliquait parfaitement à une époque ancrée dans un monde physique où toute action impliquait le corps. On constate que certains gouvernements fonctionnent toujours sur ce principe. Mais si nous prenons le cas de notre société occidentale, ce n’est plus vrai. Notre monde est devenu principalement virtuel et notre capacité à agir va bien au-delà de ce que notre corps nous permet de faire. Avec le développement des interfaces homme-machine, cela sera de plus en plus le cas. Il est d’ores et déjà possible pour des patients complètement paralysés souffrant du syndrome locked-in d’écrire un e-mail ou de contrôler un bras robotique à distance par la seule force de la pensée. Emprisonner un corps ne permettra donc plus de priver l’esprit de tout contrôle. Cela ne signifie pas qu’il n’existe plus d’enjeux politiques qui entourent le corps, seulement qu’ils ont évolué car nous fonctionnons sur un mode de plus en en plus désincorporé.
Historiquement, la tradition chrétienne est méfiante face au corps. Comment s’est brisé ce tabou et quand le corps est-il devenu le centre des attentions, parfois même fétichisé et divinisé?
Notre corps est ce qui nous rapproche le plus des autres animaux. Or, on a longtemps pensé que ces derniers n’étaient que des «brutes» dénuées d’âme. Les fonctions vitales n’avaient rien de noble et il valait mieux les passer sous silence. Mais à trop vouloir se concentrer sur les hautes sphères de l’esprit, on finissait par aboutir à une conception désincarnée de l’être humain, similaire à un ordinateur. Or, personne n’est attiré par l’hypothèse de n’être qu’un cerveau dans une cuve connectée à des machines, comme l’imaginait le philosophe américain Hilary Putnam dans les années 1970 ou le film Matrix. Le problème est que nous sommes partis dans l’autre extrême, nous focalisant totalement sur notre corps, oubliant ainsi la marque de notre humanité, ce qui fait que nous ne sommes pas des animaux comme les autres. Tous les mammifères ont à peu près les mêmes systèmes digestif, respiratoire, cardiaque… Mais très peu sont capables de raisonnements scientifiques, d’empathie ou de créativité artistique.
Pendant longtemps, à l’Antiquité comme au Moyen Age, ce fut plutôt l’esprit qui attirait toute l’attention au détriment du corps. Comment expliquez-vous ce glissement vers le corps? La modernité aurait-elle un peu cédé à la facilité?
Le corps a rarement laissé indifférent et chaque époque a connu ses détracteurs, mais aussi ses avocats. Même Descartes, connu pour sa célèbre affirmation «je pense, donc je suis», défendait aussi l’existence d’un rapport unique au corps. Selon lui, le soi ne lui reste pas externe, tel le pilote d’un navire, il forme avec lui une unité inaliénable. Nietzsche, Schopenhauer, Merleau-Ponty et bien d’autres ont ainsi défendu l’importance de notre incorporation. On a reproché à une philosophie d’origine anglo-saxonne de négliger notre dimension incarnée en faveur du langage, mais de nouveau, cela n’est pas vrai. Au siècle dernier, la philosophe Elizabeth Anscombe, par exemple, a montré que la connaissance que nous avons de notre corps n’était pas comparable à celle que nous avons d’autres objets. La question, à la fin, n’est donc pas pour ou contre le corps. Elle est d’en comprendre le rôle exact et c’est là où l’on peut céder à la facilité, en proposant une réponse trop rapide et, surtout, trop radicale. Face aux slogans chocs, la philosophie prend toute son importance, en invitant à remettre en cause nos intuitions par une analyse systématique, éclairée par une science en progrès constant.
Bio express
1976
Naissance, à Lyon.
2002
Doctorat en philosophie à l’EHESS.
2002-2003
Postdoctorat à la New York University (boursière Fulbright).
2005
Chercheuse du CNRS à l’Institut Jean Nicod (Paris).
2015
Reçoit le prix Young Mind & Brain.
2018
Publie Mind the body (Oxford University Press).
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici