
Cynthia Fleury : «Plus on est malmené dans sa dignité, moins on a confiance dans l’Etat de droit» (entretien)

Après s’être penchée sur le courage, le soin ou le ressentiment symbole de notre époque, la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury s’interroge dans son essai La Clinique de la dignité (1) sur l’augmentation des situations d’indignité, observée notamment au sein des professions dont l’épidémie de Covid avait pourtant remis en exergue l’importance. Autre paradoxe, cette dégradation se manifeste alors que le respect de la dignité a rarement été aussi développé puisqu’il s’étend désormais au vivant et à la nature. Comment remédier à ces atteintes qui au-delà de la santé physique et mentale des personnes, menacent l’avenir du vivre-ensemble et de la démocratie?
Il faut s’extraire de cette hyperspécialisation qui nous a menés à une situation où est banalisée la production de situations indignes.
Vous faites le constat que «la dignité comme valeur et pratique est mal en point». Comment l’expliquez-vous?
Je fais surtout le constat d’un paradoxe: la dignité n’a jamais été autant invoquée ces dernières années et pourtant, on observe une dégradation des conditions de vie dans la dignité en différents lieux. D’une part, la conscience moderne personnelle a le réflexe quasi conditionné d’immédiatement invoquer la dignité, du début à la fin de la vie, y compris en prenant en considération le non-humain (la dignité animale, la dignité du vivant), ce qui est nouveau. On pourrait presque estimer que cette revendication chevillée au corps est le marqueur de la période moderne occidentale. C’est peut-être pour cela que la dignité est sans cesse invoquée, mais pas seulement. Elle l’est aussi parce que la sensibilité à cette question est beaucoup plus forte. En ce sens, c’est une conquête de la modernité. D’autre part, on observe effectivement que les conditions de travail de certains se dégradent, que les modes dégradés de service au public se banalisent, et que de plus en plus de personnes, qui sont précisément les garants de la dignité, les fonctionnaires, les enseignants, les soignants, les magistrats, les politiques…, affirment qu’ils ne peuvent plus exercer leur métier dignement. Voilà le double constat et le paradoxe que j’essaie d’interroger. N’est-ce qu’une tolérance à l’indignité qui est beaucoup plus réduite? Est-ce le retour sous d’autres formes de nouvelles situations d’indignité? C’est une combinaison des deux.
«Les atteintes à la dignité des personnes sont devenues un mode de management commun de la société», écrivez-vous. Est-ce une des explications de la montée de l’indignité?
En tout cas, dès qu’on interroge les individus, c’est ce qui remonte régulièrement. Ensuite, bien sûr, ces données doivent être objectivées. Du mode dégradé des conditions de travail au management dégradant, il y a un glissement à évaluer plus objectivement. Pourtant, le récit «subjectif» ne peut être nié, car il est souvent la seule possibilité pour les plus vulnérables de témoigner de la pénibilité de leur situation: les patients, les personnes âgées, les majeurs dépendants font part de manière récurrente du fait qu’ils ne sont pas bien considérés, qu’ils sont malmenés par des soignants qui, eux-mêmes, expliquent que pour une série de raisons, ils ne peuvent pas faire autrement que de malmener les personnes dont ils ont la charge. Là, on est clairement face à des atteintes à la dignité. Si, parce qu’on manque de temps pour lui changer sa couche, on laisse une personne toute une journée dans ses excréments, c’est une atteinte à la «dignité des corps», dans la conscience moderne. Or, ces situations sont récurrentes. Et je ne parle même pas des lieux où la vulnérabilité est encore plus grande, comme les établissements pénitentiaires. On sait que la prison est moins une atteinte à la privation de la liberté qu’à la privation de la dignité. Il est des lieux, comme cela, où les atteintes à la dignité sont légion. Pendant longtemps, avant la révolution #MeToo, les femmes qui venaient dans un commissariat de police se trouvaient face à quelqu’un qui les mettait en défaillance alors qu’elles portaient plainte pour un viol. Elles avaient le sentiment d’être humiliées ou de subir une nouvelle atteinte à leur dignité par la dévalorisation instantanée de leur parole. Depuis #MeToo, c’est moins le cas. Mais malgré tout, cela a été une réalité. Les atteintes à la dignité peuvent être soit conscientes, par exemple par l’entremise d’un management harcelant dans une multinationale, soit inconscientes et peut-être même involontaires, comme une conséquence des modes dégradés d’un système.

Le traitement que l’on réserve souvent aujourd’hui aux candidats à l’asile relève-t-il de ce mode dégradé d’un système?
Bien sûr. Pour les personnes les plus vulnérables, c’est évident. Mais les atteintes à la dignité s’exercent aussi et sont plus courantes à l’égard des citoyens «ordinaires». Prenez simplement les personnes qui se présentent aux urgences. Ce service ne peut pas agir très longtemps sans tomber dans un mode de fonctionnement dégradé. C’est aussi le cas pour les services de pédiatrie quand survient, par exemple, une épidémie de bronchiolite. Les parents racontent à quel point ils se sentent malmenés, réifiés.
Le manque de dignité provoque des atteintes à la santé physique et mentale. Est-ce pour cela que vous parlez de «clinique de la dignité»?
C’est notamment pour cela. Les atteintes à la dignité, quand on vit un rapport d’indignité à soi-même ou quand on n’a plus la possibilité de restaurer en soi un sentiment de dignité, ont des impacts très délétères sur la santé des individus. En tant que clinicienne, mon premier travail a souvent été d’aider à restaurer ce sentiment symbolique de la dignité parce qu’il est protecteur de la santé mentale. C’est un premier point. Ensuite, ce qui se dit de la santé des individus se dit plus globalement, par métaphorisation mais aussi par dialectique, de la santé d’une démocratie, en tout cas du rapport de désirabilité à la démocratie. Plus les individus se sentent malmenés dans leur dignité, moins ils ont confiance dans l’Etat de droit et dans l’Etat social de droit. Les atteintes à la dignité ont une conséquence directement politique. Enfin, quand je parle de clinique de la dignité, je fais aussi référence à la philosophie clinique au sens de Michel Foucault (1926-1984), mais pour m’en libérer également, car cet auteur s’est davantage concentré sur la circulation du pouvoir, alors que je cherche aussi à aller au plus près des vies les plus malmenées pour tenter précisément d’avoir une compréhension active, et pas seulement de principe, de la dignité. Ce n’est pas parce que la médecine ne fait pas, selon Foucault, de clinique au sens clinicien, que cette notion même n’existe pas en tant que telle.
Pour La Clinique de la dignité, j’ai voulu mettre en lumière toutes les situations «indignes» qui aidaient à fabriquer la dignité de chacun d’entre nous. De la même façon que la philosophie du soin montre comment sont invisibilisés les pourvoyeurs de soins, il se passe quasiment la même chose avec les pourvoyeurs de dignité. La dignité des uns se construit aux dépens de la dignité des autres. Et donc, malgré tout, la clinique doit rendre visible de manière beaucoup plus forte cette dialectique entre la dignité des uns qui se construit sur le fardeau de la tâche «indigne», le sale boulot, qui est porté souvent par les plus vulnérables alors même que nous construisons notre dignité aussi parce que ce sale boulot est assumé. Et c’est aussi parce que nous n’assumons pas davantage à plusieurs ce «sale» boulot qu’il devient «sale». Donc la question, c’est comment rendre plus «digne» ce boulot qu’on juge «sale» alors même qu’il aide chacun d’entre nous à fabriquer sa dignité. Prenez la question de l’entretien des villes: celui-ci se réalise grâce à l’automatisation et à la division des tâches, comme beaucoup d’autres métiers. Cela produit certes de l’efficacité mais également de la déshumanisation, sans compter que la société rétribue mal ceux qui se chargent d’un tel entretien, et ne les reconnaît pas non plus avec un grand respect. Donc comment faire une clinique de la dignité? Certainement en impliquant davantage les «corps» des citoyens dans cette affaire du «prendre soin» des villes? Nous avons très certainement à repenser comment cet entretien peut davantage être porté par plus de citoyens, du moins à certains moments, comme une forme de citoyenneté qui consentirait à une solidarité plus «concrète» avec la pénibilité de certaines tâches dont nous bénéficions tous. Il existe dans le monde des municipalités qui «invitent» leurs citoyens à régulièrement aider à nettoyer la ville.
C’est ce «sale boulot» que la crise sanitaire avait pourtant mis en lumière…
Pendant l’épidémie de Covid, on n’a eu de cesse de dire «mais, mon Dieu, ce sont des métiers nécessaires ; ces personnes assurent un travail d’utilité publique, etc.». La crise sanitaire a porté haut le discours sur le soin. Pourtant, là encore, il suffit d’interroger les soignants pour qu’ils expliquent que rien n’a réellement changé, que la rationalisation gestionnaire est encore plus vigoureuse, qu’ils ont encore moins de temps à consacrer aux patients, que les postes ne sont plus pourvus, et qu’ils finissent par abandonner leur métier. Donc, de nouveau le paradoxe, voire la contradiction, entre d’un côté, un discours de défense de la dignité, et de l’autre une absence de «dignité en action». On est toujours dans ce grand discours. Mon livre vise aussi à remettre la lumière sur ce constat et à se demander comment on peut sortir de cette impasse et inscrire la dignité comme une charge publique commune. On fabrique tous ensemble l’indignité ou la dignité des uns et des autres.

Faut-il, par exemple, redéfinir la politique par le soin qu’elle procure aux personnes?
En tout cas, il faut réfléchir à concevoir les politiques publiques de demain à partir du terrain, à partir des vulnérabilités, à partir de la clinique du réel, et pas de manière technocratique. Cette réflexion nous permettra de disposer d’une politique publique moins «indéterminée», trop respectueuse des statistiques et pas assez de la diversité et de la complexité des situations des personnes. Elle nous permettra de créer des relations dignes, pas simplement de se payer de mots. De nouveau, nous professionnalisons, nous hyperspécialisons les tâches. Très bien. On peut le comprendre. Mais par cette hyperspécialisation des tâches, et notamment celles qui relèvent du soin aux corps dépendants ou de l’entretien des villes, nous dévalorisons ceux qui les exercent alors même qu’elles sont les matrices de la vie en société, au sens global du terme. Si on décrétait que penser ces «sales boulots» de façon aussi hyperprofessionnalisante et hypertechnocratique n’est plus possible car cela contribue à la dignité de certains et à l’indignité d’autres, se poserait toujours la question du service public mais elle déboucherait peut-être sur une réflexion quant à la place que chacun peut prendre dans l’entretien de la ville. Il ne s’agit pas de repartir dans le collectivisme. Ce n’est pas ça. Il s’agit de s’extraire de cette hyperspécialisation qui nous a menés à une situation où est banalisée la production de situations indignes.
La dignité des uns se construit aux dépens de la dignité des autres.
Avez-vous l’impression que ce genre de réflexion commence à infuser dans l’action du monde politique ou de la société civile?
Oui. C’est ce que cherche à promouvoir la notion de communs. Les communs, en l’occurrence, ce sont deux choses qui n’en forment qu’une. Un, la question des ressources, matérielles et immatérielles. Comment, demain, préservera-t-on l’eau, l’électricité…? Immédiatement corrélée à celle-ci, se pose la question d’une gouvernance ad hoc des parties prenantes liées à cette ressource. Cette gouvernance doit être fondée sur la qualité des relations entre les personnes et sur la valeur égale de la vie des uns et des autres. C’est quand même une autre façon de faire de la politique. Les politiques publiques actuelles, hypertechniques, sont très en retrait de cette aspiration. Elles sont encore trop dépendantes de tous les effets pervers de nos choix d’hyperdivision et d’hyperspécialisation du travail.
«La crise climatique s’annonce comme une clinique de l’indignité des plus retorses», écrivez-vous. De quelle façon?
Parce que «nos» crises sont désormais principalement systémiques, faussement démocratiques dans le sens où elles frappent tout le monde, mais, bien sûr, elles frappent plus fortement ceux qui sont déjà les plus vulnérables. Donc, c’est une clinique de l’indignité des plus retorses parce qu’il n’est pas impossible que le fait que tout le monde soit frappé par la crise climatique occulte le renforcement des vulnérabilités des plus vulnérables, ou le rende plus acceptable. Par ailleurs, plus la société est confrontée aux risques systémiques, plus elle recourt à de l’éthique utilitariste, populationnelle, qui s’appuie sur des statistiques, qui «score» les personnes. Autrement dit, l’éthique que nous aimons, jurisprudentielle, centrée sur la singularité des individus, est désavouée. On catégorise. Dans ce cas, soit vous rentrez sous les fourches caudines des catégories posées par l’éthique utilitariste, soit vous êtes éjecté du système. Les failles systémiques produisent des états d’exception. Et les états d’exception produisent de l’éthique utilitariste dans le meilleur des cas. Donc, oui, cela sera dur. Il faudra sans cesse se battre pour rappeler à ceux qui auront décrété les états d’urgence, les états d’exception, qu’ils ne doivent pas banaliser la déshumanisation alors que leur premier réflexe sera de procéder comme cela, au nom même de la protection biologique de la vie.
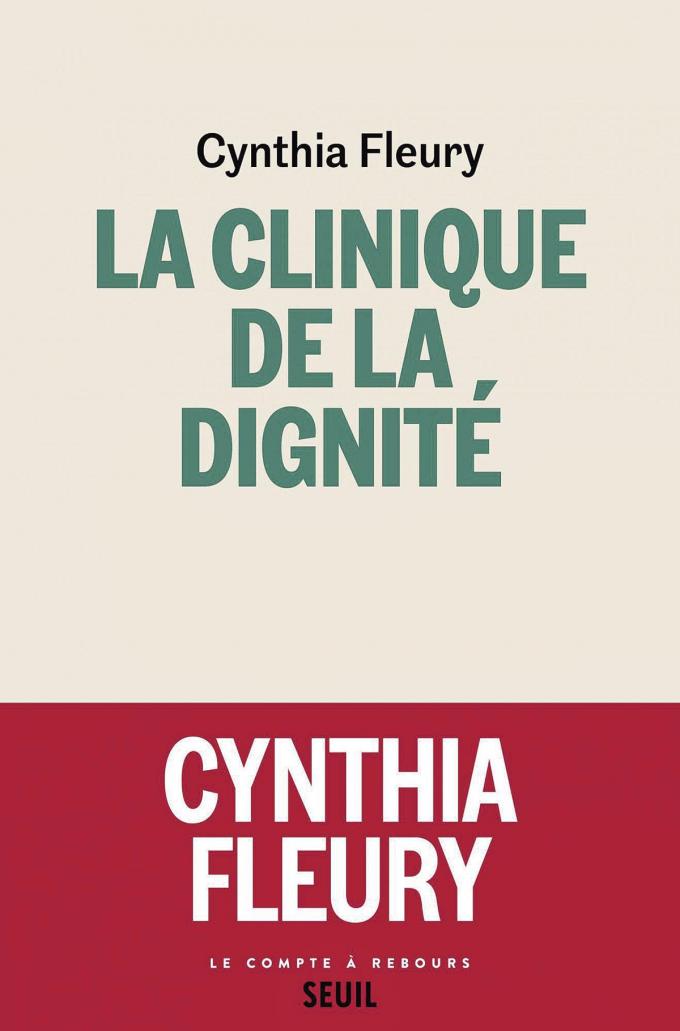
La montée des inégalités est-elle aussi un marqueur de la perte de la dignité?
Oui. Il ne viendrait à personne l’idée d’un retour à l’ancien temps, au monde antique, qui permettait une articulation entre la dignité et une société des inégalités. C’est ce que raconte la première partie de mon livre sur les âges de la dignité. Pendant très longtemps, la conception de la dignité a été corrélée à une société des inégalités. Depuis la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et en vertu de son premier article qui stipule que «tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits», plus personne, en tout cas dans les démocraties occidentales modernes, n’imaginerait séparer dignité et égalité. Donc, dès qu’un creusement des inégalités se manifeste à nouveau dans une société, cela se traduit automatiquement par une perte de dignité.
La colonisation a-t-elle été une «fabrique essentielle» d’indignité? Et aujourd’hui, le combat décolonial est-il essentiel?
Oui, parce que le combat décolonial révèle que le colonialisme n’a pas été seulement une entreprise d’exploitation des terres et de spoliation des biens mais aussi une tentative d’inculquer dans les populations colonisées l’intériorisation d’une norme d’infériorité et d’indignité. Toute colonisation est une entreprise de colonisation des esprits. C’est ce que racontent très bien Frantz Fanon, Achille Mbembe, Norman Ajari, etc… Les colonisateurs cherchaient à instiller chez les colonisés le sentiment d’une vie qui ne vaudrait jamais celle du colon.
Lire aussi | « Les politiques ne sont plus les pionniers »
Avoir le souci des autres est-il le meilleur moyen de lutter contre l’extension de l’indignité?
Respecter l’altérité, ne pas exclusivement assimiler identité et dignité, reste un premier grand viatique. Emmanuel Lévinas (NDLR: philosophe, 1906 – 1995) l’a parfaitement décrit. Seulement, il assimilait la grande figure de l’altérité à celle de la vulnérabilité. Si les «autres» sont les dominants et se conduisent de façon indigne envers tel ou tel individu, il faut pouvoir revendiquer le caractère inaliénable de la dignité de cette personne. Quoi qu’il en soit, la clinique de la dignité essaie de développer un paradigme relationnel de la dignité, une dignité en action, comme activité commune, et pas seulement comme une propriété ontologique de l’homme.
Cette action commune passe-t-elle, selon vous, par une remise en cause du système capitaliste libéral?
Oui. Nous sommes au bout du système. Nous ne pouvons pas continuer de développer une conception de la croissance aussi restrictive, qui ne se définit que par l’hyperprofit, et, en même temps, prétendre vouloir protéger des conditions dignes de travail, promouvoir les relations dignes avec autrui, assurer la conservation du vivant… Ce n’est pas crédible. A un moment donné, on se heurte à une contradiction profonde. On peut prôner une forme de croissance. Mais tout l’enjeu de l’anthropocène et du XXIe siècle sera de réconcilier la croissance avec une conception digne de la vie.
Qu’est-ce qu’une vie digne?
Une vie digne est une vie dans laquelle on ressent intimement les dynamiques individuelles – autrement dit, on y participe activement – et collectives pour rendre indivisibles des principes fondamentaux, comme la liberté, l’égalité, la fraternité. Ce n’est pas une vie sans «épreuves». C’est une vie où la traversée des pénibilités, quelles que soient leurs formes, est solidaire, inspirante, tournée vers l’amélioration des conditions de vie de chacun.
Bio express
1974 Naissance, le 7 février, à Paris.
2000 Docteure en philosophie à l’université Paris-Sorbonne.
2005 Publie Les Pathologies de la démocratie (Fayard).
2010La Fin du courage (Fayard).
2015Les Irremplaçables (Gallimard).
2017 Professeure associée à l’Ecole nationale des mines de Paris.
2019Le Soin est un humanisme (Tracts Gallimard).
2020Ci-gît l’amer. Guérir du ressentiment (Gallimard).
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici