
André Comte-Sponville, philosophe : «Arrêtons de rêver notre vie, vivons-la réellement» (entretien)

Auteur d’une trentaine d’ouvrages, le philosophe français André Comte-Sponville publie le troisième opus d’une série de recueils d’impromptus, à savoir des textes brefs qui «sont le plus souvent, malgré l’éventuelle légèreté de l’écriture, d’une tonalité quelque peu grave et mélancolique». La Clé des champs et autres impromptus (1) évoque effectivement, en douze articles, des thèmes difficiles comme l’euthanasie, les soins palliatifs, le handicap, le suicide, la mort... Pourtant, on termine leur lecture plus enclin à l’optimisme que paralysé par l’inquiétude. C’est la force du philosophe de parler du tragique tout en donnant au lecteur des raisons de toujours avancer et de vivre le plus pleinement possible. Le dernier texte de l’ouvrage, Maman, inédit, révèle quant à lui pourquoi André Comte-Sponville est devenu le philosophe utile qu’il est.
Il y a deux erreurs face à la mort, y penser en permanence et s’angoisser à l’avance, et l’oublier.
Le premier texte de La Clé des champs et autres impromptus a trait à l’euthanasie. Pourquoi êtes-vous favorable à sa légalisation?
Parce que j’aime la vie et la liberté. Quand on aime la vie et la liberté, on souhaite que la vie reste libre jusqu’au bout. Dans les Essais, Montaigne écrit: «Le plus beau cadeau que Nature nous ait fait, c’est de nous avoir laissé la clef des champs.» C’est-à-dire le droit de s’en aller. Montaigne pense que le droit de mourir, y compris volontairement, fait partie des cadeaux de la nature et, simplement, des droits de l’homme. Non pas qu’il faille privilégier le suicide. Je n’ai aucune intention de me suicider ; j’espère bien mourir de mort naturelle sans avoir besoin d’y prêter la main. Mais si je me trouve très lourdement handicapé, souffrant atrocement, ou en état de décrépitude, bref si je veux mourir, je souhaite pouvoir le faire. Des gens me disent «Mais tu n’as pas besoin de l’aide d’un médecin». Oui, je pourrais faire comme Gilles Deleuze, immense philosophe qui, à 70 ans, souffrant d’une très grave insuffisance respiratoire, a décidé d’en finir en se jetant de la fenêtre du cinquième étage de l’immeuble où il habitait. Sincèrement, qui a envie d’une mort pareille? Personne, évidemment. Donc je souhaite que la France, prenant modèle sur la Belgique, la Suisse et l’Espagne, légalise et l’euthanasie et le suicide assisté.

Doit-on réapprendre à accepter l’idée de la mort?
Je pense qu’il faut effectivement se rappeler que nous sommes mortels. Déjà, Montaigne s’étonnait que les gens fassent tout comme s’ils étaient immortels. «Ils vont, ils viennent, ils courent, ils dansent, de mort nulles nouvelles», écrivait-il dans les Essais. Sauf que quand la mort frappe leurs proches, disait Montaigne, «quelle tristesse, quel chagrin, quelle angoisse, quel désespoir, les accable». Et il concluait: «Il y faut pourvoir de meilleure heure.» Autrement dit, il faut y penser un peu plus tôt. Non pas pour s’enfoncer dans l’angoisse ou la tristesse, mais parce que si on se rappelle que l’on va mourir, on profitera mieux de l’existence. C’est la grande formule d’André Gide qui écrit dans Les Nourritures terrestres: «Une pas assez constante pensée de la mort n’a pas donné assez de prix au plus petit instant de ta vie.» Si nous pensions plus souvent que nous allons mourir, nous vivrions plus intensément parce que chaque instant serait d’autant plus précieux qu’il se détacherait, comme le dit encore André Gide, «sur le fond très obscur de la mort».
Il y a deux erreurs face à la mort: y penser en permanence et s’angoisser à l’avance, et l’oublier. Montaigne nous offre une voie dans l’entre-deux qui se résume à une des plus belles phrases de la langue française, une leçon de sagesse à elle seule: «Je veux qu’on agisse, et qu’on allonge les offices de la vie tant qu’on peut, et que la mort me trouve plantant mes choux, mais nonchalant d’elle, et encore plus de mon jardin imparfait.» Tout est dit. La sagesse, c’est d’accepter notre finitude, avec nonchalance, d’accepter notre propre imperfection, et de profiter d’autant mieux de la vie que l’on admet qu’elle a une fin.
Pendant la pandémie, s’est-on trop inquiété du sort des personnes âgées et pas assez de celui des plus jeunes?
Il fallait bien sûr s’inquiéter du sort des personnes âgées, soigner tous ceux que l’on pouvait soigner, les protéger et nous protéger nous-mêmes. Ce qui m’a ennuyé n’est pas ce que l’on faisait pour les personnes âgées, c’est ce que l’on faisait contre les jeunes. Moi qui me définis comme un héritier des Lumières, si vous m’interrogez abstraitement sur ce qui est le plus important entre l’éducation des jeunes et la santé des vieux, je n’hésite pas une seconde, c’est bien sûr l’éducation des jeunes. Or, pendant des mois, on a sacrifié l’éducation, les loisirs, la liberté des jeunes à la santé des vieux. On les a démoralisés. On les a culpabilisés. Dès qu’ils avaient le malheur de faire une fête, on les traitait quasiment d’assassins. A l’époque, mes propos avaient choqué. Je les assume très tranquillement.
A présent, ils ne choquent plus personne. Bien sûr, protégeons les plus fragiles et, en matière de santé, ce sont les plus vieux. Mais n’oublions pas qu’il n’y a pas que la santé dans la vie et que pour tout le reste, souvent les jeunes sont plus fragiles que leurs aînés. Trois exemples. Quel est le pire risque? Mourir jeune. Moi, je suis invulnérable. C’est un risque que je ne cours plus depuis déjà plusieurs années. A l’égard de la mort prématurée, mes enfants sont plus vulnérables que moi. Deuxième risque, le chômage. Je suis peinard. Je suis retraité depuis des années. Je ne cours pas le risque du chômage. Mes trois garçons, oui. Troisième risque, le dérèglement climatique. Dans trente ans, peut-être que la vie sur Terre sera difficile. Je m’en fous. Je serai mort. Mes enfants, je l’espère, seront vivants. Autrement dit, n’oublions pas qu’il n’y a pas que la santé dans la vie, et que, cette dimension mise à part, bien souvent, les jeunes sont plus fragiles que les vieux. De grâce, ne sacrifions pas l’avenir de nos enfants à la santé de nos personnes âgées. Sur le long terme, que penserait-on d’un pays qui dirait que la priorité des priorités, c’est le sort de ses octogénaires?
Un des textes de votre livre évoque la mort de votre enfant, nouveau-né, et le travail du professeur Denis Devictor, qui dirigeait le service où il a été soigné. Le médecin a ces mots: «La mort de l’enfant est la naissance de l’absurde»…
Il se trouve que nous avons perdu, mon ex-femme et moi, notre premier enfant, une petite fille, Claire, morte à six semaines d’une méningite foudroyante. Elle a été hospitalisée dans le service du jeune professeur Devictor à l’époque. D’un côté, je n’avais jamais été aussi malheureux que ces quelques jours-là, passés en bonne partie à l’hôpital. De l’autre, je n’avais jamais été aussi admiratif de l’humanité. Ce service de réanimation néonatale était un mélange de technologie, de scientificité très poussée, d’humanité, de dévouement, de fraternité... J’ai été bouleversé. C’est pourquoi quand j’ai dit que tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité mais que toutes les morts ne se valent pas et qu’il est quand même plus triste de mourir jeune que de mourir vieux, je m’étonne encore que cela ait pu choquer. Nous sommes d’accord, le professeur Devictor et moi, pour dire qu’il n’y a rien de plus atroce, injuste, absurde que la mort d’un enfant. Ce qui dit toute la grandeur du travail des pédiatres parce qu’ils sont confrontés au tragique quotidiennement.

Un autre moment tragique de votre histoire personnelle est le suicide de votre mère. Pourquoi avez-vous ressenti le besoin d’écrire un texte sur elle?
Je n’avais pas du tout prévu d’écrire un texte sur ma mère. Il y a un peu plus d’un an, j’ai été invité à l’émission La Grande Librairie, sur France 2, du temps de François Busnel. Pendant tout le début de l’émission, j’étais le seul invité. François Busnel avait choisi de m’interviewer de façon très biographique, très intimiste, notamment sur mon enfance. Quittant le plateau, je m’étais reproché d’en avoir trop dit, d’avoir été un peu impudique. Sauf que dans les jours qui ont suivi, j’ai reçu des dizaines de mails de lecteurs, et plus souvent de lectrices, me demandant dans quel livre j’avais parlé de ce que j’avais dit lors de l’émission. Dans aucun livre, leur ai-je répondu. Plusieurs m’ont dit «écrivez-le». Cela m’a paru une demande légitime parce que, bien sûr, la philosophie est un travail de pensée, de réflexion, de conceptualisation, mais enfin, on ne pense jamais qu’à partir d’un certain vécu. Et je voyais bien – je le savais depuis longtemps – que le vécu douloureux, malheureux de mon enfance n’était pas sans rapport avec ma philosophie. Quant au fond, oui, ma mère était à la fois malheureuse et dépressive. Mon enfance a été partagée entre le malheur – j’étais malheureux parce que ma mère était malheureuse – et l’angoisse – j’avais peur qu’elle se suicide puisqu’elle avait fait deux tentatives quand nous étions petits, ma sœur, mon frère et moi. Cela fait quand même un poids de gravité, de mélancolie, d’anxiété.
Comment le contexte de votre enfance vous a-t-il construit?
Toute ma philosophie, après, a servi à m’arracher à ce malheur-là. La philosophie m’a aidé à comprendre que la vie n’était pas vouée au malheur et que ma mère s’était enferrée dans un piège: à force de rêver sa vie, elle a été inévitablement déçue parce que la vie n’a jamais correspondu à ses rêves. Quand j’ai publié mon premier livre (NDLR: Le Mythe d’Icare, tome 1, Traité du désespoir et de la béatitude, Plon, 1984), qui était un appel à la lucidité et une critique de l’espérance, j’ai reçu une lettre d’un psychanalyste qui me disait être d’accord avec ma critique de l’espérance et de l’illusion parce que, ajoutait-il, «en tant que psychanalyste, je constate que l’espérance est la principale cause de suicide: on ne se tue que par déception».
Si bien que deux ans plus tard, lorsque j’ai appris que ma mère s’était suicidée, je me suis dit que ce psychanalyste avait raison. Maman s’est suicidée par déception, et parce qu’en vérité, depuis toujours, la vie ne correspondait pas aux espoirs qu’elle s’en était fait. Sauf que la vie ne correspond jamais aux espoirs que l’on s’en fait. L’erreur de ma mère, et celle de beaucoup de gens, c’est, lorsque la vie ne correspond pas à leurs espoirs, d’en conclure que c’est la vie qui a tort. Auquel cas, effectivement, le suicide est apparemment une solution. Mais qu’est-ce que cela peut vouloir dire, que la vie a tort? Pour moi, cela ne veut rien dire. Mon idée, et l’objet de mon travail depuis 45 ans, c’est l’inverse. Lorsque la vie ne correspond pas à nos espoirs, cela veut dire que ce sont nos espoirs qui, dès le départ, sont vains, illusoires, mensongers.
Comme l’a très bien compris Blaise Pascal dans les Pensées: «Ainsi nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre ; et nous disposant toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais.» Ma mère a passé sa vie à espérer vivre. Elle s’est disposée à être heureuse. Il était inévitable qu’elle ne le soit jamais. Et quand la vieillesse a rendu ses rêves de plus en plus impossibles à satisfaire, elle a décidé d’en finir. C’est pourquoi l’espèce de platitude que l’on entend sans arrêt à la télévision, en tout cas en France, m’agace toujours: «Va au bout de tes rêves.» C’est d’une niaiserie totale. La seule façon d’aller au bout de ses rêves au sens propre du terme, c‘est de se réveiller. Ce que ma mère m’a aidé à comprendre, et ce que j’aurais pu ou dû lui dire si à l’époque, j’en avais été capable, c’est «va au bout de tes rêves, ma petite maman chérie, réveille-toi».
Autrement dit, arrêtons de rêver notre vie, entreprenons de la vivre réellement, de la vivre en vérité. La vérité, pour moi, est l’outil d’une vie heureuse. Toute illusion débouche sur la désillusion. Tout espoir débouche sur la déception. Il ne s’agit pas d’interdire d’espérer. Dès que l’on a peur de quelque chose, on espère, et moi qui suis un père anxieux, je passe mon temps à espérer que tout ira bien pour mes enfants. Mais il s’agit d’espérer un peu moins, donc de craindre un peu moins, et surtout, surtout, de connaître, d’agir, et d’aimer un peu plus.
Donc «prendre mieux conscience de l’éternelle vérité de notre vie» peut nous aider à mieux accepter la mort?
Oui, c’est aussi la leçon de Montaigne, ce que j’explique dans le texte Mourir sans Dieu. Une pasteure protestante allemande, Astrid Giebel, qui dirige un ouvrage collectif à paraître, rassemblant des textes de professionnels des soins palliatifs sur l’accompagnement des mourants au plan spirituel, m’a demandé si je pouvais présenter le point de vue d’un athée. J’ai accepté parce que cela me paraissait une très belle idée. Accompagner un mourant, ce n’est pas seulement lui mettre de la morphine pour qu’il n’ait pas mal, c’est aussi être avec lui en tant qu’être humain dans cette fraternité de mortel à mortel. Je me suis demandé ce qu’un athée peut dire à un autre athée en train de mourir. Il ne s’agit pas de consoler.
Quand on meurt, il est normal d’être triste, angoissé. Si vous m’interrogez sur mon état actuel, je n’ai aucunement peur de la mort, c’est une idée qui m’est totalement indifférente. Mais j’imagine bien que le jour où mon médecin me dira «vous en avez pour quinze jours», je serai triste et sans doute angoissé. Non pas que j’ai peur de la mort parce que la mort, pour moi, ce n’est rien, donc avoir peur de rien, c’est idiot. Sauf que avoir peur de rien, c’est aussi une définition de l’angoisse.
L’angoisse, c’est une peur sans objet. Au fond, ce que j’ambitionne, ce n’est pas de mourir heureux, il est normal d’être triste quand on meurt. Ce n’est pas d’être serein, il est normal d’être angoissé quand on meurt. Ce que j’ambitionne, c’est d’accepter sereinement de ne pas être tout à fait serein, c’est d’accepter sereinement d’être angoissé et triste. Une des idées dont je pense qu’elle peut apaiser dans ce cas, c’est que la mort ne peut pas vous prendre ce que vous avez vécu. Ce que l’on a vécu est éternellement vrai. Cette essence de l’éternité relève moins de l’argumentation que de la sensibilité spirituelle, c’est ce que Proust appelle le temps retrouvé. Encore une fois, ce n’est pas une idée qui console, au sens où je n’en serai pas moins triste le jour où je mourrai. Mais il me semble que c’est une idée susceptible de procurer un certain apaisement.
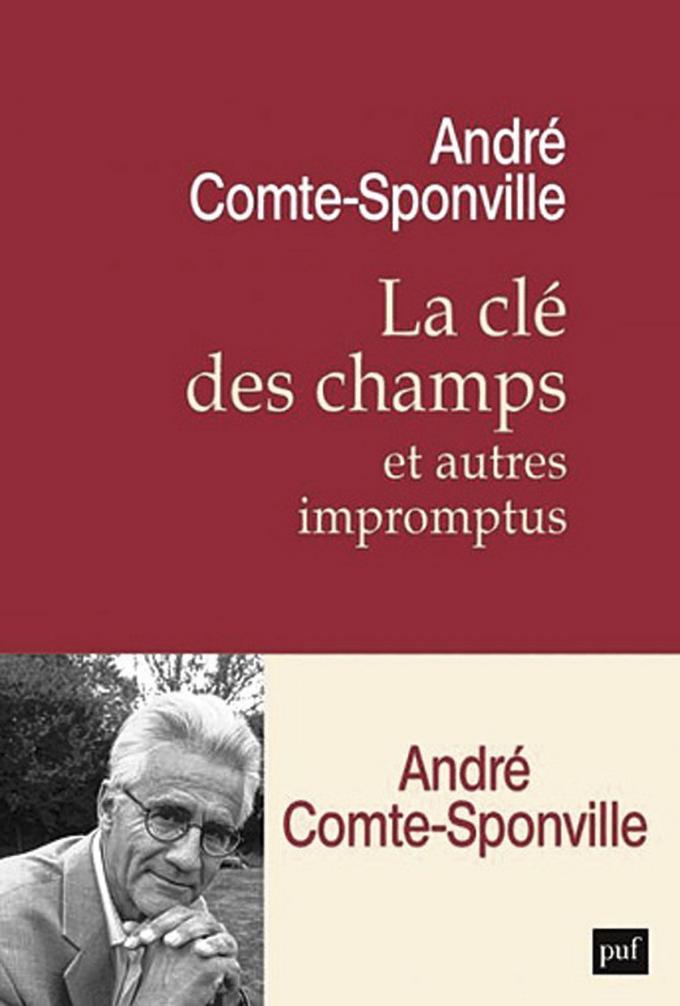
Quelles sont l’origine et la raison de votre athéisme?
J’ai perdu la foi pour de mauvaises raisons. J’étais un croyant catholique pieux et fervent. Au contraire de Michel Onfray, je n’ai rien à reprocher à l’Eglise catholique. La première raison, c’est Mai 68. J’ai été pris d’une passion politique. Je me suis réveillé d’extrême gauche le 13 mai au matin. C’est évidemment dérisoire, mais j’avais 16 ans, j’étais bouleversé par les violences policières, déjà à l’époque. Deuxième mauvaise raison, la littérature. Tous les écrivains que j’admirais étaient athées ou agnostiques: Roger Martin du Gard, André Gide, Sartre, Camus, Malraux, Aragon, René Char, Saint-John Perse… J’ai aussi de très bonnes raisons d’être athée. Je pense que les arguments allant dans le sens de l’inexistence de Dieu sont plus forts que ceux qui vont dans celui de son existence.
Je me définis comme athée non dogmatique et fidèle. Athée parce que je ne crois à aucun Dieu. Non dogmatique parce que je reconnais que mon athéisme n’est pas un savoir, personne ne sait si Dieu existe ou non. C’est une croyance. Et puis athée fidèle, parce que je reste attaché par toutes les fibres de mon être à un certain nombre de valeurs morales, culturelles, spirituelles qui sont nées pour beaucoup d’entre elles dans les grandes religions, spécialement dans les trois grands monothéismes pour ce qui est de nos civilisations, mais dont rien ne prouve qu’elles aient besoin d’un Dieu pour subsister. Néanmoins, ce n’est pas parce que je suis athée que je vais cracher sur deux mille ans de civilisation chrétienne ou sur 25 siècles de civilisation judéo-chrétienne.
Certains en France parlent d’une «décivilisation» pour décrire la situation actuelle. Partagez-vous cette vision?
La décivilisation est inscrite dans la civilisation. Le bébé qui naît est exactement le même que celui né il y a dix mille ans, au début du néolithique. C’est un petit sauvage. Il faut l’humaniser. C’est ce qu’on appelle l’éducation. On n’y arrive jamais totalement. Comme disait Romain Gary, «le barbare est en nous». On a tous un barbare en nous. C’est pour cela qu’il faut éduquer nos enfants. Mais il ne faut pas non plus exagérer. Souvent, les journalistes me demandent «qu’est-ce que vous pensez de la montée des violences?». Je leur réponds «je n’en sais rien, quand j’interroge les historiens, ils me disent qu’il y a de moins en moins de violence». Les journalistes pensent qu’il y a de plus en plus de violences ; les historiens savent qu’il y en a de moins en moins. Je pense que les historiens sont plus crédibles que les journalistes. Il ne faut pas noircir le tableau. Mais il est vrai que dans certains endroits, dans certaines cités de banlieue, certains jeunes sont tellement paumés, tellement déstructurés de l’intérieur qu’ils ne font plus de différence nette entre le bien et le mal. Et c’est un vrai danger. Si la décivilisation, c’est ça, oui, cela existe. La décivilisation fait partie de la civilisation. Raison de plus pour se battre pour la civilisation. C’est pourquoi il faut éviter de fermer les écoles, même en cas de pandémie.
Bio express
1952 Naissance, le 12 mars, à Paris.
1975 Agrégation de philosophie.
1995Petit Traité des grandes vertus (PUF).
2006L’Esprit de l’athéisme. Introduction à une spiritualité sans Dieu (Albin Michel).
2008-2016 Membre du Conseil consultatif national d’éthique, en France.
2015C’est chose tendre que la vie (Albin Michel).
2020Dictionnaire amoureux de Montaigne (Plon).
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici