


A partir de ce lundi et jusqu’à la mi-mars, les victimes passeront à la barre du procès des attentats de Bruxelles. 7h58, deux explosions à l’aéroport Bruxelles-National. 9h11, une explosion à la station de métro Maelbeek. Bruxelles vient d’être la cible de deux attentats terroristes. Dans un long format, victimes, médecins, infirmiers, pompiers, et ambulanciers racontent leur 22 mars.

Dossier réalisé par Soraya Ghali et Ludivine Ponciau – Edition finale : Nathalie Duelz – Direction artistique : Valérie Gay, Anne Fontenelle – Développement : Eglantine Nyssen – Infographies : Christophe Erhat – Photos : Hatim Kaghat

Mohamed Abrini, 31 ans, Ibrahim El Bakraoui, 29 ans et Najim Laachraoui, 25 ans, descendent d’un immeuble, situé au 4 rue Max Roos, à Schaerbeek, et montent dans un taxi à destination de Bruxelles-National. Ils insistent pour charger eux-mêmes les valises bourrées d’explosifs, de boulons, d’écrous, de vis, dans le coffre du véhicule. L’un des bagages ne rentre pas. Il sera retrouvé plus tard dans l’appartement que les terroristes occupaient. En face de l’immeuble, du matériel informatique sera également récupéré au fond d’une poubelle.


Arrivés à Zaventem, les trois hommes insistent encore pour décharger leurs énormes bagages, qu’ils déposent sur trois chariots. Durant dix minutes, ils font des allers-retours dans le hall des départs. Puis Ibrahim El Bakraoui se rend seul vers la rangée 11. Najim Laachraoui choisit les comptoirs 4 et 5, près de ceux de Brussels Airlines. A 7h58, la première bombe explose. Une dizaine de secondes plus tard, la deuxième. Mohamed Abrini abandonne son chariot qui contient la charge la plus explosive dans un coin du hall des départs au niveau de la rangée 10, et s’enfuit.


Employée au service immigration de la compagnie United Airlines, Yasmina, 30 ans, discute avec un collègue lorsqu’elle est projetée sur le sol par un souffle brûlant et violent venant du comptoir d’enregistrement voisin. Ibrahim El Bakraoui vient d’enclencher sa bombe à proximité des comptoirs d’enregistrement de Delta Airlines. Autour d’elle : des morts, parfois aux corps démembrés, des blessés qui agonisent… Le chaos. Elle parvient à se relever, quand un deuxième souffle chargé de projectiles l’atteint. C’est Najim Laachraoui qui vient d’actionner la sienne. Quelques secondes plus tard, le faux plafond s’effondre.
Elle est touchée à la jambe, à l’épaule et elle a plusieurs côtes cassées. La fumée brûlante a aussi atteint ses poumons. «Lorsque la première explosion retentit, je ne comprends pas ce qu’il se passe. A la deuxième, je sais qu’il s’agit d’une attaque. Mes oreilles bourdonnent. Autour de moi, certaines personnes sont déjà décédées. Mon regard se fige sur une femme dont la tête est fortement brûlée. J’ignore si elle est encore vivante. Mon premier réflexe est d’appeler mon frère qui travaille dans le terminal B pour lui dire d’évacuer au plus vite.»

Niek Tytgat est de garde depuis 20 heures la veille, jusqu’à 8 heures du matin ce mardi. Un peu avant 8 heures, il parle avec son collègue médecin qui prend le service de jour et Cédric, un infirmier. Leurs locaux se situent trois étages en dessous du hall des départs.
«Je sors et je vois le premier blessé. C’est un Juif religieux. Il saute, ses papillotes aussi. Il saute parce que son pied droit est presque amputé. C’est ma première image. Il est recouvert de poussière, de suie. Mon collègue prend soin du lui, moi, je pars avec l’infirmier vers le hall des départs. Rien n’est encore clair. On ne sait pas où aller. On installe très rapidement un poste médical sommaire dans la petite caserne des pompiers. On se rend ensuite au cœur, juste en face du terminal, où affluent déjà beaucoup de blessés avec l’aide des militaires et des policiers. Je n’imagine pas encore que c’est un attentat.
«C’est un Juif religieux. Il saute, ses papillotes aussi. Il saute parce que son pied droit est presque amputé.»
Oui, il y a eu une explosion. Pour moi, il pouvait s’agir d’une explosion de gaz. Nous commençons alors le triage des blessés durant une demi-heure. Entre-temps, nous avons deux alertes d’évacuation. On se cache dans le parking.»
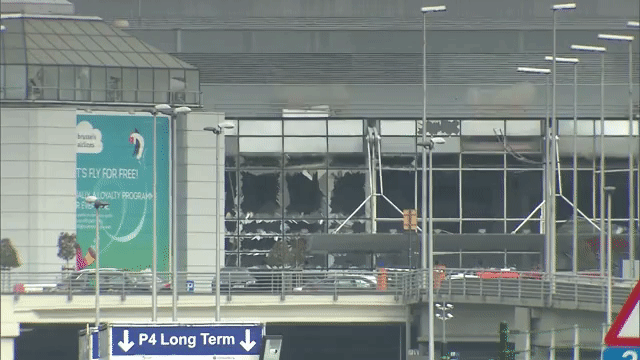



«Lorsque la première explosion se produit, on comprend que quelque chose de grave se passe. Tout à coup, on voit une foule de gens arriver dans la zone d’embarquement. C’est vraiment impressionnant, comme s’il s’agissait d’une foule de manifestants qui s’était mise à courir. Certains, ayant compris qu’une fois la zone de contrôle franchie il n’est plus possible de sortir de l’aéroport, reviennent sur leurs pas. Je vois des gens blessés. Ils essaient d’absorber le sang qui coule de leur tête avec des mouchoirs. Rien que d’en parler, j’en éprouve encore des frissons. Avec mes collègues, nous essayons de passer des appels, mais aucun moyen de communication ne fonctionne. Après une demi-heure, on voit arriver des personnes de la Croix-Rouge, puis les pompiers. Ils nous annoncent qu’un attentat a eu lieu et nous demandent de sortir sur le tarmac. On reste là pendant une heure et demie ou deux heures, je ne sais plus vraiment. Ensuite, on nous fait sortir par l’accès réservé aux livraisons. Je vois que les gens sont soulagés de se retrouver dehors, d’être sortis de là. On se soutient les uns les autres.»



«Nous sommes informés qu’un événement vient de se produire à l’aéroport. On constate très vite par nous-mêmes qu’il y a un problème, puisque la centrale de Louvain est surchargée d’appels, et que ces appels sont déviés chez nous. On cherche à comprendre ce qui se passe. Quelques minutes plus tard, on nous confirme qu’une explosion s’est produite dans le hall des départs de l’aéroport. Avec mon collègue, Christophe, nous comprenons qu’il faut agir vite. Nous mettons en place une colonne d’ambulances en renfort de celles que la centrale 112 de Louvain a déjà envoyées à Zaventem. La colonne est prête à partir mais la centrale de Louvain nous demande d’attendre.»

«Ce jour-là, je suis officier de garde. Nous sommes avisés par le centre 112 de Louvain qu’une explosion vient de se produire à Zaventem. Sur le moment même, j’imagine qu’une valise a explosé mais dans la zone réservée aux bagages, pas dans le hall des départs. Dans mon esprit, c’est forcément ça qui vient de se produire. Le 112 de Louvain nous demande d’envoyer un renfort.»
blanc
«Dans mon esprit, c’est forcément ça qui vient de se produire.»


Deux équipes Smur, des Cliniques Saint-Luc et de l’hôpital militaire, quatre ambulances et un convoi de pompiers du Siamu partent de Bruxelles vers l’aéroport. A 8h12, le premier Smur arrive à Zaventem. Dès l’annonce de l’explosion, à 8 heures, la cellule stratégique fédérale est convoquée au Centre de crise, rue Ducale. Le plan catastrophe régional est également lancé.
Quelques minutes plus tard, un poste médical avancé (PMA) sommaire est installé dans la caserne des pompiers de l’aéroport.

«Le dispatching confirme la gravité de la situation et me demande de me rendre sur place. Sur la route, j’essaie d’obtenir des détails sur la situation et demande d’envoyer un premier train de cinq ambulances. J’arrive à hauteur de la gare des bus, je ne vois pas tout de suite les dégâts qu’on peut observer de l’extérieur, comme les vitres cassées. Mais je constate que beaucoup de personnes sont rassemblées à cet endroit. Je monte à l’étage des départs sans entrer dans le hall, étant donné que mon rôle se limite à coordonner les moyens venant de Bruxelles. On me dit qu’il y a pénurie d’ambulances et qu’il y a énormément de victimes. Je demande un deuxième train de cinq ambulances, l’officier des pompiers du Brabant flamand fait de même.»


«Avec mon collègue, nous sommes évacués du hall des départs. On nous dit de rejoindre l’hôtel Sheraton, situé en face, tandis que les premières ambulances arrivent. Mon frère me rejoint. A cet instant, il y a un nouveau mouvement de panique. Une rumeur fait état de la présence d’une voiture transportant une bombe. Fausse alerte.»

«Dans la petite caserne, il y a déjà le Smur de l’hôpital militaire. Avec mon collègue infirmier, nous prenons en charge les blessés les plus graves. Nous n’avons que du matériel pour soigner deux personnes. En moins de deux minutes, ce matériel est déjà épuisé. On place les voies intraveineuses sans médicament, parce qu’on n’en a pas, mais cela facilitera le travail des collègues qui arriveront. Là aussi, nous avons deux alertes d’évacuation. On nous dit qu’il y a un tireur en train de tirer et puis qu’il y a une voiture piégée. C’est stressant. On se cache entre des conteneurs à poubelle : c’est à ce moment-là qu’on pense à ce qui se passe, à ce qu’on est en train de vivre.»

Une demi-heure après les explosions à l’aéroport, les réseaux GSM ne supportent plus les flux des appels. Les radios Astrid, réseau de communication interne aux services de secours, non plus. Or, à ce moment, la priorité est d’acheminer les blessés vers les centres hospitaliers les plus appropriés, en fonction des blessures.




Khalid El Bakraoui, 26 ans, et Osama Krayem, 23 ans, ont déjà quitté leur planque de l’avenue des Casernes, à Etterbeek. Ils portent chacun un sac à dos bourré d’explosifs et de boulons, et marchent vers la station de métro Pétillon. Osama Krayem renonce à se faire exploser et tourne les talons. Pas Khalid El Bakraoui. Arrivé à la station Maelbeek, il monte dans la deuxième rame de métro de la ligne 5. Le métro démarre. Il actionne le détonateur de sa bombe. La rame est éventrée tant le souffle est puissant. Des survivants parviennent à s’extraire et remontent à la surface, rue de la Loi.





Les premières victimes arrivent dès 8h30. En tout, près d’une centaine sont amenées à l’hôpital militaire. Les T1, les patients critiques, sont directement admis au 5e étage, qui abrite le centre des grands brûlés, ou envoyés en salle d’op. Les T2, qui demandent une surveillance plus étroite, et les T3 sont pris en charge au rez-de-chaussée, dans le grand hall d’entrée. Puis viendront celles de Maelbeek. Près de quatre-vingts médecins, infirmiers et autres intervenants sont à pied d’œuvre.
«L’hôpital m’appelle vers 8 heures, 8h05, pour m’avertir d’une explosion à Zaventem. Je doute. Je monte à l’étage et j’allume la télévision… Je saute dans ma voiture. Il n’y a alors personne sur le ring. Je roule sur trois bandes quasi vides. Sur le trajet, vers 8h30, j’ai un appel du médecin-colonel Eric Mergny, qui souhaite savoir de combien de lits nous disposons en soins intensifs. J’en ai trois, et une dizaine non intensifs. Ensuite, vers 8h40, j’essaie de le rappeler et, à ce moment-là, les portables ne fonctionnent déjà plus. Plus rien, ni les réseaux GSM ni le réseau Astrid. J’arrive à l’hôpital. Le personnel a déjà activé le « plan Mash » (Mise en alerte des services hospitaliers). Dans le hall, les tuyaux d’arrivée d’oxygène et d’air comprimé pendent déjà du faux plafond. Je prends l’ascenseur et je gagne le multisas, là où, en situation de catastrophe, on admet les patients et où se trouvent trois brancards. Puis j’arrive au monosas, un sas de déchocage (NDLR : réservé aux situations les plus graves).»
«Durant deux ou trois minutes, je suis figé»
«Il doit être 9h05. Je m’en souviendrai toute ma vie. Il y a là une jeune fille. Autour d’elle, deux anesthésistes, un kiné, un chirurgien. J’ai les yeux rivés sur les paramètres. Une tension artérielle de 66,46 et une fréquence cardiaque de 166: ce n’est vraiment pas bon. Elle est polycriblée, les membres sont fracturés, surtout sous les genoux, ses chevilles démises, elle est brûlée au décolleté et aux membres supérieurs. Elle a aussi des trous dans l’abdomen. Ose-t-on descendre au scanner ? Faut-il l’amener directement en salle d’op? Le radiologue fait une échographie. On fait de la réanimation et on va en salle d’op. Les chirurgiens ouvrent l’abdomen. Ils suspectaient fortement un saignement de la rate. C’est bien ça. On clampe l’artère et la jeune fille se stabilise. On se rend ensuite au scanner.»
«Le professionnel prend le dessus, on se dit “C’est comme en Afghanistan″ et on fait de la médecine.»
«On voit qu’elle a une fracture des 10e, 11e et 12e vertèbres thoraciques et elle a une compression de la moelle… Elle est restée paraplégique. Dans le sas de déchocage, durant deux ou trois minutes, je suis figé. Je n’imaginais pas que cela puisse arriver chez nous. Puis le professionnel prend le dessus, on se dit « C’est comme en Afghanistan » et on fait de la médecine. C’est marquant, même pour nous, de voir une jeune de 17 ans, avec ces paramètres-là, en train de mourir devant nos yeux. Ce n’est pas tous les jours que nous voyons ça. La différence avec l’Afghanistan, c’est que là-bas, on sait. On fait la guerre où il y a la guerre, des actes terroristes et on sait qu’on aura ce type de victimes. Ici, ce n’est pas la guerre, en Belgique.»


Belgocontrol annonce la fermeture de l’aéroport «jusqu’à nouvel ordre». La phase nationale du plan catastrophe est déclenchée. Le niveau général d’alerte pour la Belgique est porté au niveau 4 dans tout le pays.

«Très vite, on est dépassés par le nombre d’appels. On entend que ça parle d’explosion, de la station Maelbeek… Un convoi de secours de base est immédiatement envoyé. L’officier de la centrale vient nous trouver et nous dit: « Toi, Christophe, tu t’occupes de Zaventem, et toi, Patrick, de Maelbeek. » A cet instant, il y a eu comme un moment de stupeur. Une gifle. On nous confie une responsabilité énorme et il faut agir. Pendant une fraction de seconde, je suis perdu. Je réfléchis un instant, puis j’agis comme on me l’a appris, tout simplement. J’envoie trois Smur, cinq ambulances et je déclenche un plan d’intervention médicale. Là, je commence à me faire une meilleure idée de la situation: on m’annonce des gens avec des jambes amputées, avec des brûlures graves, dont le corps a été perforé par des vis, des clous, des boulons… On est dans du lourd. Je comprends très vite qu’il ne faut pas attendre, qu’il y a plusieurs morts et un nombre de blessés graves qui va dépasser, au minimum, la septantaine de personnes. Les personnes qui nous appellent sont en panique. Elles hurlent, expliquent qu’il y a du sang partout et de nombreux morts. C’est très compliqué pour nous de communiquer avec eux.»
«Pendant une fraction de seconde, je suis perdu.»
«Dans un second temps, on reçoit beaucoup d’appels du personnel de l’aéroport de Zaventem, dont des employés affectés à la sécurité de l’aéroport. Ce sont eux qui font les premiers garrots sur place, qui mettent les blessés dans la bonne position en attendant que les secours arrivent. On a une chance énorme que ces gens soient sur les lieux. En principe, je suis censé attendre que le Centre de crise appelle pour me donner l’autorisation de monter en puissance. Je me demande ce qui compte le plus: respecter les procédures et attendre, sachant que ça va augmenter le nombre de victimes, ou agir. Je consulte les infirmiers régulateurs qui se trouvent dans la centrale et nous décidons de monter en puissance le plus vite possible et d’appeler des renforts venant d’autres provinces. Nous entrons dans une phase fédérale. Quand j’apprends que des colonnes d’ambulances sont en route vers Bruxelles, je les envoie à Maelbeek. De cinq ambulances envoyées dès le départ, on arrive dans la demi-heure à plus de vingt.»


«Je quitte l’aéroport, où les structures d’urgence commencent à se mettre en place, pour me rendre à Maelbeek. En arrivant à hauteur de l’entrée du métro, je vois passer des victimes. Je suis marqué par l’expression du visage de l’une d’elles. Elle ne paraît pas blessée, du moins pas à première vue, mais son regard est plongé dans l’infini. Elle est là sans être là. Je suis aussi frappé par la détresse d’une dame et de son enfant, tous deux ensanglantés, qui sont pris en charge par le poste médical avancé. J’ai déjà encaissé pas mal d’émotion à Zaventem, en arrivant à la station de métro, je subis un deuxième choc. Je me mets en mode automatique pour être le plus efficace possible.
Un appel à la vigilance est lancé en raison de la potentielle présence d’une deuxième bombe dans la station. Finalement, il s’agit d’une fausse alerte. Je descends dans la station. Il y a encore une douzaine de morts dans la rame et je prends conscience de l’ampleur du drame. Deux postes médicaux avancés sont installés, rue de la Loi et chaussée d’Etterbeek. Très vite, on se rend compte qu’ils sont assez éloignés l’un de l’autre et que ça ne facilite pas la communication. Qu’il y a un genre de no man’s land entre le bas et le haut. Je vois quelques secouristes qui craquent. Ils sont assis par terre, pétrifiés.
«Je vois quelques secouristes qui craquent. Ils sont assis par terre, pétrifiés.»
C’est une intervention réellement hors norme, qu’il s’agisse du nombre de victimes ou du type de lésions. En temps normal, un ambulancier intervient sur des lieux où il y a deux ou trois victimes et est accompagné de collègues. A Maelbeek, chacun d’eux doit prendre en charge plusieurs blessés graves. Par ailleurs, nos ambulances n’étaient pas équipées pour transporter des personnes présentant ce type de blessures. On commence par organiser l’évacuation vers les hôpitaux depuis le PMA du bas, celui de la chaussée d’Etterbeek, où se trouvent la plupart des blessés graves.»


«Et sonne l’alarme Maelbeek, je pars. Il est 9h12, peut-être 9h14. Le 112 envoie trois Smur et cinq ambulances. C’est ce qui est prévu dans le plan catastrophe. Nous arrivons par en dessous du pont de la rue de la Loi, sur la chaussée d’Etterbeek. La première chose que je dois faire, c’est installer un poste médical pour accueillir les patients. Je suis là, avec mon ambulance, mon infirmier et on essaie de trouver un lieu. Je vois au loin un pub irlandais. A cette heure-là, il est évidemment fermé. L’entrée est une double porte. Difficile d’y entrer avec des brancards. Et puis un pub, ce sont de nombreuses tables, lourdes par ailleurs. Ce premier choix ne fonctionne pas. Je me retourne dans la rue et j’ai vraiment l’impression d’être toute seule en mouvement, face à un monde à l’arrêt, sur pause. Personne ne bouge. Je passe avec mon gros sac d’intervention et les gens ne bougent pas. Je cogne quelqu’un parce qu’il ne bouge pas, qu’il est dans mon chemin. Un membre de la sécurité m’indique un bâtiment de la protection civile européenne. Le hall est trop petit. Il y a les salles de réunion, aux étages.
«Les patients sur civière, inconscients, sont amenés dans notre poste médical. Tous ceux qui ont pu s’enfuir par leurs propres moyens sont sans doute rue de la Loi.»
Mais prendre les ascenseurs? C’est impossible de monter, descendre avec des patients. Et je me retrouve, finalement, à entrer dans le bureau de la sécurité. Les premiers patients arrivent. Les pompiers vont chercher les blessés dans la rame. Il est logique qu’ils empruntent une volée d’escaliers pour accéder à la rue, plutôt que les quatre volées qui mèneraient en haut, rue de la Loi. Donc, les patients sur civière, inconscients, sont amenés dans notre poste médical. Tous ceux qui ont pu s’enfuir par leurs propres moyens, le plus vite, le plus haut possible, ceux-là sont sans doute rue de la Loi.»


La décision est prise de fermer la totalité du métro bruxellois. Des passagers d’un métro en direction de la station Schuman sont évacués directement sur les voies. Toutes les liaisons aériennes sont suspendues et l’aéroport a été évacué. Les liaisons ferroviaires vers l’aéroport de Zaventem sont interrompues.


Comme de nombreux collègues, après les attentats de Paris, il avait remis dans le coffre de son véhicule son casque et sa veste d’ambulancier. Alerté par la radio d’une explosion dans le quartier européen, il tente de joindre sa compagne qui y travaille. En vain. Il fonce à sa recherche. Le 22 mars, il intervient comme volontaire.
«Le hasard fait que je me gare devant l’hôtel Thon. Ce sont des scènes de panique, la fumée s’échappant de l’entrée de la station de métro, des victimes à même le trottoir et les regards de frayeur et d’incompréhension. C’est indescriptible. Le poste médical avancé se met rapidement en place. Et puis c’est alors un flot ininterrompu de victimes. Quand j’arrive, on n’est pas nombreux. Il y a deux, trois Smur, quelques ambulances. Je me rappelle d’un pompier du centre hospitalier Paul Brien qui, avant de venir, a eu le réflexe d’emporter une caisse de Baxter. On s’organise avec les moyens qu’on a, jusqu’à ce qu’on monte en puissance et que les services Croix-Rouge arrivent. Là, on peut commencer à travailler. Une infirmière du Smur emporte à chaque fois son sac médical. C’est un réflexe, chacun travaille avec son matériel. Mais c’est difficile. Quand on a rien, on ne peut rien faire, oui, réconforter les victimes. Mais il a fallu vraiment attendre que le matériel arrive.»

«Avec les collègues, nous appelons la centrale pour proposer notre aide, ce qui est directement accepté. Nous revenons à la caserne d’Anderlecht. La circulation dans Bruxelles est déjà congestionnée. Nous prenons nos équipements dans nos casiers et nous montons dans l’autopompe pour rejoindre l’état-major. Sur le trajet, nous entendons à la radio de service qu’une procédure « flash-flash-flash » est lancée à Maelbeek. Il s’agit d’un appel à évacuer d’urgence les lieux en raison d’un danger. On sait, en effet, que certains auteurs provoquent un deuxième attentat pour viser explicitement les secours lors de leur arrivée sur les lieux.
Allers-retours
Sur place, nous déposons le matériel au poste médical avancé, à hauteur de la rue de la Loi. Sur le sol gisent déjà plusieurs victimes sur lesquelles on pratique un massage cardiaque. On est rapidement mis dans le bain et sollicités pour les massages cardiaques. Au même moment, d’autres commencent à mettre les premiers corps dans les sacs mortuaires. Avec mon collègue, nous entendons un responsable demander à qui est cette ambulance parce qu’il faut amener immédiatement des victimes à l’hôpital. Nous quittons le poste médical avancé et nous sautons dans notre véhicule. La première personne que nous prenons en charge m’a fortement marqué. Je n’ai jamais réussi à établir un contact.
«Après avoir déposé chaque victime à l’hôpital, nous revenons rue de la Loi. On se remet dans la file.»
Elle avait quelques signes de brûlures mais était totalement inconsciente. Habituellement, on stabilise le patient en attendant le médecin pour qu’il nous accompagne jusqu’à l’hôpital. Ici, on voit bien qu’il y a un danger vital: nous prenons donc l’initiative de partir seuls. Ça sort un peu de notre manière habituelle de procéder mais la priorité, ce jour-là, est de sauver un maximum de vies. Ce qui est également exceptionnel, c’est que nous sommes escortés, lors de nos trajets, par un convoi de motards. Tout ça est troublant, c’est vrai, mais on a signé pour ça. C’est notre boulot d’être au taquet. Ce n’est que quand nous avons un petit temps mort que nous prenons conscience de l’ampleur du drame. Après avoir déposé chaque victime à l’hôpital, nous revenons rue de la Loi. On se remet dans la file des ambulances pour prendre en charge un nouveau patient. Et repartir aussitôt.»


«Je fonctionne toute seule, avec mon Smur, pendant un temps qui me paraît une éternité. Il y a dix patients couchés au sol, inconscients, dont je m’occupe. Puis toute une série de patients ambulants viennent. Tant qu’ils marchent, je ne m’en occupe pas. Ils ont peut-être quelque chose de plus grave qui va se développer. Mais tant qu’ils parlent, je ne m’en occupe pas. Nous avons peu de choses, vu que nous n’avons qu’un sac d’intervention Smur. Mais, à ce moment-là, l’idée n’est pas d’aller soigner un patient après l’autre. Il y a dix patients devant moi et la seule chose que je dois faire, c’est éviter qu’ils se dégradent puis, très vite, les envoyer en salle d’op. Ces patients ont reçu des shrapnels (NDLR : des éclats d’obus), des écrous, des vis dans l’abdomen, dans la tête. Ceux-là doivent être pris en charge le plus vite possible dans un service de salle d’opération. A ce moment-là, c’est de la débrouille. Il y a une patiente qui arrive. Elle a un sac alimentaire entouré autour de son bras. Quelqu’un, dans la rue, lui avait fait une sorte de garrot. Sur place, très vite, on se dit « Qu’est-ce que j’en fais? ». Je les envoie vers les urgences, les soins intensifs, vers les salles d’opération. Au début, il n’y a aucune ambulance. Notre présence sur ce poste médical a duré moins de deux heures. Moi, j’ai l’impression que cela a duré toute la journée. Les communications avec la centrale 112 sont très, très compliquées. De mon GSM, j’ai finalement un contact avec le deck d’un junior à Saint-Pierre. J’exige que ce numéro ne serve qu’à moi. C’est mon contact avec la vie réelle. J’envoie plusieurs patients à Saint-Pierre.
«A Erasme, ils n’en ont pris qu’un seul»
Selon le principe de médecine de catastrophe, il faut envoyer les patients au plus loin (NDLR : puisque les blessés qui peuvent se déplacer se rendront au plus près et engorgeront les hôpitaux proches). Pour moi, c’est Erasme. A Erasme, ils n’en ont pris qu’un seul, pas un de plus, car l’hôpital reçoit alors les blessés de Zaventem. Là, je me sens très seule. Je me dis que même si l’endroit le plus loin ne sait pas accueillir mes patients, où vais-je pouvoir les envoyer? Puis soudain, on entend qu’il y a une explosion à Schuman, puis qu’il y a un tireur isolé rue Neuve. Je ne sais plus dire d’où venaient ces informations. Je me sens très seule, parce que, s’il se passe plein d’autres choses dans la ville, moi, je vais devoir me débrouiller toute seule avec mes patients et, au lieu de juste les stabiliser et les envoyer vers les hôpitaux, j’allais peut-être devoir les stabiliser plus longtemps. J’envoie mes patients un par un vers différents hôpitaux, à partir du moment où les ambulances arrivent pour les prendre.
«Elle n’a pas de noir, de sciure dans la bouche. Je l’envoie telle quelle à l’hôpital militaire.»
Par la suite, l’hôpital militaire signale également qu’il peut accueillir des patients. Je choisis ceux qui sont les plus brûlés. Une dame arrive sur un brancard, brûlée au visage et au torse, encore consciente. J’hésite. Son cou n’allait-il pas gonfler à la suite de l’œdème? Devrais-je l’intuber avant? Je prends le pli de ne pas le faire. Si, moi, je commence à intuber, alors je ne m’occupe plus que d’elle, pas de tous les autres. Elle n’a pas de noir, de sciure dans la bouche. Je l’envoie telle quelle à l’hôpital militaire.»


Charles Michel s’exprime sur les réseaux: «La priorité va aux victimes et au personnel de l’aéroport.» La piste d’un attentat est investiguée, indique un communiqué du gouvernement.
A 10 heures, le Centre de crise active un numéro d’urgence, le 1771, un call center classique, renforcé par des collaborateurs de la Croix-Rouge. Dès 10h20, tous les transports publics sont à l’arrêt. Le Centre de crise fédéral demande aux Bruxellois d’éviter les déplacements, puis à 10h21 d’éviter les coups de fil afin de ne pas surcharger les réseaux. Il faut limiter le trafic et faciliter le travail des secours. Les tunnels ferment vers 10h30.

Un peu plus d’une heure plus tôt, après la double explosion de Zaventem, Hans Van der Biesen tente d’organiser le départ de ses clients bloqués par la fermeture de l’aéroport.
«Je sens les fenêtres, le sol, trembler assez fortement. Je sors et je vois de la fumée s’échapper de la station de métro. Je comprends tout de suite. Un plus un font deux! J’essaie de descendre dans la rame. Après trois marches, je suis de retour. Avec toute cette fumée, c’est impossible. Je préviens la police, le propriétaire de l’hôtel et mon épouse. Ensuite, nous attendons une vingtaine de minutes avant de voir les premiers policiers. Entre-temps, avec mon personnel, nous réservons la première bande de la rue de la Loi pour qu’elle puisse rester libre pour les services de secours. Nous amenons des bouteilles d’eau, des serviettes, des petites choses au fond, aux premières victimes qui remontent de la bouche de métro. Quand les pompiers, les ambulances et les policiers arrivent, ils reprennent évidemment la situation en main. Ils ont besoin d’un lieu servant de triage et je propose le lobby de l’hôtel. Les bâtiments de la Commission, eux, sont fermés. Il n’y a pas beaucoup de solutions. Nous déplaçons les meubles jusque dans la galerie. C’est étrange, parce qu’à ce moment-là, la salle du petit déjeuner est encore bien remplie. On recouvre aussi les fenêtres de draps pour que personne ne puisse voir de l’extérieur.»

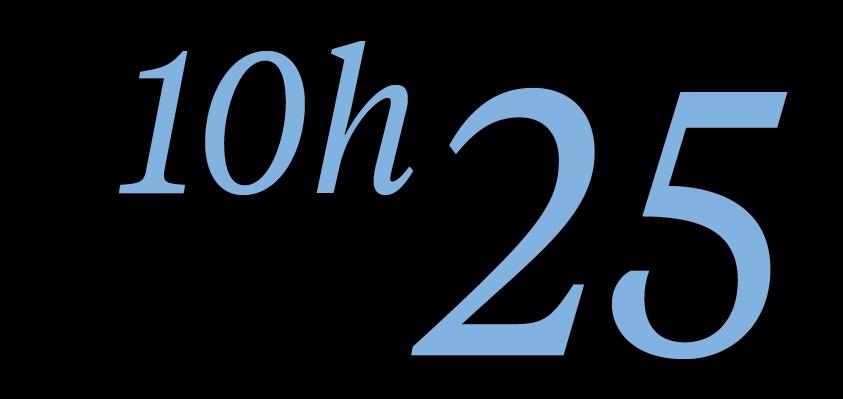
Le service de déminage neutralise un paquet suspect à Maelbeek, puis un second, à 10h42. Les secours interviennent dans la hantise d’une seconde attaque.



«Les victimes… Là où on travaille, pas un bruit, on peut entendre les mouches voler, mais dehors, ce sont des sirènes incessantes. Il y a plein de policiers, encagoulés, armés jusqu’aux dents. On est complètement encerclés et on ne voit que ça. Un homme entre dans le poste médical et prend des photos. Les policiers lui courent après. Il y a un sentiment d’insécurité et, ça y est, on se dit qu’on entre ici comme dans un moulin. Et si un autre entre avec une bombe…? On va là, traiter les douleurs, les brûlures, les blessures, piquer les perfusions. Je me souviens de cette dame, hébétée, complètement brûlée au visage, qui n’arrête pas de répéter: « Ce con a attendu que les portes de la rame se referment pour appuyer sur le bouton. » Elle répète ça en permanence. Et, dans l’hôtel, il y a une télévision qui passe des pubs, mais aucune info. Rien, on est au courant de rien.»
blanc
«On se dit qu’on entre ici comme dans un moulin.»

«Nous avons un décès dans le poste médical et deux autres patients, envoyés à l’hôpital, l’un dans le sas des urgences, l’autre dans les heures qui ont suivi, décèdent. Leurs plaies étaient difficilement gérables, même au sein d’un hôpital. Je demande du renfort au 112. J’ignore si cette demande est entendue. Quelqu’un entend dire, par la suite, « Non, nous n’en avons pas besoin, il y en a assez ». En fait, c’est quelqu’un du poste médical de la rue de la Loi qui ne comprend pas pourquoi quelqu’un demande du renfort… Durant tout un temps, eux et nous, personne ne sait qu’on existe, et inversement. Ce que je me dis, a posteriori, c’est que notre PMA était un « nid » de victimes.»


Le procureur fédéral, la plus haute autorité en charge de la lutte contre le terrorisme, Frédéric Van Leeuw, confirme qu’il s’agit d’un attentat-suicide à Zaventem. A 10h44, le 1771 est saturé.


«On entend « fusillade à l’hôpital militaire », « explosion à Beekkant », puis le summum, alors qu’on s’occupe des dernières victimes, on nous dit qu’on peut recommencer à monter des perfs, ça a explosé à Arts-Loi. Personne ne se dit qu’il n’y a plus aucun métro qui roule… Non, c’est le déminage. Cette cacophonie se surajoute à la désorganisation. A un moment donné, on nous dit « Tout le monde couché parce qu’il va y avoir un tir », tous les secours sortent à l’extérieur… On est dans une situation complètement chaotique, on intervient sur quelque chose de grave et où on n’est pas sûr que sa propre vie n’est pas en danger. C’est quelque chose de particulier.»

A Zaventem, peu avant 11 heures, tous les blessés ont été évacués. Les autorités continuent d’examiner le hall des départs.
«On nous envoie prendre en charge les patients émotionnés. En arrivant au niveau du parking P16 (NDLR: aujourd’hui le « drop off »), il y a plein de passagers qui sont évacués de l’aéroport. Les gens nous posent des questions qui nous semblent des bagatelles. L’infirmier et moi, on se dit qu’on ne peut pas rester ici. On avait vu des choses tellement plus graves… On a perdu deux patients dans la PMA. Une dame, dont je ne saurai dire l’âge. Elle avait un très grave traumatisme crânien. Il nous semblait qu’elle allait décéder et on a décidé de ne plus la traiter parce qu’on n’avait pas assez de ressources. On apprend ça durant nos études, mais la réalité est différente. En même temps, tout va très vite et on sait qu’on n’a pas d’autre choix, sinon d’autres décéderont.»
«On a décidé de ne plus la traiter parce qu’on n’avait pas assez de ressources.»


Soit… un peu plus de trois heures après la première explosion, Facebook active son «safety check», outil permettant aux internautes d’informer leurs amis qu’ils sont en sécurité. Ce dispositif avait été enclenché pour la première fois dans le cadre d’attentats après ceux qui ont frappé Paris, le 13 novembre 2015.

«Je repars avec mon infirmier, mon ambulance. Je reprends tout notre matériel, même ce qui est de base jetable, en me disant qu’on va vite le laver, qu’on devra peut-être l’utiliser ailleurs. Nous arrivons alors à l’hôtel Thon. On va les aider et, là, alors que nous sommes à même le sol, dans la poussière, dans les plumes –nous avons dû découper la veste d’un patient pour avoir accès à ses bras et à son torse et chaque fois qu’on passait à côté de lui, des plumes volaient partout–, c’est un réel poste médical. Il y a un secrétariat In, un triage, les patients sont bien installés. Il y a de la musique, de la lumière, une hôtesse qui passe avec des bouteilles d’eau. On se croirait presque à une réception tellement le contraste avec notre poste médical est grand. Sur place, on n’a pas vraiment besoin de nous. On se dit qu’on a peut-être besoin de nous à l’hôpital. On doit, en outre, recharger notre matériel.»

«Tout le matériel que l’on peut voir dans l’hôtel Thon n’a pratiquement pas servi, parce qu’il a été installé bien après. Les premières victimes ont été soignées sur les chaises, les fauteuils, à même le sol, dans la rue. Les fameux garrots, les tourniquets, ça n’existaient pas dans les ambulances avant le 22 mars. Donc, on fait avec les moyens du bord, on improvise, on fait ce qu’on peut.»




225 militaires arrivent en renfort à Bruxelles. Au total, environ un millier de soldats sont déployés dans la capitale, en appui aux policiers.




Après avoir communiqué par tweets, le Premier ministre prend la parole au cours d’une conférence de presse. «Nous redoutions un attentat et c’est arrivé.» Charles Michel lance un appel «au calme et à la solidarité» et dénonce «des attentats aveugles, violents et lâches». Les hôpitaux et la Croix-Rouge appellent aux dons de sang.


Le procureur fédéral, Frédéric Van Leeuw, réunit à son tour la presse. Il confirme que «deux explosions se sont produites dans le hall des départs, l’une étant probablement provoquée par un kamikaze» et qu’«une explosion s’est produite à Maelbeek». L’enquête a déjà débuté. La section antiterroriste du parquet fédéral ouvre une instruction. A cet instant, trois des cinq membres de l’opération terroriste sont morts. Deux sont encore dans la nature. Il s’agit d’Osama Krayem et de Mohamed Abrini.


«Les dernières victimes sont évacuées du PMA de la rue de la rue de Loi. L’après-midi, un débriefing émotionnel est organisé pour permettre aux effectifs de décompresser.»


A Zaventem, le service de déminage de l’armée neutralise la troisième valise d’explosifs, abandonnée par Mohamed Abrini.


Peu avant 13 heures, l’hôtel se vide. Les blessés ont été répartis dans les différents hôpitaux.
«Dans mon métier, on est là pour accueillir les gens. Nous avons fait notre devoir ce jour-là. Nous n’avons pas eu peur. Il y avait l’adrénaline. Le jour même, j’ai discuté avec mon personnel. Je leur ai proposé de fermer quelques jours. Tous ont voulu continuer et rester ouvert.»

La valse des ambulances ne cesse que vers 14 heures devant l’hôpital militaire.
«Nous accueillons 21 patients au Centre des grands brûlés, dont trois aux soins intensifs et 15 au medium care. A ce moment-là, nous n’avons pas beaucoup de travail. Dans notre service, il y a alors peu de patients brûlés et nous pouvons en faire sortir quelques-uns. Sur 25 lits, 18 sont occupés. Nous n’avons d’ailleurs jamais manqué de personnel et nous avons réalisé huit interventions en salle d’op. Je me souviens d’une famille américaine. Le père est lieutenant-colonel de l’armée et, avec son épouse, et leurs quatre enfants (trois filles, un garçon), ils se rendaient à San Antonio. La bombe a tué son épouse, l’a blessé lui gravement, brûlé à 7% et des fractures associées, l’une de ses filles, brûlée à 15%, la plus jeune, brûlée aux deux membres inférieurs sur 20%, plus des fragments métalliques nichés dans les loges des muscles. Cette petite est intubée et endormie lorsqu’elle arrive en hélico. Endormi, le patient ne sait pas se plaindre. Je l’extube et la réveille. Elle est bien, elle parle. Le lendemain matin, à 6h50, je constate qu’elle n’est pas bien. Elle a atrocement mal. La nuit, elle avait déjà reçu dix milligrammes de morphine, une fillette de 18 kilos.
«Il faut ouvrir. Il le fallait, sinon un œdème aurait détruit les muscles, les nerfs, les artères.»
Elle faisait un syndrome compartimental sur les fragments métalliques dans les jambes. Il faut ouvrir. Il le fallait, sinon un œdème aurait détruit les muscles, les nerfs, les artères. Elle aurait perdu le pied. Le gamin, lui, est brûlé à 40%, au 3e degré.»

Marie-Astrid de Villenfagne a regagné Saint-Pierre. Dans l’après-midi, vers 14 heures, la psychologue de Saint-Pierre décide de rassembler les équipes parties en intervention sur les lieux des attaques.
«A Saint-Pierre, comme les blessés étaient arrivés au compte-gouttes, ils avaient déjà été dispatchés vers les salles d’op et les urgences. Donc, il n’y a pas de patients. D’un coup, on se sent désœuvré. Je n’ai plus rien à faire là. Mais le fait de rester là, avec mes collègues, pour pouvoir encore aider, l’envie demeure présente. Je suis poussée dehors. Il est plus de 16 heures quand je quitte l’hôpital.»


«Je rentre chez moi. Je ne réussis pas à dormir cette nuit-là. On a traité beaucoup de gens qui étaient gravement blessés et on ignore comment ils vont évoluer. Il y avait deux petites filles que nous avons traitées au poste médical. Elles ne semblaient pas fortement blessées, mais elles se sont dégradées. Nous sommes très inquiets (NDLR : le personnel médical apprendra, plus tard, que les fillettes ne décèderont pas).»


Les opérations de recherche et de secours se terminent vers 15h30 à l’aéroport de Zaventem. Le ministre de l’Intérieur, Jan Jambon, annonce trois jours de deuil national. Il est 15h55.


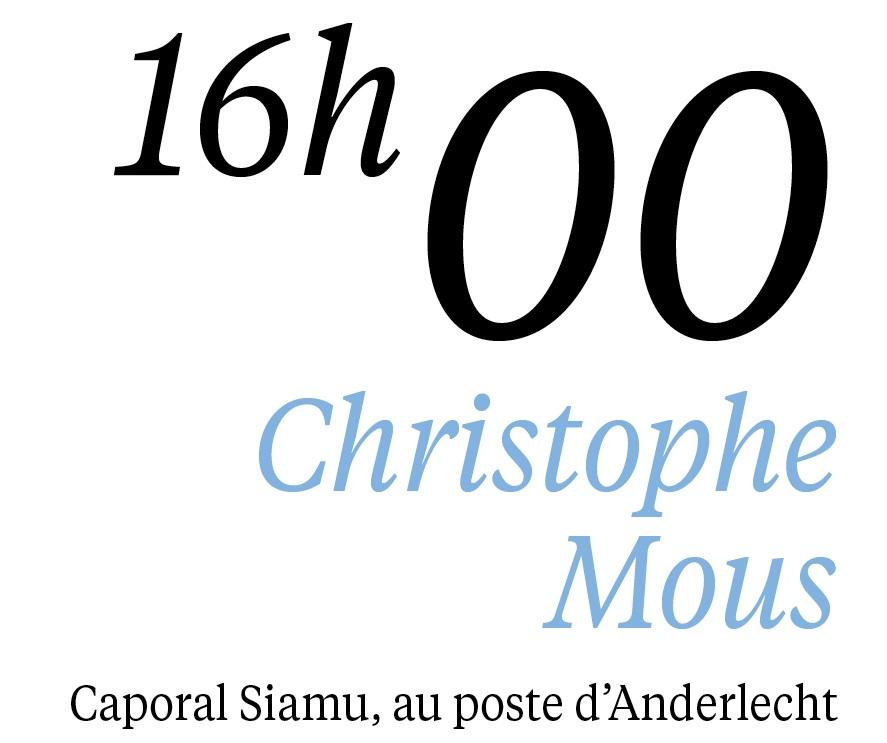

«On termine notre journée. Chacun réagit à sa façon aux événements. Avec les collègues d’Anderlecht, on prend un verre tous ensemble pour mieux se rendre compte de ce qui s’est passé et relâcher un peu la pression. Tout simplement. On se dit qu’on a fait le maximum dans des circonstances aussi exceptionnelles et que, globalement, tout a bien fonctionné. »


Charles Michel, Koen Geens, Jan Jambon et Jacqueline Galant se rendent à l’aéroport, puis à Maelbeek, pour saluer les équipes de secours. Un nouveau Conseil de sécurité est convoqué. L’organisation terroriste Etat islamique vient de revendiquer les attentats.

«Vous avez un ou deux brûlés, ça va… Mais ils arrivent tous et vous n’avez pas le matos. On utilise la même seringue de morphine chez plusieurs personnes. Là, on n’a pas cinquante ampoules de morphine. On n’a pas le choix. On fait le maximum avec ce qu’on a. On est fin d’après-midi, je rentre chez moi. Au poste médical, j’avais enlevé mon pull. Quand je le prends dans le coffre de ma voiture, il est lourd, très lourd. Je tords mon pull et de l’eau en sort, tant j’ai transpiré.»
«On n’a pas le choix. On fait le maximum avec ce qu’on a.»


Arrêté le 18 mars et détenu à la prison de Bruges, Salah Abdeslam est immédiatement réinterrogé. Il refuse de faire la moindre déclaration. L’heure est à la traque des criminels en cavale. A 18 heures, le parquet fédéral publie un avis de recherche où figure un homme coiffé d’un bob noir accompagnant Najim Laachraoui et Ibrahim El Bakraoui, les deux kamikazes morts à Zaventem: le «troisième homme», Mohamed Abrini, qui disparaîtra jusqu’à son arrestation le 8 avril, à Anderlecht, avec Osama Krayem.




A l’issue du Conseil national de sécurité, le Premier ministre appelle la population à «tout mettre en œuvre pour sauvegarder nos libertés fondamentales» et revenir rapidement à «une vie normale». Dans la foulée, à 19h00, le roi prend brièvement la parole à la télévision publique.

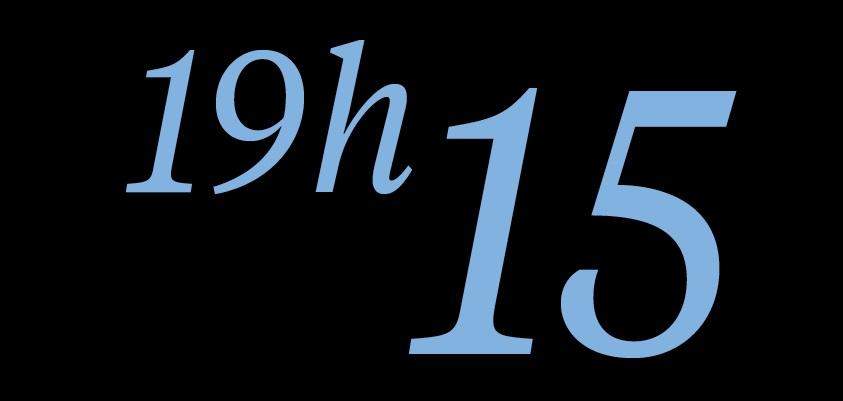

Depuis la fin de la matinée, vers 12 heures, des perquisitions sont menées. Elles se poursuivent jusque tard dans la nuit. Celles menées rue Max Roos, à Schaerbeek, permettent de découvrir un engin explosif contenant, entre autres, des clous. Les enquêteurs découvrent également des produits chimiques et un drapeau de l’Etat islamique.


Les hommages se multiplient à travers le monde pour saluer les victimes des attentats de Bruxelles. Un mémorial est improvisé place de la Bourse, dans le centre de la capitale. Des centaines de personnes se réunissent.


La police fédérale lance un second appel aux citoyens qui auraient des images des auteurs des attentats.


Les travaux de déblayage de l’aéroport et de la station Maelbeek durent toute la nuit. Les pompiers, la police scientifique, la protection civile et le parquet sont également présents. Cette nuit-là, la protection civile dégagera une partie du métro.
«La première nuit, je ne rentre pas chez moi. Il y a encore beaucoup de choses à régler. J’organise un espace pouvant accueillir ces hommes, leur apporter un peu de soutien, leur fournir à boire et à manger… L’odeur est insoutenable. En bas, ils entendent parfois encore des téléphones sonner.»
blanc
«L’odeur est insoutenable.»


Bruxelles ne dort pas. Ses habitants veillent toujours place de la Bourse. La Belgique, elle, s’endort en alerte de niveau 4.


Le périmètre de sécurité rue Max Roos, à proximité de la gare de Schaerbeek, est levé et les riverains, bloqués hors de chez eux, peuvent regagner leur domicile.

Le médecin quitte l’hôpital. Les chirurgiens ont opéré jusqu’à tard dans la soirée.
«Les patients, en moyenne, sont brûlés à 10%. Ce qui n’est pas beaucoup. On parle de grands brûlés à partir de 15% à 20%. Mais ils sont aussi polycriblés, oui, 70% sont polycriblés. Ils sont brûlés au décolleté, au visage, mais ils ont des éclats métalliques. Deux personnes en ont dans l’œil, par exemple. Dans notre langage médical, on parle des 3B, pour brûlés, blessés, blastés. Quand on a une explosion, il y a un dégagement de chaleur, des fragments métalliques, des vis, des clous… Des bombes que nous avons rencontrées comme militaires en Afghanistan, tout comme ces lésions chez les militaires et chez les civils. Ce sont des gars de Molenbeek, mais ce sont les mêmes bombes. Ils ont suivi les cours au même endroit. Nous, comme militaires, nous avions déjà vu ces polycriblages avec amputations, mais nos collègues civils, eux, n’avaient jamais vu ça!»

Le bilan officiel des attaques terroristes s’élève à 36 morts et 340 blessés. Ils étaient présents.