Thierry Fiorilli
Au Liban, certains braquent leur banque pour récupérer leur argent (chronique)
Au Liban, pas pour voler mais pour récupérer leur argent, certains braquent leur banque. Des braquages qu’on peut estimer justes.
Il y a des choses, on ne peut pas les faire, c’est interdit. Mais si quelqu’un les fait quand même et que les lois les prohibant sont iniques, elles sont admirables. Aider ceux que les meutes traquent. Tourner la carabine, malgré l’ordre de tirer. Culbuter en pleine rue le couvre-chef des suppôts du tyran. Des choses justes, mais qu’on n’ose pas, ou plus. Au Liban, Sali Hafiz, 28 ans, architecte d’intérieur sans boulot, Abdallah el-Saï, 37 ans, cafetier, Bassam el-Cheikh, 42 ans, ex-moniteur de plongée, et quatre autres ont osé. Braquer une banque. Pas pour voler, mais pour récupérer. Ils sont, depuis, des icônes, leur acte, illégal, étant tenu pour légitime et héroïque. Là-bas, c’est le carnage: la monnaie a perdu 90% de sa valeur (un dollar vaut quarante mille livres libanaises), 80% de la population (6,8 millions d’âmes) vivent sous le seuil de pauvreté établi par la Banque mondiale (2,15 dollars par jour), les retraits d’argent sont limités depuis trois ans à quatre cents dollars par mois et le système bancaire s’est effondré, entre corruption, fuite de capitaux et arnaques XXL.

Abdallah voulait retirer cinquante mille dollars, parce qu’on lui en avait piqué quinze mille et qu’il a des dettes. Bassam tablait sur les 210 000 dollars (au taux d’avant la cata) d’économies familiales, pour l’opération et le traitement de son père, tétraplégique. Sali visait ses vingt mille dollars, pour que le cancer de sa sœur soit enfin soigné. En vain. «Ce qui m’a fait vriller, raconte Bassam au magazine Society, c’est la nonchalance du banquier, son air insolent quand il refusait mes demandes.»
Lire aussi | Liban : la « génération 2019 » contre les dinosaures
Comme le 11 août. Alors Bassam a appelé sa femme pour la prévenir: «Chérie, je vais avoir un peu de retard, j’ai un petit empêchement à la banque.» Puis il a pris son fusil et un bidon dans le coffre de sa voiture et est retourné dans l’agence, à Beyrouth. «J’ai verrouillé, aspergé le sol d’essence pour qu’on ne puisse pas s’approcher de moi, demandé à voir le directeur et je lui ai dit: « Mon argent, maintenant, tu as intérêt à me le rendre. »» Treize otages, quartier bouclé, émissions télé. On lui propose cinq mille dollars. Coup de crosse contre la vitre: ça passe à dix mille. A midi, Bassam commande à manger pour tout le monde, sauf pour le directeur. Qui fait, au bout de dix heures, une dernière offre: 35 000 dollars. Bassam accepte et se rend. Dehors, la foule l’acclame. L’ argent, venu de plusieurs agences, est remis à son frère.
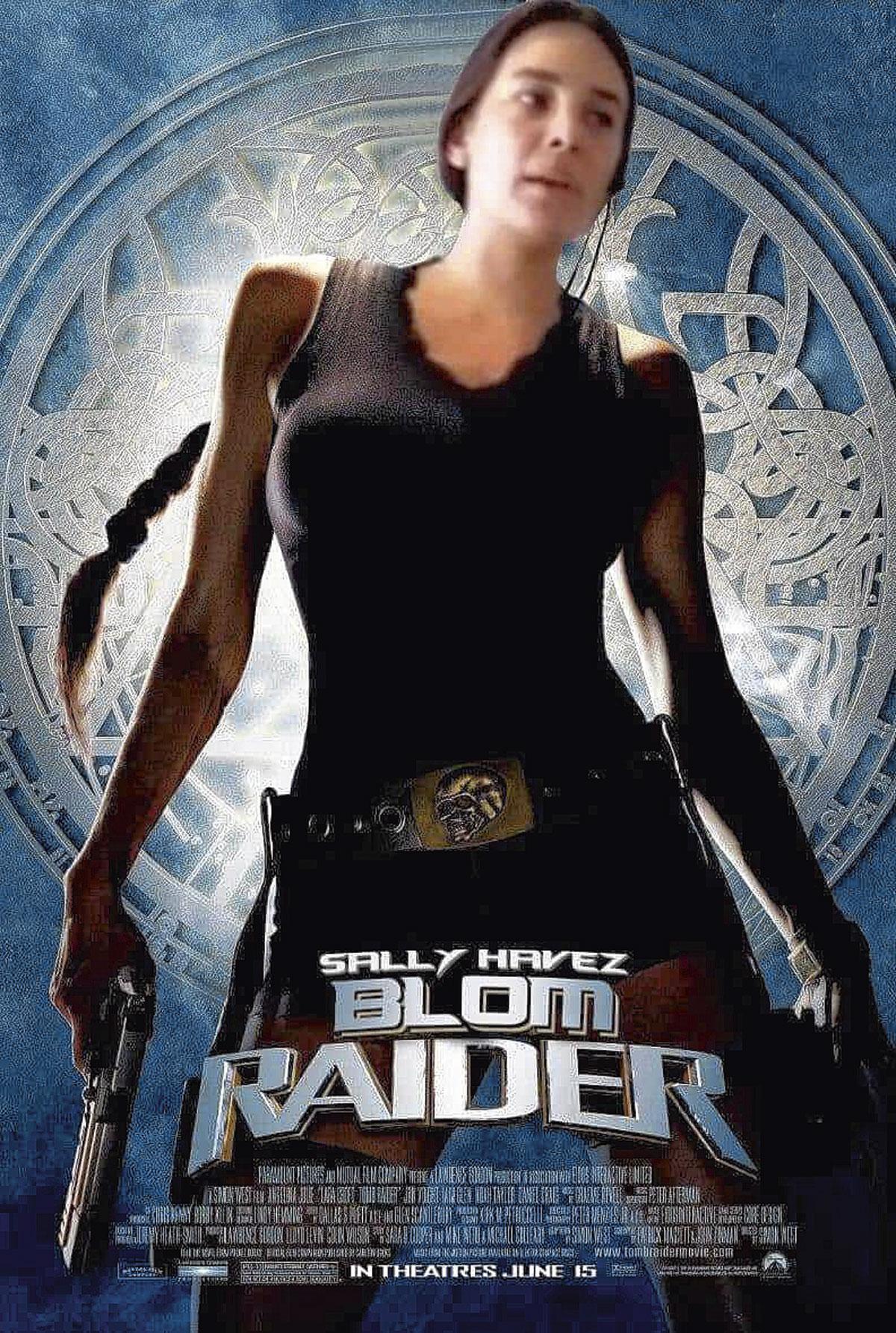
Le 14 septembre, le casse de Sali, à la Blom Bank, dans la capitale, est retransmis par des amis, en direct, sur Facebook. Pistolet jouet, otages et essence au sol. Elle vide le coffre: treize mille dollars. Elle s’enfuit, puis se livre. Et devient héroïne. Abdallah, c’était le 18 janvier, à Jeb Jenine. Otages, essence et gain de cause, encore.
Les agences, désormais, on dirait des bunkers. Mais aucune n’a porté plainte, ou alors elles l’ont retirée. Sans doute parce que, parfois, des choses qu’on ne peut pas faire mais faites quand même apparaissent justes aux yeux aussi de ceux qui les avaient interdites. Ou ils n’osent pas, ou plus, les condamner.
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici