
Un écrivain à l’affût
Aventurier et écrivain, Sylvain Tesson célèbre les vertus antimodernes de la discrétion, de l’attente et de l’invisibilité dans deux livres inspirés d’un voyage au Tibet.
Pendant de longues années, Sylvain Tesson a voyagé comme on danse sur des volcans. Si une chute presque fatale en 2014 l’a changé, sa rencontre avec le photographe Vincent Munier a été aussi décisive. Parti avec lui sur les hauts plateaux tibétains à la recherche d’une arlésienne, la panthère des neiges, il en a tiré un récit spirituel et amoureux, couronné par le prix Renaudot.
Comment avez-vous transposé dans l’écriture ce périple tibétain (1) ?
J’ai essayé d’aller au plus sec. Ma technique est toujours la même : je prends des notes sur place, j’alimente et ensuite je recompose. J’ai tenté une réduction ciselée au plus essentiel, sans débordements, pour rester au plus près de ce qu’est l’affût. C’est un livre qui parle de ce qui est en suspens, de l’observation, de vision, d’image, d’apparition.
Votre voyage avec Vincent Munier vous a fait quitter le domaine de l’aventure et du mouvement pour expérimenter de longues attentes immobiles de l’animal. Cette expérience a eu une dimension spirituelle, voire sacrée ?
L’attente est une espérance de quelque chose dont on sait qu’elle existe mais dont on n’est pas sûr de la venue. C’est pour cela que la foi en l’animal, en son apparition, n’est pas une foi grandiloquente. C’est une foi modeste, une religion modeste. La foi en Dieu, dont l’existence n’est par ailleurs jamais attestée, même si elle est grande, profonde, reste tout de même un pari… incroyable. Avoir foi dans l’animal, c’est savoir que la bête existe, mais ignorer si, ni quand elle va paraître. Tout en faisant pour elle l’expérience d’une espérance, d’une dévotion, d’un amour. La rencontre qui advient, c’est bien une expérience quasi religieuse qui mérite le terme d’apparition, oui. Et j’ai concrètement vécu un phénomène de l’ordre du sacré : la superposition d’un souvenir que je croyais éteint en moi et la vision de l’animal. Cela arrive à beaucoup de gens, en réalité, et c’est sans doute la raison pour laquelle on part en voyage, qu’on a des désirs et qu’on essaie de les assouvir : on cherche quelque chose qui est de l’ordre de cette superposition. J’ai vu des femmes dont le souvenir, qui était enfoui en moi, s’est immédiatement reflété sur le visage de la panthère. C’est aussi, d’ailleurs, la définition qu’André Breton, en 1934, donne du surréalisme : la juxtaposition de deux situations et de deux images lointaines, que l’on rapproche.
L’animal nous renvoie à ce à quoi nous avons renoncé.
Vous écrivez : » J’ai beaucoup circulé, j’ai été regardé et je n’en savais rien. » Il a fallu que Vincent Munier vous ouvre à l’urgence de ralentir, de s’arrêter, pour trouver des réponses que vous n’attendiez pas ?
C’est la vieille idée que nous avons en nous ce que nous allons chercher ailleurs, admirablement mise en mots par Pascal, » Tu ne me chercherais pas si tu ne m’avais déjà trouvé « , inspiré par saint Augustin ( » Ô beauté, je te cherchais au dehors de moi-même alors que tu étais au-dedans de moi-même « ). Pour toutes ces raisons, l’affût n’est pas qu’une observation technique et scientifique de zoologue. Il y a quelque chose si pas de sacré — c’est un bien grand mot — en tout cas d’intérieur.
Vous n’êtes pas loin de la démarche de l’éthologue : vous observez l’animal et celui qui l’observe, le photographe Vincent Munier. Vous étiez vous-même observé par les animaux des montagnes tibétaines ?
Oui et d’ailleurs ça m’intéresse de savoir qu’on est beaucoup plus observés qu’on ne le croit. Ce n’est pas une question de vanité — c’est quelque chose qu’il s’agit d’oublier très vite. Circuler dans une nature qui vous surveille, même à votre insu, je trouve que c’est fortifiant. Cela signifie qu’elle est peuplée. » Homme libre-penseur, te crois-tu seul pensant ? » écrivait Gérard de Nerval, précisant qu’il y a des esprits dans les cailloux, dans les bêtes. Ce panthéisme est une sorte de postromantisme new age (sourire) mais en même temps, il fait référence à une vieille intuition humaine, à savoir qu’il y a un principe divin dans chaque expression vivante et qu’on n’est pas seul, même quand nos semblables sont absents.

Cette panthère des neiges, comme les animaux en général, est aussi le point de départ d’une critique en règle de notre condition moderne… Qu’aurions-nous perdu sur la route du progrès ?
L’animal nous renvoie à ce que nous ne sommes plus, ce à quoi, en devenant des hommes modernes, nous avons renoncé : une forme de liberté, d’autonomie, de capacité de survie dans la nature. Nous sommes devenus très dépendants de nos technologies. Nous avons, bien sûr, gagné des contreparties : le confort, l’espérance de vie, etc. Mais pour tout cela, nous avons renoncé à tout ce qui fait la puissance et la gloire, la grâce des bêtes, leur volupté. C’est pour cela que je compare cette panthère à une reine gitane : quelqu’un qui est encore dans les jeux et les dangers du monde. Quand nous nous sommes agenouillés devant les machines, devant la force et l’efficacité, nous avons troqué tout ce jeu merveilleux : les parures, les plumes, la gaîté, une certaine violence aussi… En somme, le sentiment de la valeur de la vie.
L’homme n’est pas l’être le mieux doté physiquement : il a eu besoin de l’évolution, de la technique, de l’innovation et du progrès pour s’imposer.
L’humain, pour survivre, a dû opposer à sa débilité physique son intelligence, sa capacité à inventer un outil, une technique. A 5 000 mètres d’altitude, vous voyez l’animal dans sa nudité, parfaitement à l’aise avec ce qu’il est, alors que vous, vous êtes encombré de tout un matériel très sophistiqué, élaboré pour vous permettre d’arriver péniblement au même endroit. Cette rencontre de la présence pure qui n’a pas besoin de la technique, de l’artifice des artefacts, c’est ce qui me rend l’affût si philosophique. La présence de l’animal se suffit à elle-même, lui qui n’a pas tous les tracas qu’un humain peut s’imposer. Que ce doit être reposant d’être une bête : ne pas se demander s’il vaut mieux être ailleurs, ce qu’il faut faire, comment faire pour se dépasser… Que c’est épuisant d’être un humain ! La question de Lénine sur son lit de mort ? » Que faire ? » Jusqu’au bout, l’homme n’a de cesse de se poser cette question. La mentalité occidentale est entrée dans une religion de l’innovation, du changement, de la métamorphose. On a l’impression qu’il n’y a plus que ça qui intéresse les gens : qu’apporter de nouveau ? C’est un dogme de prétendre que tout ce qui est nouveau est forcément vertueux. » New « , ce mot est partout, jusque sur cette table ! (Sylvain Tesson pointe le menu du restaurant) Pâté de marcassin ? New ! Filet de biche ? New ! Civet de lièvre ? New… Je n’invente rien ! C’est un des problèmes de la modernité : l’emballement.
Agenouillés devant les machines, nous avons troqué le jeu merveilleux de la vie.
Votre livre a le regard et le temps suspendu comme pierres de touche. Que pensez-vous de la manie des selfies ou du besoin contemporain de donner à voir en photo le moindre moment ?
Je ne sais pas si cette manie de se regarder ou de faire regarder est si nouvelle. La flaque de Narcisse est devenue un écran, tout simplement. Les graffitis de l’Antiquité répondaient peu ou prou à la même nécessité : laisser une trace de soi. L’homme n’a qu’une préoccupation : la propagation de lui-même. C’est un besoin tout à fait biologique qui signifie que nous sommes fidèles à ce que nous sommes : des animaux. Nous devons maintenir en fonction nos organes vitaux en vue de la perpétuation de la lignée. C’est la vie. L’homme se propage, se perpétue, il essaie de s’accroître, de s’accumuler, de s’augmenter. Se répandre, se regarder, se représenter, cela procède du même.
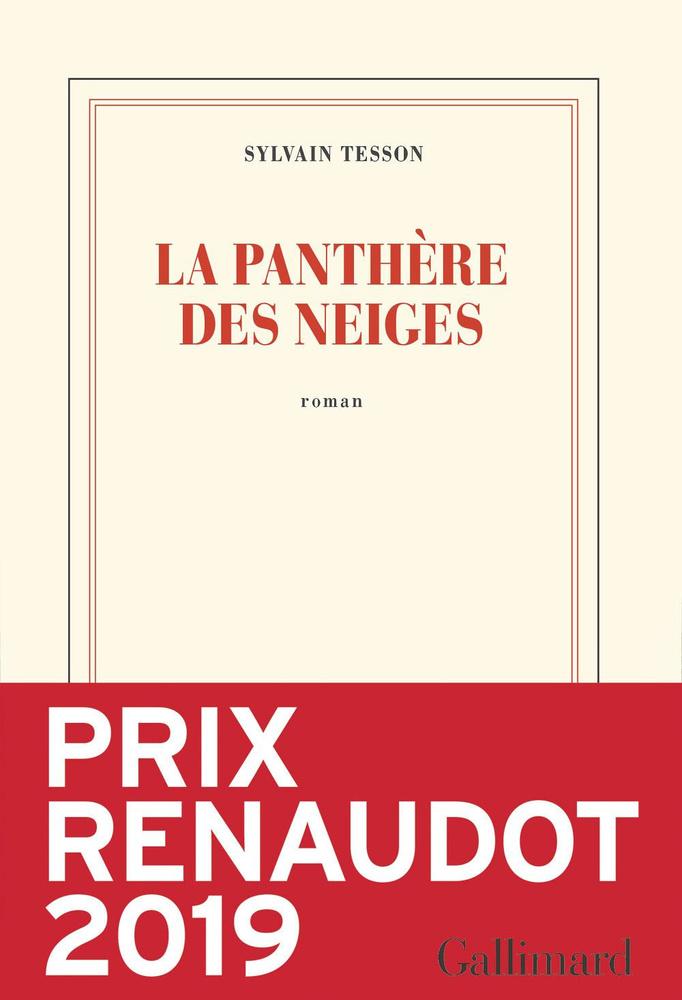
Lorsque vous citez l’injonction issue de la Genèse » Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l’assujettissez « , que vous la comparez à la contemplation et aux retours aux racines prônées par le Tao, vous regrettez la manière dont nous occupons le monde, notre rupture consommée avec la nature et ses conséquences actuelles ?
C’est un vrai débat d’historien et de penseur, ce que je ne suis pas. La question est comment l’homme occupe le monde mais aussi quand il a décidé de le faire. Aux débuts de l’agriculture, quand il a planté une graine pour en récolter deux ? A ce moment, déjà, il sélectionne, il modifie. 1492 ? La révolution industrielle ? En réalité, à l’échelle du monde, on est passé très rapidement des troupeaux dans les plaines fertiles de Babylone aux OGM. C’est l’idée géniale de Stanley Kubrick dans 2001, l’Odyssée de l’espace : le singe jette l’os et l’os devient une soucoupe spatiale. Nous sommes passés en une poignée de siècles de la pierre taillée à la capsule spatiale. On peut aussi imaginer que le moment clé est lorsqu’un homme a pu dessiner un bison sur la paroi d’une caverne : un mur que vous peignez, c’est un mur que vous repoussez, c’est le début de la grande rupture, de la séparation. A l’opposé, lorsqu’on est à l’affût et qu’on a la chance de croiser l’animal, de croiser son regard, il ne s’agit pas de copiner avec lui, de faire miaou-miaou. On est clairement séparés. Cette distance respectueuse, c’est la vraie expérience de l’altérité, du mystère.
(1) La Panthère des neiges, par Sylvain Tesson, Gallimard, 176 p. A lire aussi : le beau livre photos Tibet : minéral animal, Vincent Munier et Sylvain Tesson, Hemeria, 240 p.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici