
Nicolas Truong: «Déconnecté du réel, le commentariat s’autoalimente»

Les débats télévisés façon Cyril Hanouna ne font pas seulement du bruit. Ils disent combien le débat politique s’est vu privé d’espaces où exister, au point de trouver refuge sur les plateaux de télévision ou les réseaux sociaux. Tous les coups y sont permis, constate le journaliste et auteur Nicolas Truong. Y compris perdre de vue les faits.
A force de diriger les pages Idées/Débats du quotidien français Le Monde et de baigner dans le commentaire pendant des années, le journaliste Nicolas Truong en connaît un bout sur la question. Ce n’est pourtant pas tant du commentaire que du commentariat que son récent ouvrage, La Société du commentaire (1), fait le procès. Car à ses yeux, commenter reste sain. Du moins tant que les avis exprimés demeurent en lien avec le réel et les faits. Ce n’est plus toujours le cas, constate-t-il. Et c’est bien là le danger…
Le silence est parfois une forme de décence et de résistance à des commentaires qui ensevelissent tout.
Dans La Société du commentaire, vous revenez sur l’émergence du commentariat et pointez ses dérives. Quelle différence faites-vous avec le commentaire?
Le commentaire est une interprétation, voire une exégèse, une explication de texte ou de geste, qui part d’un fait, d’une loi, d’un programme politique. Cette interprétation fait partie de la vie, publique et démocratique. Qu’on puisse commenter l’actualité est tout à fait sain. Pendant un temps, cet exercice était mené par les journalistes, et plus particulièrement les éditorialistes, qui semblaient détenir la parole autorisée. Aujourd’hui, tout un chacun se prête à l’exercice et cela contribue à élargir la démocratie. Le commentariat, en revanche, est un système dans lequel le commentaire n’a même plus besoin de la réalité factuelle pour exister: il se commente lui-même, il se suffit à lui-même. Le commentariat s’empare de sujets qu’il a choisis et parfois même construits. Prenons la question du wokisme, par exemple. Dans le commentariat, on suppose d’emblée que le wokisme exerce une emprise massive dans la société, sans interroger d’abord sa réalité. Le commentariat soit s’affranchit du réel, soit part d’une interprétation du réel un peu biaisée. Il tourne ainsi en vase clos. Hors sol, il s’autoalimente. Cela me fait penser au film Je ne sais rien, mais je dirai tout, d’Yves Robert. Dans le meilleur des cas, dans le commentariat, on a affaire à des toutologues qui interprètent des faits sans s’être informés et parlent de sujets sans partir d’une pensée informée. Dans le pire des cas, il y a derrière cette déformation des visées idéologiques: les extrêmes se sont d’ailleurs parfaitement lovés dans la société du commentaire. Ils imposent des problématiques ou des sujets dans l’espace public et médiatique, alors que bien d’autres sujets mériteraient qu’on s’y intéresse. Un exemple: le scandale provoqué par un député du Rassemblement national à propos d’une accompagnatrice d’un groupe d’élèves qui était voilée. Des dizaines de débats ont été consacrés à cette question alors que, dans le même temps, en 2019, 733 personnes sont mortes dans un accident du travail en France. Soit deux par jour. C’est un sujet qui mériterait qu’on s’y intéresse mais qui ne semble pas abordé dans des émissions où domine le commentariat, comme chez Cyril Hanouna.

Le commentariat donne le sentiment que tous les avis se valent. Enlève-t-il, par conséquent, toute légitimité aux vrais experts?
En effet. La pandémie de coronavirus a encore plus révélé ce relativisme, selon lequel tout se vaut: non seulement la parole des généralistes est écoutée comme équivalant celle d’un virologue, mais c’est même le cas pour un éditorialiste devisant sur le système de soins. Or, sur certains sujets, comme une pandémie, tous les avis ne se valent pas. Je peux certes, à titre personnel, avoir une opinion sur la pandémie et en discuter avec un virologue sur un plateau, mais je ne peux pas affirmer qu’elle n’existe pas. Ce sont des choses qu’on a entendues au plus fort des vagues de coronavirus. Or, on ne peut pas transiger sur les faits. Tout n’est pas interprétation.
La montée en puissance du commentariat et le déplacement du débat vers les plateaux de télévision s’expliquent-ils par une faiblesse ou une absence de débat politique ailleurs?
Lorsque je dirigeais les pages Idées/Débats du Monde, entre 2011 et 2019, j’ai en effet vu basculer le débat politique. Dans le sens où les partis politiques – et dans une moindre mesure, les syndicats – se sont vidés de leur substrat idéologique. Ils ont cessé d’être des instances qui repensent la société pour ne plus être – je force un peu le trait – que des machines électorales. Ensuite, ce sont les intellectuels, médiatisés et médiatiques, qui ont porté le débat politique. Puis est venu le tour des éditorialistes et, enfin, celui des chroniqueurs. Certes il y en a de formidables, mais la politique ne s’en est pas moins déplacée sur les plateaux de télévision. Un médecin m’a confié que les scientifiques s’y rendaient parce qu’ils ne disposaient pas d’autre lieu ni d’autre espace de parole pour se faire entendre sur la politique de santé. Pourtant il est important de pouvoir parler de ces questions-là partout. Mais si le débat ne se déroule que sur les plateaux, c’est qu’il n’existe pas ou plus ailleurs. Ce besoin de politique a été capté par un certain nombre de médias qui avaient un agenda soit idéologique, soit économique. En ce qui concerne les premiers, on a bien vu que Donald Trump était arrivé au pouvoir par le tremplin des médias et du commentariat. On connaît donc leur efficacité. Et en ce qui concerne les seconds, on sait que les débats peuvent faire de l’audience.
Quel est le poids de cet enjeu économique dans le commentariat?
Sa montée en puissance s’explique d’abord par l’arrivée des chaînes d’info en continu, qui ont besoin de remplir leurs grilles de programmes. Pour cela, organiser un débat où cela clashera sans cesse coûte beaucoup moins cher – un taxi, un défraiement ou une pige pour les invités – qu’une enquête de fond sur le terrain…
Voyez-vous des issues au règne du commentariat?
Je vois trois choses à faire. Je pense que, parfois, il est possible de se taire afin de ne pas accentuer une certaine dérive de la société du commentaire: on n’est pas obligé de tout commenter, on peut s’en abstenir. La propre parole d’un individu ou d’une personnalité en vue n’est pas à ce point importante qu’il lui faille à tout bout de champ s’exprimer. C’est quand même le signe d’un rapport à soi un peu particulier de penser le contraire! Le silence est parfois une forme de décence et de résistance à des commentaires qui ensevelissent et nivellent tout. Et qui peuvent parfois profaner. Dans certaines affaires de deuils, on peut marquer un temps d’arrêt, on n’est pas obligé de twitter immédiatement ni frénétiquement, me semble-t-il. Apprendre l’art du «comment taire», c’est une chose que chacun peut faire. Ensuite, j’observe, sur le terrain, un grand nombre de collectifs et associations diverses qui rediscutent des questions qui les intéressent. Ces débats peuvent partir de la défense d’un patrimoine ou d’une forêt, par exemple. Cela crée des espaces de délibération non médiatisés, loin de son portable. Ce besoin de retrouver la présence, le regard, la parole, l’écoute, existe. Cela peut être parfois conflictuel mais c’est assez réjouissant de se parler de son propre monde. Enfin, je fais le pari qu’il y a moyen pour les journalistes d’intéresser les auditeurs, lecteurs ou spectateurs autrement que par le commentariat, avec un vrai travail de fond, accessible et compréhensible. On peut parier sur l’intelligence des gens. On peut certes partir de certains affects, comme l’amour des animaux, pour aborder, par exemple, la question écologique à travers la nouvelle pensée du vivant. Utiliser les outils qui, d’habitude, tirent vers le bas pour aller vers un peu plus d’intellectualité, de plaisir à être informé. Je crois que certains ont compris qu’ils avaient été trop loin avec les épisodes Covid et Zemmour, qui a été suivi comme une star alors qu’il n’était même pas encore candidat à l’élection présidentielle, et a ainsi imposé ses thématiques. Il y a un besoin profond de ces trois pistes: le silence, le partage et une véritable pensée informée. Même si ce n’est pas ce qui domine pour l’instant médiatiquement.

Le doute ne se nourrit-il pas de cette société du commentaire, de nature telle qu’on ne sait plus qui croire?
Le commentariat introduit le doute en permanence. Le commentariat le plus manifeste est quand même celui qui a abouti à l’assaut du Capitole, à Washington! Il a quelque chose à voir avec la mise en doute de la parole officielle, légitime, dominante, que ce soit sur le résultat d’élections ou sur le réchauffement climatique. Ce qui est difficile dans notre travail de journaliste, c’est que nous sommes aussi là pour mettre en doute, au sens de vérifier pour s’assurer de la véracité des faits. Nous avons une pratique méthodique qui consiste à recouper l’information et à ne pas prendre les choses pour argent comptant. Il y a donc des vertus au doute. Mais certains autres passent du doute au mensonge et à la falsification. Ils érigent parfois le doute en méthode pour subvertir, et ce qui commence chez eux par des mots peut se transformer en actes. A partir de là, il peut y avoir une menace pour la démocratie, comme on l’a vu lors de l’assaut du Capitole.
Tout est commenté de la même manière, ce qui fait qu’on ne sait plus ce qu’est réellement l’événement.
Le commentaire est devenu spectacle et l’information, un divertissement, écrivez-vous. Comment en est-on arrivé là?
Tout est devenu spectacle, y compris l’information. Surtout avec les chaînes d’information en continu: on peut regarder une émission non seulement pour s’informer mais aussi pour se divertir ou l’écouter comme un bruit de fond qui tient compagnie. Pour faire de l’audience, on fait donc du spectacle, parce que dans un monde marchand, tout se vend.
Le commentaire est à ce point présent que certains médias ne laissent plus de place au fait et les couvrent immédiatement de commentaires…
C’est un système où tout peut et doit être commenté. Les événements sont immédiatement couverts avant même que l’on connaisse leur développement ou leur accomplissement. On parle d’un ouragan avant qu’il n’arrive et avant de savoir s’il a eu ou non des effets dévastateurs. Tout est en outre commenté de la même manière, ce qui fait qu’on ne sait plus ce qu’est réellement l’événement – j’exagère un peu. Il existe une sorte d’aplanissement de ce qui est réellement de l’ordre de l’événement. Si on traite une rixe en banlieue comme un conflit interétatique en Europe, on n’a plus la juste mesure de la nature du fait, de son importance. Les événements sont dissous dans un grand bain de commentaires. Peut-être pour des raisons psychologiques? Un événement, au sens propre du terme, c’est-à-dire qui rompt la chaîne de l’ordinaire, peut nous plonger dans une telle sidération que l’on aurait besoin de le commenter, dans un réflexe de réassurance. Mais quand on en arrive à un certain niveau de saturation, le commentariat produit l’effet contraire: il banalise l’événement en même temps qu’il «événementialise» l’ordinaire, le petit fait. On peut certes parler du banal, qui est parfois beaucoup plus intéressant et passionnant qu’on ne le croit, mais pas comme on le fait maintenant, à la manière d’un fait divers auquel on donne un sens qu’il n’a pas toujours. Certains sujets ordinaires sont peu analysés alors qu’ils disent beaucoup plus de la société et le disent de façon beaucoup plus forte que le tweet corrosif d’untel ou untel. Que la France n’arrive pas à mettre en place un contrôle technique pour les deux roues, pourtant imposé par l’Europe, en dit beaucoup plus sur la société et la politique écologique française qu’une petite phrase cinglante.
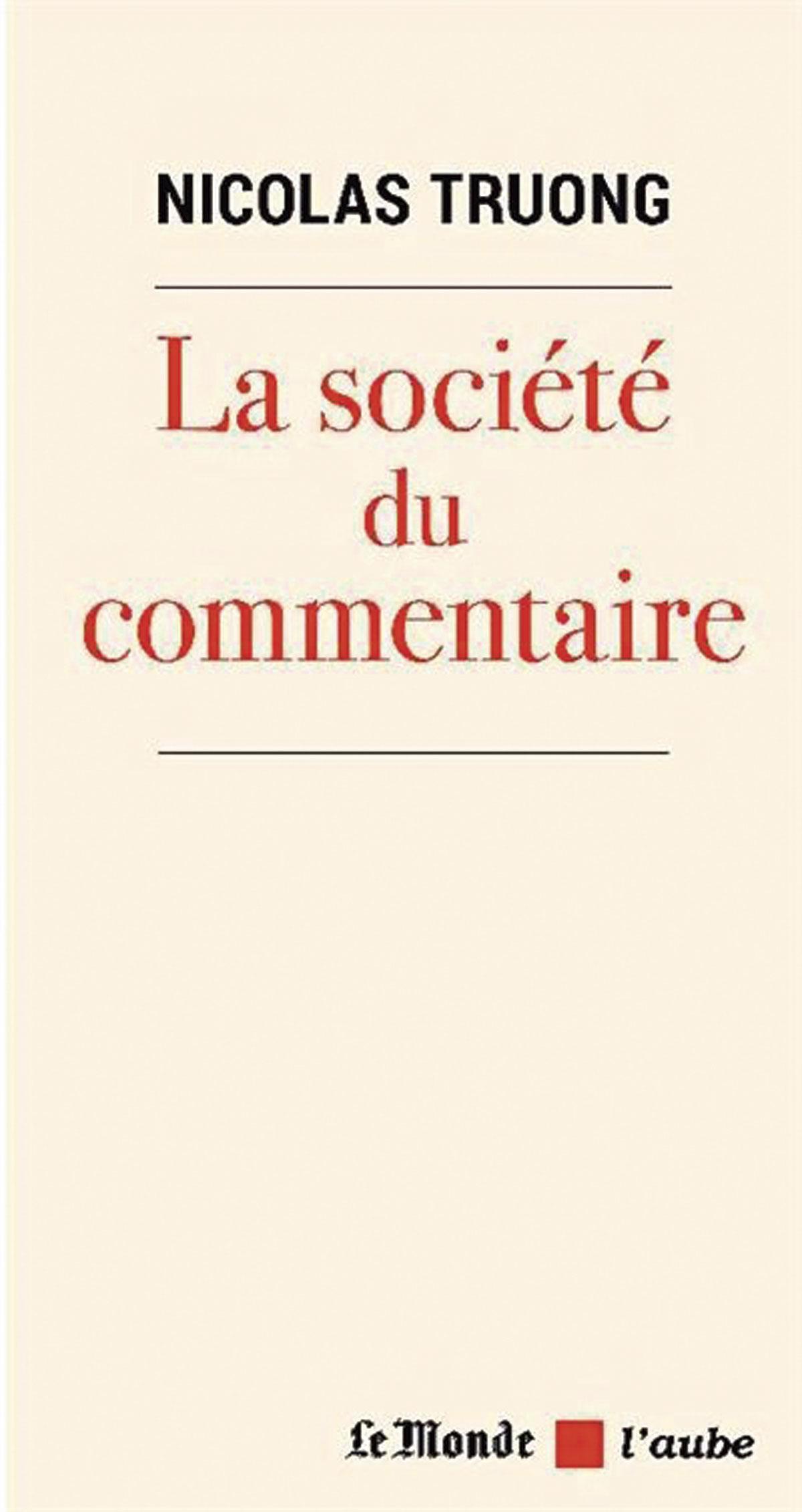
Le rôle des journalistes n’est-il pas précisément de hiérarchiser l’information?
Si. Il leur revient de mettre en évidence ce qui est vraiment saillant et ce qui ne l’est pas. En dépit de la sidération que peuvent provoquer certaines images. Car il y a des choses qui font image, comme une voiture qui brûle en banlieue, et d’autres non. Une vague de cancers provoqués par des pesticides dans un champ de tournesols ou de maïs, c’est moins spectaculaire…
Ne craignez-vous pas qu’on vous reproche de plaider pour votre chapelle, celle des journalistes?
Non. Parce que j’essaie justement de montrer qu’il ne s’agit pas d’une chapelle: il appartient à tout le monde de faire des enquêtes, mais il serait bon pour la vie démocratique, déjà fragile et fragilisée, qu’on le fasse à partir de faits avérés. Même si on peut être très partisan. C’est ce travail d’enquête qui permet d’éviter le piège de l’idéologie, qui consiste à soumettre la réalité à la logique d’une idée. Si les journalistes ne sont plus que des commentateurs, qui sont là pour étayer leurs opinions en ayant lu les articles des autres sans avoir éprouvé les faits, c’est un problème. Cela délégitimise notre métier. Je ne défends donc pas notre chapelle, mais notre métier. Nous faisons profession, nous, d’informer, à partir de recoupements d’informations et d’investigation. On y consacre tout notre temps. En vertu d’un contrat tacite avec le lecteur, ce dernier nous croit. Dès lors, notre profession serait moins abîmée aux yeux du public si elle ne donnait pas l’impression d’être dans le commentaire. Car dans ce cas, il y a rupture de contrat avec celui qui nous lit ou nous écoute et peut, à juste titre, se dire: si lui se permet de commenter sans vraiment savoir, alors pourquoi pas moi?
Certains hommes politiques semblent avoir parfaitement compris que dans une société du commentaire, il est facile de détourner l’attention…
Des stratégies de communication sont effectivement à l’œuvre. Dès lors qu’on s’intéresse un peu plus au geste et à la parole, à la forme qu’au fond, il est très simple, par exemple pour un homme politique, de faire diversion. Beaucoup peuvent donc tirer profit de la société du commentaire: des idéologues de tout poil, et d’autres qui ont des raisons de faire le buzz ou d’allumer des contre-feux. Il leur est facile d’imposer une problématique dans l’espace public ou une polémique. De ce point de vue, le règne du commentariat, pour eux, c’est parfait.
Le milliardaire américain Elon Musk, qui vient d’acheter Twitter, n’y voit-il qu’un instrument de puissance? Ou risque-t-il de voir un jour cette société du commentaire se retourner contre lui, comme l’indiquent les abonnés qui désertent le réseau social depuis qu’il l’a repris?
Les deux, je pense. Aux XIXe et XXe siècles, les groupes achetaient des journaux pour avoir la puissance. Aujourd’hui, on achète les réseaux sociaux, où se niche une partie du pouvoir. C’est assez stratégique. Mais en même temps, cela peut se retourner contre Elon Musk. Car il n’y a pas de fatalité à ce que la société du commentaire ne serve que des groupes idéologiques ou des gens qui voudraient marchandiser l’information. Espérons qu’il soit encore possible de critiquer Twitter sur Twitter. On pourrait aussi créer des réseaux sociaux différents. Parce que nous avons un pouvoir que nous ignorons, le système fonctionnant sur la base de notre adhésion et de nos abonnements. Je pense donc qu’un commentaire démocratique, critique et émancipateur peut se faire jour, même si c’est fragile. Et que des enquêtes et analyses journalistiques peuvent aider à ce que cet espace de délibération existe.
Bio express
1967 Naissance, à Paris, le 22 décembre.
1999 Entre au journal Le Monde, d’abord au Monde de l’éducation.
2011-2019 Dirige les pages Idées/Débats du Monde.
2012 Met en scène Projet Luciole, adaptation théâtrale de textes issus de la pensée critique.
2016 Met en scène Interview, sur l’art de l’entretien journalistique.
2022 Publie La Société du commentaire (L’ Aube/Le Monde).
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici