
Jean Echenoz dynamite le polar
Dans Vie de Gérard Fulmard, l’auteur de Je m’en vais (Goncourt 1999) et Les Grandes Blondes, régale d’un nouveau polar disruptif et jubilatoire. Rencontre avec un maître du burlesque.
A l’occasion d’une rencontre organisée par Bozar, à Bruxelles, c’est dans le hall d’un palace bruxellois que nous guettons l’apparition de Jean Echenoz parmi le ballet des pilotes de ligne. Au sein du personnel navigant, seul Gérard Fulmard, héros du roman auquel il donne son nom, manque à l’appel. Et pour cause : éconduit pour faute grave, l’ancien steward se retrouve embauché comme homme de main au sein d’un parti politique de seconde classe, dont la secrétaire nationale a été enlevée. N’étant spécialisé en rien hormis le service des plateaux-repas en altitude, notre antihéros placide va découvrir l’échange de coups bas au fond d’un panier de crabes. En grande forme, avec ce sens si particulier du roman noir burlesque et méthodique, Echenoz ravive le plaisir premier, jubilatoire, de la lecture. Hauteur de vue, génie comique, cascade de parenthèses tonitruantes : on tient l’un des livres les plus drôles et élégants de l’année.
J’essaie d’exclure tout sentiment d’ennui.
La Vie de Gérard Fulmard (1) est un roman noir où on s’amuse beaucoup, avec, aussi, un côté grinçant aussi. Un regard distancié sur les travers de vos contemporains ?
J’ai eu cette idée de faire quelque chose autour d’une petite organisation politique, qui pense surtout à sa propre existence plus qu’à un idéal social. C’était l’idée d’un parti comme une petite entreprise. J’avais du mal à envisager des personnages valeureux dans ce cadre-là. Il y a le parti pris d’une série de portraits, si je puis dire, une série de crapules, il faut bien l’admettre (sourire). Le roman me donnait l’occasion de mettre en scène des situations contemporaines de notre environnement. Les chaînes d’information continue, par exemple. J’avais envie de faire un portrait de ça. C’est aussi parce qu’écrire des romans est une activité de kleptomane : on dérobe beaucoup de choses de la réalité et on essaie de les reconstruire.

Fulmard rappelle Le Grand Blond avec une chaussure noire, voire une sorte de Buster Keaton ralenti…
Je n’ai jamais été spécialement attaché à l’idée d’un personnage héroïque. Je m’intéresse plutôt à des personnages un peu plus démunis. Le héros est un peu ennuyeux, souvent. C’est une référence extrêmement noble, Buster Keaton… Je n’aurais pas la prétention de m’en inspirer mais il y a des effets délibérés de drôlerie dans le livre et je me demandais quelle quantité de travail, de précision, de minutie, Keaton pouvait développer pour mettre au point une situation comique. Ça demande peut-être plus de travail qu’un bel acte tragique. Au départ, je voulais qu’il y ait un fond dramatique, même en jouant, en désamorçant les choses. Je m’étais servi d’un schéma de tragédie classique, en inversant les sexes des personnages, en bricolant tout ça… Mais ce n’était pas suffisant, cette toile de fond, ces personnages agités par des espèces de passion, des rivalités, des histoires de pouvoir, etc. Et donc l’idée était d’envoyer une espèce d’innocent dans ce panier de crabes.
La rue Erlanger, dans le xvie arrondissement de Paris, est au centre du récit. Elle a été le théâtre de nombreux drames. Travaillez-vous à réenchanter le fait divers ?
J’ai commencé à aller dans la rue Erlanger il y a cinq ans. Franchement, c’est une rue qui n’a aucun intérêt architectural, pas de commerces, assez terne, elle est très décevante. Elle n’est pas non plus sordide, elle est d’une banalité affligeante. Mais c’est ce qui me plaisait assez. J’ai photographié tous les immeubles, cherché dans l’histoire du vieux Paris le moment où elle a été percée… Je ne savais pas du tout où j’allais mais il fallait que je fasse quelque chose avec cet endroit très ingrat, qui se mettait à ressembler au personnage de Fulmard. Et puis, ce qui était impressionnant avec cette rue de Paris, c’est comme si elle produisait des faits divers. Il y a eu cette histoire du chanteur populaire qui s’est suicidé (NDLR : Mike Brant), l’histoire du Japonais cannibale et, il y a un an ou deux, il s’est passé un truc effroyable encore, où une femme folle a mis le feu à un immeuble. C’était comme si ça confirmait que cet endroit de Paris produisait du drame.
Avec le jazz, j’ai eu l’impression de dénicher un trésor.
Comment définiriez-vous le » style Echenoz « , si singulier ?
J’essaie que mes textes me procurent du plaisir mais ce n’est pas quelque chose qui se fait automatiquement. Il faut quand même beaucoup reprendre le récit, l’économie de la phrase, trouver un rythme et une sonorité qui puissent espérer produire cet effet-là. Sur la matière, oui, c’est un travail un peu physique. C’est l’idée que la phrase soit un matériau un peu vivant, qui puisse sonner et vibrer. J’essaie d’exclure tout sentiment d’ennui. Il faut toujours que ça bouge d’une manière ou d’une autre.
Avez-vous beaucoup tâtonné avant de trouver votre » voix » ?
Enfant, il me semblait qu’écrire était la meilleure des choses à faire. Pendant les années qui ont précédé mon premier roman – je n’étais pas tout jeune, j’avais 30 ans -, je crois que c’était une écriture qui n’était pas faite pour être lue. C’était quelque chose pour mon propre plaisir, une espèce de recherche, comme si j’apprenais à écrire. A un moment, je me suis dit : ce n’est plus possible de tourner autour de ce projet… Il faut essayer de construire quelque chose qui tienne du roman, de la fiction. Il y a une période de ma vie où je lisais beaucoup de romans policiers, beaucoup de Série noire, les classiques américains… J’ai essayé d’écrire un roman policier. Assez vite, je me suis rendu compte que je me permettais des choses qui n’entraient pas vraiment dans ce cadre strict. Je suis toujours resté attaché à cette forme et il y a pas mal de livres où j’ai essayé de jouer avec ça.

On a vanté l’influence que le cinéma a pu avoir sur votre écriture. Mais la musique ?
J’ai beaucoup appris au cinéma sur une idée du roman possible. Exercer la plus grande liberté, comme si je pouvais utiliser plusieurs caméras en même temps, penser au moment où il faut couper. On ne finit pas un geste, on finit l’ébauche du geste. Mais la musique a joué un rôle, dans la mesure où on peut essayer de reproduire des accélérations, des scansions particulières, des nappes sonores, des espèces d’envolée. Ça a été très présent, autant la musique de jazz que la musique classique que toutes sortes de musiques.
Si on devait retenir un mouvement d’ensemble, serait-ce le jazz ?
Oui, je crois que ça a beaucoup joué. C’est une musique que j’ai découverte quand j’avais 15-16 ans. J’avais l’impression de dénicher un trésor. Je pense quelques fois à des musiciens comme à des références pour le montage d’une phrase. Mon premier éblouissement, musical comme de la parole aussi, fut Thelonious Monk. Ce sentiment un peu puéril de découvrir quelque chose qui était pour moi, qui venait combler une attente difficile à définir. Mais le jeu avec les dissonances, les retards, les fausses fausses notes, les choses comme ça, ça a dû jouer.
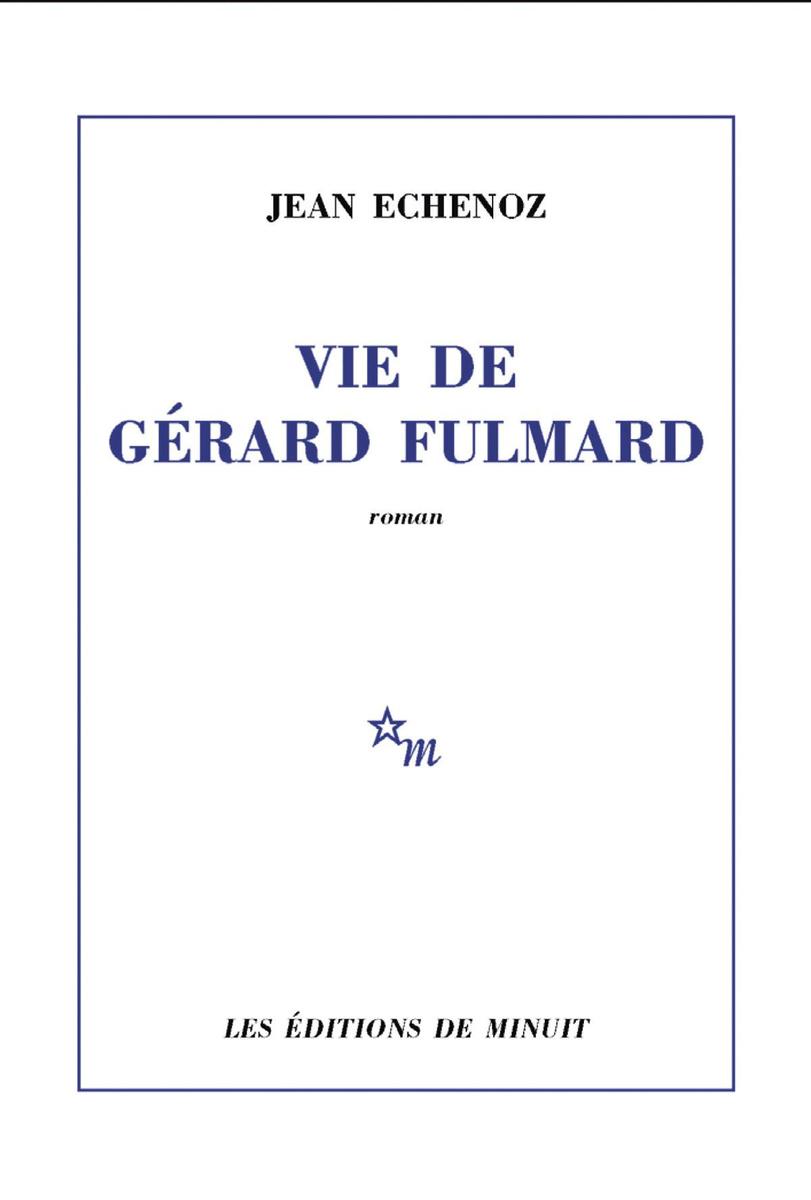
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici