
Etienne Balibar: «Cette guerre est celle de l’indépendance des Ukrainiens» (entretien)
Figure emblématique de la pensée contemporaine, le philosophe français Etienne Balibar publie Cosmopolitique. Des frontières à l’espèce humaine, recueil d’essais sur la paix, la guerre, les frontières et l’hospitalité. Une publication qui tombe à pic. Rencontre avec un iconoclaste de la pensée.
Visage jovial, voix enjouée, poignée de main franche. Etienne Balibar, aujourd’hui intellectuel réputé qui réunit à la fois les prestiges de la philosophie, de l’érudition et de l’engagement public, ne s’est pourtant pas départi de l’ethos du militant communiste de base qu’il fut dans les années 1960: camaraderie facile, enthousiasme débordant, élan joyeux, et ce tempérament de paladin que tout intellectuel instruit à l’école de Marx s’efforce de ne jamais abjurer. Mais aussi cette part d’utopisme assumée devant le réel. Quand il vous parle et qu’il sent que son propos vire à l’idéalisme, il interrompt brutalement son développement, vous fixe, et essaie de vous rassurer: «Alors oui, ce que je vous raconte là est un peu utopique, je le sais, il n’empêche que c’est dans cette direction qu’il faut marcher.»
Né d’un père mathématicien et d’une mère professeure de lettres classiques et historienne de la langue française, il épousa la physicienne Françoise Dumesnil. Le couple donnera naissance à la célèbre actrice césarisée Jeanne Balibar. Précoce, Etienne Balibar obtint son agrégation de philosophie à l’âge de 22 ans, un an avant de copublier avec son maître, l’influent philosophe structuraliste Louis Althusser, Lire le Capital, ouvrage au succès international qui le hissera sur les pavois académiques. S’ensuivent une vie militante au sein du Parti communiste français des années 1960 et 1970, dont il sera exclu sur fond de désaccord, et une brillante carrière universitaire: professeur émérite à l’université Paris-Nanterre (où il dirigea le mémoire de maîtrise du futur président de la République française Emmanuel Macron), il est aujourd’hui courtisé par les plus prestigieux campus américains et anglais.
A 80 ans, il continue de polir une œuvre magistrale d’une vingtaine de livres. Dernier en date, Cosmopolitique. Des frontières à l’espèce humaine (1), dont les thèmes résonnent singulièrement dans la conjoncture présente.
Bio Express
· 1942 Naissance, le 23 avril, à Avallon, dans l’Yonne, au sud-est de Paris.
· 1961 Adhère à l’Union nationale des étudiants de France et au Parti communiste français.
· 1964 Est reçu premier à l’agrégation de philosophie.
· 1965 Publie Lire le Capital (PUF) avec les philosophes Louis Althusser, Jacques Rancière, Pierre Macherey et René Establet.
· 1981 Exclusion du Parti communiste français après la publication d’un article critiquant la gestion du parti sur «l’affaire du bulldozer de Vitry».
· 2002 Professeur émérite à l’université Paris-Nanterre.
«Une situation de guerre abolit la possibilité de rester neutre», écrivez-vous. Selon vous, cette règle s’applique-t-elle à la guerre en Ukraine?
Les développements sur la guerre qui figurent dans le livre sont tous extraits d’une conjoncture déterminée et extrêmement courte. On se trouvait notamment au lendemain du 11-Septembre de l’intervention américaine en Irak (NDLR: l’ouvrage est un recueil de textes rédigés sur plus de trente ans, augmentés d’un avant-propos et d’une postface). A peine avais-je terminé la postface spécialement dédiée à cette édition, que la guerre en Ukraine a éclaté. Je me suis alors dit, avec un peu d’inquiétude, que tout ce que j’y disais sur la guerre allait paraître décalé, voire inadéquat, sauf peut-être cette citation. Ainsi, une semaine après l’invasion russe, j’ai déclaré publiquement qu’on ne peut pas rester neutre par rapport à ce qui se passe en Ukraine.
Je continue de prendre position pour qu’on aide les Ukrainiens à résister par la force, et si possible à vaincre, du moins à ne pas être écrasés.
Vous la reprenez donc aujourd’hui?
Absolument. D’abord pour des raisons de fond qui touchent à la nature du conflit. J’avais ajouté dans cette intervention cette allusion historique qui a une forte résonance: «Ne rejouons pas la non-intervention.» Mais des amis intellectuels, dont je me sens très proche, m’ont repris et m’ont non pas dit qu’ils étaient neutres mais que la recherche de la paix et la résistance aux entreprises militaires et guerrières devraient demeurer la seule boussole d’une position internationaliste. C’est la position qu’ a soutenu, par exemple, Noam Chomsky (NDLR: intellectuel américain majeur de tendance socialiste). Sauf que je pense qu’une guerre n’est jamais une guerre générale: elle est toujours déterminée, dans un lieu, dans une forme, et dans le cas spécifique de la guerre en Ukraine, je pense que non seulement il n’est pas possible de rester neutre mais qu’il faut prendre parti. Je ne détiens pas de canon ni de dogme en la matière, et je ne dis pas non plus que c’est facile de décider. Mais j’ai pris position et je continue de prendre position pour qu’on aide les Ukrainiens à résister par la force, et si possible à vaincre, du moins à ne pas être écrasés. Pour répondre directement à votre question: oui, je maintiens cette formule, mais je ne dis pas qu’elle a une valeur universelle, mais la guerre crée une situation où il est difficile de rester neutre.

Vous estimez que le nom d’une guerre est décisif et est plus qu’une simple question nominale. Selon vous, comment convient-il de nommer la guerre en Ukraine?
D’abord, il s’agit d’une guerre européenne. Je propose de la nommer «la guerre d’indépendance des Ukrainiens». Elle me fait penser à bien des égards à la guerre d’indépendance des Etats-Unis et à la guerre d’indépendance de l’ Algérie, à laquelle je tiens beaucoup. La guerre des Ukrainiens a une dimension civique importante, dont l’indice le plus frappant est que tout le monde a relevé que Poutine a envahi l’Ukraine en pensant que les Ukrainiens russophones allaient l’accueillir à bras ouverts. Or, la majorité de ceux-ci ont réagi comme les doigts de la main avec le reste de leurs compatriotes pour se défendre contre l’agression. Ce faisant, ils dépassent la définition ethnique de la nation – mais je ne dis pas que la dimension nationaliste est totalement absente. Ils accèdent ainsi, à travers la guerre, comme c’est hélas souvent le cas, à une dimension civique, qui fait que l’appartenance à l’Ukraine se définit par le projet de former ensemble une nation.
A vous entendre, vous n’employez pas le terme «indépendance» uniquement dans un sens symbolique ou métaphorique. On pourra vous objecter que l’Ukraine est officiellement indépendante depuis la dislocation de l’URSS.
Le discours des envahisseurs russes consiste à dire aux Ukrainiens: «Votre nation n’existe pas» – ce qui rappelle d’ailleurs le discours des Français en Algérie, qui déniait l’existence du pays. Certes, l’Ukraine est formellement indépendante depuis 1991. Mais dans la mesure où cette indépendance formelle n’a jamais été acceptée par l’Empire voisin et où elle fait l’objet aujourd’hui, sous une forme ultraviolente, d’une tentative d’anéantissement, il y a là quelque chose de l’ordre d’une guerre d’indépendance.
Au lendemain de la guerre, vous avez plutôt parlé de «guerre européenne».
En effet, j’estime qu’il est important de la désigner aussi comme une «guerre européenne». L’Ukraine fait partie de l’Europe et, d’une certaine manière, la Russie également. Aujourd’hui, il faut admettre que l’Union européenne n’englobe pas toute l’Europe, d’ailleurs ni toute l’Europe historique ni celle future. On pourra me rétorquer qu’il est inimaginable que la Russie intègre l’UE. Je réponds que ce n’est pas le sujet. Il est en revanche très important de bien savoir ce à quoi, en dernière analyse, nous aspirons. Le but moral ou politique que nous pouvons maintenir comme une boussole dans cette guerre n’est pas celui qui consiste, après avoir repoussé les envahisseurs, à nous séparer d’eux définitivement ; l’objectif est de recréer, dans la mesure du possible, une communauté d’intérêt, de pensée et de destin qui engendre non seulement la communication, la négociation, les accords de paix, mais quelque chose qui va dans le sens de la réintégration de l’espace russe dans une communauté ouverte où les Russes ne seraient ni ennemis ni intrus – tout cela paraît difficile, je le concède, mais il faut avoir cet objectif en ligne de mire. Il ne faut pas oublier que la Russie n’est dans l’Europe que depuis le XXe siècle. Ce qui l’a coupée de l’Europe, c’est la Première Guerre mondiale et, surtout, la Révolution russe et la guerre froide, de sorte qu’aujourd’hui, si vous dites à quelqu’un que la Russie fait partie de l’Europe, il vous regarde avec de grands yeux.

Dans quelle mesure cette guerre, que vous qualifiez de «guerre européenne», a invalidé la célèbre thèse du «choc des civilisations» de Samuel Huntington?
La thèse de Huntington comporte deux aspects que l’histoire contemporaine investit d’une signification très différente. Le premier, dans la tradition des théoriciens de la «géopolitique», en particulier Carl Schmitt, concerne l’idée que les acteurs des conflits ne sont plus des nations, mais de «grands espaces» continentaux. Le second concerne l’idée que l’unité de ces ensembles repose sur des traditions religieuses. Huntington en déduit que les guerres nouvelles surgiront dans la zone de «fracture» entre les blocs. Il n’y a pas de doute que l’Ukraine, comme l’ensemble des pays historiquement disputés entre l’Empire russe et ses voisins, constitue une frontière en ce sens. Mais le ressort de la guerre actuelle n’a rien à voir avec le «conflit de civilisation» au sens de Huntington, même si le régime de Poutine a élaboré toute une idéologie en opposition avec les valeurs de «l’Occident».
La guerre actuelle n’est pas une surprise, mais une continuation et une aggravation. Elle met plus que jamais à l’ordre du jour la question de la paix véritable.
En 1991, le politologue Francis Fukuyama publiait le célèbre ouvrage, La Fin de l’histoire et le dernier homme. Il y annonçait que l’ère des idéologies et des grands conflits meurtriers était révolue. Que pensez-vous de cette thèse à la lumière du contexte actuel?
L’idée que la victoire d’un des deux systèmes en lutte dans la guerre froide allait ouvrir une ère de paix mondiale, où ne régneraient plus que la concurrence économique et le constitutionnalisme à l’américaine, était un fantasme néolibéral et un instrument de propagande. Non seulement les guerres n’ont jamais cessé, mais elles se sont intensifiées, du fait même des Etats-Unis, en combinant terrorisme et contre-terrorisme, ressorts idéologiques et économiques. Les limites entre «guerre civile» et «guerre étrangère» se sont estompées. La guerre actuelle n’est donc pas une surprise, mais une continuation et une aggravation. Elle met plus que jamais à l’ordre du jour la question de la paix véritable.
Vous êtes un fervent défenseur du fédéralisme européen, l’un des rares dans votre famille idéologique. Dans quelle mesure cette forme politique et institutionnelle est adéquate pour apporter les réponses aux défis actuels?
S’agissant de la conjoncture actuelle, on est mal partis. On nous explique que l’unité européenne se renforcera. Mais la question est de savoir par quel bout? Ce qui semble se dessiner, c’est qu’elle se fera par la militarisation, qui, en plus, ne se ferait pas dans la voie de l’indépendance puisqu’elle sera en étroite collaboration avec les Etats-Unis. Et puis, avec la militarisation viendront s’ajouter des degrés supplémentaires d’intégration des politiques budgétaires. Disons que le renforcement s’opérera par «le haut» et par les aspects les plus autoritaires et dirigistes de la politique européenne. Aujourd’hui, il y a un déficit démocratique à l’échelle européenne.
Cette forme de fédéralisme n’est pas celle que vous appelez de vos vœux…
Dans mon esprit, le fédéralisme doit être le contraire de ce modèle. Je suis en réalité plus en phase avec l’idéal proudhonien (NDLR: Pierre-Joseph Proudhon (1809 – 1865) est un philosophe et économiste libertaire) qui prône l’autogestion locale et la fédération des entités à un échelon de plus en plus élevé. Mais cela suppose que la fédération soit le contraire d’un Etat. Moi, ce qui me sert de boussole, c’est la citoyenneté. J’appelle «fédération» un ensemble politique dans lequel les habitants, citoyens ou résidents, sans exclusive, non seulement jouissent de droits civiques mais constituent une communauté capable de débattre et d’infléchir, autant que possible, les décisions politiques qui les engagent. A mes yeux, le fédéralisme doit reposer sur deux piliers: une citoyenneté non exclusive et une participation politique active et effective à l’échelon supranational. Cela ne veut pas dire que, dans cette configuration, les nations doivent ou sont vouées à disparaître.
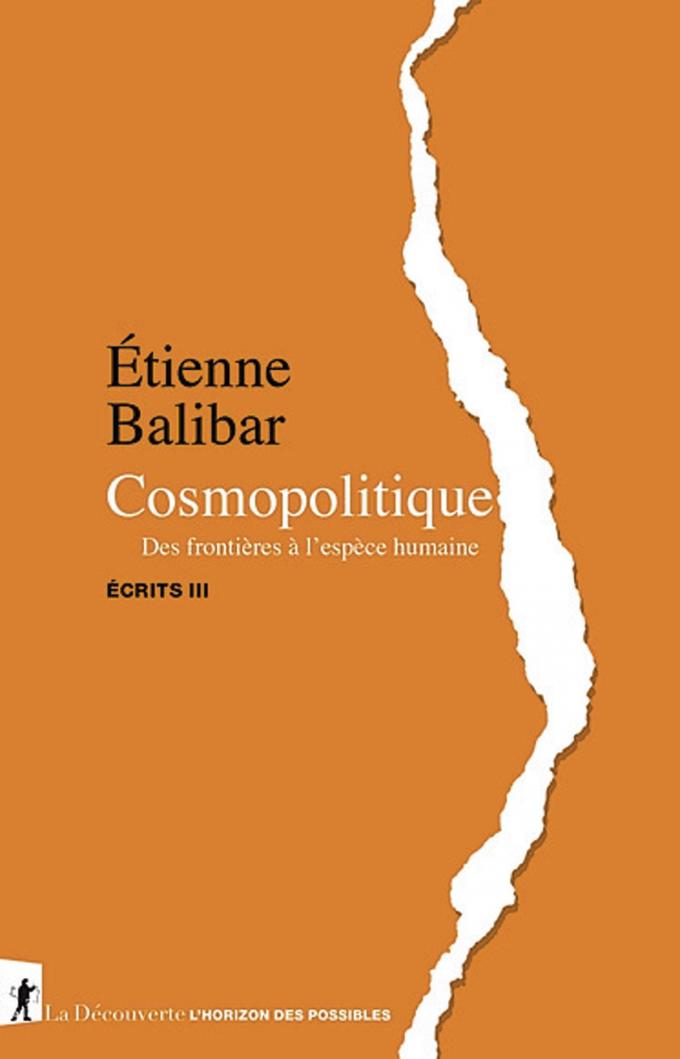
C’est pourtant ce que vous reprochent certains de vos adversaires et même quelques amis, à savoir de porter une vision politique qui efface les nations.
Ce n’est pourtant pas ce que je défends. Il n’en reste pas moins que j’estime que le souverainisme est un grand danger. Je redoute terriblement le développement des passerelles entre la gauche et la droite, voire entre l’extrême gauche et l’extrême droite. Je le redoute, car je vois bien l’attractivité et même la solidité de certains arguments – même si je ne les partage pas, ni sur le plan économique ni sur celui des valeurs. En même temps, je pense qu’il y a dans l’histoire des précédents très inquiétants de ce point de vue. Quand, il y a quelques années, l’économiste Jacques Sapir a proposé de faire émerger un «front national» dans lequel des défenseurs de la souveraineté qui viennent aussi bien de la gauche que de la droite finiraient par marcher ensemble, cela a résonné dans ma tête comme une sonnette d’alarme avec d’autres indices historiques du même genre.
Vous définissez-vous toujours comme «citoyen du monde»? Comment peut-on le revendiquer par ces temps de nationalisme exacerbé?
J’attache une importance symbolique à cette formule. Je l’aborde dans le livre pour me poser la question du sens qu’elle pourrait avoir aujourd’hui. De nos jours, nous vivons dans un monde où la politique est devenue nécessairement «cosmopolitique». Cela veut dire qu’il n’y a plus aucun problème dans le monde qui ne puisse concerner qu’une partie de ses habitants.
Vous avez beaucoup écrit sur l’hospitalité. Quelle forme devrait-elle prendre à l’égard des Ukrainiens?
Elle se développe en Europe sur une grande échelle, et c’est bien ainsi, même si on peut remarquer que, par contraste, la politique de rejet envers les réfugiés originaires du «Sud» se caractérise toujours par l’hostilité et le racisme. En fait, la question des réfugiés ukrainiens dépasse le cadre de l’hospitalité: c’est un problème de déplacement forcé de populations, donc une redéfinition de tout l’espace européen et des lignes de démarcation entre les nations.
Aux termes «migrants» ou «exilés», vous préférez «errants».
Je n’ai récusé aucune terminologie, notamment pas celle des «exilés» qui est en usage dans le discours des associations de secours aux migrants et réfugiés. Mais j’ai cherché un terme avec des résonances historiques autant que symboliques, à la fois pour dépasser les oppositions artificielles entre plusieurs catégories de personnes déplacées, et pour attirer l’attention sur la dimension génocidaire d’institutions comme Frontex, dont un récent scandale vient de révéler que l’objectif n’est pas de traiter les demandes d’asile, mais d’envoyer à la mort des milliers de fugitifs. La guerre des frontières n’est pas une suite d’opérations de police qui cherchent à bloquer l’accès d’un territoire à des étrangers cherchant à y entrer sans autorisation, c’est une politique d’élimination du peuple des errants.
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici