
Robert Guédiguian, cinéaste engagé: « L’identité se construit tout au long de la vie » (entretien)

Le cinéaste français engagé Robert Guédiguian observe que la crise sanitaire a été propice à l’éclosion de « moments communistes ». Ils nourrissent, pour lui, l’espoir de lendemains qui chantent à nouveau, pourvu que l’aspiration au bien commun supplante l’exacerbation des divisions identitaires et que le politique reprenne les rênes de l’économie.
Ce n’est sans doute pas un hasard si Robert Guédiguian, cinéaste engagé, ennemi de l’injustice sociale, réalisateur il y a vingt-cinq ans du savoureux Marius et Jeannette, a choisi la fin du mandat d’un Emmanuel Macron « président des riches » pour distiller ses « intuitions documentées » dans un livre dont le titre, Les Lendemains chanteront-ils encore? (1), risque d’occulter l’optimisme qui, à 68 ans, continue de l’animer. L’homme ne se complaît pas dans la nostalgie. Au contraire, depuis le quartier marseillais de l’Estaque qu’il a si souvent mis en scène, il scrute le monde pour mieux adapter à ses évolutions le combat contre les inégalités qu’il mène depuis son enfance. C’est la dureté de la vie de ses parents qui, raconte-t-il, lui a fait prendre conscience que « personne ne mérite de souffrir ». Robert Guédiguian garde espoir dans le progrès au service de l’humanité, source de son engagement communiste, même s’il juge aujourd’hui qu' »il faut travailler dans le cadre du capitalisme pour fabriquer du socialisme« . Les effets de la crise sanitaire lui donneraient même raison…
Le souvenir des gilets jaunes met une belle pression dans l’esprit de ceux qui veulent encore dégrader la protection sociale.
Donnant l’exemple de Donald Trump qui a ordonné à General Motors de fabriquer des respirateurs artificiels, vous expliquez que la crise sanitaire a donné lieu à des « moments communistes ». Pensez-vous qu’elle peut redonner une certaine actualité au communisme?
On savait que « le capitalisme porte la guerre comme la nuée l’orage », comme le disait Jaurès (NDLR: président du Parti socialiste français de 1902 à 1905). On ne savait pas qu’il portait aussi des virus, des épidémies et la fin de la planète. Il me semble que ce désastre que constitue la crise sanitaire crée un climat plus propice à des moments communistes, des moments où les individus vont dans le même sens, développent une forme d’harmonie en considérant qu’il faut faire société. Faire société, cela signifie partager les richesses, tester de nouveaux modes de vie de manière assez urgente et en revenir à l’idée de « communs », la racine même du mot « communiste ». Il faut vraiment réfléchir à ce qui nous est commun. Le capitalisme de la petite entreprise, souvent quasiment autogérée, est un capitalisme dynamique, j’allais dire de proximité. Le patron connaît son métier ; il travaille avec ses salariés ; l’écart entre leurs salaires n’est pas énorme. On n’est plus dans l’exploitation comme on l’entendait au début du XXe siècle. Ce capitalisme-là, qui a une forme coopérative, je veux bien qu’on l’encourage. Mais il faut d’urgence démanteler les multinationales et que les politiques reprennent les rênes de l’économie.
Bio express
1953 – Naissance à Marseille, le 3 décembre.
1981 – Réalise son premier film, Dernier été, avec Ariane Ascaride, son actrice fétiche et sa compagne.
1985 – Sortie de Ki lo sa?.
1997 – Prix Louis-Delluc pour Marius et Jeannette, dans la sélection Un certain regard du Festival de Cannes.
2005 – Le Promeneur du Champ-de-Mars, sur François Mitterrand.
2011 – Les Neiges du Kilimandjaro.
2017 – La Villa.
2021 – Twist à Bamako. Sortie prévue en Belgique en ce début d’année.

Pourquoi insistez-vous sur une « nationalisation » du secteur de la santé?
Le constat vaut pour la France. Mais je crois que c’est le cas dans d’autres pays. Le système de santé publique était dix à quinze fois meilleur il y a vingt ans qu’il ne l’est aujourd’hui. Il est sur le déclin parce qu’on l’a soumis aux méthodes du secteur privé. Aucun spécialiste ne peut nier cela. Si on considère que toute personne a le droit d’être soignée, il faut déconnecter tout le système de santé du marché et assurer les leviers de son financement.
Le « printemps marseillais » – l’union des formations de gauche victorieuse des élections municipales de 2020 – vous avait fait espérer un scénario semblable à l’échelon national pour le scrutin présidentiel. Ce ne sera pas le cas. Qu’est-ce que cela vous inspire?
Jamais la gauche n’a remporté d’élection, en France, sans être unie. Il n’y a pas de solution, hors l’union. Dans un groupe, on peut préférer un tel ou un tel. J’ai des préférences. Mais je sais que sans union, il ne peut rien se passer. Donc, je place l’union avant mes préférences parce que je veux gagner. On dirait que les partis de la gauche ne veulent pas gagner ou tablent sur une possible victoire à d’autres échéances. Mais pendant ce temps-là, des tas de gens vivent mal, font face à des engagements qu’ils ont très difficile à tenir. Grosso modo, dix millions de Français souffrent de pauvreté, aujourd’hui. On n’a pas le droit de leur dire: on verra dans cinq ans ce qui se passera. Il faut agir tout de suite.
La gauche française n’a-t-elle pas négligé la classe ouvrière ces dernières années? Beaucoup de personnes issues du monde ouvrier votent pour le Rassemblement national et Marine Le Pen.
C’est une analyse un peu désuète. A Marseille, par exemple, la liste du candidat de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a pris énormément de voix, lors des élections législatives de 2017, au Rassemblement national. D’abord, il y a beaucoup moins d’ouvriers qu’avant. Avec la désindustrialisation et la délocalisation, ils sont dans des pays moins développés que les nôtres. Notre classe ouvrière du XIXe siècle et du début du XXe siècle a disparu. La conscience de classe n’est plus la même. Aujourd’hui, les pauvres gens ne forment plus une classe. Ils travaillent pour des plateformes ou dans des magasins. Ils sont salariés ou indépendants. Des tas de gens ne gagnent pas grand-chose. Mais le monde du travail est très différent. Ils ne quittent pas le travail à 17 heures quand retentit la sonnerie. Ils ne se retrouvent pas au bistrot du coin. Ce monde-là, avec une unité dans l’espace et dans le temps qui forgeait quasi physiquement une conscience de classe, a disparu. Cette conscience-là, elle ne pourra revivre qu’à travers de la pédagogie et de l’éducation, qu’à travers des luttes concrètes, qu’à travers des associations, des partis et des syndicats. Si la gauche décline en Occident, ce n’est pas uniquement le fait de dirigeants qui ont fauté. Le phénomène s’explique aussi par le mouvement de restructuration du capitalisme qui a disséminé les pauvres gens et a affaibli les partis qui les représentaient.
Pourquoi faut-il « remercier » les gilets jaunes pour leur mobilisation en 2019 et 2020?
Très simplement parce qu’ils ont fait peur à la bourgeoisie. La bourgeoisie et les gens qui la représentent ont eu peur. Une grève par-ci, par-là, une manifestation de temps en temps, ça va. Mais avec les gilets jaunes, ils se sont dit: « Merde, tous les samedis, des types viennent manifester dans les rues et empêchent les commerces des Champs-Elysées d’ouvrir. » Ça, c’est très ennuyeux. D’ailleurs, il est rare que des manifestations aient suscité des réactions policières aussi violentes que celles que l’on a observées à l’encontre des gilets jaunes. Les forces de l’ordre ont très mal rempli leur fonction. Il est difficile de savoir ce que le mouvement des gilets jaunes a laissé dans les mémoires. On peut quand même penser que certains responsables politiques réfléchiront avant de lancer telle ou telle réforme de peur qu’elle ne ravive les gilets jaunes. Cela met une belle pression dans la tête de ceux qui veulent encore dégrader la protection sociale. Elle peut freiner leurs ardeurs.

L’usage de la violence se justifiait-il dans ce cadre? Vous écrivez qu’il est justifié quand il n’y a pas d’autre alternative…
L’opportunité du recours à la violence est une question qui a traversé l’histoire. Pour répondre très simplement, la violence est légitime quand il n’y a pas d’autre solution à une confrontation. Quand on appelle aujourd’hui « violence » une vitrine brisée ou une Mercedes malmenée dans les beaux quartiers de Paris, cela me fait sourire. Pour moi, la violence, ce n’est pas ça. La violence, c’est quand on jette des Algériens à la Seine en octobre 1961 (NDLR: répression par la police d’une manifestation d’Algériens, à Paris, réclamant l’indépendance de leur pays). Ça oui, c’est de la violence.
Je crois qu’au fond du fond du fond…, il reste une petite trace de racisme même chez le plus farouche antiraciste.
Emmanuel Macron aura-t-il été le « président des riches »?
Oui, hormis dans le « quoi qu’il en coûte » de la crise sanitaire. Là, on a assisté à un moment de communisme nécessaire pour que le capitalisme s’humanise. Ce qui n’empêche pas de constater que les mesures qu’il avait prises avant la pandémie et qu’il recommence à prendre aujourd’hui sont des dispositions de droite dans la lignée de ce qui se faisait avant. Contrairement à ce qu’il prétend, il continue de fonctionner comme dans l’ancien monde. Pour preuve, sa réforme de l’assurance-chômage (NDLR: qui prévoit une dégressivité des allocations). Mais, en même temps, Emmanuel Macron a l’habileté tactique de toujours glisser, dans une mauvaise réforme, quelque chose qui n’est pas trop mal. En l’occurrence, un minimum social plus élevé que ce qu’il était auparavant…
La démocratie représentative continue à avoir vos faveurs. Pourtant, elle est régulièrement remise en cause. Comment lui redonner du souffle?
L’adéquation entre le système politique et la société qui évolue est à réinventer en permanence. Avec de nouvelles lois, de nouvelles manières de faire… Ce n’est pas à moi de dire s’il faut une limitation des mandats, s’il est préférable d’être élu pour quatre, cinq ou sept ans, comme on contrôle effectivement les élus… Cela doit être soumis à discussion. Mais j’ai beau me creuser la tête, je ne vois pas d’autre système que celui qui consiste à voter pour un représentant. Si on est dix personnes dans un petit village, on peut se réunir tous les jours et décider de tout ensemble. C’est très agréable. Mais dès que l’on est cinquante, cent, dix mille, un million ou cinquante millions, je ne vois pas très bien comment on peut agir sans représentation politique. La démocratie représentative doit être surveillée de très près pour la faire fonctionner le mieux possible. Mais l’Etat, on ne peut pas s’en passer. C’est un voeu pieux. Quand on me dit que les députés pourraient être tirés au sort, je trouve cela ridicule. Je préfère voter pour quelqu’un que je connais, qui me parle, dont je sais le parcours, les qualités, les diplômes, les compétences… que d’être dirigé par des personnes tirées au sort. Autre proposition, le référendum d’initiative citoyenne, OK, pourquoi pas? Mais il ne peut exister que s’il cohabite avec le fonctionnement normal de la démocratie représentative. On ne va pas organiser un référendum toutes les semaines…
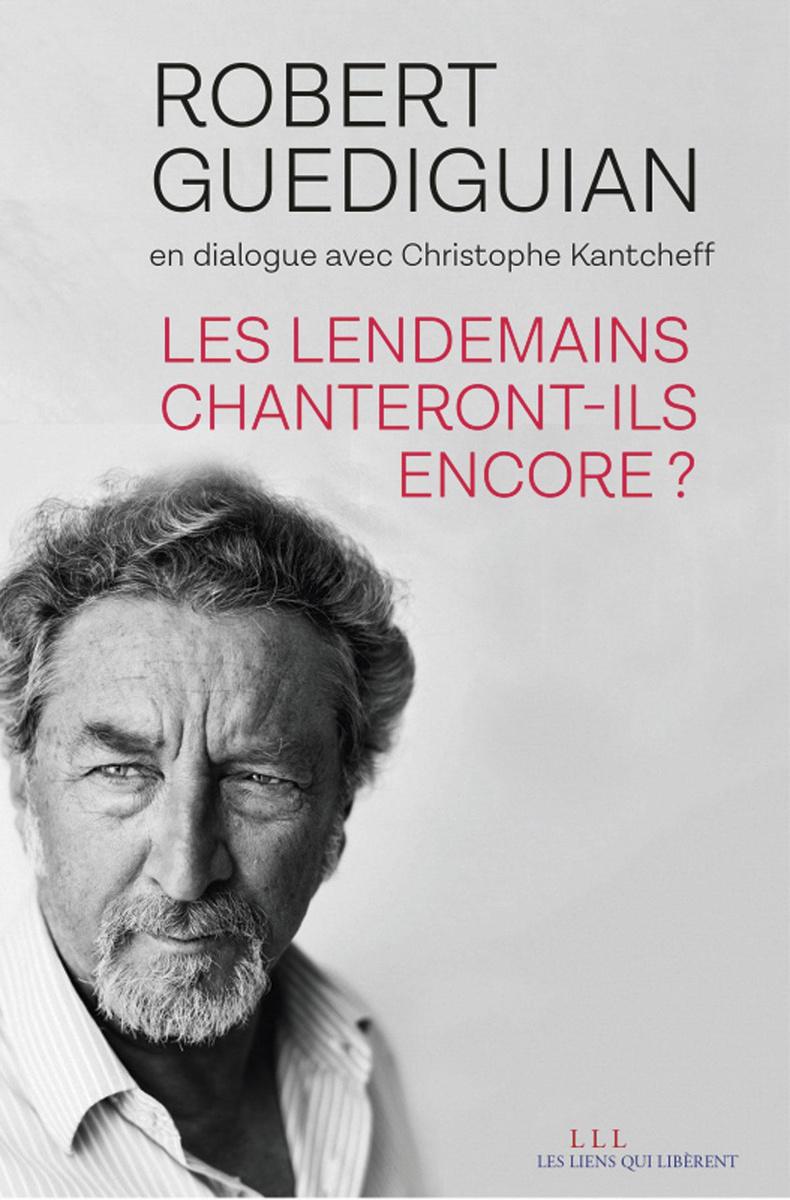
« Mon identité, c’est la biographie », écrivez-vous. Qu’est-ce que cela implique, selon vous? Et pourquoi parle-t-on tant d’identité en France?
Là, j’en parle de manière presque philosophique et pas de manière politique. Les identités, ce sont des moments de vie. Je ne connaîtrai mes identités que le jour de mon dernier souffle. Mon identité, je l’ai construite au fur et à mesure de ma vie autant que j’ai hérité de choses qui appartenaient à mes ancêtres et aux terres d’où je viens. L’identité est devant nous ; elle n’est pas statique ; elle se construit tout au long de la vie. Pourquoi en parle-t-on beaucoup aujourd’hui en France? Parce qu’il reste en nous des traces profondes de l’ancien fonctionnement du monde. Prenons la question du racisme. Je crois qu’il y a, qu’il reste, profondément enfoui dans le cerveau de chaque Français ou de chaque Belge, un tout petit peu de racisme. Parce qu’on a considéré, pendant des générations et des générations, par exemple, que les Africains nous étaient inférieurs. Moi, au moment où je vous parle, je considère évidemment qu’il est horrible de penser cela. Mais je crois qu’au fond du fond du fond…, il reste une petite trace de racisme même chez le plus farouche antiraciste. Face à cela, si un Africain qui se promène en France ou en Belgique me raconte qu’en certaines circonstances, il lui arrive de ne pas être considéré comme faisant partie de l’humanité, je comprends qu’il ait un ressenti différent du mien qui suis Blanc parce que moi, ce sentiment, je ne l’ai pas. Je peux avoir le sentiment d’être exploité par un patron. Je peux avoir le sentiment d’être humilié par des policiers. Jamais je n’aurai le sentiment de ne pas être considéré comme un homme, de ne pas faire partie de l’humanité, à l’instar de ce qu’on disait au temps de l’esclavage. Selon les théories de l’esclavagisme, les Noirs étaient considérés comme des meubles et pas comme des hommes. Cela a laissé des traces profondes, même si je n’ignore pas que la situation change.
Il y aurait donc encore, dans nos sociétés, un reliquat de la domination occidentale?
Bien sûr. Mais disant cela, je ne me repens d’absolument rien, parce que je ne m’en considère pas responsable.
Ne pas vouloir se faire vacciner par principe, est-ce la défaite du collectif au profit de l’individualisme?
Il y a quelque chose de cet ordre-là. Peut-on refuser aujourd’hui la vaccination, au nom de la liberté, alors que l’on sait qu’elle est le meilleur moyen de lutter contre cette pandémie et d’éviter que les autres attrapent la Covid? Mais il y a plus grave encore que ce constat. Agir ainsi, cela signifie ne plus croire en la science. Dans le livre, je cite Platon qui disait: « Lorsque les pères s’habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu’ils ne reconnaissent plus au-dessus d’eux l’autorité de rien ni de personne, alors c’est là, en toute beauté et en toute jeunesse, le début de la tyrannie. » Voilà ce qui me fait peur dans cette attitude. Cela étant, il faut aussi dire que lors de cette pandémie, tous les scientifiques se sont mis à parler en direct à la télévision et, donc, à quasiment réaliser leurs recherches devant nous. Auparavant, les scientifiques tâtonnaient longtemps dans les laboratoires à l’abri de nos regards. Aujourd’hui, ils tâtonnent sur les plateaux de télé devant nous. Ce n’est pas forcément rassurant. Pour autant, je n’ai jamais douté de leurs capacités. Il est formidable, d’un point de vue scientifique, d’avoir inventé un vaccin aussi vite. Et il n’y a pas lieu de discuter tous les jours de son efficacité.
A la fin de votre livre, vous vous demandez si vous avez perdu la foi et vous répondez que vous cherchez, avec une vitalité désespérée, des espaces où la réinvestir… Y a-t-il une forme de spiritualité dans votre engagement communiste?
Oui. Je crois profondément à l’engagement. Je considère que le paradis, il faut le faire advenir sur Terre. Etre communiste, pour moi, c’est une éthique, une manière d’être, une façon de penser le monde. La richesse doit être partagée. La planète appartient à tout le monde. C’est Sitting Bull, le chef indien d’Amérique qui disait lorsque les siens se faisaient massacrer par les colons: « C’est l’homme qui appartient à la Terre ; ce n’est pas la Terre qui appartient aux hommes. » Toutes ces idées-là participent de quelque chose de spirituel qui représente, de manière abstraite, notre humanité.
(1) Les Lendemains chanteront-ils encore? , par Robert Guédiguian, en dialogue avec Christophe Kantcheff, Les Liens qui libèrent, 240 p.
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici