
Plagiat : littérature de haut vol
On ne vole pas un livre de la même manière qu’on dérobe un tableau de maître. Polymorphe, honteux, tabou, le plagiat littéraire interroge autant le droit d’auteur que les pouvoirs de la fiction. Illustration par l’affaire ayant déchiré, en 2007, les romancières françaises Marie Darrieussecq et Camille Laurens.
Michel Houellebecq défrayant la chronique pour avoir recopié des notices issues de Wikipédia dans La Carte et le Territoire, Patrick Poivre d’Arvor accusé d’avoir intégré des paragraphes entiers d’une référence américaine dans sa bio d’Ernest Hemingway, le journaliste et écrivain Joseph Macé-Scaron reconnaissant ce que certains passages de ses livres devaient en fait à Cioran, Giono et Bill Bryson ou, plus récemment, Helene Hegemann, jeune frondeuse allemande qui revendiquait dans son livre Axolotl Roadkill le droit inconditionnel à « l’emprunt » et l’on en passe : encouragé par une ère numérique qui fluidifie les échanges et ralentit les scrupules, le plagiat sous toutes ses formes (des plus serviles aux plus créatives), fait régulièrement tache dans le paysage littéraire. Les procès pour recopiage littéraire passionnent, laissant le lecteur au choix déçu ou amusé devant tant d’audace et d’espoir d’impunité. Née avec l’invention du droit d’auteur (concept flottant jusqu’à ce que la protection juridique se concrétise à la fin du XVIIIe siècle), la notion de vol, quand elle concerne la chose littéraire, vise forcément moins la détention de ses pages (le livre est un objet d’art indéfiniment reproductible) que la matière, nécessairement plus flottante, qu’elles traduisent. Siphonner un paragraphe remarquable, faire main basse sur une tournure de phrase jalousée, fondre les mots d’un autre dans les siens sont autant de manifestations de son vice. Et parfois l’occasion de remettre en perspective les buts et définitions de la littérature même. A cet égard, l’une des plus passionnantes affaires de ces dernières années aura sans doute été celle ayant opposé Marie Darrieussecq et Camille Laurens à la rentrée littéraire de 2007. Rappel des faits.

En 2007, Marie Darrieussecq publie Tom est mort, l’histoire d’une mère qui perd son enfant de 4 ans. A la lecture du livre, bientôt de toutes les sélections pour les grands prix d’automne, Goncourt en tête, la romancière Camille Laurens y reconnaît quelque chose de Philippe, récit qu’elle faisait paraître en 1999 sur le traumatisme ayant suivi le décès de son fils mort-né, qui plus est sous la même couverture blanche POL (les deux femmes partageant à l’époque le même éditeur). Stupeur dans le petit monde littéraire parisien, et bientôt au-delà. Car ce n’est pas la première fois que Marie Darrieussecq est taxée de copieuse. En 1998, c’est Marie Ndiaye qui l’accusait de s’être servie de son roman La Sorcière pour élaborer Naissance des fantômes. « Aucune phrase, rien de précis : on n’est pas dans le plagiat mais dans la singerie », dira Ndiaye. Difficilement recevable, l’argument n’aura pas de suite. Il n’empêche : il crée un précédent médiatique qui, neuf ans plus tard, ouvrira une voie royale à Camille Laurens, aggravant de fait les soupçons de malhonnêteté à l’égard de Darrieussecq.
En 1998 déjà, Marie Ndiaye accusait Darrieusecq d’avoir plagié son roman « La Sorcière ».
Plagiat psychique
Qu’aurait donc volé l’écrivain dans Tom est mort ? Camille Laurens le reconnaît d’emblée : il s’agit ici d’un plagiat singulier. Il suffit d’ouvrir les deux livres pour s’en convaincre : si « emprunts » il y a, ils ne sont pas identifiables mot à mot, ni explicitement perceptibles par le lecteur. Tout comme Ndiaye avant elle, la romancière parlera plutôt de similarité des scènes, de parenté des images voire de « modulations de phrases » : son accusation concerne le domaine de l’inspiration, du climat, et des idées. Dans l’article virulent qu’elle fait paraître alors dans La Revue littéraire, « Marie Darrieussecq ou le syndrome du coucou » (titre hautement ironique : le coucou est un oiseau qui pond ses oeufs dans le nid des autres), Camille Laurens déclare notamment : » J’ai eu le sentiment en le lisant que Tom est mort avait été écrit dans ma chambre, le cul sur ma chaise ou vautrée dans mon lit de douleur. Marie Darrieussecq s’est invitée chez moi, elle squatte. » Ce que Laurens reproche à Darrieussecq, c’est d’avoir écrit un roman à la première personne, et imaginé en « je » une expérience traumatique qu’elle n’a pas vécue. Non pas un livre de deuil, mais un livre sur le deuil. Pour Camille Laurens, c’est clair : puisque Darrieussecq n’a pas vécu dans sa chair ce sur quoi elle se permet d’écrire, elle doit donc avoir pillé quelque chose de sa propre souffrance. Sur les ondes de France Inter, elle explicitera sa diffamation : « Quand je raconte (NDLR : dans Philippe) que je me mets parfois devant ma glace et que j’essaie de retrouver le visage de mon enfant et que je vois que Marie Darrieussecq raconte ça, je me dis que ce n’est pas quelque chose qu’elle a imaginé, je me dis que c’est quelque chose qu’elle a pris chez moi, j’estime que je suis dépossédée de quelque chose. Pour moi, c’est un problème moral. » Elle ajoutera : « J’ai lu Tom est mort dans un vertige de douleur, le sentiment d’une usurpation d’identité, la nausée d’assister par moments à une sorte de plagiat psychique. » Plagiat psychique : le concept est inédit, pour le moins flou et impénétrable (il vise quelque chose comme un prélèvement effectué sur l’âme d’un romancier).
Défaillante, trop intime, trop abstraite : tout comme à l’époque de Ndiaye, l’affaire ne sera pas suffisamment solide pour prétendre aux tribunaux. Dans son essai Du plagiat, publié peu après, la professeure de littérature Hélène Maurel-Indart contestera la possibilité de copié-collé entre deux textes au traitement stylistique trop différent, faisant remarquer que, si certaines situations et certains sentiments passent effectivement étrangement d’un livre à l’autre, « ils sont ceux auxquels une mère endeuillée est inévitablement confrontée dans la réalité ; comment pourraient-ils être le monopole de tel ou tel écrivain ? Ils ne sont pas susceptibles d’appropriation ou de vol. »

De son côté, Paul Otchakovsky-Laurens, l’éditeur des deux femmes (et incontestablement une figure de « père » au sein de la petite structure familiale) prendra fait et cause pour Marie Darrieussecq contre sa soeur ennemie, s’adressant à cette dernière par l’intermédiaire d’une tribune qu’il fera paraître dans Le Monde. L’article, au titre limpide (« Non, Marie Darrieussecq n’a pas plagié Camille Laurens ») fera grand bruit, et pour cause : en même temps qu’il l’évince publiquement de sa maison, l’éditeur parisien confrontera la romancière à une question édifiante : « Cela veut-il dire que désormais tout romancier devra justifier d’une expérience avant de la faire vivre par ses personnages ? Faudra-t-il tuer pour mettre en scène un assassin ? Dostoïevski l’a échappé belle, et pas seulement lui. » L’argument est imparable : on voit bien comment le raisonnement de Laurens pourrait, si l’on n’y prend pas garde, museler l’ambition même de la fiction. Il n’empêche : le trouble semé est persistant, et une accusation de cette nature difficilement soluble dans l’air…
Faudra-t-il tuer pour mettre en scène un assassin ? Dostoïevski l’a échappé belle, et pas seulement lui
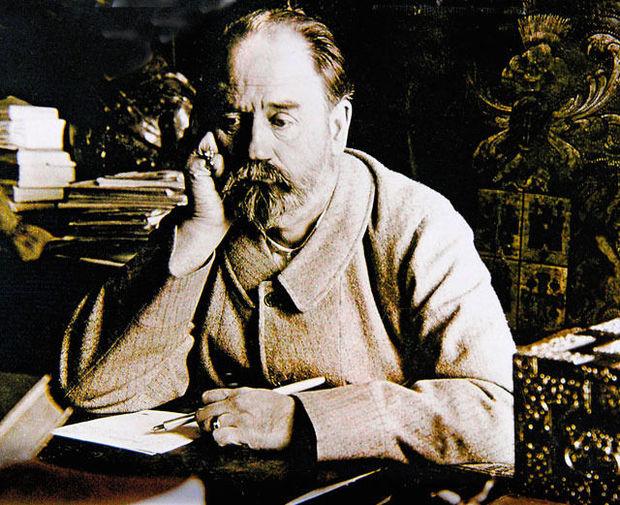
Surveiller la fiction
Pendant ce temps, Darrieussecq, elle, fomente sa réponse. Deux ans plus tard, l’auteure de Truismes fera paraître Rapport de police, son premier et son seul essai à ce jour, passionnante réplique intellectuelle à ce qu’elle considère comme une double (Ndiaye, Laurens) tentative d’assassinat symbolique. Remontant le fil de l’histoire littéraire à la recherche de ses grands scandales de plagiat (des affaires ayant éclaboussé Zola, Mandelstam ou Daphné du Maurier, en passant par le cas de l’écrivain d’origine yougoslave Danilo Kis, que l’on a accusé, de manière étonnamment similaire, de « vol spirituel et d’absence de citation »), elle y parlera d’une dénonciation calomnieuse – dont elle fera le néologisme « plagiomnie ». Dans ce livre cathartique, qui renvoie dos à dos dénonciateurs et accusés, elle montrera que la » plagiomnie » peut être vue comme un mode de méfiance, voire de surveillance à l’égard de la fiction. Pire : la preuve d’une incompréhension fondamentale de ses codes. Surtout, Darrieussecq y rappelle que le débat des droits respectifs de la fiction et du réel est aussi vieux que la littérature. Et qu’entre Platon (qui affirmait qu’Homère n’avait pas le droit de parler de la guerre, puisqu’il ne l’avait pas faite) et Aristote (qui encourageait les auteurs à donner dans la tragédie et l’épopée comme une tentative de libérer le monde de sa violence), elle a, plus que jamais, choisi son camp. « Au bout du compte, il y a chez certains le sentiment que puisque la fiction invente, elle ne peut que voler les textes sacrés que sont les autobiographies. Bref, elle ne serait qu’une pâle copie des textes qui disent la vie. Moi, je pense que le roman peut dire la vérité, rendre compte du monde, de façon aussi valide et légitime que l’autobiographie ou l’autofiction. »
Le droit, à la littérature, non seulement de faire vrai, mais de dire vrai. C’est ironique : à relire toute l’affaire, la sortie de Camille Laurens pourrait d’ailleurs finalement presque être vue comme le meilleur des arguments fournis à la défense… Car à l’instant où elle est percutée par la mise en scène littéraire d’une autre à qui elle reproche d’avoir annexé ses larmes, la romancière « plagiée » n’est-elle pas, de fait, en train de l’accuser d’avoir inventé trop juste ? N’est-elle pas en train, par là même, de valider les vertigineux et définitifs pouvoirs (de substitution, d’identification, de sublimation, de catharsis, de métabolisation, peu importe) de la fiction ?
Depuis, Camille Laurens a repris l’écriture, autrement, ailleurs (elle est publiée chez Gallimard aujourd’hui). Et Marie Darrieussecq donné un essai dense et captivant qui fera date dans l’histoire de la pensée. Né de la littérature, l’affrontement des deux écrivaines les y a fait replonger de plus belle, non sans avoir suscité de très inconfortables interrogations. Donc aussi de nouvelles pistes, contre les automatismes, les répétitions et les scléroses de la pensée. A la sortie de Rapport de police, Marie Darrieussecq ne disait finalement peut-être pas autre chose, malicieuse : « Si je crains d’être plagiée ? Non, ma plus grande peur, confiait-elle, serait de m’autoplagier. »
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici