
Orhan Pamuk : « Je suis fasciné par les personnes aux idées radicales» (entretien)
Villes versus campagnes, progressistes vs conservateurs, religieux vs laïques: cette dichotomie, qui fait partie du débat social turc, est trop simple, estime le prix Nobel de littérature. En chacun de nous sommeillent à la fois de la modernité et du conservatisme.
Il faut avoir de la chance, avec Orhan Pamuk. Notre première rencontre, il y a une vingtaine d’années, à l’occasion de la publication de son cinquième roman, le chef-d’œuvre Mon nom est Roug (1998), s’était transformée en une joyeuse après-midi. L’ écrivain, alors peu connu, n’avait cessé de rire et imitait toutes sortes de personnages: un militaire se plaignant de ses articles dans la presse, un rédacteur en chef appelant pour s’excuser parce que l’écrivain serait attaqué le lendemain à la Une de son journal. En 2017, quinze ans et cinq romans plus tard, c’est un Pamuk fatigué et méfiant que nous avions retrouvé à Amsterdam pour la promotion de son livre La Femme aux cheveux roux (2017). Il ne cessait de regarder sa montre – pas question de nous accorder ne fût-ce qu’une minute de plus – et était très agacé lorsqu’on faisait allusion aux critiques de ses confrères turcs.
Mon devoir est de susciter de l’empathie, y compris envers les individus les plus méprisables.
Lors de ce nouveau rendez-vous à l’occasion de la publication de son dernier ouvrage, Les Nuits de la peste (1), nous ne parlerons pas du président turc, Recep Tayyip Erdogan. Nos discussions doivent rester centrées sur le livre, a averti la maison d’édition. Mais ce jour-là, l’auteur est de bonne humeur. Du haut de ses 70 ans, il lâche des blagues dont il rit lui-même à gorge déployée et se dit ravi lorsqu’il apprend que nous avons fait des recherches systématiques sur les faits et personnages historiques cités dans son roman de près de sept cents pages. On pourrait qualifier Les Nuits de la peste de long «documenteur» littéraire sur une épidémie ayant ravagé l’île méditerranéenne fictive de Minger en 1901, sous le règne du sultan ottoman Abdülhamid II (1842 – 1914). La narratrice est la chercheuse et historienne Mina Mingerli, l’arrière-petite-fille imaginaire de la tout aussi fictive sultane Pakize, cadette du souverain déchu Murat V (1840 – 1904). Avec un grand sens aigu du détail, elle raconte l’histoire de ses arrière-grands-parents qui, pendant un voyage (réel) en Chine, se voient soudain confier la mission d’aider à lutter contre la peste sur l’île. Mission qui échoue. Alors que les fossoyeurs sont débordés, la communication avec le reste de l’empire est coupée et l’île est placée sous un blocus international. Leur ancien garde du corps, le chef d’escadron Kamil, déclare l’indépendance. Il devient président et dirige l’île avec Sami Pasja, l’ex-gouverneur de Minger. Après leur décès, la malheureuse île se retrouve aux mains d’administrateurs divers, des fondamentalistes musulmans à des têtes couronnées, en passant par un ancien chef de la sécurité.
Pamuk utilise ces intrigues pour aborder des thèmes qui lui sont chers, comme les relations Est-Ouest, la légitimité politique, la portée de la religion, la répression et la force destructrice de la méfiance civique. Le lecteur est-il aussi placé face à un miroir de la crise sanitaire actuelle? Pamuk affirme que non et souligne surtout les différences. «Une personne sur trois en contact avec la peste en est morte», alors qu’à peine 1% des personnes ayant contracté le Covid sont décédées. Et nous disposons de vaccins, nous ne sommes plus aussi effrayés qu’au début. Autre différence, encore plus fondamentale: seuls 5% des citoyens ottomans savaient lire et écrire. Aujourd’hui, en Turquie, ils sont 95%.

En quoi l’alphabétisation de la population marque-t-elle une distinction si essentielle?
En 1901, aucune communication n’était possible à l’exception du télégraphe, réservé aux puissants bureaucrates et à l’élite. En 2021, tout le monde regardait la télévision quotidiennement et un nombre quasi infini de sites Internet pouvaient être consultés. Dans le livre de Daniel Defoe, Journal de l’année de la peste, qui parle de l’épidémie de peste à Londres en 1665, nous rencontrons deux personnages issus de deux quartiers différents et qui s’informent sur ce qui se passe dans leur zone respective. La situation est catastrophique dans le nord, explique le premier, elle est catastrophique dans le sud, estime le second, mais fondamentalement, ils n’ont aucune idée de ce que veut dire leur interlocuteur. Rien de comparable avec notre expérience au cours des premiers mois de la pandémie. Chaque jour, nous avons vu, lovés dans nos maisons douillettes, les cercueils des victimes italiennes, nous avons entendu le gouverneur de New York et nous avons assisté aux bûchers funéraires en Inde. Cela nous a encore plus effrayés, ce qui explique pourquoi nous avons fini par respecter les recommandations. Du moins la plupart des gens.
Le thème de la peste vous fascine depuis longtemps. Vous l’abordez déjà dans La Maison du silence (1983) et Le Château blanc (1985). D’où vous vient cet intérêt?
Dans La Maison du silence, l’historien Faruk étudie en effet de vieux documents pour comprendre ce qu’était la peste au XVIe siècle. Dans Le Château blanc, on assiste à un combat de supériorité entre Hodja, un Ottoman, et un esclave vénitien, où le premier aborde les épidémies de peste en faisant confiance à son dieu, tandis que l’autre pense qu’il faut combattre la maladie activement. Ce phénomène m’occupe depuis 45 ans, mais mes idées ont évolué au fil des années. Tout d’abord, l’objectif était d’écrire un roman existentiel, ensuite un livre sur le fatalisme des musulmans. A cette époque, je venais de lire L’Orientalisme d’Edward Said, un homme que j’admire et que je respecte. Plus tard, je me suis rendu compte qu’il y avait aussi une certaine vérité dans l’idée d’un fatalisme islamique. Au même moment, en mars 2020, nous avions un leader musulman comme Erdogan qui a fermé les mosquées du jour au lendemain. Le monde n’est-il pas plein d’ironie?
Qu’est-ce qui vous intéresse tellement dans cette problématique?
Que la mort soit très visible. Elle vous fait comprendre la valeur de votre vie et de votre individualité. Je m’intéresse à la façon dont les gens changent lorsque la mort les attend au coin de la rue.
A en croire son année de naissance, 1880, il semblerait que la sultane Pakize soit inspirée de la sultane Aliye, fille cadette du sultan déchu Murat V. En réalité, elle ne s’est jamais mariée et décède à l’âge de 23 ans de problèmes pulmonaires.
En effet, mais n’ai-je pas droit à une certaine liberté? (il rit) Ne puis-je pas «ciseler» un peu Aliye? Je pense que cette transformation fictive est moins radicale que l’invention d’une île comme Minger, non?
Quel était votre objectif en jouant entre fiction et faits historiques?
Ce livre ressemble quelque peu à Neige (2002), dont l’histoire se déroule également dans un parfait isolement. Dans Neige, j’ai opté pour une ville réelle, ce qui a provoqué une vague de critiques. La population locale a dénoncé de nombreuses «inexactitudes». Pour éviter de nouvelles critiques, j’ai cette fois choisi un lieu fictif. En outre, le sujet du roman n’est pas l’île, car fondamentalement, le lieu n’a aucune importance. Les derniers jours de l’Empire ottoman occupent une place centrale et sont encore plus visibles sur l’île fictive.

Pourquoi, alors, n’avoir pas opté pour la pure fiction?
Avec quelque chose dans l’esprit des Voyages de Gulliver? Ce livre est beaucoup plus burlesque que mon roman mais, en même temps, il fait totalement référence à la situation en Angleterre à cette époque-là (NDLR: l’ouvrage date de 1726). Il n’est donc pas entièrement fictif. Prenez Les Démons de Dostoïevski, le roman le plus politique de tous les temps. L’ histoire se passe dans une ville anonyme non loin de Saint-Pétersbourg, alors qu’en réalité, c’est toute la Russie qui est présente dans ce roman. Mon livre s’inscrit dans cette tradition.
La seule action positive des extrémistes religieux dans le roman consiste à distribuer du pain à la population. Erdogan ne peut même pas le faire, car l’économie est à genoux.
Vous présentez la peste comme un terreau propice à la naissance d’une nation.
Il s’agit surtout de mauvaise gestion du centre de pouvoir dans cette province éloignée. J’aurais aussi bien pu me baser sur la lutte contre la criminalité ou contre une mauvaise politique économique. Le problème est qu’ Abdülhamit et sa bureaucratie ne peuvent résoudre la question cruciale de la peste. Les habitants de l’île veulent sauver leur peau et comprennent qu’ils doivent se débarrasser du sultan et se débrouiller seuls. En parallèle, la nostalgie de l’immense empire ottoman se retrouve dans des personnages comme le gouverneur Sami Pasja. Mon objectif était de montrer tout le spectre des sentiments. N’oublions pas que les grands-parents de mon père ressemblaient aux bureaucrates et aux scientifiques des derniers jours de l’Empire…
Le jeune Etat Minger voit défiler un cortège de nouveaux dirigeants qui, pour la plupart, ne recueillent pas beaucoup de succès.
Pour moi, il s’agit d’une prise de conscience fondamentale. La plupart du temps, dans le débat sur la mentalité turque, on arrive rapidement à la dichotomie villes-campagnes, progressistes-conservateurs, religieux-laïques, et on se chamaille pour savoir qui représente 60% de l’un et qui représente 40% de l’autre. Il ne faut pas voir les choses ainsi. Nous avons tous en nous une dose de modernité et de conservatisme, de science et de tradition. Les humains sont des êtres complexes, les plus grands positivistes ont des idées traditionnelles, les plus grands fanatiques religieux ne jurent que par certaines idées scientifiques. Ce serait trop facile d’approcher les gens et les nations de manière essentialiste. Shakespeare et Dostoïevski l’avaient bien compris.
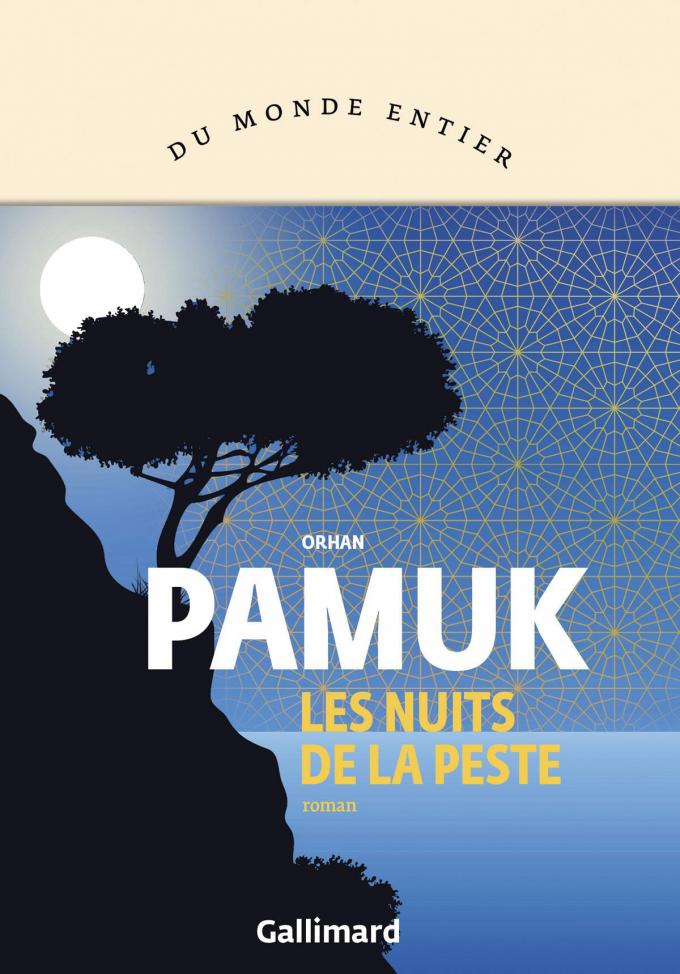
Dans votre roman, les pères fondateurs de la nation se fient à la science et mènent une politique de quarantaine, mais ils dansent sur la corde raide: ils essaient de limiter l’influence des communautés religieuses sans pour autant perdre leur soutien. De qui vous êtes-vous inspiré?
Insinuez-vous que Sami Pasja soit inspiré d’Erdogan? Je ne le pense pas. La motivation pour créer ce duo repose sur le constat que, pour lutter contre une pandémie, les pouvoirs publics deviennent inévitablement autoritaires. J’ai voulu écrire sur la cruauté de la bureaucratie, mais également sur la chute de l’Empire ottoman. Dans bon nombre de mes romans, vous trouverez des personnages d’extrême droite, mal-pensants. Je suis fasciné par les personnes aux idées radicales. En tant que romancier, je considère que c’est mon devoir de susciter de l’empathie, y compris envers les individus les plus méprisables. Cela m’a valu de nombreuses critiques. Après Neige, on m’a reproché d’avoir rendu acceptable la logique des terroristes. C’est exact, mais je n’ai pas justifié le terrorisme. Cette frontière est fondamentale. L’ art du roman est la possibilité de s’identifier avec des personnages qui sont très différents de l’auteur et de ses lecteurs. Même si cela implique que je me trompe parfois, c’est le type d’écrivain que je souhaite être. Quelqu’un qui suscite de l’empathie envers les méchants. La création d’un personnage riche, shakespearien, est beaucoup plus importante que l’entrelacement de messages politiques, qui peuvent en outre être mal interprétés.
Le président Kamil de votre livre pense qu’il est prédestiné. Que c’est son destin d’écrire l’histoire en tant que héros de l’indépendance.
Les gens qui se retrouvent au premier rang de l’histoire à des moments importants ont toujours tendance à être narcissiques. Dès qu’ils ont le sceptre du pouvoir en main, ils croient que ce n’est pas dû au hasard. Il y a des exceptions, mais elles sont rares.
Cet orgueil est sévèrement puni: Kami meurt de la peste, seul dans une petite chambre, peu après le décès de sa femme Zeynep, enceinte, qui lui brise le cœur. Les choses finissent tout aussi mal pour le gouverneur Sami Pasja.
Punir? Moi? (il rit) Mais à la fin, je veux aussi que les lecteurs compatissent avec Sami Pasja lorsqu’il se dirige vers la potence. C’est une des joies de l’écriture que de pouvoir jouer avec les sentiments des lecteurs, de faire en sorte qu’ils s’interrogent sur leur propre compassion.
Ensuite, le pouvoir tombe aux mains des extrémistes religieux…
La seule chose positive qu’ils font dans le roman est de distribuer du pain à la population. Erdogan ne peut même pas le faire, car l’économie entière est à genoux.
Le meilleur gouvernement est celui de la sultane Pakize et de son mari, le docteur Nuri.
C’est un conte car, dans l’islam, les femmes n’ont aucun pouvoir politique. Oui, nous avons un jour eu une femme Première ministre (NDLR: Tansu Çiller, 1993-1996) mais ce n’est pas à elle que je fais référence. Dans la communauté musulmane traditionnelle, les femmes sont invisibles. J’ai voulu m’amuser avec la fable d’une reine islamique. Derrière cela se cache cependant un raisonnement plausible: le pays est si petit et si jeune qu’il a besoin d’une visibilité internationale. C’est un plan astucieux d’utiliser la fille d’un sultan – qui sera aimée du peuple en raison de ses origines – comme porte-drapeau.
Suggérez-vous qu’un mélange d’empathie, de confiance dans les connaissances scientifiques, de sensibilité démocratique et de réalisme est préférable?
Elle réussit aussi parce qu’elle est une femme et parce que les gens en ont assez du pouvoir en place et de certains groupes sociaux. A moins qu’elle n’ait simplement eu de la chance et que la pandémie était de toute façon vouée à disparaître?
Finalement, le chef de la sécurité, Mazhar Effendi, évince la sultane Pakize et son mari. Il remporte la partie. Pourquoi ce retournement de situation?
Je ne l’avais pas prévu ainsi. Mais, c’est un fait, dans le monde où l’on vit, certains personnages vont très loin. Prenez Vladimir Poutine et sa carrière au KGB. Nous n’avons d’ailleurs pas le monopole: dans les années 1970, George Bush senior était également à la tête de la CIA. La réussite de tels personnages s’appuie sur le fait qu’ils font partie d’un cercle restreint de bureaucrates très puissants, ce qui leur ouvre la voie vers le pouvoir.
Les Nuits de la peste a été publié en Turquie en mars 2021. Comment y a-t-il été accueilli?
Le procureur général a ouvert une enquête moins d’un mois après sa publication, à la suite d’une plainte de l’avocat Tarcan Ülük. Il estimait qu’il y avait violation de l’article 301 du code pénal turc, qui concerne l’irrespect de l’identité turque, l’insulte au drapeau et à la mémoire de Kemal Atatürk. C’est faux. J’ai témoigné au tribunal et j’ai demandé sur quelle page se trouvait la soi-disant insulte. Je n’ai obtenu aucune réponse. L’affaire a été classée, mais elle a été rouverte en novembre. Nous attendons. Selon mon avocat, elle devrait disparaître dans le labyrinthe de la bureaucratie du ministère de la Justice à Ankara. Vous ne devez pas vous en faire pour moi.
Sur quoi porte cette plainte?
Je ne veux pas faire de commentaires sur une fausse accusation. S’ils vous accusent d’être une espionne japonaise, est-ce à vous de prouver que c’est faux alors qu’il est évident que vous ne l’êtes pas? Je refuse. Point final.
Bio express
1952 Naissance, à Istanbul, le 7 juin, dans une famille nantie, pro-occidentale.
1974 Son premier ouvrage, Cevdet Bey et ses fils, est refusé par les éditeurs et le sera pendant des années. Il ne sera publié qu’en 1982.
1977 Est diplômé en journalisme, après des années d’études (infructueuses) en architecture.
1985-1988 Séjourne aux Etats-Unis et donne depuis des cours à l’Université Columbia, à New York.
2006 Se voit décerner le prix Nobel de littérature. Il est le premier écrivain turc à recevoir cet honneur.
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici