
« Le monde de l’art est un archipel et pas un continent cerné de murs »
C’est le curateur en vue. Hans Ulrich Obrist est une sorte d’empereur de l’art contemporain sur le territoire duquel les néons ne s’éteignent jamais. Hyperactif et proche des artistes, il débarque à Bruxelles où il cosigne le commissariat de Mondialité à la villa Empain.
Quel regard portez-vous sur l’art contemporain aujourd’hui ?
Nous vivons un changement de paradigme radical. Quand, dans les années 1980, je suis entré dans le monde de l’art en tant qu’étudiant, celui-ci se nouait essentiellement entre Cologne, New York et quelques autres capitales occidentales. Cette situation de concentration a changé au profit d’une polyphonie de centres. Aujourd’hui, l’idée d’un ouvrage comme celui de Serge Guilbaut, Comment New York vola l’idée d’art moderne, paru en 1983, est devenue complètement absurde : aucun lieu ne peut prétendre à une hégémonie culturelle. Désormais, pour reprendre un concept cher au philosophe Edouard Glissant (1928-2011), le monde de l’art est un archipel et pas un continent cerné de murs. Ce phénomène nouveau, on n’en a pris conscience que tout récemment.
Quelles sont les conséquences de cette décentralisation ?
C’est un seismic shift, un changement considérable. Cette situation a donné un dynamisme nouveau à la production artistique. L' » archipellisation » du monde de l’art que j’évoque fait naître un rapport inédit à l’identité, une sorte de troisième voie entre la mondialisation et les cultures locales. A l’opposé, des menaces de repli planent sur nous, elles sont politiques, d’Erdogan en Turquie à Narendra Modi en Inde. Ce contexte fait que la présence de l’art parmi nous est absolument nécessaire. Nous vivons des moments compliqués, politiquement difficiles, qui sont partagés par le monde entier. Dans ce contexte, comme le dit le peintre allemand Gerhard Richter, l’art est » la plus grande forme d’espoir » car il est vecteur d’échanges. » Je peux changer à travers l’échange avec l’autre « , écrit également Edouard Glissant.
La prégnance du contexte politique difficile doit-elle pousser les artistes à s’engager ?
Je refuse d’énoncer ce que devrait être le programme de l’art, il est vain de lui assigner une mission. Il faut se rappeler l’inscription au-dessus de l’entrée du palais de la Sécession à Vienne : » A chaque âge son art, à chaque art sa liberté. » En revanche, je pense que si un poème épouse une cause politique mais qu’il est écrit en alexandrin, son contenu sera totalement non avenu. Il faut une forme nouvelle. On ne peut pas instrumentaliser l’art, décider de faire de la politique avec lui, il est politique d’une manière plus profonde. C’est le poème qui doit nous mener, la forme indique la voie à suivre. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’art nous survit, que les tableaux de Goya peuvent traverser le temps et évoquer la guerre qui se déroule en Syrie.
Les forces homogénéisantes de la globalisation […] imposent le même là où il y a de l’autre
Vous êtes né en Suisse, vous voyagez partout dans le monde et vous êtes codirecteur des expositions et directeur des projets internationaux de la Serpentine Gallery, à Londres. Comment vivez-vous la sortie de l’Europe de la Grande-Bretagne ? Quel sera son impact sur le marché de l’art ?
Quand on évoque le Brexit, je réplique par une citation d’Etel Adnan, la poétesse américano-libanaise : » Le monde a besoin d’unité, pas de séparation. D’amour, pas de suspicion. D’un avenir commun, pas d’isolation. » Pour le reste, à l’instant où je vous parle, cela reste très abstrait. Je crois que plus que jamais, selon la phrase de la romancière américaine Toni Morrison, » l’art doit se mettre au travail « .
Dans ce contexte de changement de paradigme pour l’art et de l’importance cruciale de sa diffusion, comment imaginez-vous les institutions culturelles à venir ?
Je pense qu’il est capital d’intégrer la technologie. A la Serpentine, nous avons nommé un curateur digital en la personne de Ben Vickers. A l’avenir, chaque ville devra posséder l’équivalent d’un centre d’art et de technologie des médias de Karlsruhe. Je pense aussi à la nécessité de créer des endroits où littérature, sciences, musique et arts plastiques se rencontrent, une sorte de Black Mountain College (NDLR : du nom de cet établissement américain transdisciplinaire qui ferma ses portes en 1957). Il faut casser les silos du savoir, j’ai appris cela il y a une vingtaine d’années, ici à Bruxelles, en discutant avec Ilya Prigogine et Isabelle Stengers. Cela dit, il est encore plus nécessaire de pratiquer une politique de l’entrée libre. Dans une société où les inégalités ne cessent de grandir, il faut se battre pour cette gratuité. Etre en contact avec l’art peut changer une vie, c’est ce qui m’est arrivé lorsqu’à 11 ans, j’ai découvert l’oeuvre de Giacometti au Kunsthaus de Zurich. La création a cette possibilité transformatrice. Je discutais récemment avec Tim Berners-Lee, l’inventeur du World Wide Web. Son plus grand regret est qu’Internet a été confisqué par le commerce. Les musées doivent oeuvrer pour que la culture reste comme une version originale du Web, un lieu de flânerie accessible à tous.
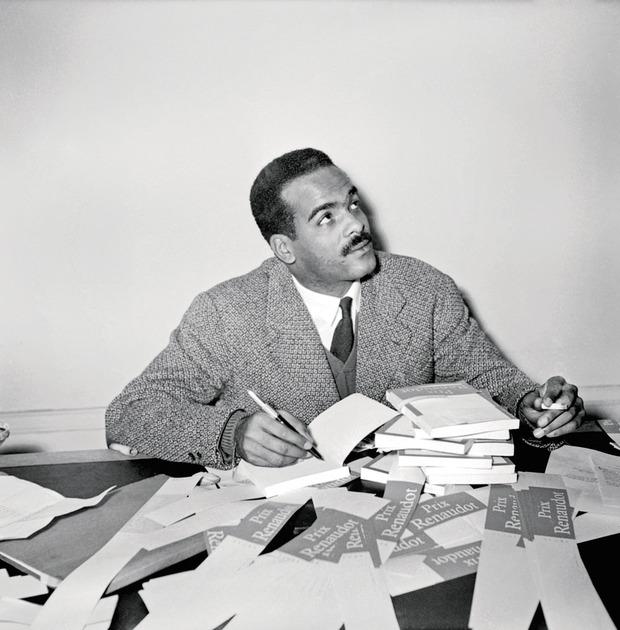
Bruxelles n’a pas de musée d’art contemporain, situation étrange pour une capitale européenne… Un nouveau projet est en chantier dont le contenu serait fourni par la France, à travers le Centre Pompidou. Qu’en pensez-vous ?
Je pense que l’idée même d’un musée d’art contemporain pouvant résoudre l’ensemble des questions culturelles d’une ville est désuète. C’est très xxe siècle, très » continental » pour reprendre la terminologie d’Edouard Glissant. Ce qui rend Bruxelles intéressant, c’est la multiplicité qui la traverse. Avant de vouloir ajouter une nouvelle pièce, il convient de regarder ce qu’il y a. Pour moi, le Palais des beaux-arts, même sans collection, est l’une des plus formidables institutions en Europe. Il faut écouter les différentes voix dans la ville : le Wiels, la fondation Boghossian ou le Coffre-fort, un lieu que l’on doit à un collectif d’artistes. Il y a là une véritable cartographie, un » archipel « , qui rend Bruxelles intéressant. Un projet qui advient doit être à l’écoute de ce qui est là. J’ai souvent accompagné Rem Koolhaas dans ses démarches et, en tant qu’architecte, il s’interroge d’abord sur ce dont la ville a besoin.
Vous évoquez régulièrement le philosophe Edouard Glissant. Mondialité, l’exposition que vous avez commissionnée avec Asad Raza, à la villa Empain s’appuie également sur ce penseur de la créolisation. Pourquoi cette obsession ?
Parce qu’il est le penseur pour comprendre et vivre le xxie siècle. Depuis près de vingt ans, je m’impose de lire au moins quinze minutes de ses écrits par jour. C’est le peintre, sculpteur et plasticien italien Alighiero Boetti qui me l’a fait découvrir. Edouard Glissant permet de se réapproprier un phénomène comme celui de la globalisation à travers la notion de » mondialité » qui est cette » mise en présence des cultures dans le respect du divers « . Ce n’est pas la première fois que nous vivons des forces de globalisation, mais c’est la première fois qu’elles se produisent avec une telle véhémence. Son impact est rendu encore plus brutal en raison de la technologie. D’un côté, la mondialisation est une chance en ce qu’elle amène des possibilités de dialogue plus amples ; mais de l’autre, elle engendre des dangers. Les forces homogénéisantes de la globalisation, les brands, les marques, qui sont partout, qui imposent le même là où il y a de l’autre.
N’est-il pas vain d’opposer une résistance à ces forces qui nous dépassent ?
Au contraire, il est de notre devoir de résister. Personnellement, tout mon compte Instagram est dédié à l’écriture à la main. Je me sers du numérique pour poster des croquis et des textes tracés manuellement. C’est une façon de lutter contre l’homogénéisation. Il ne s’agit pas seulement de résister à la mondialisation, il faut également ne pas succomber aux contre-forces qu’elle engendre. En cela, Edouard Glissant était visionnaire, lui qui nous a mis en garde contre ce phénomène. Ces contre-forces s’incarnent aujourd’hui dans le discours et la politique d’un personnage tel que Donald Trump, mais la situation n’est pas différente avec Erdogan ou Narendra Modi évoqués plus haut.
Comment qualifieriez-vous votre apport à l’art contemporain à travers les trois cents expositions que vous avez mises sur pied ?
Je crois qu’il y a plusieurs axes. D’abord, j’essaie d’expérimenter sans cesse, de trouver de nouveaux formats et d’inventer de nouvelles règles du jeu sans être trop prescriptif. Ces règles, j’essaie de les trouver dans le dialogue avec l’artiste. L’idée, c’est de ne jamais arriver avec une idée toute faite. Il y a aussi ce terme, qui est mon mot préféré, » urgent « . Je me pose sans cesse la question de ce qui est urgent. Aujourd’hui, l’urgence c’est de créer des connexions entre les gens à la lueur de ce que j’ai expliqué plus haut. Enfin, je suis guidé par l’idée d’utopie concrète. Dans mon travail, je pars souvent de cette question posée aux artistes : » Quel est le projet que vous n’avez pas pu réaliser ? » Toutes ces idées, trop grandes, trop petites, censurées, autocensurées, évacuées… sont celles qui m’enthousiasment le plus.
Bio Express
1968 Naissance à Zurich.
1976 A 16 ans, il traverse trente pays en trente jours pour rencontrer des artistes. Depuis lors, il collecte les entretiens dont il a réuni plus de 2 400 heures.
1991 Première exposition dans sa propre cuisine : World Soup (The Kitchen Show).
2011 Reçoit le CCS Bard Award for Curatorial Excellence pour son engagement dans l’art.
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici