
Justice internationale : « Il faut donner une vraie place à l’accusé » (entretien)

Ecouter davantage leur parole aiderait à la reconstruction, selon Damien Scalia, professeur de droit à l’ULB et auteur d’une étude inédite.
Interpellé, lors d’échanges avec la Croix-Rouge, sur la non-prise en compte de la voix des accusés dans la reconstruction d’une nation après un conflit, le professeur de droit Damien Scalia a mené une étude auprès d’une soixantaine de personnes condamnées ou acquittées par les tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda. Il en a tiré un livre, Génocidaire(s). Au cœur de la justice internationale pénale (1), qui explique ce que la société gagnerait à prendre en considération leurs paroles.
Pourquoi est-il important de prendre davantage en compte la voix des accusés dans le droit pénal international?
Parce qu’ils sont des protagonistes de ces drames. Mais cette idée suscite un rejet moral car subsiste la crainte que leur donner la parole conduise à adhérer à leur idéologie. La voix des accusés a été prise en compte dans certains cas, en Afrique du Sud lors de la commission Vérité et Réconciliation ou en Colombie. On doit écouter cette parole pour aider, ensemble, à la reconstuction.
La vision positive de la justice internationale qu’ont, au départ, les accusés que vous avez interrogés est-elle motivée par le fait qu’ils craignent davantage encore la justice nationale?
Il y a deux raisons principales. Certains prévenus avaient peur d’être déférés devant une justice locale, au Rwanda et en ex-Yougoslavie, par crainte qu’elle ne soit pas impartiale. Ils nourrissaient aussi, à l’époque, l’idée que la justice internationale était de haute qualité et au-dessus de tout soupçon. Le fait d’y être soumis a remis en cause cette croyance.
Les accusés estiment que l’acte d’accusation ne reflète pas la réalité qu’ils ont vécue. Cela s’explique-t-il par le fait que les procès de justice internationale ne prennent pas en compte la contextualisation politique?
Les accusés ont, en effet, le sentiment qu’il ne peut même pas être fait mention du contexte politique dans ces procès. Ils trouvent aussi que les catégories juridiques, crimes de guerre, crimes contre l’humanité… sont des termes essentialisants qui ne permettent pas de retranscrire la finesse de la réalité vécue.
Existe-t-il un moyen de remédier à cet écueil de la catégorisation?
On peut le pallier en étant plus précis, plus proche du terrain, c’est-à-dire en prenant aussi en compte les différences historiques, culturelles ou de culture juridique. Toutefois, il y a une problématique que le droit pénal international n’arrivera pas à résoudre: les crimes, commis dans des contextes particuliers, sont collectifs ; or, le droit pénal cherche une ou plusieurs personne mais individuellement en les culpabilisant à juste titre pour ce qu’elles ont fait tout en les responsabilisant pour l’entièreté du crime.
En pointant les responsabilités individuelles, la justice pénale internationale ne cherche-t-elle pas à éviter de stigmatiser une communauté et à préserver les chances de reconstruction d’une nation?
Pointer des responsabilités individuelles permet d’absoudre le reste de la population. Qu’on s’entende bien, ces responsabilités ne sont pas fausses. On ne condamne pas des personnes innocentes. Mais cela autorise à dire que les autres n’ont rien fait. Bien entendu, tout le monde n’a pas participé aux crimes. Néanmoins, en poursuivant quelques centaines de personnes quand il y a eu entre 150 000 et 200 000 auteurs de crime, il y a quand même un souci d’équilibre.
Pourquoi la justice pénale internationale refuse-t-elle d’aborder la dimension politique des crimes dans ses procès?
Elle ne veut pas apparaître potentiellement influencée par la politique. Ce constat repose sur le positionnement des juristes, qui ont le sentiment que le droit est objectif et hors de tout enjeu. Pourtant, il n’est pas hors de tout enjeu. Il faut accepter que le droit est politique.
Les accusés reprochent que la justice pénale internationale soit celle des vainqueurs. La critique est-elle fondée?
C’est un argument un peu facile pour délégitimer la justice internationale. En même temps, l’argument semble assez en phase avec une réalité, lorsqu’on observe que le procureur de la Cour pénale internationale choisit de ne plus enquêter sur des crimes commis en Afghanistan par les Américains et décide de le faire sur les crimes commis par les Russes en Ukraine. Il y a deux poids, deux mesures. C’est son choix. Mais cela prouve bien qu’il est politique.
Dans la guerre en Ukraine, la justice pénale internationale ou nationale est en train de s’écrire alors que le conflit n’est pas encore terminé. Cela vous rassure-t-il ou vous inquiète-t-il?
Que les preuves soient recherchées maintenant est nécessaire si on veut un jour aller au pénal. Mais qu’il y ait un renouveau à ce point de l’appel à la justice internationale pénale me semble un peu décalé. Aujourd’hui, la priorité est d’établir la paix. La justice, on verra après. Il y a un temps pour tout. En plus, agiter la menace de la justice pénale internationale face à la Russie est un peu fallacieux. Que l’Ukraine juge des Russes comme elle l’a déjà fait et comme elle le fera, OK. Mais ambitionner de mettre Vladimir Poutine en jugement, c’est autre chose. Tant qu’il sera au pouvoir, il ne pourra pas être jugé.
Quelles leçons tirez-vous de ces travaux pour améliorer la justice internationale?
Il faut donner une vraie place à l’accusé. Pas seulement une place passive tel qu’actuellement. Il faut aussi remettre le droit pénal international à sa place. Il ne sert pas à rétablir la paix. Il ne sert pas à faire l’histoire. Il sert à condamner. Il faut aussi se poser la question de savoir ce que l’on met en œuvre à côté de la justice internationale pour pouvoir atteindre les objectifs, plus importants, de la reconstruction, de la réparation des victimes et de la mémoire.
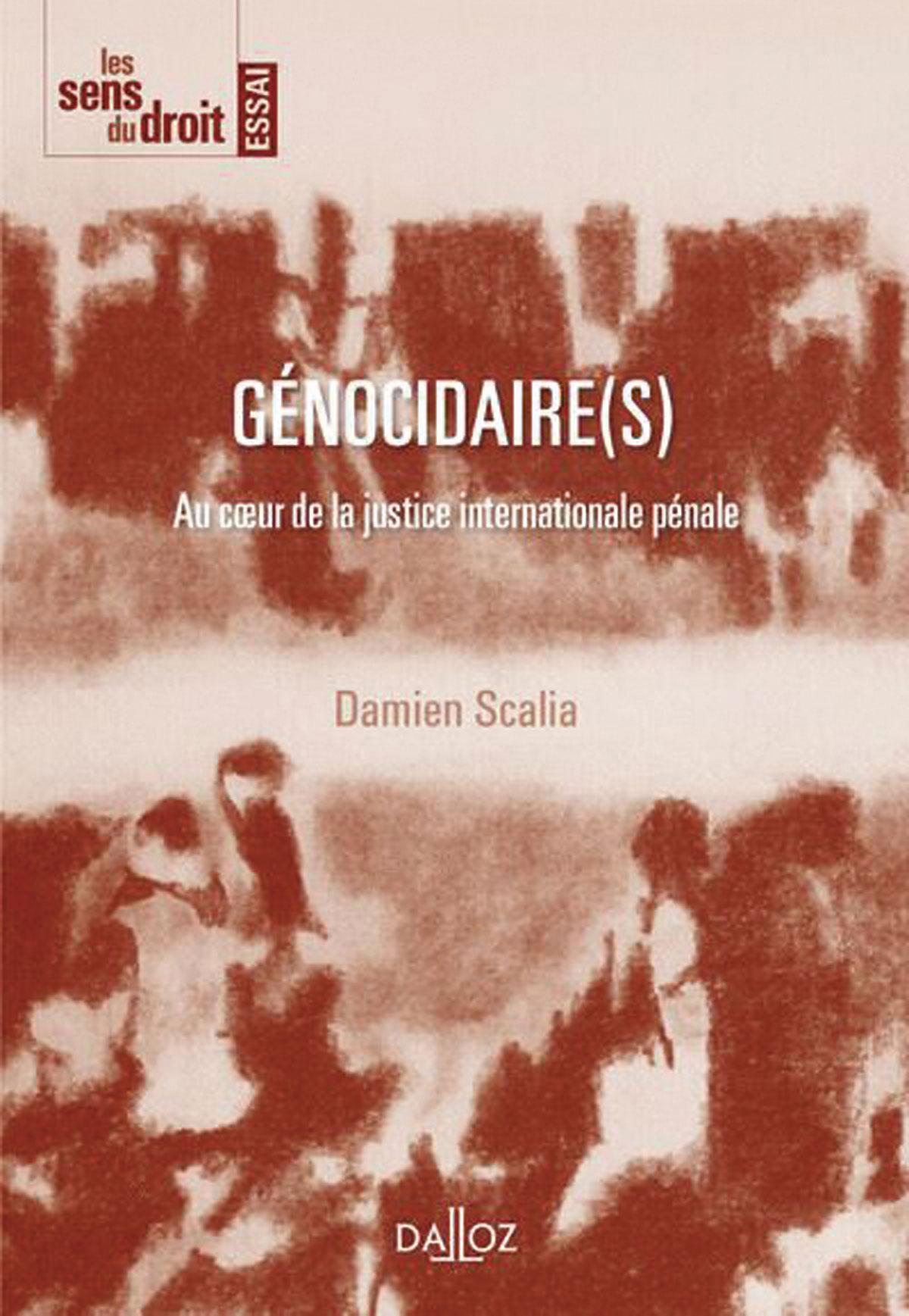
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici