
James Suzman: « Il faut en finir avec l’idée que la paresse est un vice » (entretien)
Dans une histoire panoramique de « la grande affaire de l’humanité », l’anthropologue James Suzman remet en cause toutes les évidences acquises au sujet du travail. A commencer par sa nécessité.
Rien ne prédisposait James Suzman à écrire un jour une histoire mondiale du travail. Né en Afrique du Sud, formé à l’anthropologie sociale en Ecosse, c’est dans le désert du Kalahari, au contact des bushmen Ju’hoansi (qu’il fut le premier à étudier), qu’il découvre une société ayant choisi, comme valeur cardinale, le bien-être plutôt que l’accumulation. Il lui faudra près d’un quart de siècle de voyages en Afrique et un passage traumatisant par le monde de l’industrie diamantaire pour finalement coucher sur papier le résultat de ses recherches de terrain puis, avec Travailler (1), les leçons sur le labeur que son contact avec les Ju’hoansi devraient obliger chacun à méditer. Car plutôt qu’un universel devoir jetant les êtres humains les uns contre les autres dans leurs efforts pour s’accaparer des ressources prétendument trop rares, le travail, pendant la plus grande partie de l’histoire de l’humanité, a d’abord été une forme de mesure de notre relation au monde. Depuis l’émergence de la vie sur Terre jusqu’aux enjeux contemporains de l’automatisation, c’est un récit aussi épique que limpide des transformations du travail que livre Suzman, nous abandonnant à cette question: mais pourquoi continue-t-on à travailler comme nous le faisons?
Bio express
- 1970 Naissance à Johannesburg.
- 1996 Soutient sa thèse de doctorat sur les bushmen Ju’hoansi.
- 2002 Participe à plusieurs commissions de défense des droits des bushmen.
- 2007 Rejoint la société diamantaire De Beers, dont il démissionne en 2013.
- 2017 Publie Affluence without Abundance.
- 2020 Travailler paraît en anglais.
Que s’est-il passé pour qu’un anthropologue comme vous se dise « je dois écrire une histoire du travail »?
Il existe sans doute plusieurs raisons à cela. La première pourrait être que, lorsque j’étais jeune, j’ai rencontré pas mal de problèmes, entre autres à l’école, à cause de ma propre paresse. Je faisais partie de ces enfants dont on disait: « Il a du potentiel, mais c’est une limace. » (rires) Plus sérieusement, je pense qu’avoir passé une grande partie de ma vie d’adulte en compagnie des chasseurs-cueilleurs du Kalahari a joué un rôle essentiel. La première chose qu’on réalise à leur contact, c’est à quel point leur vie est bien plus heureuse et plus simple que ce qu’on imagine. Lorsque je suis arrivé là-bas, j’ai débarqué en pleine crise. Dans une sorte d’écho terrifiant de ce qui s’était passé au Congo belge sous Léopold II: les bushmen, qui avaient parcouru le Kalahari en toute liberté pendant des millénaires, se sont retrouvés spoliés de leurs terres par les fermiers ; ils ont été enrôlés de force dans les fermes, voire torturés pour les récalcitrants. Il s’agissait de la rencontre de deux cultures du travail opposées, avec deux histoires reposant sur des attitudes et une architecture culturelle différentes. Pour les Ju’hoansi, l’idée d’attendre la fin du mois pour recevoir un chèque permettant d’acheter des choses en échange d’un travail est un non-sens. Leur culture est celle d’individus se levant pour chasser, partir à la cueillette, ou se livrer à des activités d’entretien de leurs outils puis, une fois les provisions de la journée récoltées, tout s’arrête. Enfin, la dernière raison qui m’a poussé à écrire cette histoire du travail est qu’en rentrant d’ Afrique, je me suis retrouvé, à 37 ans, avec un enfant, à me poser la question de savoir comment faire vivre une famille, alors que j’avais moi-même vécu comme un chasseur-cueilleur durant des années. J’ai passé sept ans chez De Beers, une des plus grosses sociétés de négociants de diamants, où j’ai grimpé toute l’échelle hiérarchique pour arriver quasi au sommet. C’était absurde, parce que De Beers était partie prenante à la guerre du diamant qui mettait une partie de l’Afrique à feu et à sang, dont le territoire des Ju’hoansi, et surtout parce que j’y ai découvert ce qu’on appelle la « culture d’entreprise ». Face à la débauche d’énergie et de luxe qui porte ce nom, et ne sert à rien d’autre qu’à nourrir l’idée, tout à fait illusoire, de ce que ceux qui y participent sont indispensables, j’ai fini par claquer la porte. Mais j’ai réalisé qu’après tout ce temps, je n’avais fait que travailler sur le travail.
Nous sommes des créatures qui dépensons une énergie considérable à vivre, à construire des choses, puis à les détruire, dans un cycle infini de dépense énergétique inégale.
Pour vous, le travail est quelque chose de très différent de ce qu’on entend d’ordinaire…
Au départ, je souhaitais écrire un livre sur le repos. Mais pour répondre à la question « qu’est-ce que le repos? », il faut d’abord se demander ce qu’est le travail. Le problème, lorsque vous disposez de lunettes qui traversent les cultures, c’est qu’il est pour ainsi dire impossible d’établir une définition universelle du travail. Lorsque je faisais la promotion de ce livre aux Etats-Unis, des journalistes m’ont même reproché d’avoir utilisé le mot « travail » pour parler du travail des enfants au XIXe siècle – alors que, pour eux, ça ne pouvait pas être considéré comme tel. Un autre exemple: lorsqu’il m’est arrivé d’accompagner, en Namibie, des chasseurs payant des fortunes pour pouvoir tirer des éléphants, j’ai été frappé de voir à quel point certains sont prêts à consacrer leurs loisirs à ce qui est pour d’autres un véritable travail. Et de fait, la plupart des activités que nous accomplissons pour nous détendre impliquent une forme de travail: le jardinage, la cuisine, même le sport! De sorte que, pour répondre à la question « qu’est-ce que le travail? », j’ai voulu aller voir comment nos ancêtres se sont mis à penser de façon spécifique à la place qu’occupaient leurs activités dans leur vie. Cela m’a obligé à me demander, entre autres, ce qu’est le travail pour un gorille. Et c’est là que j’ai réalisé que tous les êtres vivants présentent un point commun: ils constituent une exception à la seconde loi de la thermodynamique, qui stipule que la distribution de l’énergie dans le monde tend à rechercher un état d’égalité sans retour. Or, nous sommes des créatures qui dépensons une énergie considérable à vivre, à construire des choses, puis à les détruire, dans un cycle infini de dépense énergétique inégale. Il en va ainsi depuis les origines de la vie, où les premiers micro-organismes se sont mis à capturer et à dépenser de l’énergie pour former des molécules, puis des cellules, des organes, des organismes, etc. De ce point de vue, nous ne sommes guère différents du tisserin mâle, par exemple, qui passe la plus grande partie de sa vie à construire et détruire des nids d’une complexité inouïe, mais qui ne sont occupés par personne. Pour moi, penser le travail en termes de dépense énergétique déséquilibrée est une manière de souligner le fait que ce que nous croyons souvent être le produit de notre « conscience » humaine est en fait le simple résultat de notre histoire génétique.

Disant cela, vous vous opposez tant aux tenants du libéralisme que du socialisme, pour lesquels le travail est d’abord une fonction sociale liée à la richesse.
Oui, je pratique l’insulte égalitaire (rires). Je suis fasciné par tous ces livres qui prétendent définir les principes d’un futur soutenable, qui annoncent la prochaine révolution de la connaissance, etc. Je n’ai aucune réponse à proposer, si ce n’est un léger sentiment de désespoir. La seule chose qui m’intéresse est de parvenir à déplacer les bases du débat sur la nature et l’importance du travail, dans l’espoir que d’autres, peut-être, parviennent à fournir les réponses qui nous manquent. Ce qui est certain, c’est qu’il faut en finir avec l’idée, répandue à gauche comme à droite, que la paresse est un vice. Le chômage n’est jamais le résultat d’un échec individuel ; il est le produit d’un mode de fonctionnement social. Que nous soyons incapables d’accepter ce simple fait est ce qui conduit les solutions que nous prétendons inventer à propos du « problème » du travail à causer des difficultés plus grandes encore. Nous le voyons surtout aujourd’hui où les débats entre la gauche et la droite n’ont guère abouti à autre chose qu’à susciter une espèce de néonationalisme furieux, sans régler quoi que ce soit. Dans l’entre-deux-guerres, Charles Maynard Keynes avait prévu que nous atteindrions un jour un niveau de richesse tel que nos besoins de base à tous seraient couverts, et qu’il nous faudrait nous poser la question de l’usage des excès de cette richesse. Mais la réponse que nous avons apportée à cette question n’est pas celle qu’il avait imaginée: au contraire, elle est celle d’une pression toujours accrue à la productivité des travailleurs, qui cause aujourd’hui des risques existentiels très graves.
Ce modèle productiviste, toutefois, remonte à bien plus loin qu’au siècle dernier…
Nous devons comprendre que l’architecture intellectuelle qui gouverne notre rapport au travail est née avec l’invention de l’agriculture, environ dix mille ans avant notre ère. Là où toute l’humanité ressemblait jusque-là aux Ju’hoansi que j’ai étudiés dans le Kalahari, nous sommes entrés dans un système de production d’énergie (donc de nourriture) qui a abouti à des bouleversements profonds dans notre manière d’interagir avec notre environnement. Pour la première fois, l’énergie a pu être accumulée et a permis de dégager des marges non immédiatement consommées. Ces bouleversements ont donné naissance aux villes, et à la spécialisation des tâches qu’on y observe dès le début. A l’époque, toutefois, il revenait à la plupart des êtres humains, aidés de leurs animaux domestiques, de produire l’énergie dont ils avaient besoin. Mais, avec l’apparition des énergies fossiles, le pourcentage d’individus travaillant à la production d’énergie de leur communauté s’est réduit au point où, dans nos pays, seuls 2% de la population travaillent la terre. Les autres se contentent de dépenser cette énergie. Cela a conduit à des conséquences dramatiques, qui vont de l’augmentation progressive des inégalités entre ceux qui bénéficient des excès énergétiques aux dommages environnementaux liés à l’exploitation naïve de la Terre. Parce que nous continuons à accorder foi au récit qui veut que le travail soit d’abord production de richesses et compétition pour l’accès à des ressources rares, nous persévérons dans une voie productiviste dont les seuls résultats sont une accumulation toujours plus frivole de biens et de services inutiles et périssables. Il est temps que nous réalisions que ce modèle né avec la révolution agricole n’est plus soutenable.
Si le travail se trouvait dissocié des valeurs économiques qui l’écrasent, nous travaillerions peut-être un peu moins.
Devrions-nous redevenir des chasseurs-cueilleurs?
Oh non! Le paracétamol me manquerait trop (rires). La vie des chasseurs-cueilleurs reste une vie difficile, soumise à de nombreux aléas. En revanche, ils peuvent constituer un modèle pour nous aider à réfléchir à un mode de vie soutenable. Il est un fait que l’invention de l’agriculture nous a permis de disposer de plus de biens, de vivre plus longtemps, etc. Il ne s’agit pas de nier ces gains, mais de nous poser la question de savoir qu’en faire. Les chasseurs- cueilleurs montrent que nous disposons tous de la faculté de modérer nos besoins et nos désirs. Nous n’avons pas besoin de toilettes en or et de Trump Towers. Pourtant, c’est ce que l’orthodoxie économique ne cesse de nous répéter: nous sommes des créatures nourrissant des désirs infinis au milieu d’un monde de ressources finies. Or, cette idée de la rareté, qui gouverne la structure du travail qui est la nôtre, est fausse. Ce que démontrent les recherches archéologiques, c’est que, pour la plus grande partie de notre histoire, la rareté n’a pas été un problème. Il existe aussi, en Occident comme en Orient, des philosophies qui ont soutenu que la satisfaction et la plénitude pouvaient être plus facilement atteintes grâce à la modération de nos envies. Nous aussi, nous pouvons aboutir à des constats identiques si nous apprenons à dissocier le travail de l’emploi, de sorte que ce à quoi nous oeuvrons puisse être séparé de la simple quête d’argent visant à assurer notre participation au cirque de la consommation. La difficulté est que nous vivons dans un monde où l’économie cherche à bloquer cette quête de sens. Ce faisant, elle opère un prodigieux gaspillage de talents, qu’elle enferme dans des boulots absurdes, à la Bourse ou dans les assurances. Quand vous demandez à un enfant ce qu’il veut faire plus tard, aucun ne vous répondra broker chez Goldman Sachs.

Plutôt qu’une question économique, le travail est donc une affaire de morale?
La diabolisation de la paresse est née avec l’agriculture. Dans une agriculture de subsistance, vous vous trouvez en permanence au bord du gouffre. Tout le monde, des enfants aux vieillards et même aux animaux, doit contribuer à éviter la chute. A l’époque de la révolution industrielle, la situation a empiré. L’idée a prévalu que ceux qui ne pouvaient contribuer à l’effort collectif étaient un poids qui reposait sur les épaules de tous ceux qui travaillaient. Aujourd’hui, le contexte est différent mais la morale demeure. C’est ce qui fait, par exemple, que nous continuons à refuser la distinction entre travail et emploi, qui pourrait, notamment, nous conduire à accepter l’idée d’un revenu de base universel, qui serait aussi une véritable bénédiction environnementale. Pourtant, il n’est pas compliqué de voir que, même dans nos loisirs, nous ne cessons de « travailler ». Un être humain qui reste à ne rien faire, ça n’existe pas. Ce n’est pas pour rien que nous avons inventé les prisons: ce ne sont que des endroits où on est privé de travail. Il est vrai que, si le travail se trouvait dissocié des valeurs économiques qui l’écrasent, nous travaillerions peut-être un peu moins. Mais lorsqu’on sait que le travail réel d’un employé de grande entreprise est au maximum de trois heures par jour, le reste se passant en réunions idiotes, en évaluations sans aucun sens, la différence ne serait sans doute pas très importante.
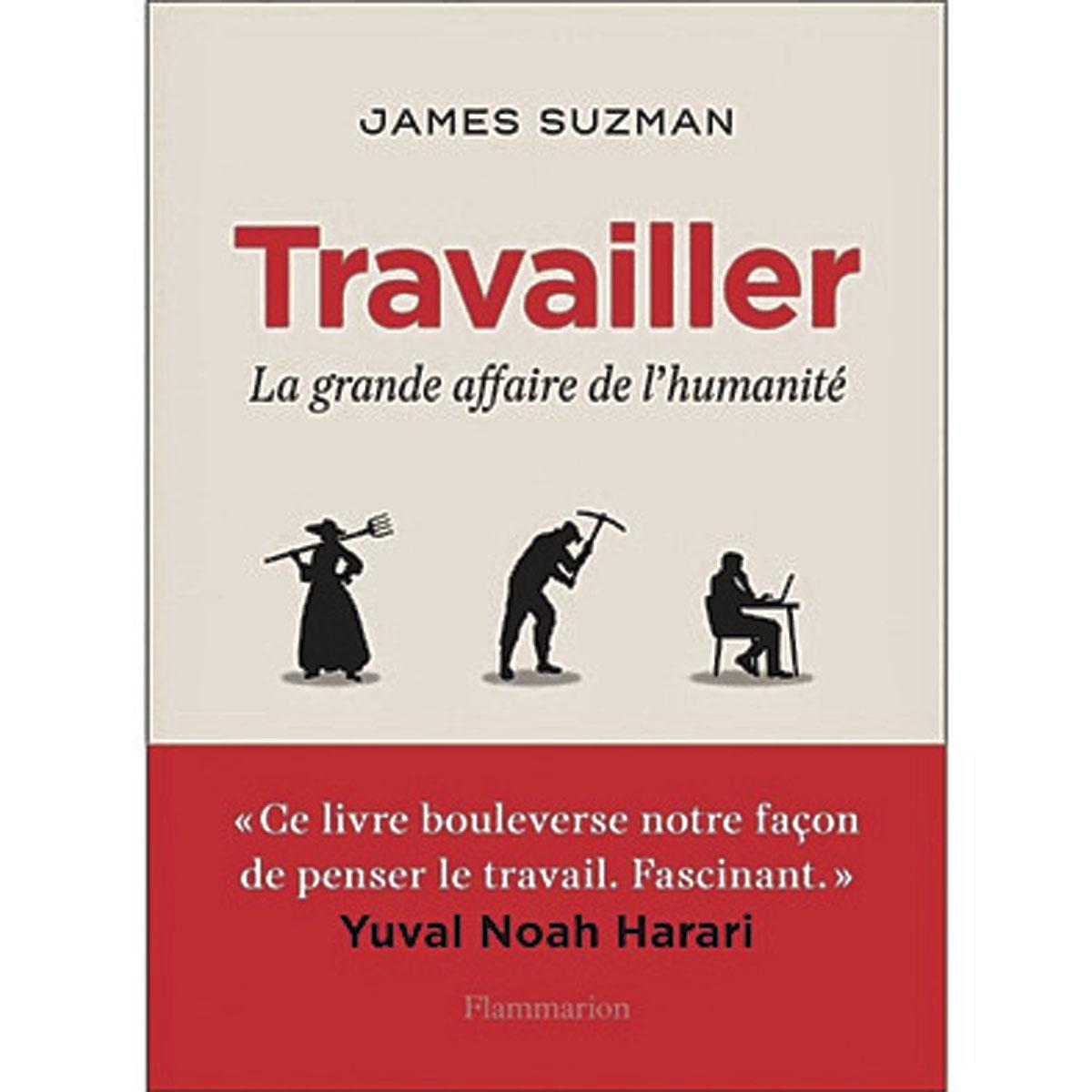
Vous critiquez aussi l’individualisme de notre conception du travail.
C’est vrai. Le travail, parce qu’il implique le corps, le fait de faire quelque chose, transforme votre personne. Mais il vous pousse aussi en direction de celles et ceux qui ont connu les mêmes transformations que vous. Comme on dit, ce ne sont pas les potiers qui font les pots, mais les pots qui font les potiers. C’est ce qui explique que, dans les milieux très aliénants des villes, les professionnels d’un certain domaine se soient toujours spontanément réunis en quartiers communautaires. Cela a pu prendre des formes d’organisation très sophistiquées, comme les collegae, à Rome, qui sont l’ancêtre des corporations du Moyen Age. Or c’est toujours le cas. L’idée que nous ne serions que des « ressources » interchangeables, pouvant sauter d’un boulot à l’autre et ne devant notre loyauté qu’à la compagnie qui nous emploie, qui ne tient plus debout. Le travail, c’est d’abord une manière de construire une communauté avec ceux qui font le même travail que nous. Cela signifie que le présupposé voulant que les marchés soient structurés comme des systèmes d’organisation de la compétition entre acteurs économiques, et donc comme mettant en concurrence les travailleurs pour des emplois toujours moins nombreux qu’eux, doit être abandonné. Le véritable problème de l’économie n’est pas la concurrence, mais la coopération. C’est parce que les marchés ont tendance à coopérer trop que la plupart des pays possèdent des lois antitrust ou antimonopole. La concurrence est une situation artificielle. Elle nous a conduit à idéaliser les sociopathes, alors que la plupart des travailleurs sont des personnes décentes et sociales avant tout. Il est temps que nous réapprenions à les mettre en valeur.
(1) Travailler. La grande affaire de l’humanité, par James Suzman, traduit de l’anglais (américain) par Marie-Anne de Béru, Flammarion, 480 p.
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici