Aux raisons «traditionnelles» de la guerre, la cupidité, la peur et la vanité, le philosophe français Frédéric Gros ajoute la colère et «la pente suicidaire de l’humanité». Une réflexion au cœur de l’actualité de 2023.
Guerre en Ukraine, reconquête du Haut-Karabagh par l’Azerbaïdjan, conflit entre Israël et le Hamas…: la guerre s’est imposée comme un point focal de l’actualité. En expliquer les ressorts et les enjeux est important et utile.
Le philosophe français Frédéric Gros y a consacré un essai au début de 2023, soucieux de décrypter l’analyse du «retour d’une vraie guerre» que beaucoup associaient à l’agression russe en Ukraine. Depuis, le massacre du Hamas le 7 octobre et les représailles israéliennes à Gaza ont amené à approfondir le questionnement sur le recours répandu à la violence, donc à se plonger dans Pourquoi la guerre? (1).
L’intransigeance morale entraîne une criminalisation de la solution diplomatique. C’est risqué.
Plutôt que du retour de la guerre en Europe, vous suggérez, dans votre livre, de parler, à propos du conflit en Ukraine, du retour d’un style de guerre. Quel style de guerre peut-on invoquer à propos de l’Ukraine?
J’ai en effet été frappé par une expression reprise en chœur par les éditorialistes aux mois de février-mars 2022, celle de «retour de la guerre». Or, cette expression, qui témoignait d’abord de la surprise et de la sidération face à une agression militaire qui avait lieu aux confins de l’Europe, pouvait sembler très inexacte.
D’abord parce qu’elle laissait croire que le monde aurait été un havre de paix depuis l’armistice de 1945 alors qu’il avait malheureusement connu beaucoup de guerres interétatiques longues et meurtrières, comme celle qui opposa l’Iran à l’Irak pendant huit ans, sans même parler des guerres de décolonisation.
Et même sur le sol européen, la tragédie des guerres d’ex-Yougoslavie date d’à peine quelques dizaines d’années et la menace terroriste est toujours présente. Cependant, il y avait, dans cette expression qui pouvait paraître plus qu’approximative, une part de vérité.
C’est que quand l’Europe ces dernières décennies avait effectivement connu sur son sol des attentats terroristes, elle avait été contrainte d’affronter des ennemis invisibles, de craindre des frappes meurtrières ponctuelles n’importe quand et n’importe où. L’agression russe, avec ses files de chars sur les routes d’Ukraine, ses champs de bataille localisés, a fait réapparaître en Europe un style de guerre «classique»: celui qui oppose deux armées nationales pour des conquêtes et des défenses territoriales.
Y a-t-il dans la guerre en Ukraine une dimension de «guerre par procuration», du fait que les Ukrainiens défendraient le «monde libre des démocraties libérales» face au «totalitarisme russe aux visées expansionnistes»?
Il est vrai que le soutien indirect, militaire, logistique, médical, apporté par l’Europe et les Etats-Unis à l’Ukraine se justifie par une communauté de valeurs. On peut en effet dire que les valeurs défendues par l’Ukraine – liberté, droit des peuples à l’autodétermination – sont les nôtres.
On voit bien, du reste, comment le soutien militaire européen s’accompagne aussi d’une «facilitation» administrative des conditions d’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne. C’est comme si l’Europe se redécouvrait une dimension politique, après avoir accepté longtemps de se définir uniquement comme espace économique de libre circulation.
De l’autre côté, la propagande russe joue à fond, sur le mode accusatoire, le thème d’une décadence proprement occidentale. Mais pour en venir à la fin de votre question, je suis de mon côté dubitatif – certains peut-être diront «naïf» – quant à la «visée expansionniste» de Vladimir Poutine. A mon sens, l’agression contre l’Ukraine est moins une «première étape» vers une reconquête des anciens pays satellites de l’URSS qu’un ultime sursaut de la Russie pour s’affirmer comme empire.

En Ukraine, la Russie mène-t-elle une guerre inique et l’Ukraine une guerre légitime?
C’est au moins de cette manière qu’elle est régulièrement présentée, et j’y souscris pour une grande part. La légitimité de l’effort de guerre ukrainien tient dans sa dimension de défense, qui a toujours été définie comme le noyau sacré de légitimité de toute violence – qu’elle soit étatique ou individuelle.
L’Ukraine livre du reste une guerre non seulement légitime, mais héroïque. Et donc, on doit en conclure que l’agression menée par la Russie est «injuste». Mais parler d’«iniquité» me paraît déplacé. Ce terme est bien trop chargé de morale. Cela supposerait d’accepter sans sourciller l’opposition entre «le bien» et «le mal», entre l’angélique et le diabolique.
Or, ce dualisme ne peut qu’être un raccourci facile. Je suis toujours méfiant face au manichéisme. Je sais qu’il ne peut que passer à côté du réel et je fais mienne la phrase de Nietzsche quand il s’écriait: «Malheur à moi, je suis nuance.» On me reproche souvent cette réserve, mais pour moi, elle est essentielle. Je soutiens la cause ukrainienne pour des raisons politiques, ce qui ne veut pas dire céder aux facilités du manichéisme moral.
Vous expliquez que le risque de l’ultramoralisation de la guerre est qu’à force de diaboliser Vladimir Poutine, on ne puisse envisager la fin de la guerre que sous la forme d’une capitulation. Vingt-deux mois après le début du conflit, diriez-vous qu’on est encore dans cette configuration?
C’est exactement ça. Et ma dénonciation de l’ultramoralisation des guerres est dans le droit-fil de celle du manichéisme. On ne négocie pas avec le mal, on l’élimine. Or, toute négociation diplomatique exige la fiction d’une égalité entre les belligérants, ce qui signifie aussitôt: des compromis, un équilibre dans les concessions, etc., alors même que l’Etat russe est bien l’agresseur et l’Ukraine l’agressée.
Cette hypocrisie monstrueuse faisait pourtant partie de la culture de la guerre. Elle a pu permettre d’éviter des paix humiliantes qui préparaient à de nouveaux conflits. Si on refuse de négocier, cela signifie qu’on accepte d’emblée que la solution sera uniquement militaire: victoire ou défaite totale.
Une puissance nucléaire comme la Russie pourrait-elle accepter une capitulation sans condition, sauf à imaginer la disparition de Poutine, ce qui rebattrait complètement les cartes? Là, je pose une seconde question: est-ce être réaliste ou défaitiste que de penser que non? L’intransigeance morale a un coût. Elle entraîne une criminalisation de la solution diplomatique, et cette fin de non-recevoir adressée à la diplomatie me paraît risquée.
La notion de «guerre globale» est-elle essentiellement une réponse au «terrorisme global»?
Face à celui d’«universalité», qui désignait un horizon normatif (les droits de l’homme), ou de «totalité», qui signifiait un embrigadement des populations et pouvait renvoyer à des séquences historico-politiques précises (nazisme, stalinisme, etc.), le concept de «globalité» renvoie plutôt à la constitution d’un espace mondial concrètement interconnecté, interdépendant, sans frontières perméables, etc.
La guerre qu’on a pu qualifier de «globale» fut en effet celle menée contre un terrorisme lui aussi désigné comme tel. On a signifié le plus souvent par là la prévalence du sécuritaire sur le militaire, de la figure du «suspect» sur celle de l’«ennemi», d’où l’importance du renseignement et du contrôle, et la fragilisation des anciennes dichotomies (le policier et le militaire, l’intérieur et l’extérieur, etc.).
Le problème ne se réduit plus à la défense des frontières contre une agression conventionnelle éventuelle, il s’agit à présent de combattre une idéologie fanatique qui peut frapper n’importe où, n’importe quand.
Le propre de la guerre russo-ukrainienne, c’est de se structurer selon un schéma beaucoup plus classique. On assiste bien à un affrontement d’armées conventionnelles sur un front de guerre relativement défini. On peut cependant considérer que, du fait de la démultiplication des échanges et de la montée en puissance des réseaux sociaux, toute guerre aujourd’hui devient «globale», au sens où elle «résonne» selon des effets d’écho qui ne dépendent plus des configurations géographiques.

Comment définir les «guerres de chaotisation» et en quoi revêtent-elles un profil inquiétant?
J’ai forgé ce concept pour rendre compte de la situation d’un certain nombre de pays comme la Libye ou l’Irak au sortir des interventions occidentales destinées à les «libérer» de leurs dictateurs. Ces pays se sont retrouvés privés de leurs principales instances d’autorité et de leurs forces de sécurité classiques, contraints à une économie de subsistance, «chaotisés» par le développement de milices armées anarchiques.
Par «guerre de chaotisation», j’entends une situation de guerre civile caractérisée par ce développement sans frein d’une violence marquée simultanément par des prédations primaires et un millénarisme de basculement des mondes. Ce sont des guerres qui s’autofinalisent. L’intensité continue des violences profite en effet à la fois aux milices prédatrices, qui peuvent sévir impunément, et aux fanatiques religieux, qui y cherchent des signes de confirmation divine. Cette double référence à deux extrêmes humains, le mystique et l’élémentaire, me semble désigner une sortie hors de l’ordre civilisationnel ; c’est elle qui doit inquiéter notre modernité.
L’ambivalence morale, entre «parts maudite et divine» du soldat, est-elle inhérente à toute guerre?
Je pense en effet que ce qu’on pourrait appeler «l’effet de subjectivation» de la guerre, c’est-à-dire la série de mutations mentales que le fracas des armes, la peur de mourir, l’énergie des combats peut produire en chaque individu, est profondément double. De tous temps, cette dualité a impressionné. On la retrouve au cœur des héros guerriers de l’Antiquité (Ajax, Hercule, etc.). L’individu peut en effet à la fois s’élever à des sommets de courage, de solidarité, de dévouement, et se laisser entraîner dans des déchaînements de cruauté, de rage, de brutalité bestiale. Je ne pense pas qu’il faille résoudre de façon psychosociologique cette ambivalence au moyen d’un partage entre individus, comme s’il y avait d’un côté des brutes épaisses et bestiales et de l’autre des héros d’abnégation et d’endurance. Le vrai mystère serait plutôt de considérer cette double polarité au cœur même de l’âme humaine.
A propos de la guerre à Gaza, on invoque le droit d’Israël à se défendre après le massacre commis par le Hamas le 7 octobre. Cela en fait-il une «guerre de juste cause»?
C’est un axiome incontestable que la défense de sa vie immédiatement menacée est un fondement intangible de légitimité. Ce principe s’entend surtout, si ce n’est essentiellement, «en présence», c’est-à-dire «au moment même» de l’attaque. Pour la guerre dans Gaza menée par l’armée israélienne, elle peut être décrite comme l’exercice d’un droit de riposte. Celui-ci demeure légitime tant qu’on le considère comme de la légitime défense reportée dans le temps. Après un moment de sidération et d’impuissance, il s’agit bien de poursuivre et de «neutraliser» les agresseurs. Cependant, l’ampleur prise par les combats, l’exposition de milliers de civils aux bombardements donnent progressivement à ce droit de riposte un autre visage, lui-même ambigu: on hésite entre une vengeance punitive massive ou une sécurisation par destruction. Ce sera aux juges internationaux de décider si on peut parler ou non de «crime de guerre», ou même de «nettoyage ethnique», ces catégories dépendant de critères stricts. Il demeure que l’impression de disproportionnalité s’accentue au fil des semaines et des morts.
La vengeance et la revanche sont des notions avancées pour expliquer la guerre qu’Israël mène contre le Hamas. Ces notions sont-elles de nature à atténuer la condamnation du recours à la violence?
Hegel avait sur ce point une belle formule: «La vengeance est juste, mais elle n’est pas la justice.» De fait, la vengeance – ou la revanche, un mot plus doux – porte avec elle une légitimité intuitive. Elle correspond en effet à une «rétorsion» censée rétablir un «équilibre» brisé par le crime. C’est ce qu’on nomme la «loi du talion». Je fais seulement remarquer qu’on a injustement dénoncé cette dernière comme un principe barbare alors qu’elle portait originellement en elle une exigence de mesure. C’est un œil pour un œil, une dent pour une dent. Elle se comprenait comme un principe de justice et de mesure face à des représailles aveugles et illimitées. Le problème provient du fait que ce droit de vengeance a été confisqué dans nos sociétés policées par la justice: il est interdit de se venger, on doit en référer au juge. Mais cette interdiction, de fait, ne vaut pas pour les Etats. Cela donne-t-il aux Etats le droit de se venger? Ce qui me frappe surtout, c’est l’immense échec des institutions internationales qui font chaque jour l’aveu de leur impuissance profonde.
«La guerre extérieure est en fait ce par quoi s’obtient l’obéissance intérieure.» Cette dimension peut-elle être invoquée dans la guerre d’Israël contre le Hamas?
Il est indiscutable que l’agression atroce du Hamas a eu un effet de coalition et de cohésion alors même que la société israélienne était profondément divisée entre Juifs laïcs et religieux. La guerre suppose, exige, entraîne une mise au pas des hommes, des femmes et des consciences: l’urgence est à l’unité. Cet effet de rassemblement a été remarquable en Israël: les Juifs se sont sentis attaqués dans leur identité profonde, menacés au cœur de leur territoire. Simplement, il ne s’agit pas, comme c’est le cas pour l’Ukraine, d’une guerre conventionnelle qui pourrait s’étaler sur de très nombreux mois. Les divisions demeurent profondes et touchent le règlement même de la question palestinienne, la colonisation, l’idée de «deux Etats». Elles ressurgiront vite.
Quelles sont les principales raisons invoquées pour faire la guerre? L’appropriation, la peur, la vanité?
Hobbes dramatise une trinité passionnelle fameuse pour expliquer ce qu’il appelle «la guerre de tous contre tous», celle des individus «avant» l’Etat. Mais elle peut valoir aussi pour les guerres interétatiques. C’est au fond la tragédie du désir humain: je désire ce que l’autre possède (cupidité) ; je désire défendre ce que j’ai de la convoitise de l’autre (peur) ; je désire montrer à l’autre que je suis supérieur à lui (vanité). On peut facilement déduire de cette tripartition une classification entre guerres: de conquête, de sécurité ou de prestige. A cette présentation traditionnelle des «raisons» de la guerre, qui a fait ses preuves au cours des siècles, je voudrais juste ajouter deux éléments. D’abord Hobbes oublie, me semble-t-il, une quatrième passion fondamentale, qui est la colère: la rage née d’humiliations passées, le ressentiment face à une situation qu’on ressent comme profondément injuste. Cette «quatrième» cause de la guerre est souvent oubliée, alors qu’elle me semble être une grille de lecture des violences particulièrement féconde pour notre monde contemporain. Par ailleurs et enfin, subsiste toujours, par-delà ces trois ou quatre raisons des guerres proposées par la philosophie, une inquiétude qu’agite la psychanalyse. Et si les guerres renvoyaient avant tout à cet abîme de violences creusé en chaque individu que Freud désigne comme «la pulsion de mort»? Elles témoigneraient avant tout alors et en dernière instance, par-delà toutes les raisons «objectives» déployées par les historiens pour expliquer les guerres, d’une pente profondément suicidaire de l’humanité dans son ensemble. Pessimisme profond et qui a ses adeptes. A quoi je préférerai toujours l’optimiste lucide et rationnel de Spinoza qui nous apprend qu’il n’y a guerre que pour autant que nous cultivions et nourrissions, en nous et chez les autres, les passions tristes de la crainte, de l’envie et de la haine.
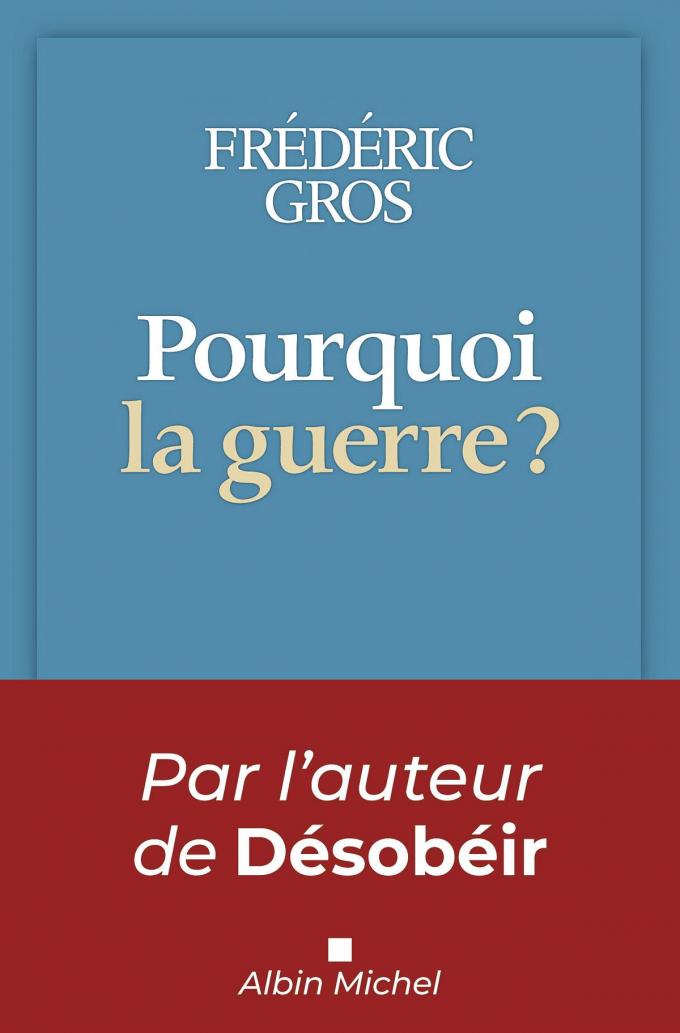
Bio express
1965
Naissance, à Saint-Cyr-l’Ecole, au sud-ouest de Paris.
1990
Obtient l’agrégation de philosophie à l’Ecole normale supérieure de Paris.
1996
Publie Michel Foucault (PUF, Que sais-je?).
2006
Etats de violence. Essai sur la fin de la guerre (Gallimard).
2017
Désobéir (Albin Michel).
2019
Se voit décerner le Prix lycéen du livre de philosophie pour Désobéir.
2021
La Honte est un sentiment révolutionnaire (Albin Michel).

