
(Z+ Le Vif) Iris Bey, essayiste : « Notre culture a moins mis en valeur le cinéma de femme »
Empêcheuse de tourner en rond et entre hommes, l’auteure et critique Iris Brey théorise, dans son dernier essai, le female gaze : un regard cinématographique féminin qui a le pouvoir de changer l’éthique et l’esthétique du cinéma.
Un corps qui serait sujet, et pas seulement à l’appréciation masculine cinématographique, c’est ce que défend Iris Brey dans son livre Le Regard féminin. Une révolution à l’écran (1). Après avoir observé la révolution sexuelle des séries dans un premier ouvrage, la critique française, qui a fait ses classes à l’université de New York, s’attaque au septième art. Tour à tour indignée par l’invisibilisation des réalisatrices et celle de l’expérience du corps féminin à l’écran, elle exhume une théorie développée aux Etats-Unis : celle du female gaze, » un regard qui donne une subjectivité au personnage féminin, permettant ainsi au spectateur et à la spectatrice de ressentir l’expérience de l’héroïne sans pour autant s’identifier à elle « . Un regard utile alors que la cérémonie des César 2020 continue à susciter le débat.
Le cinéma montre le corps des femmes comme un objet de désir. Pas un corps en capacité d’agir.
Quelle oeuvre vous a fait prendre conscience que le » regard cinéma » est genré, codifié par les hommes ?
Je crois que la première oeuvre qui m’a fait prendre conscience qu’il y avait une possibilité de filmer les corps féminins différemment, c’est La Leçon de piano de Jane Campion. Par contre, j’ai mis plus de temps à reconnaître le regard masculin, parce qu’il est si omniscient qu’aucun film ne se démarquait : il était partout, tout le temps. J’y étais totalement habituée.
Qu’est-ce qui vous a frappée, dans La Leçon de piano ?
Avant toute chose, d’être face à une héroïne qui n’avait pas droit à la parole. La mise en scène de ce corps féminin corseté, muet, a bizarrement résonné en moi : elle était l’image de quelque chose que je pressentais, que je vivais. Je n’avais pas réalisé tout ce que ce personnage, cette expérience d’un corps féminin silencié, racontait de ma réalité.
Que montre le cinéma du corps des femmes ? Et que ne montre-t-il pas ?
Le cinéma, en général, montre le corps des femmes comme un objet de désir : un corps morcelé. Ce qu’il ne montre pas, c’est un corps en capacité d’agir – un corps qui jouit.

Dans votre livre, vous opposez d’ailleurs objet de désir et sujet de désir…
Etre un sujet de désir, c’est pouvoir prendre son désir entre ses propres mains, l’articuler, le vivre tout simplement. C’est être en capacité d’agir face à lui.
Depuis quand existe-t-il des films qui montrent la femme comme sujet de son propre désir ?
Depuis toujours, en fait, dès les films d’Alice Guy ! Celui dont je parle dans le livre, Madame a des envies, date de 1906 : on y voit un personnage féminin qui a des désirs de femme enceinte et qui fait tout pour les assouvir. Dès les premiers films jamais réalisés, c’était déjà au coeur des problématiques. Mais notre culture les a moins mis en valeur.
Pensez-vous que les réalisatrices ont été sciemment effacées de l’histoire du cinéma ?
Très clairement. Le regard des cinéastes femmes a même été éradiqué de notre patrimoine. Par contre, parce qu’il est aussi le fait d’hommes, ce n’est pas le cas du female gaze. Il faut s’interroger sur la raison pour laquelle, quand ce sont des hommes qui adoptent un regard féminin, leurs films ont tendance à devenir cultes. Des films comme Thelma et Louise ou Titanic ont marqué la culture populaire de manière extrêmement forte, alors que des films réalisés par des femmes et qui adoptent ce point de vue féminin, il y en a bien moins.
A quand remonte l’invention du terme male gaze ? A quoi répondait-il ?
Elle remonte à un article de 1975 écrit par Laura Mulvey dans une revue intitulée Screen. A la base, ce n’était que ça, un article. Mais il a trouvé un vrai écho, parce que Laura Mulvey avait mis des mots sur une chose que l’on pressentait, mais qui n’avait jamais été présenté de manière théorique. Ce qu’elle articule très bien, c’est que le regard du spectateur s’identifie au regard de la caméra qui, elle-même, est le relais du regard du personnage masculin, le héros. Et que ce héros prend du plaisir en objectifiant le corps des femmes.
Ce qui n’est pas si évident à saisir, c’est que le female gaze n’est pas le miroir du male gaze…
Laura Mulvey décrit le male gaze comme l’acte de prendre du plaisir en regardant l’autre comme objet. Pour moi, peu importe que celui qui objectifie soit un homme ou une femme : cela reste du male gaze – même si l’on objectifie le corps d’un homme, d’ailleurs. Le female gaze, quant à lui, déconstruit ce regard pour prendre du plaisir en considérant l’autre comme sujet. C’est un vrai déplacement, pas simplement une inversion de genre. C’est une grammaire visuelle à inventer.
De la même manière, il ne faut pas être une femme pour poser un regard féminin.
Exactement, un homme peut produire du female gaze. Ce n’est pas le sexe du cinéaste qui définit la manière dont il filme : c’est un geste conscientisé, ou non. Mais la plupart du temps, ceux qui filment reproduisent les gestes qu’eux-mêmes ont vu en tant que cinéphiles. On est imprégné de cette culture. C’est donc un vrai travail de déconstruction de décider, en tant que réalisateur, de faire différemment.
Cela signifie-t-il que le female gaze vaut mieux que le male gaze ?
Ce serait une position moralisatrice de le dire. En revanche, je pense que le female gaze permet de nous déplacer et de valoriser l’expérience féminine et ça, ça a de la valeur. Ces deux régimes de regard ont toujours existé, coexisté. Simplement, l’un des deux a toujours été moins valorisé que l’autre. C’est ça que j’interroge. C’est une question d’éthique, pas de morale. C’est ensuite au spectateur de décider quels récits il a envie de regarder, une liberté individuelle à laquelle je ne toucherai jamais. Mais notre cinéphilie et notre rapport aux autres ont le droit d’évoluer : on n’est pas obligé de continuer à fétichiser indéfiniment les mêmes films. C’est l’inverse d’un geste révisionniste.
On peut faire des succès au box-office en racontant des histoires de femmes, d’un point de vue féminin.
Comment se décentre-t-on de cette vision très masculine du cinéma ? Dans votre livre, vous racontez par exemple l’anecdote d’une réalisatrice qui se rend compte que son chef opérateur, par son cadrage, sexualise le corps d’une comédienne pendant une scène de danse. Elle le pousse physiquement pour faire pivoter son cadre…
C’est un geste très privé et individuel, à mon avis, mais ça passe clairement par la mise en scène. C’est en effet souvent une question de cadrage, de distance et de mouvement de la caméra. Parfois, il suffit de bouger un petit peu pour faire ressentir des choses très différentes. C’est une intention, un choix conscient de chercher des contre-discours.
Dégenrer le cinéma relève donc encore d’un véritable effort aujourd’hui ?
On aimerait que ce ne soit pas le cas, mais visiblement, oui, puisqu’il s’agit encore de reconnaître ce regard… C’est peut-être l’étape la plus difficile : prendre conscience de ses réflexes, c’est reconnaître l’existence d’un inconscient patriarcal. Et c’est une violence de le déconstruire, parce que cela remet en question notre intimité.
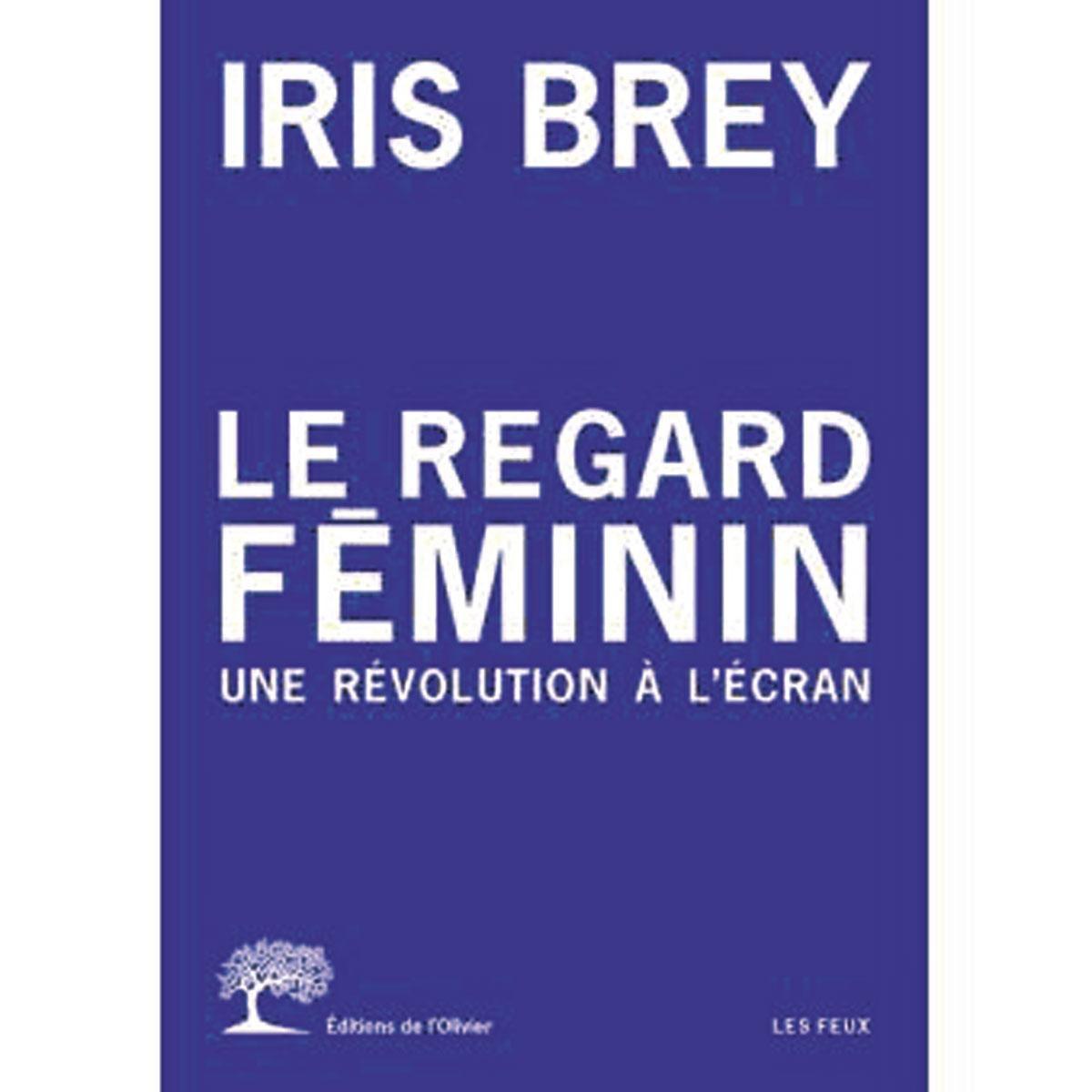
Le female gaze est-il un concept post-#MeToo ?
Non. Par contre, le fait que j’écrive ce livre après #MeToo et qu’il fasse écho, c’est la preuve qu’on s’est mis à réfléchir collectivement aux violences faites aux femmes. Le female gaze a toujours été là, mais on a eu besoin de cette grande révolution. D’autant qu’en France, il existe toujours une grande résistance à #MeToo. On met encore en doute la parole des femmes, qui vivent dans une culture du viol à la française.
Qu’est-ce que la pop culture, les séries, les blockbusters, ont fait pour la mise en scène du corps des femmes ?
Les séries ont une telle force de frappe… La Servante écarlate, par exemple, a eu un vrai impact. Elle a marqué les imaginaires. A l’inverse, Game of Thrones montre tout ce qui est problématique, notamment à travers sa représentation du viol. Mais la culture populaire produit aujourd’hui des oeuvres qui portent d’autres récits. Je commence mon livre avec l’exemple de Wonder Woman, qui montre bien qu’on peut faire des succès au box-office en racontant des histoires de femmes, d’un point de vue féminin. Je pense d’ailleurs qu’on est à un moment intéressant de la production, parce qu’on se rend compte que le féminin fait vendre. J’ai hâte de voir comment tout cela va évoluer.
Bio express
1984 : Naissanced’Iris Brey.
2015 : Thèse sur les mères déchaînées dans le cinéma d’Arnaud Desplechin, Joachim Lafosse, Christophe Honoré et Claire Denis. Docteure en études cinématographiques et en littérature (université de New York). Se plonge dans l’analyse du cinéma sous le prisme du genre.
2016 : Publie Sex and the series. Sexualités féminines, une révolution télévisuelle (Libellus), qui explore le rôle des séries dans le récit contemporain autour de la sexualité féminine.
2017 : Réalise l’adaptation de Sex and the series dans un film-documentaire en cinq épisodes qui se penche sur les séries Masters of Sex, Fleabag, Girls, Transparent et The L Word.
2018 : Membre du Collectif 50/50 qui milite pour plus de diversité et la fin des dynamiques de pouvoir sexistes dans le cinéma.
2020 : Le Regard féminin. Une révolution à l’écran (Editions de l’Olivier).
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici