
Julia De Funès, philosophe: « Le télétravail ne pourra plus se limiter à quelques heures par semaine » (entretien)

Prisonniers d’un lieu et maîtres de notre vie, nous avons dû faire des choix. Or, la liberté, c’est choisir, analyse la philosophe française. Le confinement a provoqué une rupture épistémologique, c’est-à-dire un arrêt qui fait… avancer les façons de penser. La preuve par le monde de l’entreprise.
Lire également notre dossier consacré à la crise du coronavirus
Dans l’essai Ce qui changerait tout sans rien changer (1), vous rappelez que les catastrophes facilitent les ruptures épistémologiques. La crise du coronavirus en provoque-t-elle une ?
Une rupture épistémologique est un choc brutal qui marque un arrêt des modes de fonctionnement et des façons de penser qu’on estimait convenus et qu’on ne questionnait plus. Elle est épistémologique au sens où elle fait avancer les choses. Sans tomber dans des prédictions hasardeuses, on peut déjà le constater, notamment dans le domaine du travail. Cet arrêt fait avancer certaines manières de faire.
Le confinement a-t-il pu convaincre des chefs d’entreprise de l’utilité du télétravail et de l’intérêt d’accorder plus d’autonomie à leurs employés ?
Qu’est-ce qui a maintenu l’activité économique, certes à un niveau très ralenti, pendant le confinement ? Le télétravail. Heureusement que toutes les banques, les sociétés d’informatique, les compagnies d’assurance… ont télétravaillé. Sa nécessité n’est plus questionnable. Les outils numériques sauvent des sociétés en cas de grandes difficultés. Tout le monde s’y est mis. Cela ne s’était jamais vu dans le monde de l’entreprise. Or, quand on a octroyé une liberté, il est très difficile de revenir en arrière et de décréter que » maintenant, c’est fini « . Il y aura évidemment des ajustements, une hybridation des modes de travail. Le télétravail ne sera pas continu. Mais il s’est en tout cas généralisé. Et, de la sorte, il favorise l’autonomisation des collaborateurs d’une entreprise.
L’hybridation entre présentiel et télétravail s’organisera de façon plus équilibrée.
Des sociétés qui acceptent le principe du télétravail sauf le lundi et le vendredi, par suspicion d’allongement du week-end, et sauf le mercredi, par suspicion de garde d’enfants comme vous l’expliquiez dans La comédie (in)humaine (L’Observatoire, 2018), ce ne sera plus possible ?
Cela continuera à exister parce qu’il y aura toujours des dirigeants et des directions qui, malheureusement, ne font pas confiance à leurs collaborateurs et qui contrôlent tout. Mais il est sûr que, de manière générale, le télétravail ne pourra plus se limiter à quelques heures par semaine. La répartition entre présentiel et télétravail s’organisera de façon plus équilibrée.
Vous classez les métiers en trois catégories, les utiles et nécessaires, les utiles et non nécessaires, les non utiles et non nécessaires. La crise sanitaire va-t-elle modifier la hiérarchie des valeurs des professions ?
Quand j’évoque des métiers non utiles et non nécessaires, je ne parle pas des personnes mais bien des fonctions qui, parfois, ne servent à rien. Ce sont les employés qui les occupent qui les qualifient eux-mêmes de la sorte. Beaucoup de personnes souffrent désormais de brown-out (NDLR : lassitude face à un travail perçu comme dénué de sens). La femme de ménage ou l’assistante de direction ne sont pas confrontées au problème du sens de leur métier. En revanche, des cadres ne savent absolument plus à quoi ils servent parce que leur job est devenu tellement technique qu’ils ne voient plus son impact sur le monde, sur les autres… La technique est un moyen, ce n’est jamais une finalité en soi. La technicisation des tâches a rendu un certain nombre de métiers totalement » définalisés « , dénués de sens. C’est ceux-là que je qualifie de non utiles et non nécessaires.

La façon dont a été vécu le confinement a-t-elle pu contribuer à débureaucratiser les entreprises ?
Par nécessité pragmatique, les entreprises ont dû s’adapter et décongestionner certaines lourdeurs bureaucratiques. Les banques n’ont jamais eu des procédures aussi flexibles que pendant le confinement, pareil pour les assurances. Un peu de jeu a été mis dans des process qui semblaient très ankylosés. C’est un paradoxe. Plus le pays est congestionné au niveau macro, plus il se décongestionne au niveau micro, parce qu’il faut bien survivre. Alors que quand tout va bien, on est plutôt libre au niveau macro et on sécurise à outrance au niveau micro sous peine de bloquer les initiatives. Pendant le confinement, on a plus pensé en fonction du sens de la conjoncture qu’en fonction des procédures à respecter.
» Nous devrions apprendre à être lents pour devenir forts » : ce conseil de Nietzsche, vous le citez dans votre précédent livre, Développement (im)personnel (L’Observatoire, 2019). Le ralentissement dû à la crise sanitaire nous aurait-il fait découvrir les vertus du temps long ?
Le temps long est structurant et déterminant pour la maturation, pour le perfectionnement, pour la maîtrise de nos actions, de notre travail… Certaines personnes qui ont disposé de conditions confortables pendant le confinement (un lieu pour travailler, un autre pour se concentrer…) ont effectivement pu se déprendre d’un temps plus stressant, plus destructeur, plus anxiogène, celui de la vie courante avant le confinement. Pour elles, cette découverte a indéniablement constitué un bienfait. Mais il est impossible de généraliser. Pour beaucoup d’autres personnes, le confinement a été un enfer parce que, justement, elles n’avaient pas de lieu pour s’isoler ou n’ont pas réussi à s’accorder des moments à elles pour se concentrer et approfondir une tâche.
Une fois que les libertés ont été réaccordées, c’est comme si elles étaient devenues des faveurs gouvernementales.
En quoi le confinement a-t-il contribué à ce que nous soyons plus libres, comme vous le prétendez ?
C’est le paradoxe du confinement : il nous a forcés à être libres. Nous avons dû faire des choix. Des choix très difficiles pour les mères et les pères de famille. Il a fallu arbitrer entre s’occuper des devoirs des enfants et préparer sa réunion ou ses dossiers. Arbitrer, c’est choisir. Choisir, c’est renoncer. C’est comme cela que nous sommes des personnes autonomes et libres. La liberté, c’est faire des choix. Nous avons été contraints d’exercer notre responsabilité, notre liberté. Or, il n’est pas si facile d’accepter d’être libre. D’une certaine façon, nous avons eu les cartes en main, nous avons été maître de notre destin. C’est satisfaisant. Mais en même temps, cela implique une grande responsabilité parce que si nous nous trompons, c’est uniquement de notre faute. Voilà en quoi le confinement – le fait d’être prisonnier d’un lieu – nous a rendus libres parce qu’il nous a obligés à choisir. On rejoint là l’idée que Jean-Paul Sartre avait développée en affirmant que l’on n’avait jamais été aussi libres que sous l’occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale (NDLR : dans un texte de l’intellectuel français paru dans le mensuel Les Lettres françaises en septembre 1944). C’était très provoquant bien sûr. Mais cela voulait dire qu’à un moment, il y avait un choix d’existence à poser : où on résistait où on subissait. On parle du vertige de la liberté humaine. Et lors de la période du confinement, dans des proportions vraiment incomparables, nous avons eu à choisir entre des actes divers et à éprouver notre responsabilité, notre liberté.
En quoi la poignée de main pourrait-elle se comprendre, une fois l’épidémie passée, comme une » reconnaissance de liberté » ?
Le virus nous a permis de réfléchir sur ces gestes que nous faisions de manière complètement machinale et dont nous ne comprenions pas la teneur philosophique. La main est la partie la plus libre de l’humain. Elle est projet ; c’est avec elle que l’on fabrique, que l’on écrit. Elle n’a pas de dimension charnelle comme d’autres parties du corps, la bouche, les fesses, les seins ; elle n’est pas désirable. La main est, d’une certaine façon, très intellectuelle. Quand on serre la main d’une personne, on ne cherche pas son corps mais sa liberté dans un désir d’appropriation paradoxale : posséder ce qui est impossédable. A méditer quand nous pourrons renouer avec ce geste qui nous paraissait si anodin avant le Covid-19.
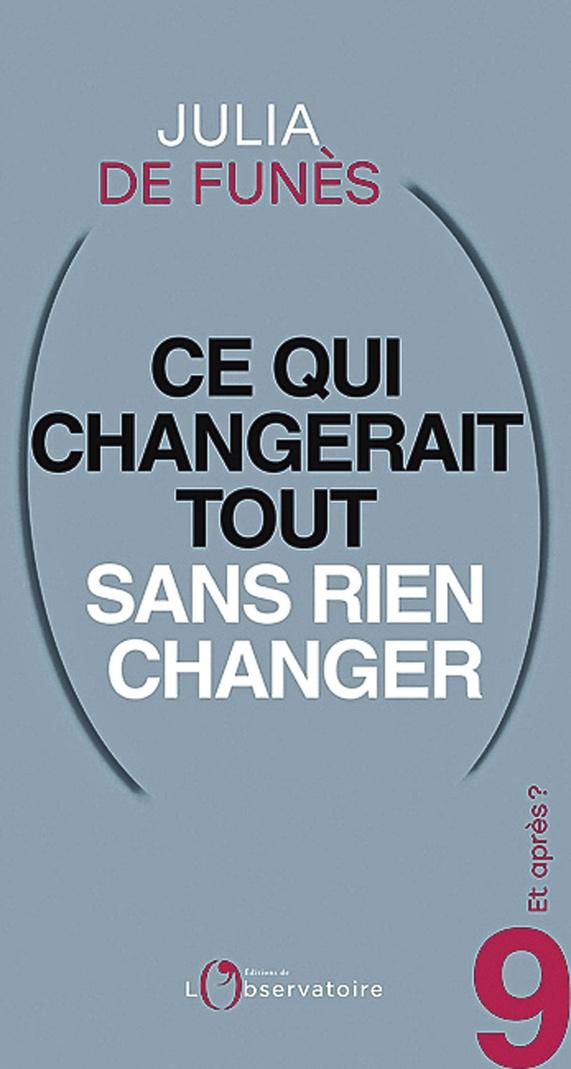
Vous écrivez qu' » agir n’est pas suivre l’ordre des événements passivement, se retrancher derrière le donné mais le comprendre pour en orienter les faits « . N’avez-vous pas été surprise par la docilité des citoyens face aux mesures de sécurité sanitaire ?
Je ne juge pas la population. Nous avons été dociles, moi y compris. Nous n’avions pas tellement le choix. Enfin, si, on a toujours le choix. Mais nous ignorions tout de ce virus ; nous étions impuissants, ignorants, dans le doute et dans la peur. Nous nous sommes conformés aux injonctions gouvernementales. La docilité est compréhensible. Ce qui l’est moins, c’est la menace un peu liberticide émanant du gouvernement, en France en tout cas. Nous avons subi une restriction totale des libertés. Et une fois qu’elles ont été réaccordées, c’est comme si elles étaient devenues des faveurs gouvernementales. » Vous avez le droit d’aller en vacances « . » Vous avez le droit de retourner dans les restaurants « … Cela donne l’impression que la liberté devient un cadeau du gouvernement, alors que c’est un droit fondamental et inaliénable. Je trouve qu’on a perdu un peu le sens de la liberté. On s’est laissé faire, ce qui est compréhensible. Mais devait-on aboutir à cette imposition extrême de restrictions ? La question reste ouverte.
Bio express
– 1979: Naissance le 4 mars à Paris. Julia Florence de Funès de Galarza est la petite-fille de l’acteur Louis de Funès.
– 2010 : Crée son cabinet de conseil en philosophie, Prophil conseil.
– 2017 : Publie Socrate au pays des process (Flammarion).
– 2018 : La comédie (in)humaine. Comment les entreprises font fuir les meilleurs, avec Nicolas Bouzou (L’Observatoire).
– 2019 : Développement (im)personnel, Le succès d’une imposture (L’Observatoire).
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici