
Frédéric Paulin, romancier: « Les peuples européens ont la mémoire courte »
L’écrivain français achève avec La Fabrique de la terreur son triptyque géopolitique et historique sur le djihadisme en remontant aux racines du mal, dans l’Algérie des années 1990, pour aboutir aux attentats parisiens de novembre 2015. Selon lui, le risque, pour les Européens, est un dysfonctionnement de la démocratie.
En 1995, vous voyez sur les murs de la gare de Rennes le portrait de Khaled Kelkal, responsable d’une vague d’attentats en France. C’est sur ceux-ci que se referme La Guerre est une ruse, premier volet du triptyque que vous achevez avec la tragédie du Bataclan dans La Fabrique de la terreur (1). Comment votre réflexion s’articule-t-elle au cours de ces deux décennies ?
La photo anthropométrique de Khaled Kelkal ( NDLR : terroriste algérien du Groupe islamique armé) circule dans les lieux publics. Il est de face et de profil. Il est surtout vêtu d’un blouson de cuir avec cette gueule tout à fait banale de mes camarades de lycée lorsque j’habite en région parisienne. Je me dis que ça peut être l’un de mes potes qui va au bled l’été. Dans la foulée du 13 novembre 2015, j’entends des gens éduqués, cultivés et conscientisés dire des choses comme : » Dans quel monde vit-on pour voir ces jeunes gens qui tirent dans le tas et se font exploser dans une salle de concert ! » Sauf que je me souviens de Khaled Kelkal et j’y vois une trajectoire d’individus. Je réalise qu’il y a aussi une trajectoire d’organisations politiques. L’histoire est faite de différentes couches qui relient le présent au passé. Je crois aussi qu’on ne peut pas penser le moment présent sans connaissance. C’est pour cela que j’écris sur ces moments-là. Parce qu’il faut expliquer les choses et questionner le lecteur.
C’est soit de l’incompétence, soit de l’arrogance de penser qu’un virus ne nous touchera pas.
Vous avez été professeur de géographie et d’histoire ainsi que journaliste pigiste pour la presse locale. Deux métiers où les notions de transmission et de mémoire sont importantes. Ce triptyque répond-il aussi à ce devoir de transmission et de mémoire ?
Aujourd’hui, j’y vois un sens. J’écris peut-être pour cela. Parce que je crois que les peuples, particulièrement européens, ont une mémoire très courte. La question de la mémoire est un problème actuellement très présent sur notre continent. Pour revenir au triptyque, ce qui est gratifiant, ce sont les retours des Algériens qui me remercient en librairie d’avoir écrit sur cette période que personne n’aborde. Ensuite, des Français me disent ne pas se souvenir, ou alors très vaguement, de la guerre civile en Algérie. Idem avec le gang de Roubaix ( NDLR : association de malfaiteurs réputée proche d’Al-Qaeda et responsable de vols à main armée violents en 1996). Pareil avec le dysfonctionnement entre la CIA et le FBI ( NDLR : rétention d’informations, défaut de coopération...) avant le 11 septembre 2001.
Ces jeunes qui se font sauter en Europe ne cristallisent-ils pas l’impuissance et le désarroi des parents, des professeurs et des services sociaux ?
Et d’une certaine manière, des flics aussi. Je crois vraiment que l’écrit, l’éducation, la connaissance sont des armes à opposer à une tyrannie, à un totalitarisme et même à une démocratie qui fonctionne mal. Le risque, pour nous, Européens, c’est le dysfonctionnement de la démocratie. Qui peut aussi nous amener à un régime totalitaire. Il est clair que dans l’histoire que je raconte, il y a des parents, des enseignants qui sont dépassés. C’est ce que j’essaie de montrer dans La Fabrique de la terreur. Vous n’envoyez pas des gamins se faire exploser dans une salle de concert sans les débrancher à un moment.
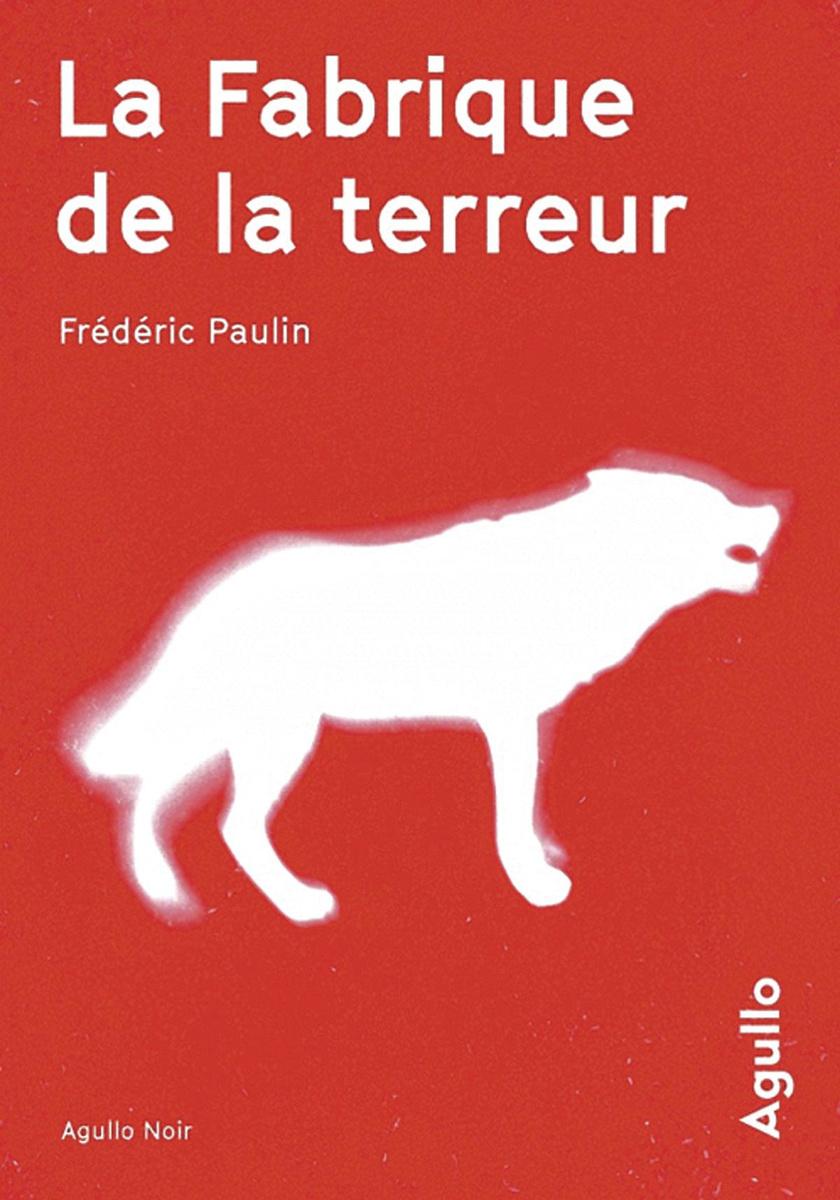
Quelques mots sur votre travail de recherches en amont de l’écriture ?
C’est un sujet qui me prend la tête depuis longtemps. J’ai cet exemplaire du Monde avec Ben Laden, un autre de Libération avec l’assaut du GIGN sur la planque des frères Kouachi, j’ai des bouquins sur le djihadisme, je me documente depuis longtemps. Au point que je me demande si c’est la documentation qui crée l’architecture du bouquin ou si c’est l’architecture du bouquin qui me pousse à me documenter. En tout cas, il y a un mouvement de balancier. Le site sur la situation des droits humains en Algérie, Algeria-Watch, est aussi une mine de données sur la période des années 1990 dans le pays. Par contre, je n’ai pas de sources auprès de repentis ou au sein de la DGSE. Néanmoins, je vérifie toute ma documentation. Je blinde mes sources documentaires parce que je travaille sur un matériau douloureux. Et par respect pour les victimes, les familles de victimes et certains témoins qui sont toujours en vie. Je m’interdis de modifier l’histoire pour mon confort d’écrivain parce j’ai bien conscience d’être sur une ligne étroite où évoluent le romancier, l’historien et le journaliste.
La guerre n’est plus frontale. Elle est non conventionnelle.
Comme dans la trilogie de Don Winslow sur la guerre que mènent les Etats-Unis contre le narcotrafic – La Griffe du chien (Fayard), Cartel (Seuil), La Frontière (Harpercollins) – vous glissez la petite histoire dans la grande. Le personnage fictif de Don Winslow, Art Keller, est un agent de la DEA et chez vous, c’est Tedj Benlazar, agent de la DGSE algéro-français. Double nationalité nécessaire pour faire le lien entre les deux pays et remonter à la source du mal ?
Je suis fortement marqué par La Griffe du chien et je me reconnais en Don Winslow. Tedj Benlazar a du Art Keller en lui. Assurément. C’est un personnage métaphorique qui l’est historiquement dans les rapports de l’Algérie et de la France par sa double nationalité. père est algérien. Sa mère, française. Il l’est aussi parce qu’il est considéré comme un fonctionnaire nul en Algérie. Par contre, par ses collègues français, il est considéré possiblement comme un agent double, voire triple. Comme pour Art Keller, le métier de Benlazar, c’est de mentir. Sa vie est un mensonge. Il y a la métaphore géopolitique et la métaphore des diverses strates qui engendrent le chaos entre le gouvernement, l’armée algérienne, les différents offices de renseignement, les Français. Benlazar est un personnage intéressant qui doit s’allonger sur le divan d’un psychologue plutôt que traquer les terroristes. C’est le héros du roman noir qui a plein de casseroles, des problèmes avec la justice. A un moment, un personnage s’interroge sur lui en disant : » Mais comment il a pu vivre si longtemps en ayant toujours échoué. » Finalement, comment arrive-t-on au 13 novembre 2015 alors qu’on sait depuis l’Algérie que tout est en place. Ça tape à Paris, New York, Londres, Madrid sans parler de l’Afghanistan et de l’Irak. Tous les signaux sont là ! Néanmoins, on voit comment les sociétés vivent en échouant tout comme Benlazar et Art Keller vivent, eux aussi, en échouant.

Pourquoi affirmez-vous que depuis l’Algérie, la France est toujours en guerre sans le dire vraiment ?
Il y a cette croyance du Français qu’il n’y a plus de guerre depuis quatre-vingts ans. La guerre n’est plus frontale. Elle est non conventionnelle. La France est présente au Liban, en ex-Yougoslavie, dans la coalition contre Daech et aujourd’hui, quatre mille soldats français sont toujours au Mali. On fait la guerre parce qu’on craint que la contagion nous touche à nouveau. C’est quand même une façon problématique de communiquer de la part d’un gouvernement ou d’une société de dire : » Non, non, nous ne sommes pas en guerre, nous sommes un Etat pacifiste. »
Pour paraphraser le discours du président Emmanuel Macron au début de cette crise sanitaire, il est tentant d’établir un parallèle entre la guerre contre le terrorisme et celle contre le Covid-19. Qu’est-ce que cela vous inspire ?
Le parallèle, c’est la difficulté de prendre la menace au sérieux. Lorsque Khaled Kelkal commet ses attentats en France, le gouvernement français se considère à l’abri. Plus tard, les attentats à Londres (NDLR : le 7 juillet 2005) sont justifiés par la présence de nombreux radicaux sur le sol britannique. De fait, jusque Mohammed Merah en 2012, la France est peinarde. Et même là, on ne veut pas voir. Après Charlie Hebdo, alors que de nombreux attentats sont déjoués, on s’imagine enfin tranquilles. Avec le coronavirus, même si je pense qu’il faudra un peu de temps pour élargir la focale, j’ai l’impression que le gouvernement français n’a pas pris cette menace au sérieux. Quand ça commence à exploser en Chine, notre ministre de la Santé, Agnès Buzyn, nous dit que le virus ne passera pas les frontières. Quand ça arrive en Italie du Nord, que ça tombe de partout et que le pays se confine, la France n’est toujours pas en confinement. On autorise un match de foot à Lyon (NDLR : huitième de finale de la Ligue des Champions entre l’OL et la Juventus, le 26 février dernier) avec la présence de trois mille supporters italiens sur le sol français et on autorise le premier tour des élections municipales le 15 mars. C’est soit de l’incompétence, soit de l’arrogance de penser qu’un virus ne nous touchera pas.
Bio express
1972: Naissance en Ile-de-France.
1992: Installation à Rennes.
2009: Sortie de son premier roman, La Grande Déglingue (Les Pérséides, 321 p.).
2019: Lauréat du grand prix du roman noir au Festival du film policier de Beaune pour La Guerre est une ruse (Agullo Noir, réédité récemment en poche chez Folio) et sortie de Prémices de la chute (Agullo Noir).
2020: Sortie de La Fabrique de la terreur (Agullo Noir).
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici