
Enzo Traverso «Le mot ‘révolution’ a été galvaudé, ce n’est pas une raison pour l’abandonner» (entretien)
Historien des idées, professeur en sciences humaines à l’université Cornell, aux Etats-Unis, Enzo Traverso propose une étude panoramique de l’histoire culturelle des révolutions. Loin de cantonner le concept à l’imaginaire du «Grand Soir», il en explore toute la polysémie.
Il est reconnu comme l’un des historiens des idées les plus pertinents de sa génération. L’un des plus impertinents, aussi. Né en Italie dans une famille «catho-communiste» et spécialiste de l’histoire du judaïsme et des totalitarismes, Enzo Traverso a réussi à fidéliser un cercle stable de lecteurs que l’exigence et la rigueur de ses travaux n’ont jamais ébréché. Il peut en effet s’enorgueillir d’une qualité qui scelle sa marque de fabrique: sa capacité à capter l’air du temps et sentir l’époque. En témoigne une fois encore son dernier livre: Révolution. Une histoire culturelle.
· 1957 Naissance, le 14 octobre, à Gavi, au nord-ouest de l’Italie.
· 1985 S’installe à Paris et s’inscrit en doctorat d’histoire à l’Ehess.
· 1989 Soutient sa thèse «Les Marxistes et la question juive: histoire d’un débat (1843-1943)».
· 1995 Est nommé professeur à l’université de Picardie.
· 2016 Publie l’ouvrage à succès Mélancolie de gauche. La force d’une tradition cachée (XIXe-XXIe siècle) (La Découverte).
«Révolution citoyenne», «révolution écologique», «révolution MeToo», l’inflation du lexique révolutionnaire dans le débat public et son spectaculaire retour en grâce dans les mouvements sociaux sont aujourd’hui grandement revendiqués. Que révèle ce regain d’intérêt?
L’histoire s’écrit toujours au présent, car c’est dans le présent que nous formulons les grandes questions avec lesquelles nous interrogeons le passé. Il est donc possible que mon étude surgisse d’une effervescence politique contemporaine qui a redonné une certaine actualité au concept de révolution. J’y explore les différentes dimensions – culturelle, politique, idéologique, esthétique – d’une expérience révolutionnaire qui a si profondément marqué les deux siècles passés. Mais cette expérience est achevée – c’est la condition pour en écrire l’histoire – et le bouillonnement rebelle d’aujourd’hui présente des traits profondément nouveaux, qui appartiennent à un autre cycle historique. Si mon ouvrage entre en résonance avec le présent et réussit à amorcer une réflexion sur le rapport qui existe entre les révolutions du XXe siècle, épuisées ou défaites, et les espoirs de changer les mondes nés en ce début du XXIe siècle, j’en suis très heureux. Mon effort n’aura pas été inutile.
La nécessité de se réinventer fait la force des mouvements révolutionnaires actuels mais leur manque de mémoire les rend fragiles, voire éphémères.
Quel regard portez-vous sur cette nouvelle effervescence?
J’observe ce regain d’intérêt pour la révolution avec attention et beaucoup d’espoir, tout en sachant que ces mouvements – une constellation extrêmement hétérogène, allant des révolutions arabes de 2011 à Occupy Wall Street, de Nuit debout aux gilets jaunes, de Puerta del Sol à Madrid à Black Lives Matter – sont nés d’un tournant historique et d’une rupture dans la transmission mémorielle. Aucun de ces mouvements ne revendique l’héritage des révolutions du passé, ni leurs idéologies. Aucun ne s’identifie au communisme. Ils affichent sans doute une certaine sensibilité libertaire, mais ils n’incarnent pas une continuité avec les mouvements anarchistes du XIXe ou du XXe siècle. Bref, ils essaient d’inventer un projet révolutionnaire pour notre époque et doivent le faire en remettant en question toutes les traditions héritées. Le communisme n’existe plus, en tant que force propulsive, depuis au moins les années 1980. Le socialisme est devenu un visage de la société libérale et – c’est le moins que l’on puisse dire – ne prétend pas changer le monde. Le mouvement ouvrier de l’âge fordiste est un souvenir du passé. Dans le Sud, les courants nés de la décolonisation – nationalisme, panarabisme, anti-impérialisme – ont disparu, parfois remplacés par l’islamisme. L’écologie a pris une place nouvelle, centrale, dans un projet politique transformateur. Cette nécessité de se réinventer fait la force de ces mouvements, explique leur créativité mais leur manque de mémoire les rend fragiles, en leur donnant souvent un caractère éphémère.
Ce manque de mémoire fait à la fois leur force et leur faiblesse, écrivez-vous. Qu’entendez-vous par là?
Cette rupture de la transmission mémorielle est particulièrement visible dans tous ces mouvements. D’une part, la société néolibérale, avec ses formes de vies fluides, individualistes, fragmentaires (et précaires), a brisé ce que le sociologue Maurice Halbwachs appelait les «cadres sociaux de la mémoire». D’autre part, les organisations qui incarnaient la tradition et la culture de la gauche – les puissants partis de masse du XXe siècle – ont cessé d’exister. Le passé est appréhendé aujourd’hui par l’étude et l’industrie culturelle, il n’est plus transmis d’une génération à l’autre comme un ensemble de connaissances, expériences et pratiques partagées. Les mouvements du Printemps arabe de 2011, puis les gilets jaunes en 2018, se réclamaient de la Révolution française, en mettant en avant la liberté pour les uns, l’égalité pour les autres. Ils n’affichaient pas de drapeaux rouges. Cela indique que la culture socialiste et communiste héritée du passé ne paraît plus adéquate pour les armer, mais cela révèle aussi une incapacité d’inscription dans l’histoire, en dépassant les contingences du présent. Je ne crois pas qu’il faille reprocher quoi que ce soit à ces mouvements, qui sont fils de leur temps, mais ce constat s’impose.
Les politiques, de différents bords, convoquent aussi le terme «révolution». Emmanuel Macron a intitulé son livre Révolution, tandis que Jean-Luc Mélenchon parle de «révolution citoyenne». Que vous inspirent ces usages?
Personne n’a jamais cru à la «révolution» macroniste. Si Macron a été élu il y a cinq ans et réélu cette année, ce n’est pas à cause de l’enthousiasme suscité par sa «révolution», c’est parce que les institutions de la Ve République le placent en face de candidats inéligibles comme Marine Le Pen. La «révolution citoyenne» de Jean-Luc Mélenchon est bien différente, car elle incarne une alternative à la société néolibérale. Elle essaie de dialoguer avec les révoltes mentionnées plus haut, d’une manière générale assez indifférentes à la politique traditionnelle, de les fédérer et de leur donner une dimension politique. Je ne suis pas du tout certain qu’elle sera capable d’atteindre cet objectif, mais il faut lui reconnaître cette ambition. Le problème réside dans le fait que tous ces mouvements de révolte expriment un nouvel imaginaire, de nouvelles formes d’action et de représentation politiques, alors que Mélenchon incarne un style très ancien, celui du socialisme de la IIIe République. Je vois mal comment une synthèse entre ces deux tendances pourrait se faire.

Cet usage massif du terme «révolution» risque-t-il de le vider de sa substance?
«Révolution» est un mot galvaudé, susceptible d’usages multiples et contradictoires, mais ce n’est pas une raison pour l’abandonner. Pour les sciences sociales, notamment pour l’histoire, il possède une signification claire – une révolution est une rupture sociale et politique – et son usage ne tient pas aux modes passagères. Il est une catégorie analytique irremplaçable de la modernité, au moins depuis 1789. L’ ambiguïté du concept sera néanmoins surmontée, puisque les réalités sociales transforment le langage. Ce sont les mouvements sociaux et politiques qui, à chaque moment, définissent le contenu du mot. C’est un constat que je fais, en rappelant que ce concept sert à décrire et à interpréter la réalité. La tâche de l’historien est critique ; je n’écris ni pour idéaliser ni pour stigmatiser les révolutions, j’essaie de les comprendre.
La notion est aussi revendiquée par des mouvements féministes et sociétaux. On parle, par exemple, de révolution MeToo.
MeToo participe de l’effervescence abordée au début de notre conversation. Ce mouvement ne surgit pas du néant, car il serait incompréhensible sans l’histoire du féminisme et des luttes émancipatrices des femmes qui ont marqué si profondément l’histoire du monde moderne. Reste que renverser les structures patriarcales de nos sociétés et de nos institutions signifie remettre en cause des hiérarchies et des formes d’oppression millénaires, changer nos «formes de vie», et cette ambition me semble authentiquement révolutionnaire. MeToo, pourrait-on ajouter, remet en cause les hiérarchies de genre qui ont toujours dominé au sein de la gauche et même de plusieurs mouvements qui se voulaient révolutionnaires. Sa portée va donc bien au-delà de quelques actions spectaculaires ou de son impact médiatique.
Le renversement de l’ordre établi peut rarement faire l’économie de la violence, qui est un moment incontournable du processus révolutionnaire.
Cette lutte féministe est parfois articulée à d’autres causes: environnementales (écoféminisme), économiques (anticapitalisme patriarcal), etc. S’agit-il du bon mode opératoire ou la question féministe devrait-elle être plus autonome?
Je n’ai pas de leçons à donner au mouvement féministe, ni à lui indiquer une stratégie ou des modalités d’action. Tous les mouvements ont besoin de préserver leur autonomie pour exister, avec leurs propres formes d’organisation, leurs lieux de débat, leurs instances délibératives. Cette autonomie est indispensable à leur existence, à leur construction et à leur développement. Ils doivent aussi pouvoir apprendre de leurs erreurs. En même temps, tout mouvement ne peut s’affirmer ni gagner sans dépasser ses limites intrinsèques, sans se connecter et se coordonner avec d’autres mouvements. C’est cette convergence dans une perspective de transformation globale qui a manqué jusqu’à présent. Autrefois, les partis politiques avaient l’ambition d’élaborer une synthèse, de fédérer les mouvements en leur donnant une expression politique d’ensemble. Aujourd’hui, les partis politiques – ou ce qu’il en reste – ne sont plus en mesure de remplir ce rôle. Les questions de classe, de genre, de race, ainsi que les questions environnementales, sont toutes profondément imbriquées ; elles ne peuvent pas trouver de solutions sectorielles, séparées. L’oppression des femmes possède aussi une dimension sociale, raciale et environnementales. Toutes les approches «intersectionnelles» partent de ce constat.
Vous consacrez une partie de votre livre à plusieurs féministes révolutionnaires – Louise Michel, Clara Zetkin… Dans quelle mesure peuvent-elles être une source d’inspiration dans les combats d’aujourd’hui?
Je constate qu’elles ont été redécouvertes au cours des dernières décennies. En France, Louise Michel est une figure très populaire au sein de la gauche radicale: elle a fait l’objet de biographies, de films et ses écrits ont été réédités. C’est une nouvelle Louise Michel que les jeunes découvrent et aiment aujourd’hui, qui n’a plus grand-chose à voir avec la «vierge rouge» de la tradition communiste, martyre incarnant toutes les vertus conventionnelles de la féminité. Il s’agit d’une rebelle avec une vie sexuelle riche et diverse – on a décrit une Louise Michel queer – et animée par des convictions féministes et anticolonialistes. Nous savons que, lors de sa déportation en Nouvelle-Calédonie, elle s’est engagée, à la différence d’autres communards, dans le soutien de la grande révolte kanak. D’autres figures féministes aux parcours extraordinaires – Alexandra Kollontaï ou Claude Cahun – avaient déjà été sorties de l’oubli. La première reste une source fondamentale pour le féminisme contemporain, car elle fait le lien entre la libération des femmes, l’émancipation sexuelle, la remise en cause de la famille patriarcale et la critique du capitalisme. La seconde est un exemple unique de féminisme queer, communisme hérétique, anti- fascisme, anticolonialisme et avant-garde esthétique.
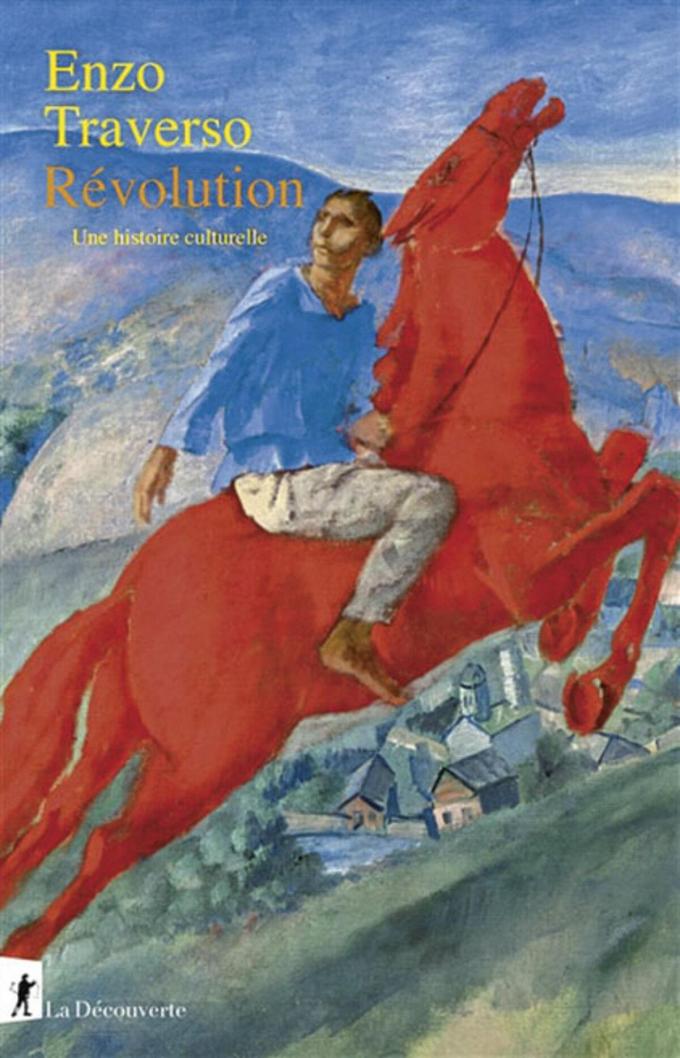
La mémoire des révolutions reste entachée de sang et de violence. Dans le livre, vous assumez éluder la question de la violence. Pourquoi ce choix?
Je ne crois pas éluder la question de la violence. J’explique ne pas avoir consacré un chapitre spécifique à cette question, car elle traverse l’ensemble du livre. La violence est ontologiquement inscrite dans le fait révolutionnaire. Le renversement de l’ordre établi peut rarement faire l’économie de la violence, qui est un moment incontournable du processus révolutionnaire. Les dominés ne peuvent pas se débarrasser gentiment de décennies ou siècles d’oppression ; les révolutions mobilisent des sentiments, des émotions, des passions. La Terreur est une étape centrale dans l’histoire de la Révolution française comme dans celle de la Révolution russe, car les révolutions sont des «furies» – j’emprunte cette définition au grand historien Arno Mayer – qui possèdent une dynamique irréfrénable. Encore une fois, il ne s’agit pas d’idéaliser cette violence, qui effraie notre regard rétrospectif, ni de la stigmatiser. L’approche historiographique conservatrice, qui dénonce l’irruption aveugle d’une violence criminelle sur la scène de l’histoire en l’expliquant comme l’accomplissement d’une idéologie malfaisante, se limite à condamner la révolution, tout en ignorant ou minimisant la violence contre-révolutionnaire. Les «livres noirs» du communisme ont toujours eu un fort impact médiatique mais leur apport à une connaissance critique de l’histoire des révolutions est quasiment nul. Ils n’ajoutent rien au diagnostic de Joseph de Maistre, le chantre du légitimisme, pour qui la révolution était un événement «satanique», mais ils ne possèdent pas la force de la prose légitimiste.

Pour un ouvrage de recherche rigoureux, votre livre est richement illustré.
Comme son sous-titre l’indique, mon livre est une «histoire culturelle», ce qui signifie aussi une histoire visuelle. On ne peut pas parler de révolution dans la culture sans évoquer les tableaux de Delacroix, les murales de Diego Rivera, les films de Sergueï Eisenstein ou les photos de Tina Modotti et Claude Cahun. C’est pourquoi les images occupent une si large place dans mon ouvrage. Elles ne visent pas à «illustrer», au sens conventionnel du terme, mais plutôt à expliquer, révéler et, finalement, à comprendre. Elles sont profondément intégrées au texte et essaient de montrer comment certaines valeurs et certaines idées ont trouvé une forme, se sont métamorphosées en «images dialectiques» et ont ainsi façonné un imaginaire collectif. Depuis ma découverte, il y a une trentaine d’années, du théoricien du cinéma Siegfried Kracauer, je tiens les images pour des outils de connaissance. Elles «nous regardent» et nous interpellent, en se chargeant de nouvelles significations à chaque époque.
Vous êtes un historien identifié plutôt à gauche. Quel regard portez-vous sur son état aujourd’hui?
Observée au prisme de la politique traditionnelle, la gauche traverse une crise profonde: au Royaume-Uni, Jeremy Corbyn a été défait ; aux Etats-Unis, Bernie Sanders a été éclipsé par Joe Biden ; en Italie, elle n’a plus de représentation parlementaire ; en France, elle n’a pas été représentée au deuxième tour de l’élection présidentielle ; en Allemagne, Die Linke a connu un revers électoral majeur ; en Espagne, Podemos participe au gouvernement tout en se débattant dans de grandes difficultés. Je pourrais continuer. Mais cette vision serait myope. Si on considère la gauche comme une constellation de mouvements sociaux – antiracistes, féministes, écologiques, anticapitalistes, anticoloniaux, «zadistes», etc. – elle ne se porte pas si mal. Elle mobilise une nouvelle génération à la recherche de formes nouvelles d’organisation et d’action collective. Les voies de sa recomposition sont complexes et je ne possède aucune recette miraculeuse. Son avenir tient à sa capacité de répondre à des défis de civilisation, pas à ses stratégies électorales.
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici