
Elie Barnavi: « L’Europe existe en tant que civilisation » (entretien)

L’historien et essayiste israélien, spécialiste de l’Europe, se réjouit que le temps de la complaisance envers le pouvoir russe soit révolu. Les dirigeants européens devraient davantage parler de ce qui les unit que de ce qui les divise. Le conseil vaut aussi pour cette Belgique qu’il a appris à aimer.
Il n’était pas fait pour l’armée qu’il a pourtant servie, comme officier parachutiste, lors de la guerre des Six-Jours en 1967, vécue comme « l’irruption d’une violence brève, ponctuelle mais intense, à laquelle l’apprentissage de la chose militaire, pour dur et violent qu’il soit lui-même, ne vous prépare jamais vraiment ». Il n’était pas fait pour la politique parce que « lorsqu’un intellectuel réussit en politique, c’est que le goût du pouvoir, chez lui, l’a emporté sur la passion des idées« . La passion des idées, Elie Barnavi ne pouvait s’en passer. Elle n’a cessé de le guider, lui, l’historien, l’essayiste, le conseiller scientifique du musée de l’Europe et de la société Tempora, créatrice d’expositions à succès, l’ambassadeur d’Israël en France, le conférencier… Avec toujours le même mantra, apporter de la nuance dans une période qui privilégie les opinions réductrices, expliquer la société israélienne, promouvoir une solution négociée au conflit avec les Palestiniens… C’est cette vie riche, multiple mais marquée par un humanisme constant que raconte Elie Barnavi dans Confessions d’un bon à rien (1).
Bio express
- 1946: Naissance à Bucarest, en Roumanie, le 2 août.
- 1978: Professeur d’histoire de l’Occident moderne à l’université de Tel-Aviv.
- 1982: Publie Une histoire moderne d’Israël (Flammarion, 347 p.).
- 2000-2002: Ambassadeur d’Israël en France.
- 2002: Histoire universelle des Juifs (avec Denis Charbit, Hachette, 300 p.).
- 2006: Les Religions meurtrières (Flammarion, 172 p.).
Vu la menace exercée par les voisins d’Israël, « la guerre a fini par devenir un mode de vie pour la société israélienne », écrivez-vous. L’Europe paie-t-elle aujourd’hui le fait d’avoir considéré que le temps de la guerre était révolu?
L’Europe s’est voulue un espace de paix postguerrier. Elle a refusé jusqu’à l’éventualité de la guerre. Elle est devenue irénique et complaisante. Avec la guerre en Ukraine, le réveil a été brutal. Mais il aurait pu survenir plus tôt. Dès que l’empire soviétique s’est effondré, les conflits ont commencé, d’abord en Yougoslavie, sans vraiment jamais s’arrêter. C’est un paradoxe: le rideau de fer, l’Union soviétique, la guerre froide assuraient au moins la non-guerre en Europe. L’Union européenne a vécu dans l’illusion qu’elle pouvait passer entre les gouttes et que cela ne la concernait pas vraiment. Aujourd’hui, elle a compris que l’irénisme n’est plus de saison. Elle est enfin en train de s’organiser.
Les relations d’Israël avec les Etats-Unis sont plus simples et plus saines qu’avec l’Europe. Mais elle est notre premier hinterland.
Les avancées enregistrées depuis le début de la guerre en Ukraine en matière de défense vont-elles dans le bon sens?
Ce n’est pas encore fait. Le chemin sera long. Mais l’Union européenne a pris conscience que le temps de la complaisance était terminé. Ce qui s’est passé en Allemagne est une véritable révolution copernicienne. Qu’elle tourne le dos à la posture pacifiste à laquelle elle s’était tenue depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale est considérable. Je ne désespère pas de voir le début de la création d’une souveraineté européenne. Coincée entre le relatif désintérêt américain et l’agressivité des nouvelles puissances, il faudra bien que l’Europe apprenne à se débrouiller seule.
On a une Europe de l’économie, peut-être demain une Europe de la défense. Mais ne manque-t-il pas, encore et toujours, une identité européenne, une Europe de la culture?
Les dirigeants européens n’ont jamais cessé d’exalter la diversité européenne. C’est une réalité, elle existe. Elle n’a pas besoin d’être vantée à tout bout de champ. Ils auraient davantage dû parler de l’unité européenne. Ils auraient davantage dû affirmer que l’Europe est une civilisation à part, dont on peut retracer les étapes, et qu’elle a pu s’unifier politiquement parce que ce substrat commun existait. L’ Asie est un concept géographique, l’Afrique aussi. L’Europe, elle, existe en tant que civilisation. Les grands absents de cette construction, ce sont la culture et le sentiment d’une identité commune. Cela s’explique par le fait que l’Union européenne n’a pas encore de frontières à elles. Mais cela viendra. A force de pouvoir se déplacer partout en Europe et de mener des projets communs tel Erasmus, une formidable réussite, une citoyenneté commune se créera.

Vous racontez dans votre livre la polémique qui vous a opposé au dirigeant politique français François Bayrou sur les racines chrétiennes de l’Europe au moment des débats sur le traité constitutionnel européen, projet finalement avorté. Font-elles partie du substrat européen?
Il fallait mentionner les racines chrétiennes de l’Europe dans le préambule du traité constitutionnel. Moi qui ne suis ni chrétien ni croyant, je me suis prononcé en ce sens parce qu’il était utile de dire qui sont les Européens, quitte à ajouter que ces racines ont été sécularisées, que la philosophie des Lumières est passée par là et que le fameux « limes » musulman n’a plus aucun sens aujourd’hui. Ce n’est pas parce qu’une nation est majoritairement musulmane, comme l’Albanie ou le Kosovo, qu’elle n’a pas sa place en Europe. Je n’ai pas été entendu. A l’image de François Bayrou, chrétien et pratiquant, les politiques français ont jugé qu’inscrire cette dimension dans le traité constitutionnel européen aurait manifesté une forme d’exclusion à l’égard des Européens qui ne sont pas chrétiens. Alors qu’il s’agissait juste de rappeler qu’ils s’agrègent à un ensemble qui n’est ni venu de rien ni de nulle part. On a assisté à un déni de l’histoire au nom d’une frilosité politique mal venue. C’est dommage. Les gens manquent de cadre de référence commun.
La difficulté que vous avez rencontrée pour organiser des expositions à dimension religieuse dans l’Hexagone, à l’inverse de la façon dont cela s’est passé en Belgique, dit-elle quelque chose de la France?
Je croyais connaître la France. Je pensais que la question de la laïcité était un problème réglé. Je me suis aperçu, au mitan des années 2000, qu’il ne l’était pas du tout, alors que, curieusement, il l’était en Belgique. En France, il y a une espèce de peur panique de ce qui touche à la religion. L’exposition Dieu(x), modes d’emploi a finalement pu être montée à Paris, mais cela a été la croix et la bannière. Ils avaient peur. Or, il n’y avait pas de quoi avoir peur.
L’islamo-gauchisme est-il une réalité en France?
Oui. Ce n’est pas un fantasme de droite. Pour certains, les musulmans se sont substitués aux opprimés d’antan. On observe une alliance de fait entre une certaine extrême gauche et l’islamisme. Une alliance contre nature: il n’y a rien de plus réactionnaire que l’islamisme. C’est un cliché que de le dire. Les extrêmes se rejoignent. De la même manière que l’extrême droite et l’extrême gauche se retrouvent dans la haine de la démocratie libérale et de l’Amérique. Ces phénomènes ne sont pas massifs mais ils sont influents. Ces groupuscules pèsent dans des lieux où se forge l’opinion.
Est-ce un des terreaux qui facilitent l’antisémitisme?
Bien sûr. L’ antisémitisme est différent de celui des années 1930. Nous ne sommes pas à la veille d’une nouvelle Nuit de cristal (NDLR: pogrom contre les juifs organisé par les nazis dans la nuit du 8 au 9 novembre 1938). Il ne faut pas exagérer. Les sociétés européennes dans leurs tréfonds ne sont pas antisémites. Les Etats, les élites, la presse ne le sont pas. Il faut se remémorer ce qu’était l’antisémitisme dans l’entre-deux-guerres. En revanche, il y a une montée de l’antisémitisme qui trouve son origine dans ce que nous évoquions. J’ai été aux premières loges de ce phénomène quand j’étais ambassadeur à Paris. C’était l’époque de la deuxième intifada. On brûlait des synagogues. J’ai parlé avec les dirigeants français, dont un ami, Lionel Jospin, qui était Premier ministre. Je lui ai dit que ces actes étaient intolérables. Il a acquiescé tout en expliquant que c’était le fait de « laissés-pour-compte » de la société. Son gouvernement a cherché les moyens de calmer le jeu, sans nommer le « monstre ». La gauche est mal armée pour se battre contre ce phénomène parce qu’elle a une lecture exclusivement sociale et politique de la question alors qu’il faudrait en avoir une lecture culturelle. Quand on abdique devant l’islamisme, on ne sait jamais où il s’arrêtera. C’était un tiers-mondisme dévoyé. Mais, depuis, ils ont compris.
Y a-t-il une prise de conscience de la menace de l’islamisme dans la « gauche de gouvernement »?
Dans la « gauche de gouvernement », oui. Dans la presse de gauche, non. Dans l’extrême gauche, sûrement non. A l’université, non. Il existe une espèce de complaisance politique face à l’antisémitisme, et à d’autres phénomènes comme cette forme de racisme à l’envers qui autorise désormais des réunions de racisés où les Blancs ne sont pas admis. Ils ne sont pas assez combattus. Quand la gauche trahit ses idéaux, il ne faut pas s’étonner que les gens ne votent pas pour elle. Cette attitude lui est très préjudiciable parce qu’elle laisse à la droite des valeurs traditionnelles de gauche, la laïcité, l’école, le savoir, la sécurité des personnes… La droite s’ en est emparée. Et la gauche est toute désemparée.

Quand vous voyez la campagne présidentielle en France, que vous inspirent les propos d’un Eric Zemmour sur le maréchal Pétain qui aurait sauvé les juifs français?
C’est grotesque. Eric Zemmour est un imposteur. Mais le plus extraordinaire est qu’il bénéficie d’une telle audience. Que les extrêmes droites en France récoltent plus de 30% des intentions de vote est très inquiétant.
Les arguments de la dénazification et du génocide des russophones avancés par Vladimir Poutine pour justifier la guerre en Ukraine relèvent-ils du même registre?
Evidemment. Vladimir Poutine veut « dénazifier » l’Ukraine. Un pays où le président est juif, le ministre de la Défense est juif et la vice-présidente du Parlement parle mieux hébreu que moi. On est dans un délire verbal qui est celui d’une propagande de type soviétique ou nazi. Beaucoup de gens y adhèrent parce qu’ils n’ont rien d’autre comme source d’information. Ce n’est pas pour rien que Vladimir Poutine et Donald Trump s’aimaient bien. Mais c’est aussi une des raisons pour lesquelles le président russe est en train de perdre cette guerre. Si vous méprisez la liberté, elle finit par se venger. On s’aperçoit que le génie des échecs n’a rien compris. Il est en train de se brûler. Par conséquent, il devient encore plus dangereux.
Avec l’argumentaire de Vladimir Poutine pour justifier la guerre en Ukraine, on est dans un délire verbal qui est celui d’une propagande de type soviétique ou nazi.
Vous estimez que des avancées sur le conflit israélo-palestinien ne pourront être réalisées qu’avec une pression extérieure. Mais la communauté internationale ne s’en désintéresse-t-elle pas de plus en plus?
Il y a un net désintérêt. Les dirigeants regardent ailleurs. Ils ont sans arrêt des incendies à éteindre, y compris la guerre en Ukraine qui est un immense dossier. Le conflit israélo-palestinien est considéré comme de basse intensité. L’idée générale est qu’on peut le « gérer ». Mais ce ne sera pas le cas jusqu’à la fin des temps. La paix conclue avec certains pays arabes à travers les accords d’Abraham, en septembre 2020, ajoute à la confusion. Ils visent à faire la démonstration que l’on peut faire la paix avec les Arabes sans s’occuper des Palestiniens. C’est une illusion complète.
Pourquoi la gauche israélienne est-elle devenue si faible?
Elle est faible pour des raisons qui la rendent faible un peu partout. La social-démocratie ne se porte bien nulle part. Elle semble se ressaisir un peu dans les pays scandinaves, en Allemagne… La gauche israélienne a suivi cette orientation générale avec, en plus, cette spécificité qu’en Israël, elle a été confrontée à un type de combat national palestinien qui l’a rendue atone, incapable de se faire entendre. La gauche s’est effondrée, pas seulement celle des partis, mais aussi celle des ONG. Le cadre est toujours là. Il n’est pas négligeable. Mais il a du mal à s’exprimer. Les citoyens voient l’enthousiasme des pionniers du néosionisme messianique d’un côté et, de l’autre, les divisions de la société palestinienne. Dans ce contexte, nous sommes confrontés à un refus d’entendre et d’écouter ce que nous avons à leur dire.
Tirez-vous un bilan globalement positif de votre fonction d’ambassadeur en France?
Je tire un bilan politique mitigé. J’ai présenté un visage amène de mon pays, peut-être trop. Mais je n’ai probablement pas eu un impact réel sur les événements. Que peut un ambassadeur aujourd’hui, emporté par le tourbillon des événements? Il fait plutôt un travail de communicant. L’influence politique directe sur les événements que je me flattais d’avoir au début de ma mission a échoué à opérer, à la fois par manque de réactivité de mes inter- locuteurs français et européens et puis, par le changement d’équipe au pouvoir à Jérusalem (NDLR: le 7 mars 2001, Ariel Sharon, du Likoud de droite, succède à Ehoud Barak, travailliste, à la tête du gouvernement).
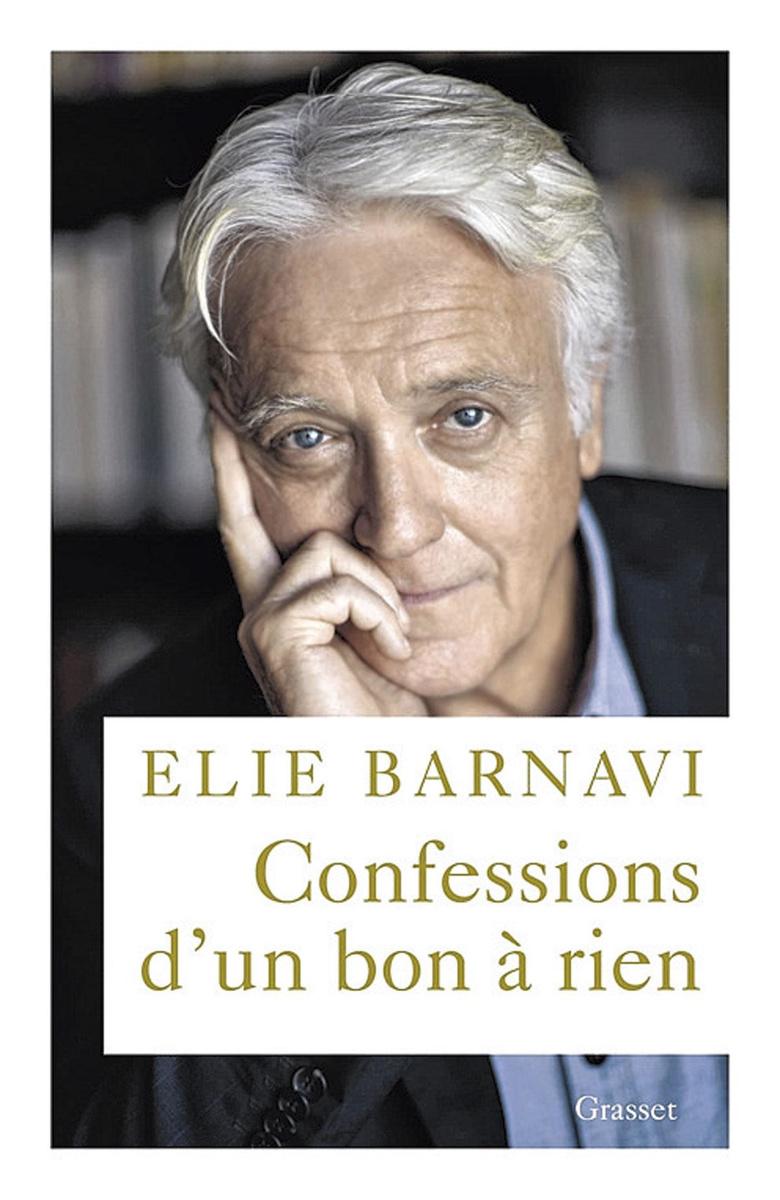
Que représente la Belgique pour vous?
Avant même de savoir que j’y vivrais un jour, la Belgique représentait beaucoup de choses parce que c’est un phénomène politique national fascinant. J’avais consacré un séminaire aux Pays-Bas dans mon université, entendus dans le sens global qui était le leur au XVIe siècle. Pour quelles raisons cet ensemble de régions qui était le plus riche d’Europe n’avait-il pas réussi à devenir un Etat puissant? Comment un homme, l’historien Henri Pirenne, a-t-il construit le mythe de la Belgique? Et, enfin, comment cette expérience nationale n’a pas tourné aussi bien que l’on pouvait l’espérer? Pour moi, la Belgique était un laboratoire européen extraordinaire. Après, j’ai découvert le pays, Bruxelles, les gens et cela m’a plu. Mon regard d’historien n’a pas changé. Un sentiment humain amical s’y est ajouté.
Qu’y a-t-il d’européen en Israël?
D’abord, les origines de ce pays. Le sionisme est européen. Quand Israël a été créé, l’immense majorité des Israéliens étaient d’extraction européenne. Après, l’équilibre démocratique a changé puisqu’il y a eu les migrations d’Afrique du Nord et d’autres pays méditerranéens. L’Europe existe dans la culture, la littérature, l’architecture, dans les liens qui nous unissent… L’Europe est notre principal partenaire commercial et notre principale destination touristique. Mais il y a aussi énormément de réserves envers l’Europe parce qu’elle a été le cimetière de notre peuple. Les sentiments sont très ambigus. Le fait que l’Europe donne des leçons ne fait rien pour résoudre le problème. On a l’impression d’être tout le temps sous le miroir grossissant des regards européens qui nous disent: « Cela, ce n’est pas bien », « Nous sommes des parangons de vertu, vous êtes des occupants… » Pour ces raisons, les relations avec les Etats-Unis sont plus simples et plus saines. Mais on n’y échappe pas. L’Europe est notre premier hinterland. Le paradoxe est d’ailleurs que la plupart des Israéliens voudraient que leur pays devienne membre de l’Union européenne parce qu’elle est quand même une terre de prestige, de grande culture, avec laquelle nous partageons des racines. Les Israéliens considèrent beaucoup d’Etats européens avec sympathie et l’Union européenne comme un ensemble hostile. Allez comprendre… J’ai passé beaucoup de temps à expliquer l’Europe à mes compatriotes, presque autant qu’à expliquer Israël aux Européens.
Vous êtes un passeur?
Je suis un passeur. Je suis plutôt content de cela. C’est une fonction honorable.
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici