Au moment de corriger les épreuves de son dernier livre, L’Empire du discrédit (1), un des préceptes de Christian Salmon, écrivain et essayiste, s’est matérialisé dans le résultat des élections législatives des 30 juin et 7 juillet derniers en France.
«Parvenu aux portes du pouvoir, [le simulacre du lepénisme] était apparu par la nature problématique de ses candidats et l’élagage de ses mesures sociales comme un vecteur du discrédit qui couvait dans la société et le modèle d’une gestion autoritaire de la crise», écrit ce grand observateur des mœurs politiques et médiatiques. Ainsi le parti d’extrême droite qui avait forgé sa popularité sur le discrédit des politiques traditionnelles était lui-même rattrapé par l’accusation de discrédit parce qu’il affichait une conviction toute relative à défendre des fondamentaux de son programme dans l’espoir de convaincre les derniers hésitants, entre les deux tours du scrutin, de lui octroyer les moyens de diriger la France depuis Matignon… «C’est la logique immanente du discrédit qui finit toujours pas se discréditer lui-même. Celui qui fait campagne par le discrédit périra par le discrédit», établit Christian Salmon dans son dernier ouvrage. En 2020, il publiait La Tyrannie des bouffons. Sur le pouvoir grotesque (Les Liens qui Libèrent), estimant que «la politique était devenue carnavalesque». Autant de thèmes que l’actualité risque de raviver encore.
Vous écrivez avoir vu se propager, au cours d’une enquête étalée sur quinze ans, «le mal du discrédit tel un incendie». Quels ont été les vecteurs de cette propagation?
Trois dates: 2008, 2016, 2020, comme autant de départs de feux. La crise financière de 2008 est le premier et sans doute celui qui a fait le plus de ravages aux Etats-Unis et en Europe sur le crédit de la parole politique et qui a porté un coup fatal aux récits politiques sur lesquels reposaient tous les discours des gouvernants néolibéraux. Ce discrédit a trouvé dans les réseaux sociaux apparus en 2005 une chambre d’écho qui a transformé le doute en colère et généralisé le soupçon –étendu à toutes les régions des discours autorisés– politique, médiatique, scientifique… Puis le Brexit et l’élection de Donald Trump en 2016 ont légitimé les discours des «populismes» et révélé le rôle incendiaire des réseaux sociaux. Le décrochage des discours officiels, leur décalage par rapport à l’expérience concrète des hommes ont ruiné la crédibilité de tous les récits officiels. Troisième départ de feu: la pandémie du coronavirus, en 2020, au cours de laquelle le discrédit a révélé son pouvoir de dissémination à l’échelle mondiale. La peur ancestrale des épidémies a muté sur les réseaux sociaux en un complotisme généralisé.
Comment le discrédit mine-t-il toute croyance?
Partout, le discrédit établit sa légitimité de manière paradoxale, non pas en se fondant sur le crédit au cœur du pacte de représentation, mais sur le discrédit qui mine toute croyance. Est fameux ce qui jette le trouble, renverse le sacré en profanation, retourne la réputation en infamie et emprunte ses formes au carnaval et au travestissement grotesque. Si cette logique se manifeste à maints endroits de la vie sociale et culturelle dans de nombreux nœuds des réseaux sociaux, reste à savoir comment le phénomène du discrédit s’impose à des univers sociaux éloignés les uns des autres. C’est une question qui n’a pas cessé de m’intriguer pendant l’écriture de ce livre. Comment le discrédit se transmet-il si rapidement, sautant d’un champ d’activité à l’autre: la vie politique, la crise sanitaire, la crise écologique, les arts et la culture, le discours sur la guerre…? Par quelles médiations ce principe s’impose-t-il à tous ces niveaux discursifs et symboliques comme le trait distinctif d’une époque, la crise de notre temps? Quoi de commun entre les images de réfugiés qui envahissent nos écrans et l’ours bleu Waldo de la série Black Mirror? Le virus de la série Hot Skull qui détruit le langage et se transmet par l’ouïe et la généralisation du trash talk dans les médias et sur les réseaux sociaux? Quel rapport entre la sextape de Michel Houellebecq et la photo d’identification judiciaire de Donald Trump?
«Les attaques des écologistes contre des œuvres d’art provoquent plus d’attention médiatique que d’action politique.»
«Les adhésions politiques ne se font plus sur le registre des idéologies et des convictions mais sur celui du désir et des attentions», écrivez-vous. Quel impact cela a-t-il sur la gestion des affaires publiques?
La rationalité des politiques publiques s’éclipse au profit des lois de l’économie de l’attention. Les dirigeants n’exercent plus le pouvoir, ils l’interprètent, jouant des rôles, construisant des séquences narratives, exerçant une tension narrative sur leur audience. Mais cela vaut aussi pour tout le spectre politique. Les attaques des écologistes contre des œuvres d’art dans les musées provoquent plus d’attention médiatique que d’action politique. Ce type de performance reproduit les mêmes mécanismes de dévoration dénoncés par les écologistes quand il s’agit des ressources naturelles. Ils produisent des pics d’attention qui se succèdent et se dévorent entre eux. Puis ils sont vite absorbés par l’actualité et tombent dans l’oubli. Ces buzz abusent de notre attention et participent d’une société de prédation économique, industrielle, culturelle, sexuelle qui dévore les attentions mais aussi les esprits, les désirs et les imaginaires…
Comment la notoriété peut-elle s’acquérir sur les réseaux sociaux au prix du discrédit jeté sur toutes les formes de discours et d’action légitime?
C’est la logique du clash. Sur les réseaux sociaux, ce n’est pas la rationalité qui gouverne les énoncés mais la transgression. Les provocations verbales, les bouffonneries, les chambrages, l’autoglorification et les insultes ne sont plus pratiqués seulement par les stars de la boxe et du basket-ball pour gagner en notoriété mais par tout internaute en quête de clics et de reprises. C’est l’art de créer de la rivalité, quel qu’en soit le sujet. Cela peut être le bien contre le mal, le grand contre le petit, le fort contre le faible. Les politiciens y ont recours quand il s’agit de décrédibiliser l’adversaire. La même tendance se reproduit en ligne où les comptes de médias sociaux d’entreprises tentent de gagner des abonnés en déclenchant des guerres sur X ou sur TikTok.
Même la tête de Donald Trump en photo d’identification judiciaire le 24 août 2023 peut être retournée à son avantage. Qu’est-ce que cela dit de la société?
Une photo d’identification judiciaire, le mugshot, est a priori incriminante. Elle affiche le portrait d’un suspect avant même qu’il soit jugé. Elle jette le soupçon sur un individu, en l’occurrence un ex-président des Etats Unis. L’inculpation de Trump qui se voulait le symbole de l’égalité de tous devant la loi a été retournée par Trump dans une prise de judo symbolique en un abus de pouvoir du système judiciaire. Trump a déplacé son combat de la sphère judiciaire vers la sphère médiatique et de l’ordre juridique vers un ordre symbolique dont la règle est celle du défi et de la surenchère. Ce n’est pas lui mais la justice qui perd la face. Le mugshot de Trump est devenu instantanément une photo iconique consacrée par les réseaux sociaux. Hommage du vice démocratique (élection volée, corruption) à la vertu médiatique et narrative (la légende de l’homme seul face au système). Le conflit entre Trump et les juges va au-delà d’un conflit entre l’exécutif et le judiciaire comme ce fut le cas de l’affaire du Watergate. C’est un conflit entre le judiciaire et l’imaginaire, la puissance de la loi et celle des réseaux sociaux. Qui va gagner? Qui forcera l’autre à comparaître, et devant quelle juridiction?
Comment la réaction de Donald Trump à sa tentative d’assassinat à Butler, en Pennsylvanie, peut-elle s’inscrire dans le mythe fondateur de la culture américaine?
C’est la même logique rehaussée d’un cran symbolique! Cette fois, ce n’est pas seulement de ses accusateurs que Donald Trump a triomphé, mais de la mort elle-même, à laquelle il venait d’échapper. «Je ne devrais pas être ici, je devrais être mort», a-t-il affirmé dès le lendemain dans un entretien au New York Post. «Beaucoup de gens disent que c’est la photo la plus iconique qu’ils aient jamais vue. Ils ont raison, et je ne suis pas mort.» Le mythe, ici, est attesté par la connexion établie entre le fait d’avoir survécu et le caractère iconique de la photo. Trump est un artificier de l’image. Il n’écrit pas une histoire, il maçonne un mythe. Et ce mythe a trouvé son totem avec cette photo de l’ex-président, le visage ensanglanté et le poing levé en signe de défi. En émergeant de la masse amorphe formée par ses gardes du corps qui le plaquaient au sol, Trump est apparu le poing dressé et le visage en sang comme un héros imbattable, revenu du monde des morts pour sauver l’Amérique. Un abonné de X souligna la parenté de cette image, sa composition triangulaire et le rôle central qu’y joue la bannière étoilée, avec la photo des Marines dressant un drapeau américain dans l’île japonaise d’Iwo Jima à la fin de la Seconde Guerre mondiale, une photo culte inscrite au cœur de l’imaginaire américain. Trump rejoignait l’un des mythes fondateurs de la culture américaine.
«Trump est un artificier de l’image. Il n’écrit pas une histoire, il maçonne un mythe.»
Le «héros négatif» est-il un produit d’avenir?
La formule de cette théologie hérétique et pas seulement négative peut se lire dans la profession de foi d’un certain Milo Yiannopoulos, ex-éditeur du site Breitbart News et figure de l’alt-right américaine: «J’aime me considérer comme un troll vertueux.» C’est le credo d’un nouveau «catéchisme révolutionnaire», pour reprendre le titre du programme écrit en 1866 par Mikhaïl Bakounine; un credo inversé qui ne repose pas sur le crédit qu’on accorde à des principes ou des valeurs révolutionnaires mais sur le discrédit de toute valeur, un bréviaire du discrédit.
La puissance du discrédit consacre-t-elle l’inversion des valeurs?
On peut remonter jusqu’à Nietzsche et à sa dégradation des valeurs et certainement à Jean-François Lyotard dans La Condition postmoderne (éd. de Minuit, 1979) qui annonçait la fin des grands récits d’émancipation. Mais ce à quoi nous avons affaire aujourd’hui, ce n’est pas à la mort de Dieu dont nous avons reçu le faire-part depuis longtemps, ni même à un bouleversement du statut des savoirs, mais à une crise de croyance. Nous vivons dans une sous-culture de l’incrédulité. Qu’en est-il des mythes résiduels qui peuplent notre «palais d’imagination», selon le mot de Paul Veyne qui qualifiait ainsi l’espace «de croyance partagée propre à une société et qui la constitue comme telle»? Mais lorsque la croyance partagée cède la place au discrédit général, la société tend à se constituer autour d’un imaginaire de destitution, un espace d’incrédulité partagé qui structure notre imaginaire au début du XXIe siècle. Qu’ils prennent la forme du discrédit de la parole et du personnel politique, des objets culturels plébiscités par les réseaux sociaux, des performances des influenceurs ou des youtubeurs, du discours sur la guerre véhiculé par TikTok, nos mythes épousent la courbure d’un seul et même phénomène qui donne sa forme au monde, une sorte de loi de gravitation symbolique qui attire tous les référents culturels vers le bas, autant d’opérations, de scènes ou de strates de délégitimation. Carnavalisation, éclipse, meutes, dévoration, confinement, offuscation…

Sans présence importante du ressentiment parmi les citoyens, le discrédit aurait-il moins de succès auprès des leaders politiques?
Sans doute, mais la colère des peuples est au fondement de la démocratie, car il n’y a pas d’autre forme à la démocratie que l’attroupement spontané d’une foule en colère. C’est elle qui inaugure la grande dispute citoyenne qui fonde la démocratie. En ce début de XXIe siècle, le ressentiment des citoyens, aiguillé par les Gafam, excité par les démagogues illibéraux, est un ressentiment antidémocratique, et même à certains égards proto-fasciste. Il n’inspire aucune entreprise démocratique. Il est inspiré, au contraire, par un imaginaire féroce de destitution.
Comment peut-on espérer sortir de cette période où le discrédit triomphe?
Pessimisme de l’intelligence. Optimisme de la volonté. La formule de Romain Rolland (NDLR: écrivain français, 1866 – 1944) reprise par Antonio Gramsci n’a jamais été autant d’actualité. Mais elle ne nous arme pas contre le discrédit. La dynamique des populismes repose sur l’énergétique perverse du discrédit. Il faut y répondre en lui opposant un régime de croyance légitime, un horizon de possibles. Croyance contre discrédit, c’est le nouvel enjeu démocratique. Il faut opérer pour cela un triple déplacement du débat public. Primo de la scène du souverain et de ses rivaux vers la scène du forum, de la place publique. Secundo, provoquer un changement social mais aussi un changement communicationnel, démagnétiser les échanges, réguler les réseaux sociaux, débrancher les attentions, déconstruire le discrédit. Tertio, rendre contagieux un certain état d’esprit démocratique: susciter l’espoir plutôt que surfer sur la colère, car celui qui triomphe par le discrédit, périra par le discrédit.
(1) L’Empire du discrédit, par Christian Salmon, Les Liens qui Libèrent, 288 p.
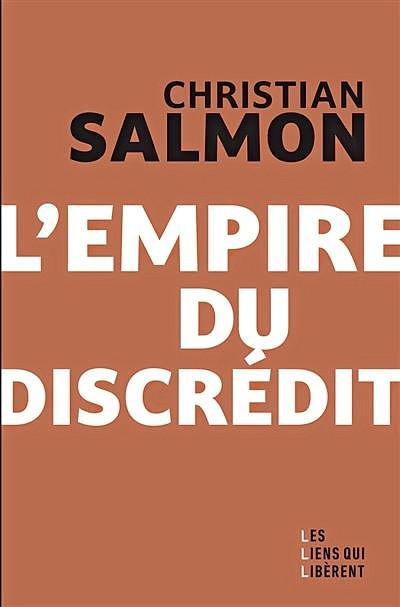
Bio express
1951
Naissance, à Marseille.
1982
Travaille au Centre de recherches sur les arts et le langage, à Paris.
1993
Fonde le Parlement international des écrivains et le Réseau des villes refuges.
2007
Publie Storytelling. La machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits (La Découverte).
2013
La Cérémonie cannibale (Fayard).
2019
L’Ere du clash (Fayard).
2020
La Tyrannie des bouffons. Sur le pouvoir grotesque (Les Liens qui Libèrent).

