
Didier Fassin: «La multiplication des crises conduit à leur banalisation» (entretien)
Dans une étude magistrale de 1 300 pages, le sociologue et médecin français Didier Fassin, entouré d’une soixantaine de chercheurs internationaux, analyse les défis et basculements qui guettent la «société qui vient», dans toute sa complexité.
Sur le papier, il coche toutes les cases de l’intellectuel irénique, tempéré, excessivement policé. Sociologue, médecin et anthropologue, Didier Fassin trône sur les plus prestigieux postes académiques: professeur au mythique Institute for Advanced Study de Princeton et directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales de Paris (Ehess), il occupa aussi, en 2019, la chaire annuelle de santé publique au Collège de France. Mais derrière ce brillant CV se dissimule un intellectuel (discrètement) engagé qui ne rechigne pas à prendre parti pour les réfugiés dépourvus de protection sociale ou à dénoncer les modes opératoires problématiques de la police des quartiers (La Force de l’ordre. Une anthropologie de la police des quartiers, Le Seuil, 2011). Frondeur, Didier Fassin l’est jusqu’à abolir les frontières disciplinaires entre science politique, anthropologie, sociologie et morale, quitte à s’attirer l’ire de ses confrères les plus orthodoxes.
Parler de crise écologique ou climatique, c’est ne pas prendre la mesure de ce qui constitue un véritable bouleversement géologique.
Cette fureur de savoir et de cerner la société dans toute sa complexité d’un regard panoramique, on la retrouve intacte dans l’ouvrage collectif qu’il a dirigé, La Société qui vient (1). Entouré du gotha du monde universitaire – les philosophes Michaël Fœssel et Jean-Claude Monod, la sociologue franco-israélienne Eva Illouz, entre autres –, Didier Fassin et une soixantaine de chercheurs, de France, de Belgique, d’Italie et d’ailleurs, décryptent le «moment critique» que traversent nos sociétés et les défis majeurs, démocratiques, environnementaux ou démographiques, qu’ elles ne peuvent esquiver dès lors qu’il s’agit d’assurer leur survie. Loin de la spéculation prospective, La Société qui vient est une ambitieuse tentative de dégager l’horizon pour se donner les moyens de faire face au futur qui nous appelle.
Bio express
1955: Naissance à région parisienne, le 30 août.
1982: Docteur d’Etat en médecine à l’Université Pierre-et-Marie-Curie.
1984: Départ au Sénégal pour une étude anthropologique sur les relations entre thérapeutes et malades en milieu urbain.
1999: Directeur d’études en anthropologie politique et morale à l’Ehess.
2019: Titulaire de la chaire annuelle de santé publique au Collège de France.
2020: Réédition, augmentée d’un album illustré, de La Force de l’ordre. Une enquête ethnographique (Delcourt).
Qu’est-ce qui vous a amené à vous lancer dans une étude de cette envergure?
Au départ, c’est une conversation avec un directeur éditorial des éditions du Seuil. Nous sommes en plein mouvement des gilets jaunes. De nombreux ouvrages paraissent pour en rendre compte. Et nous nous disons qu’au-delà de cette mobilisation, il y a une société qui est en train de se transformer en profondeur et qu’il faut la donner à comprendre. C’est ce projet-là qui nous retient. Il prend rapidement de l’ampleur, jusqu’à associer plus d’une soixantaine d’auteurs et d’autrices à la rédaction des 1 300 pages du livre. Un travail collectif couvrant un grand nombre de thèmes, de la mondialisation et les migrations au néolibéralisme et à l’autoritarisme, des plateformes numériques à la désobéissance civile, des théories du complot à la reconnaissance des non-humains, des inégalités aux communs. Car je m’efforce de multiplier les perspectives tout en conservant un axe, celui d’une approche critique susceptible de penser, sur chacun de ces thèmes, quels en sont les enjeux.

L’épigraphe de votre livre reprend cette célèbre réplique du film La Haine, de Mathieu Kassovitz: «Jusqu’ici tout va bien.» Faut-il y voir une alerte de votre part quant à «la société qui vient»?
Il y a bien sûr une intention ironique dans le placement de cette citation au début du livre puisque celui qui prononce cette phrase dans l’histoire racontée en voix off du film est un homme qui tombe du haut d’un immeuble et la répète à chaque étage. A la fin du film, ce n’est plus un homme qui tombe, mais c’est métaphoriquement «une société qui tombe». Je crois qu’en effet nous sommes dans une situation de calme qui précède la tempête. En particulier en France, comme chacun le comprend avec une élection présidentielle qui a vu s’opposer une candidate d’extrême droite et un candidat de droite accordant du crédit à l’extrême droite et à ses idées, par exemple en acceptant un long entretien sur l’identité nationale et l’islam dans le magazine Valeurs actuelles, en demandant au polémiste Eric Zemmour une note sur l’immigration, et, surtout, en réintroduisant sans cesse les questions de l’identité nationale, de l’islam et de l’immigration dans le débat public au risque d’embarrasser sa propre majorité.
«Crise sanitaire», «crise des migrants», «crise démocratique», «crise environnementale», «crise économique»… De quoi l’inflation du lexique de la crise dans le débat public est-elle le reflet, selon vous?
Il faut se méfier de ce langage de la crise. La multiplication des crises conduit à leur banalisation. La crise est en principe une rupture de l’ordre normal. Si tout devient crise, alors c’est elle qui, paradoxalement, devient la nouvelle normalité. Surtout, cette banalisation a deux effets. D’abord, il n’y a plus de hiérarchie d’intelligibilité, et donc plus de priorité d’action: ce qu’on appelle crise climatique n’est plus qu’une crise parmi d’autres, alors que se joue l’avenir de la planète et de l’humanité. Ensuite, il n’y a plus de compréhension en profondeur des phénomènes: on se contente de remèdes immédiats quand il faudrait s’interroger sur les processus qui aboutissent à ces problèmes.
Justement, les crises appellent des réponses d’urgence et d’exception. Dès lors, comment veiller à ce que l’état d’exception ne devienne pas un paradigme normal de gouvernement?
La tentation de réagir dans l’urgence et de produire de l’exception est grande. On a vu, avec le Covid-19, comment de nombreux gouvernements ont imposé un état d’urgence avec des suspensions graves des libertés fondamentales, et ce d’autant plus qu’ils se montraient incompétents à faire face à la pandémie. La France en est l’illustration, car elle fut plus de la moitié du temps en état d’urgence depuis fin 2015 (NDLR: après les attentats de Paris), quand l’ Allemagne n’a jamais pris de telles mesures. Le risque est que l’exception ne devienne la règle, comme l’écrivait Walter Benjamin, que l’on s’habitue à être gouvernés sous le couvert d’une idéologie de crise.

Au terme «crise», vous préférez la formule «moment critique». En quoi est-elle plus pertinente?
Comme je viens de le dire, le langage de la crise est aussi inadéquat pour traiter les problèmes que dangereux pour la démocratie. Parler de situations critiques, c’est inviter à une réflexion en profondeur sur les causes structurelles qui conduisent à ces situations et qui restent souvent ignorées lorsqu’on parle de crises. D’ailleurs, c’est aussi permettre de penser des situations critiques qui ne donnent pas lieu à des crises, comme ce devrait être le cas: pensons à l’inflation carcérale qui n’est liée qu’ à une plus grande sévérité des peines et à une plus grande intolérance de certaines catégories de population, et dont il n’est guère question dans l’espace public. L’inverse existe aussi avec des crises qui ne recouvrent pas des situations critiques mais sont des manipulations de l’opinion: pensons à l’instrumentalisation permanente des statistiques de délinquance et de criminalité pour nourrir l’idéologie sécuritaire.
La guerre en Ukraine nous met devant nos incohérences et, il faut l’espérer, devant notre responsabilité collective à l’égard de la société qui vient.
Votre étude est un travail de recherche intégralement conçu par des universitaires. N’avez-vous pas songé à solliciter des écrivains, des artistes ou d’autres profils pour penser la «société qui vient»?
J’en avais eu l’idée, et j’avais imaginé avoir, entre chaque section du livre, des sortes d’intermèdes ou de respirations, avec deux textes d’écrivain ou d’écrivaine et quelques œuvres d’artistes. J’avais même fait un choix de grands noms français, mais aussi allemands, libanais, égyptiens, chinois, argentins, sud-africains, que, pour certains, je connaissais personnellement et à qui j’en avais d’ailleurs parlé. Mais le livre était déjà très volumineux, assez complexe à diriger, et des questions de droits allaient se poser. J’y ai finalement renoncé et, à la place, j’ai invité de grands intellectuels du monde entier, hommes et femmes, dans une section ultime que j’ai intitulée «Libre cours».
Le chapitre que vous consacrez à l’écologie est intitulé, non sans provocation, «Il n’y a pas de crise écologique». Qu’entendez-vous par là?
Parler de crise écologique ou climatique, c’est ne pas prendre la mesure de ce qui constitue en réalité un véritable bouleversement géologique: l’entrée dans l’anthropocène, cette nouvelle ère qui est le produit de l’œuvre destructrice des êtres humains et qui rend la planète de moins en moins habitable pour une partie croissante d’entre eux. Il nous faut changer de grille d’analyse et donc d’échelle de réponse politique.
Vous alertez sur le fait que les crises se neutralisent et s’invisibilisent dans l’espace public. Dans le nouveau contexte géopolitique, n’y aurait-il pas à craindre que la «crise environnementale» soit éclipsée et reléguée au second plan?
Il y a en effet une logique médiatique et politique qui fait qu’un problème en chasse un autre. La pandémie de Covid en est une illustration remarquable. Tout ce qui se passait dans le monde, guerres, famines, catastrophes, s’est trouvé relégué. Les journalistes ne parlaient plus que de nouveaux cas, de mortalité, de masques, de vaccins, d’expérience du confinement. Les décideurs donnaient des chiffres, montraient des tableaux, présentaient des projections, annonçaient des mesures draconiennes. L’économie de l’attention était tout entière tournée vers la pandémie et ses conséquences. On peut comprendre qu’il s’agissait d’une priorité mondiale. Mais on voit qu’elle absorbait tout. A commencer par la question du réchauffement climatique et de l’avenir de la planète ; comme elle ne se donne pas à voir comme une crise immédiatement perceptible, elle passe toujours au second plan, derrière les attaques terroristes, les gilets jaunes, les élections nationales, la guerre en Ukraine. Ce n’est jamais le bon moment pour s’en préoccuper à la hauteur de la gravité et de l’enjeu. Les experts en sont bien conscients, et ils tentent de «dramatiser» la situation pour en faire une crise qui devrait passer avant toutes les autres, car elle met en jeu l’existence même des générations futures.
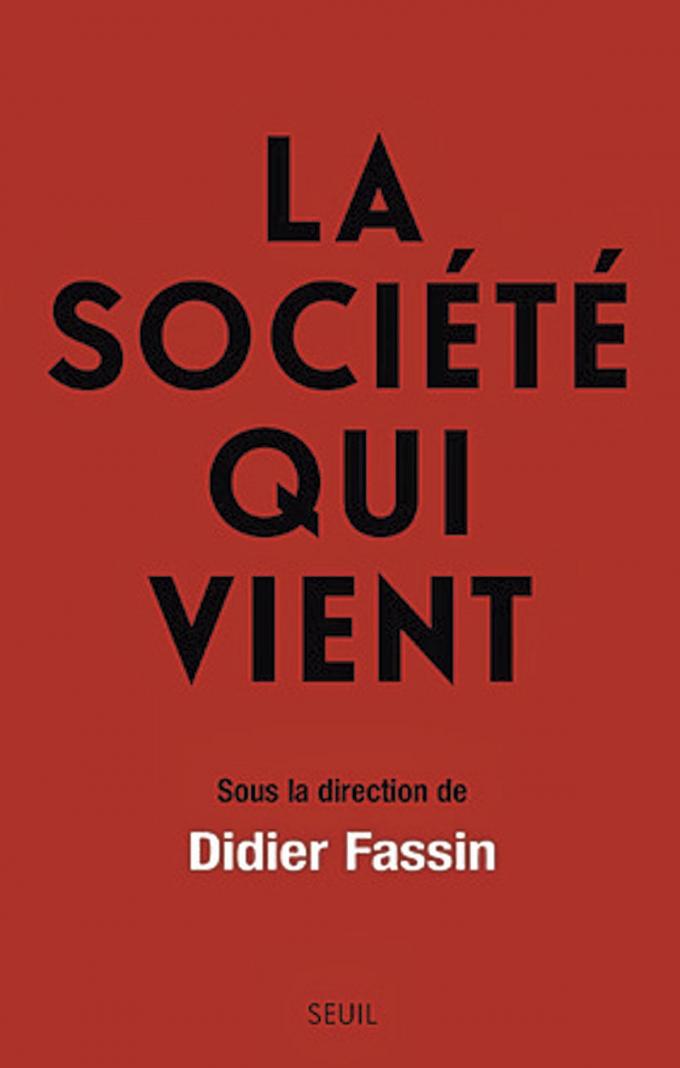
Le lancement de votre étude est bien antérieur au déclenchement de la guerre en Ukraine et aux tensions sur les ressources énergétiques qui en découlent. Dans quelle mesure ce nouveau contexte a-t-il une influence sur les contours de «la société qui vient»?
Bien sûr, ce conflit n’était pas prévisible au moment où nous écrivions notre livre, encore que l’appétit de conquête de Vladimir Poutine ne soit pas une découverte et que l’impérialisme russe soit en passe de supplanter l’impérialisme états-unien, lui aussi faiseur de guerres. Les conséquences de l’invasion de l’Ukraine sont multiples, et ce, à de nombreux niveaux. Il y a d’abord la réitération, après l’ex-Yougoslavie, que la guerre, qu’on croyait disparue d’Europe, y est toujours présente à ses marges, et il semble que cette fois on s’en émeuve alors qu’on a fait peu de cas des centaines de milliers de morts en Syrie, pourtant si près des portes de notre continent. Il y a ensuite le retour de la question des réfugiés, l’accueil généreux fait aux Ukrainiens ne rendant que plus visible, par contraste, le traitement indigne que les pays européens infligent aux réfugiés des autres régions du monde, et donc les hiérarchies morales et raciales qui sous-tendent la protection des personnes menacées de persécution. Il y a enfin le problème de la dépendance à l’égard du pétrole et du gaz russe, l’augmentation de la facture énergétique pour les industries et plus encore pour les ménages, la réactivation des énergies fossiles comme le charbon pour faire face à la pénurie, tous ces éléments montrant que les pays européens n’ont pas encore pris conscience de l’urgence de trouver des modèles innovants plus économes en énergie. Cette guerre nous met devant nos incohérences, et peut-être, il faut l’espérer, devant notre responsabilité collective à l’égard de la société qui vient, celle que connaîtront nos enfants.
Votre ouvrage ne s’en tient pas à établir le diagnostic, en filigrane, il esquisse des solutions.
Plutôt que des solutions, je dirais des pistes, et j’ai d’ailleurs donné à cette section du livre le titre «Explorations». J’ai voulu montrer qu’existaient dans la société telle qu’elle est des expérimentations et des innovations qui devaient retenir notre attention, qu’il s’agisse de la défense des communs, des nouveaux modes de production et de consommation, de la redécouverte de répertoires de lutte comme les occupations et la désobéissance, des gestes de protection de la planète et de l’attention portée aux non-humains. Ce sont là des formes de protestation contre l’idée répandue selon laquelle il n’y aurait pas d’alternative à la société matérialiste, injuste, brutale à l’encontre des humains et destructrice de l’environnement. Modestement, elles nous disent qu’un autre monde est possible.
L’élection présidentielle vient de se tenir en France. A la lumière des réflexions menées dans votre ouvrage, que vous inspirent cette séquence et ces résultats?
Pour la seconde fois, l’électorat s’est trouvé confronté à un choix entre les deux mêmes candidats. Il ne s’agissait pourtant pas tout à fait d’une reproduction à l’identique. Paradoxalement, Marine Le Pen a habillé son programme xénophobe et islamophobe d’annonces sociales en direction des milieux populaires tandis qu’Emmanuel Macron, qui avait mené une politique néolibérale et autoritaire pendant cinq ans, a introduit des thématiques d’extrême droite dans son action en durcissant la législation à l’encontre des exilés dans la Loi asile et immigration et en prenant pour cible les organisations luttant contre l’islamophobie avec la Loi dite contre le séparatisme. Pour beaucoup des électeurs qui n’avaient voté au premier tour ni pour l’une ni pour l’autre, la différence a semblé considérablement réduite entre les deux candidats. D’où le niveau d’abstention le plus élevé pour une présidentielle depuis un demi-siècle, surtout parmi les jeunes qui n’ont connu, depuis qu’ils sont en âge de voter, que des scrutins sans choix ouvert. Les deux grands enseignements de cette élection ont donc été une poussée sans précédent de l’extrême droite – le tiers des votants au premier tour, plus de quatre sur dix au second – et une désaffection massive du vote – plus du tiers des inscrits se sont abstenus ou bien ont mis dans l’urne un bulletin blanc ou nul au deuxième tour. Si, de surcroît, on prend en compte les personnes qui ont déclaré avoir voté pour l’actuel président de manière à faire barrage à sa rivale, on peut dire que seul un inscrit sur cinq l’a choisi, ce qui fragilise sa légitimité. D’une manière générale, ces différents éléments indiquent une menace sur la démocratie. Le fait intéressant, toutefois, est que les partis de gauche, sévèrement défaits, puisque tous ensemble ils n’atteignent qu’un tiers des votes du premier tour, ont bâti une union populaire qui leur permettrait d’obtenir un meilleur résultat au scrutin législatif du mois de juin. C’est dire que, sur le plan politique, malgré la réélection du même président pour un nouveau mandat, la société qui vient n’est pas entièrement déterminée.
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici