
Comment Poutine a installé la culture de la peur pour se rallier les élites

Le chercheur Gilles Favarel-Garrigues décrit comment, par la dictature de la loi, le président russe a pu asseoir son pouvoir. Edifiant.
Après le déclenchement de la guerre en Ukraine, on a pu croire que les sanctions imposées à la Russie pousseraient la population à la révolte et les élites à la prise de distance avec Vladimir Poutine. Ces phénomènes ne se sont pas produits. Comment l’expliquer? Directeur de recherche CNRS à Sciences Po Paris, Gilles Favarel-Garrigues avance comme élément de réponse le recours par le président russe à la dictature de la loi, dans son passionnant essai La Verticale de la peur.
En quoi consiste la dictature de la loi qui permet la verticale de la peur mise en œuvre par Vladimir Poutine?
La «dictature de la loi» est une expression que Vladimir Poutine emploie lui-même lorsqu’il arrive au pouvoir en 2000. De manière assez paradoxale d’ailleurs, parce que le paradigme dominant du changement politique à ce moment-là, c’est la démocratisation. Lui-même est élu au suffrage universel. Mais dans son premier discours à la Nation, il annonce qu’il va mener la «dictature de la loi «. C’est une technique de gouvernement qui consiste à intimider par le droit. Elle est utilisée très rapidement. Un très bon exemple de cette pratique est la lutte contre les oligarques, dès le début des années 2000, et notamment le procès contre Mikhaïl Khodorkovski. Ce dernier écope d’une condamnation lourde pour des pratiques assez banales dans les milieux d’affaires à ce moment-là. La dictature de la loi, c’est cela: l’exploitation sélective de la vulnérabilité juridique contre l’ensemble des adversaires du pouvoir. Le principe est que n’importe quelle personne a potentiellement quelque chose à se reprocher. Si ce n’est pas le cas, on peut fabriquer des dossiers compromettants ou, du moins, manipuler la justice pour intimider ses adversaires.
La dictature de la loi peut aussi servir à l’échelon local à alimenter des règlements de comptes.

Gilles Favarel-Garrigues
Directeur de recherche CNRS à Sciences Po Paris
La collecte de renseignements est un des éléments constitutifs de cette dictature de la loi. Découle-t-elle directement de l’expérience dans ce domaine de Vladimir Poutine?
Il est clair que le renseignement est central dans les opérations de déstabilisation des adversaires politiques. On peut le relier à la culture professionnelle de Vladimir Poutine. Dans l’affaire Khodorkovski, par exemple, la structure qui joue un rôle clé dans les poursuites judiciaires contre lui est la cellule du renseignement financier, fondée au début des années 2000 sous Vladimir Poutine, avec la bénédiction des pays occidentaux.
Lire aussi | Comment Vladimir Poutine étouffe l’opposition russe
C’est l’époque où les Occidentaux réclament un renforcement de la lutte contre la corruption. Vladimir Poutine n’est-il pas doublement gagnant en cadenassant son opposition et en donnant l’image d’une Russie qui combat la corruption?
Absolument. La dictature de la loi en tant que technique de gouvernement s’est construite avec des outils que le monde occidental tentait alors d’imposer à la Russie, liés aux politiques de lutte contre la corruption et contre le blanchiment d’argent sale. Vladimir Poutine a bien saisi l’aubaine que pouvaient représenter ces mesures à partir du moment où il les appliquait de manière extrêmement répressive en interne. Cela lui permettait, d’une part, de montrer un visage coopératif avec les organisations internationales comme l’ONU, le FMI, la Banque mondiale, le Groupe d’action financière (Gafi), le Conseil de l’Europe… et d’autre part, de discipliner les élites en interne.
L’Occident a-t-il été dupé par Vladimir Poutine?
Je ne sais pas qui a dupé qui. Ce qui est certain, c’est que l’Occident paie sans doute assez cher ses obsessions sécuritaires du début des années 2000 en lien avec le crime organisé, le terrorisme… Le volet financier de ces dispositifs répressifs contre des menaces jugées existentielles pour les démocraties occidentales s’est partout imposé. Il requérait notamment que les banques, les compagnies d’assurances, les acteurs financiers deviennent en quelque sorte des auxiliaires de la police. C’est ce qui a été fait en Russie avec un zèle surprenant. Mais alors que dans les pays occidentaux, le plus souvent, ces politiques répressives n’ont pas abouti, dans les faits, à de fortes sanctions judiciaires, en Russie, elles ont donné lieu à des sanctions pénales extrêmement lourdes pour les milieux d’affaires.
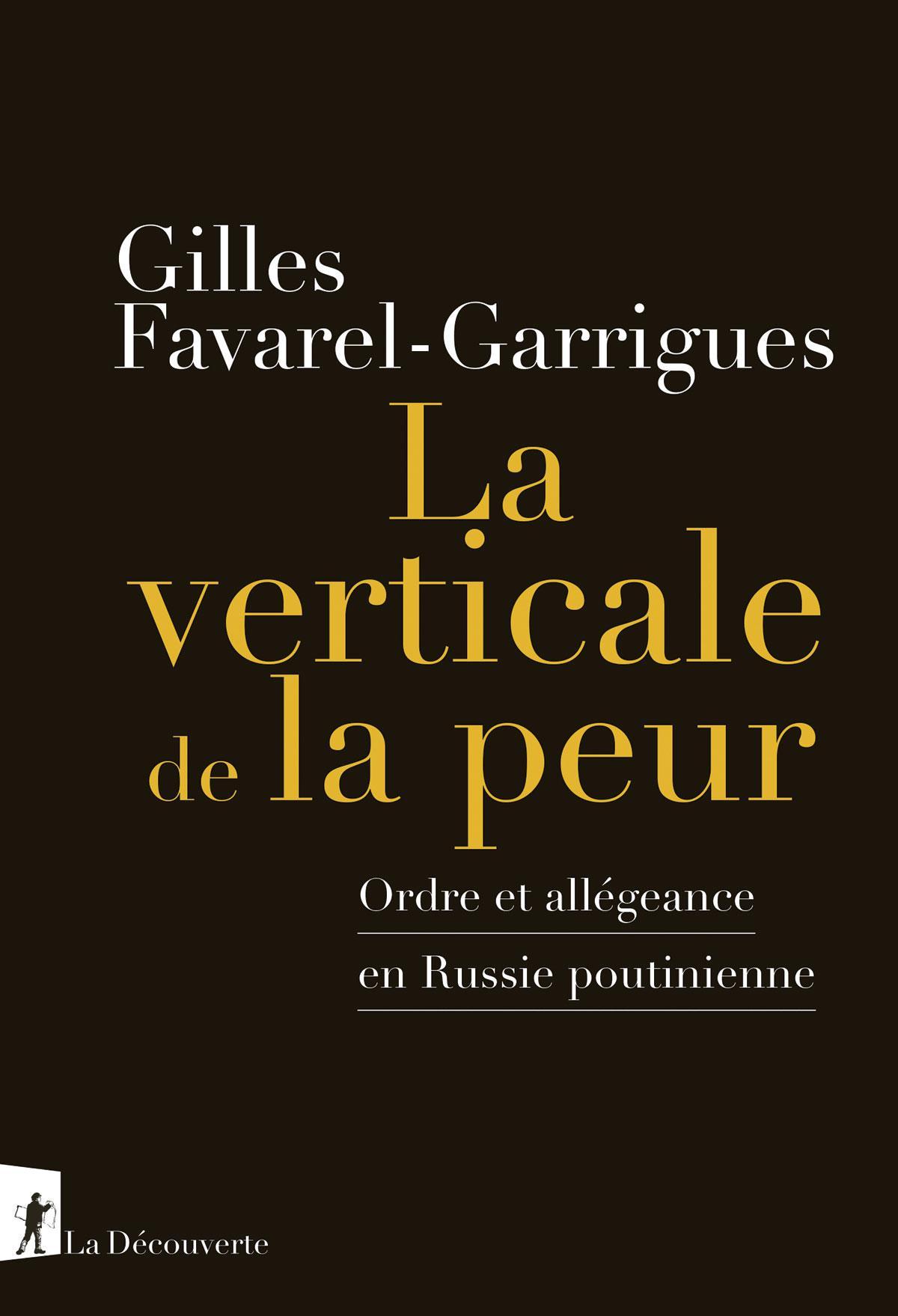
Le combat contre la corruption a-t-il effectivement porté ses fruits, indépendamment de l’usage politique qui en a été fait?
Je suis tenté de dissocier assez fermement la corruption comme problème social et la lutte anticorruption comme mode de gouvernement. La Russie était perçue comme un pays très corrompu lorsque Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir. Elle l’est toujours aujourd’hui. D’ailleurs, lorsqu’on interroge les Russes sur le sujet, c’est aussi ce qu’ils pensent. Cela contribue à parer la lutte anticorruption d’une dimension populaire. Pour autant, la lutte anticorruption est-elle là pour endiguer la corruption ou pour servir d’arme de déstabilisation des opposants politiques? La Russie montre très clairement une préférence pour la deuxième option.
L’intérêt de cette dictature de la loi est-il surtout pour Vladimir Poutine de s’assurer la loyauté des élites?
Tout à fait. On peut parler de «consensus imposé», selon l’expression proposée par Vladimir Gelman, un politiste russe. Il y a, certes, d’autres facteurs qui expliquent le maintien du régime poutinien: une forme de légitimité auprès d’une partie de la population, la propagande distillée par les médias... Mais il est indéniable que l’intimidation, la coercition, la peur jouent un rôle important dans la cohésion des élites.
Cet usage de la dictature de la loi se pratique-t-il à des niveaux régionaux?
Oui, et c’est important. La dictature de la loi est une technique de gouvernement qui, à l’échelon fédéral, est mise au service d’un projet, celui de la verticale du pouvoir, avec l’idée que l’on aurait un pouvoir extrêmement hiérarchique et centralisé. Or, dans la réalité, cela ne fonctionne pas aussi bien que cela. La dictature de la loi peut aussi servir localement à alimenter des règlements de comptes entre élites politiques, par exemple entre le maire d’une grande ville et le gouverneur de la région dont elle dépend, ou économiques, sans que ceux-ci soient orchestrés au niveau central. Les armes avec lesquelles gouverne Vladimir Poutine peuvent être réemployées par des acteurs locaux plus mineurs afin de poursuivre leurs propres intérêts. C’est incontestablement une limite importante à ce projet de verticale du pouvoir.

Quel est le rôle des siloviki, les représentants des ministères de force, dans cette application de la dictature de la loi?
Ils ont un rôle important parce ce sont des spécialistes de l’usage de la coercition. Ils sont très présents dans les structures de renseignement ou dans l’application de la justice pour les affaires les plus sensibles. Les analyses privilégient souvent l’idée selon laquelle les siloviki constituent un bloc homogène, mais les divers groupes qui les composent – militaires, policiers, agents de renseignement… – ont des cultures professionnelles différentes et peuvent cependant s’opposer les uns aux autres.
La police est fort décriée par la population. Comment le pouvoir central gère-t-il ce discrédit?
La police est un bouc émissaire assez central dans les discours politiques de l’équipe au pouvoir. C’est peut-être lié au fait que les services de renseignement ont souvent une forme de mépris pour la police ordinaire. En réalité, les raisons en sont plus profondes. Il existe une forme de consensus sur le constat que la police travaille mal, est trop indifférente, trop lointaine, trop corrompue, trop violente, même si c’est peut-être un peu moins le cas aujourd’hui que dans les années 2010. Par conséquent, pointer du doigt la corruption de la police et, d’une manière plus générale, celle des fonctionnaires accrédite l’idée que les politiques décidées par le pouvoir central seraient fondamentalement bonnes mais mal mises en œuvre par une classe intermédiaire corrompue. Si l’on en croit les sondages d’opinion, et notamment les études du dernier institut indépendant qu’est le centre Levada, il y a une dissociation entre l’adhésion à Vladimir Poutine, au pouvoir central, et la perception de la probité des fonctionnaires.
L’apparition d’«entrepreneurs de violence» résulte-t-elle de ces failles observées dans la police?
Je dissocie deux choses. Les entrepreneurs de violence renvoient au rôle de la mafia dans l’économie russe au cours des années 1990. Ceux que je mets en avant dans le livre sont des justiciers autoproclamés qui s’appuient sur cette critique de la police pour affirmer qu’ils mèneront eux-mêmes la lutte contre le crime. Ils se développent dans les années 2010 et ressemblent à des «vigilantes», comme on dirait aux Etats-Unis, c’est-à-dire à des justiciers autoproclamés qui se sont mis à lutter contre des formes d’incivilités extrêmement variées: les voitures mal garées, les gens qui fument dans les endroits où c’est interdit, les supermarchés qui vendent des produits périmés, etc. Ils tirent profit de leurs activités grâce aux réseaux sociaux, ce qui en fait de véritables entreprises justicières.
Certains “entrepreneurs de violence” sont prêts à faire le coup de poing contre les opposants du régime.
Ces entrepreneurs de violence ne pourraient-ils pas se retourner contre le pouvoir?
Certains de ces groupes ont été réprimés lorsqu’au milieu des années 2010, ils étaient notamment associés à l’extrême droite radicale. Mais la plupart d’entre eux relèvent d’une zone grise. Certains sont notamment prêts à harceler ou à faire le coup de poing contre les opposants du régime. Ils le font en toute impunité tant qu’ils ne commettent pas de bavure, auquel cas le pouvoir peut aisément décider de s’en désolidariser.
La tolérance du pouvoir envers le groupe Wagner au plan militaire relève-t-elle de la même «politique»?
Oui, c’est un art du clair-obscur. On s’appuie en même temps sur les forces officielles et sur les forces informelles. C’est le cas sur le front en Ukraine. Mais c’est aussi le cas en interne. Depuis que l’offensive massive contre l’Ukraine a commencé, les opposants sont soumis non seulement à une répression judiciaire accrue mais aussi à des intimidations physiques.
Que sont les kompromaty, les dossiers montés contre des opposants, dans l’application de la dictature de la loi?
Les kompromaty renvoient à des techniques de gouvernement qui visent à déstabiliser des opposants politiques, des ONG, des gouverneurs de région désireux d’exploiter leur légitimité locale pour s’opposer au pouvoir en place ; bref, tous les gens susceptibles de contester l’autorité présidentielle. La fabrique des kompromaty consiste à essayer d’intimider en menaçant d’un recours en justice contre des crimes plus ou moins avérés. C’est une arme qui a été monopolisée par Vladimir Poutine à partir du moment où il a mobilisé les services de renseignement, les médias, la justice, dès son arrivée au pouvoir. Mais il y a eu par la suite des tentatives de retournement, notamment avec les réseaux sociaux. En un sens, la stratégie d’Alexeï Navalny, qui a utilisé les réseaux sociaux pour dévoiler la corruption des élites au pouvoir, participe d’une volonté de décentraliser l’usage des kompromaty et de les retourner contre le pouvoir en place.

Les personnalités critiques de certaines institutions du pouvoir russe comme Evgueni Prigojine ne sont-elles pas plus nationalistes encore que Poutine?
Quand on observe la manière dont gouverne Vladimir Poutine depuis plus de vingt ans, on voit que ce pouvoir a tendance à s’appuyer sur des figures un peu marginales au sein du régime, qui se caractérisent par leur intransigeance, leur côté excessif, leur vocabulaire outrancier. Evgueni Prigojine est un de leurs représentants. Il y a en a bien d’autres. Il y a, au sein du parti et des élites au pouvoir, une forme de division des rôles entre des personnalités qui se montrent raisonnables et modérées et d’autres plus radicales. Mais il ne faut pas s’y tromper: tous ces gens concourent au même objectif, en tout cas pour l’instant. Je ne vois pas Prigojine comme un opposant. Il est au sein du pouvoir une voix qui canalise une partie du mécontentement de la population. Un peu comme le faisait Vladimir Jirinovski (NDLR: président du Parti libéral-démocrate de Russie, d’extrême droite, à partir de 1991) jusqu’à sa mort en 2022. Il est d’ailleurs intéressant de constater que Prigojine semble caresser des ambitions politiques internes. Depuis quelques mois, il a donné plusieurs interviews où il s’est dit prêt à fonder une formation politique ou à prendre la main d’un parti systémique existant comme Russie juste. Il faut prendre cette ambition au sérieux. Prigojine pourrait très bien devenir une forme de voix radicale, loyale au régime, mais canalisant une partie du vote protestataire.
L’antioccidentalisme est un tropisme fort utilisé par Vladimir Poutine. L’utilise-t-il parce qu’il reflète une tendance forte au sein de la population?
On l’a vu lors du discours du 9 mai, centré sur la dénonciation de l’ennemi occidental. On voit émerger cette figure de l’ennemi dès la deuxième moitié des années 2000 après la révolution orange en Ukraine, mais elle est davantage exploitée depuis le début des années 2010. La Russie se considère comme une forteresse assiégée. Mais les ennemis menaçant cette forteresse ont évolué dans le temps. Alors que dans les années 2000, l’ennemi principal était l’islamiste venant du Caucase ou le Chinois utilisant le pression démographique pour conquérir l’Extrême-Orient, aujourd’hui, c’est l’Occidental aidé en interne par une «cinquième colonne» composée de traîtres. Ce discours est-il populaire? Il est difficile de répondre à cette question parce que je n’ai pas les moyens d’enquêter sur ce sujet. Mais si l’on en croit les études disponibles, une partie de la population, peut-être dans les couches les plus âgées, semble adhérer à un discours selon lequel le monde occidental voudrait la perte de la Russie et nourrirait à son encontre des projets impérialistes.
La «libéralisation des mœurs» des Occidentaux est-elle un argument ressassé par les dirigeants pour alimenter ce discours antioccidental?
Ressassé est le mot. Depuis dix ans, ce leitmotiv tend à associer à ce monde occidental menaçant un mode de vie jugé contraire à la tradition russe. Le lien avec les questions de sexualité et de genre est absolument évident. C’est la raison pour laquelle, dans mon livre, je m’attache beaucoup à montrer comment le prétendu combat contre la pédophilie génère justement des discours pour développer l’antioccidentalisme. L’amalgame entre pédophilie et homosexualité est explicitement établi dans la loi de 2013 sanctionnant la propagande aux mineurs des relations sexuelles dites «non traditionnelles».
Trois idées fortes de l’interview de Gilles Favarel-Garrigues:
1. L’obsession des Occidentaux pour la lutte contre la corruption au début des années 2000 a servi Vladimir Poutine dans son combat contre les élites.
2. Le «consensus imposé» par l’intimidation, la coercition, la peur joue un rôle important dans la cohésion des élites russes.
3. Le pouvoir russe mène un prétendu combat contre la pédophilie pour développer l’antioccidentalisme.
Pris dans l’entrelacs des forces de sécurité
Une illustration du magma dans lequel peut plonger l’application de la dictature de la loi décrite par Gilles Favarel-Garrigues est fournie par le livre Dans l’œil du FSB (1), le récit d’un Français actif en Russie et arrêté en mars 2016. Jean-Michel Cosnuau a conçu, créé et décoré une vingtaine de bars, restaurants et clubs en deux décennies de présence en Russie lorsqu’il est emprisonné et accusé de «complicité d’organisation de la prostitution» dans le cadre de ses activités dans un club réputé de Moscou – le 19 – situé en face du bâtiment principal du FSB, le service fédéral de sécurité de Russie. C’est le propriétaire du lieu, un homme d’affaires du Kazakhstan, qui est principalement visé par l’opération. La situation se complique pour le Français lorsque son entourage découvre que l’enquête est diligentée par le service du FSB, l’USB-FSB, chargé de la sécurité interne et de la lutte contre la corruption. A la prévention originelle viennent s’ajouter celles d’espionnage et d’atteinte à la sécurité de l’Etat.
Au terme d’une évasion via le Bélarus, d’une arrestation par les autorités du Maroc sur la base d’un signalement d’Interpol et d’une extradition vers la Russie, celui qui reconnaît avoir «vécu sur la ligne fine qui sépare la légalité de l’illégalité» verra l’accusation d’espionnage abandonnée et sera finalement condamné, en octobre 2018, à trente mois de prison, l’équivalent de sa détention préventive, et libéré. De son expérience, on retiendra notamment le propos d’un de ses interlocuteurs: «Le FSB, c’est le KGB en pire. Avant, ils étaient au service du Parti, maintenant, l’Etat est à leur service.»
Pour appréhender l’injustice de la justice russe, à Dans l’œil du FSB on préférera cependant recommander au lecteur Dans les geôles de Sibérie (Stock, 2020, 300 p.), le récit plus fort encore d’une autre arrestation-évasion de Russie, celle de Yoann Barbereau, le directeur de l’Alliance française d’Irkoutsk, victime d’un kompromat (une technique de déstabilisation) en 2015.
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici