
Arnaud Orain, économiste: «Trump est l’incarnation d’un capitalisme illibéral et autoritaire»

Pour l’économiste Arnaud Orain, l’actuelle guerre commerciale témoigne d’un retour du capitalisme de la finitude, «un monde qui privilégie la puissance sur l’abondance».
«Le néolibéralisme est terminé», assène au début de son essai Le Monde confisqué (1) Arnaud Orain, économiste, historien et directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), à Paris. Il en donne pour indices «la remise en cause du libre-échange», «le retour d’une conception autarcique de l’économie», «la nouvelle course à l’accaparement des terres, des minerais»… La stratégie mise en place par Donald Trump depuis l’entame de son second mandat accrédite largement la prémonition de l’auteur, arrêtée en janvier de cette année. Depuis, la réalité imposée par Donald Trump l’a dépassée.
Quelles sont les caractéristiques du capitalisme de la finitude?
Le capitalisme libéral est une promesse d’enrichissement des individus, des firmes et des Etats, si le principe concurrentiel et le libre-échange sont respectés. Dans ce cadre, l’économie n’est pas un jeu à somme nulle. Dans le capitalisme de la finitude, elle l’est. Celui-ci est fondé sur l’idée qu’il n’y a pas assez de marchés et de ressources pour les individus, les firmes et les Etats. Par conséquent, ce capitalisme tente en permanence de contourner les mécanismes du marché en favorisant les droits de douane, les silos impériaux, les monopoles, la prédation directe, l’accaparement territorial des ressources, hors du principe concurrentiel. Dans cette forme de capitalisme, on considère qu’il n’y en aura pas pour tout le monde.
Comment se traduit le refus de la logique concurrentielle?
Par une organisation de l’économie sur des bases différentes du libéralisme. Notamment en édifiant des silos impériaux: on ne commerce plus de manière multilatérale avec tout le monde mais seulement avec les acteurs qui sont favorables ou soumis. Dans ce cadre, se protéger des autres silos est nécessaire. Pourquoi? Pour pouvoir être en relative autonomie par rapport à ses rivaux systémiques et en dépendre le moins possible en cas de conflit. Cela peut passer par la mise en place d’un système de droits de douane relativement élevés par les grandes puissances rivales systémiques. Autre caractéristique du capitalisme de la finitude: on ne croit plus que la concurrence permette l’innovation et puisse répondre aux besoins du marché. Seul le monopole –la firme unique et gigantesque– est en mesure d’y répondre et de se positionner face aux entreprises des rivaux. Seul le monopole est en capacité d’innover, parce qu’il bénéficie d’une rente, réalise des superprofits, et pourra développer une vision de très long terme. Enfin, ce capitalisme de la finitude implique aussi une volonté d’accaparement territorial qui induit un impérialisme de la part des Etats mais aussi des compagnies-Etats. Ils voudront étendre les frontières de leur silo, s’accaparer des mines, des terres et des mers afin de ne plus devoir passer par le marché pour s’approprier des ressources. Les mers se fragmentent. Il est de plus en plus dangereux de les parcourir. Un système de convoyage est mis en place. Les marines marchandes sont protégées par des militaires ou se militarisent.
«Si l’escalade continue, on peut craindre qu’Etats-Unis et Chine entrent dans un conflit qui ne soit plus seulement économique.»

Voyez-vous émerger dans la conjoncture actuelle les caractéristiques du capitalisme de finitude?
Mon hypothèse est que c’est la troisième fois que ce capitalisme de la finitude se développe dans l’histoire après une première période s’étalant du XVIe siècle jusqu’au début du XIXe, et une deuxième entre 1880 et 1940. Aujourd’hui, on observe un retour de la rareté, né d’un double sentiment: celui d’un trop grand nombre de producteurs d’un côté, et d’une trop faible quantité de ressources de l’autre. Le premier inspire parmi les gagnants d’hier la volonté de se protéger par des droits de douane, de faire du «friendshoring», c’est-à-dire relocaliser chez des amis ou chez soi à coups de subventions. C’est ce qu’a fait le président Joe Biden et ce que fait aujourd’hui Donald Trump à coups de tarifs douaniers. Alors que la Chine produit de tout –et même de la technologie de pointe– moins cher, les Etats-Unis considèrent désormais que la thèse des avantages comparatifs, défendue jusqu’ici par l’Organisation mondiale du commerce (OMC), n’est plus valide. Le deuxième sentiment caractéristique du capitalisme de la finitude, depuis une vingtaine d’années, découle de l’extension du niveau de vie occidental à des pays émergents. Les ressources minières et alimentaires sont pensées comme en tension. Cela amène un certain nombre de décideurs politiques et économiques à vouloir ces minerais et ces produits agricoles sur des bases non strictement libérales. On achète ou on loue des terres, on apporte des intrants (les engrais et les semences) et on repart avec la marchandise, sans qu’il y ait eu un passage par des intermédiaires de marché. Troisième indice du retour de la finitude, la transition écologique. Si on veut faire de la décarbonation, on a besoin d’une grande quantité de métaux. Pour fabriquer quatre milliards de voitures électriques, il faut beaucoup de lithium, de cobalt, etc. Les dirigeants des Etats et des firmes multinationales savent très bien qu’il sera très compliqué de les fabriquer en même temps pour tout le monde. Donc, se répand l’idée que la conquête des ressources nécessaires à la transition énergétique ne peut être laissée aux forces du marché. D’où, là encore, un retour de l’appréhension d’un monde fini où il faut s’accaparer certaines ressources dans la précipitation aux dépens de l’autre.
Dans cette compétition pour les terres rares et les minerais, la Chine a-t-elle une longueur d’avance?
Oui. Les terres rares ne sont pas si rares sur la planète. Le problème, c’est leur traitement. Il demande beaucoup d’eau et de produits chimiques. Aujourd’hui, il n’y a quasiment que la Chine qui soit capable de traiter ces terres rares et qui accepte le niveau incroyablement élevé de pollution et de consommation hydrique que cela génère. Elle dispose d’une arme très puissante dont elle a déjà fait usage sous Joe Biden: restreindre l’exportation de métaux critiques et de terres rares pour empêcher ses rivaux systémiques de se développer. Voilà une autre caractéristique de la finitude. La France et l’Espagne faisaient exactement la même chose aux XVIIe et XVIIIe siècles en empêchant les exportations de laine, un produit critique pour l’industrie textile occidentale.
Que dit la bataille actuelle des droits de douane des relations entre les Etats-Unis et la Chine?
Elle est de très mauvais augure. Si l’on se réfère aux concepts du théoricien militaire Carl von Clausewitz, nous sommes dans une montée aux extrêmes. Chacun surenchérit sur l’autre dans la hausse des droits de douane. On verra si une désescalade se profile, ce qui serait l’évolution la plus souhaitable, même si je n’y crois pas complètement. Je ne pense pas, en effet, que les Etats-Unis souhaitent réellement se recoupler avec la Chine, et inversement. On pourra avoir des baisses des droits de douane dans les semaines à venir. Mais la tendance lourde pour les Etats-Unis et la Chine restera le découplage, une relocalisation sur le sol américain d’une partie des chaînes de valeur, et une relance de la construction navale, civile et militaire. Quelle que soit la désescalade, si elle a lieu, cette tendance de fond prévaudra. Et si l’escalade continue, on peut craindre que ces rivaux systémiques entrent dans un conflit qui ne soit plus seulement économique. Je ne parle pas d’une Troisième Guerre mondiale, mais d’une montée des tensions dans les ports, sur les mers, autour des nouvelles routes de la soie construites par la Chine, sous la forme de blocus, d’intimidations…
«Pour avoir l’assurance américaine, Trump et Vance veulent faire payer ses bénéficiaires en espèces sonnantes et trébuchantes.»
Donald Trump est-il le symbole d’un capitalisme illibéral et autoritaire?
Oui. Il en est l’incarnation la plus pure avec ses homologues Xi Jinping et Vladimir Poutine. Mais le capitalisme de la finitude a commencé avant eux et il leur survivra. Le moment Trump est une incarnation très forte de ce que je décris: les droits de douane, le règne des monopoles, avec ces géants de la tech qui sont à l’intérieur de l’Etat, les nouvelles velléités impériales sur le canal de Panama, le Canada, le Groenland, l’idée des nouvelles frontières américaines… Je crois qu’il ne peut pas y avoir de retour en arrière quand bien même ces dirigeants ne seraient plus là. Le mouvement est désormais trop profond. Du reste, l’administration Biden, avec d’autres moyens et d’une manière beaucoup plus soft, ne poursuivait pas des objectifs si différents.

Le prix sera-t-il un affaiblissement généralisé des économies du monde?
Le capitalisme de la finitude, c’est un monde qui privilégie la puissance sur l’abondance. Il faut toujours garder cette logique en tête. Donc, par définition, il créera moins de croissance économique. Il ne peut créer qu’une stagnation ou une légère augmentation du niveau de vie d’un certain nombre de pays et vraisemblablement, la stagnation et la baisse du niveau de vie d’autres pays puisque son principe est de s’accaparer des marchés et des ressources contre les autres, dans une démarche qui n’est pas de faire croître l’ensemble du bien-être.
Ce seront donc les Etats les plus faibles qui paieront le plus lourd tribut?
Tout à fait, à l’exception de quelques pays vassalisés depuis longtemps et qui constitueront des remparts. Je pense par exemple aux Philippines, un vassal des Etats-Unis affecté par des droits de douane moins élevés dans la proposition initiale… pour qu’il ne soit pas attiré par le silo impérial chinois. Les Philippines sont en conflit territorial avec Pékin en mer de Chine méridionale. C’est aussi une ancienne quasi-colonie américaine. Donc des Etats, en se vassalisant, tireront leur épingle du jeu. Mais à quel prix?
Pensez-vous que Donald Trump pourrait se satisfaire d’une cohabitation entre des silos impériaux, ceux de la Chine, de la Russie, de l’Union européenne coexistant avec le plus puissant, celui des Etats-Unis?
Oui, parce qu’en fait, la base «Maga» aux Etats-Unis ne veut plus payer pour la sécurité mondiale. Lors de la révélation des échanges du «Signal gate», le vice-président J.D. Vance n’était pas favorable à l’attaque contre les rebelles houthis du Yémen. Pourquoi? Parce qu’il pense que ce n’est pas à l’armée américaine de défendre le trafic en mer Rouge, qui bénéficie surtout à l’Union européenne. On voit bien cette conjonction d’idées selon lesquelles il n’est peut-être plus nécessaire pour les Etats-Unis d’avoir sept bases navales prépositionnées et de dépenser autant pour la sécurité mondiale. C’est la logique de l’assurance. Et pour avoir l’assurance américaine, Trump et Vance veulent faire payer ses bénéficiaires en espèces sonnantes et trébuchantes. L’administration Trump pourrait en effet se satisfaire d’un monde fragmenté. Cela coûterait moins cher aux Etats-Unis. Ils sécuriseraient leur seul silo impérial, mais pas vraiment au-delà.
Pourquoi indiquez-vous que «nous ne reviendrons pas au libéralisme politique et économique» alors que l’histoire semble montrer une alternance entre périodes de capitalisme libéral et de capitalisme de la finitude?
Je pense qu’il est souhaitable que nous ne revenions pas au capitalisme libéral. Pour deux raisons. La première, c’est qu’il n’a pas produit de l’abondance pour tout le monde. Il a laminé les classes laborieuses occidentales, en particulier en France, en Belgique, aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne… La deuxième raison, c’est que le capitalisme libéral revient toujours après un énorme conflit, qui décide en fait lequel des rivaux systémiques va vaincre. Ce sont les guerres de la Révolution et de l’empire à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècles, soit le triomphe sur la France et les autres pays de la Grande-Bretagne qui deviendra la puissance hégémonique. En 1945, même scénario. La question est de savoir qui contrôlera le Pacifique. Ce sera la puissance américaine. Revenir au capitalisme libéral, ce serait à l’issue d’un conflit majeur entre la Chine et les Etats-Unis. Ce n’est pas souhaitable.
Quelle serait alors l’alternative au capitalisme de la finitude?
Si le retour au libéralisme est compromis, l’alternative au capitalisme de la finitude ne peut résider que dans une politique d’économie écologique très forte, de décarbonation, de sobriété énergétique, de réduction de la consommation, de décroissance d’un certain nombre de pans de l’économie. Le problème est qu’il est très difficile de mener cette politique dans un monde où des rivaux systémiques, en particulier fossiles comme la Russie, n’ont pas d’intentions bienveillantes. De surcroît, la décarbonation et la transition écologique demandent de grandes quantités de ressources. C’est la quadrature du cercle: comment conjuguer une géopolitique très défavorable et la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique et la sixième extinction de masse des espèces?
(1) Le Monde confisqué. Essai sur le capitalisme de la finitude (XVIe-XXIe siècle), par Arnaud Orain, Flammarion, 368 p.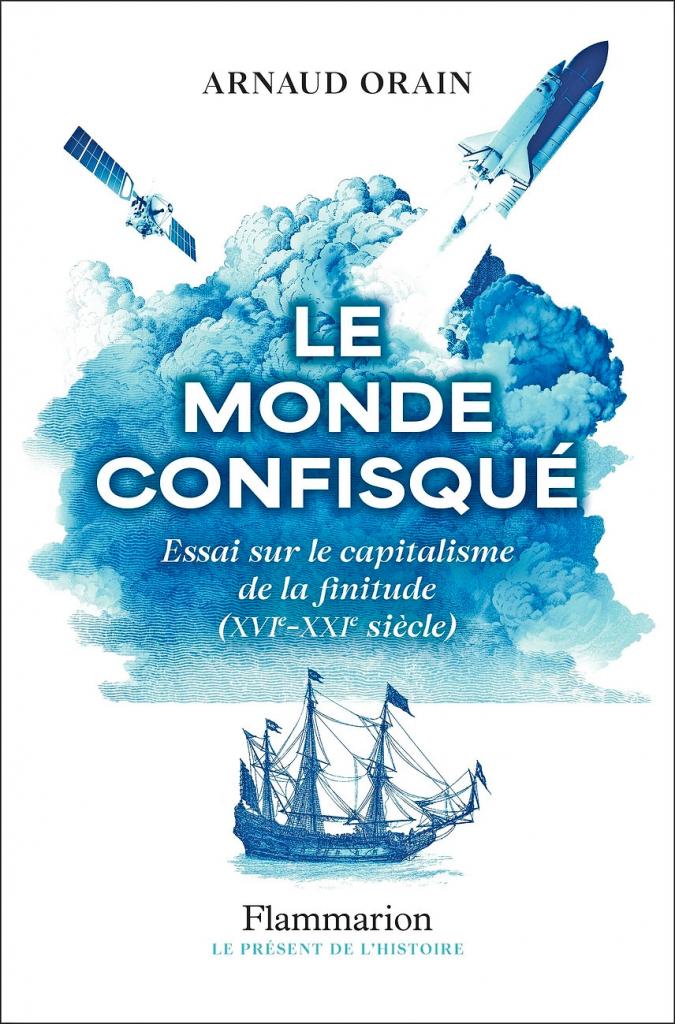
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici