
Monica Sabolo : «Trancher le bien et le mal n’est pas si simple » (entretien)
En se découvrant des liens insoupçonnés avec les membres du groupe terroriste Action directe, qui sévissait dans les années 1980, Monica Sabolo plonge à nouveau dans la quête intime qui animait ses précédents romans, vers un possible apaisement. Et vers le Goncourt?
Depuis l’étonnant Tout cela n’a rien à voir avec moi (JC Lattès, 2013), Monica Sabolo creuse cette veine intime qui constitue désormais son style caractéristique. C’est de sa propre intimité dont il est question. «Protégée sous ce grand châle de littérature», Monica Sabolo ne se cache jamais, ou à peine (dans Tout cela n’a rien à voir avec moi, elle était «M.S.»), et se débat, de texte en texte, avec ce même traumatisme: l’inceste commis sur elle par son père adoptif. Dans le fraîchement paru La Vie clandestine (1), elle pousse encore plus loin sa quête de vérité.
J’ai eu la sensation, en me penchant sur les années 1980, que tout ce qui constitue notre monde aujourd’hui était né à ce moment-là.
Tout commence pourtant comme une enquête à la Philippe Jaenada (l’auteur de La Serpe), sur un ton plutôt humoristique. L’autrice cherche à écrire «quelque chose de facile et d’efficace, qui aurait des chances de se vendre». Après avoir écouté en boucle l’émission Affaires sensibles sur France Inter, elle est particulièrement marquée par un épisode portant sur l’assassinat de Georges Besse, alors patron de Renault, le 17 novembre 1986, par des membres d’Action directe (AD). Troublée que ce soient deux jeunes femmes (Nathalie Ménigon, 29 ans, et Joëlle Aubron, 27 ans) qui ont appuyé sur la gâchette, elle décide d’enquêter sur ce groupe terroriste d’extrême gauche. Elle se plonge alors dans cette France des années 1980, sa violence tant psychologique que physique, l’éventualité constante d’un attentat en toile de fond. «Je me suis fourrée dans un sacré merdier…», reconnaît-elle.

Elle n’est pas au bout de ses surprises: contre toute attente, cette enquête a priori si éloignée d’elle – Monica Sabolo vivait d’ailleurs en Suisse au moment des faits – fera resurgir les traumatismes de son passé «comme un corps gonflé d’eau qui remonte doucement vers la surface». Ce n’est plus une, mais deux enquêtes pareillement passionnantes et bouleversantes qui s’écrivent alors sous nos yeux.
Le jour de notre rencontre, elle est impatiente que sa tournée internationale d’interviews à la chaîne se termine, tant il est difficile pour elle de s’épancher, encore et encore, sur ces faits douloureux, de «prononcer des mots à haute voix que je n’ai jamais prononcés».
Vous choisissez d’enquêter sur le groupe terroriste Action directe. C’est tout sauf facile. Qu’est-ce qui vous a poussé à vous lancer là-dedans?
C’est une bonne question. Pourquoi je me mets tout le temps dans des situations pareilles? Je ne sais pas. Je pense que le fait que ce soient deux femmes qui ont tué Georges Besse, le patron de Renault, m’a interpellée. Et puis, il y avait probablement d’autres choses secrètes, celles qui se sont révélées pendant l’écriture, qui étaient là de façon inconsciente.
Vous allez assez loin, vous lisez à peu près tout ce qui existe sur le sujet, et le lecteur se dit que ça peut être dangereux, que vous risquez des menaces…
J’étais d’une totale naïveté, je crois. Mais peut-être que c’est en raison de cette méconnaissance, de ce côté «enquêtrice bras cassé», que j’ai pu aller plus loin. Parce qu’il faut savoir que je perds tout, je n’arrive plus à relire mes notes, j’oublie tout, quand je lis ce qui a été écrit sur Nathalie Ménigon et Joëlle Aubron, je projette mes propres émotions, j’invente des choses qu’elles n’ont jamais ressenties… En dépit de cet aspect maladroit, peut-être que cette espèce d’innocence m’a permis d’aller plus loin. Finalement, cela a paradoxalement été un atout.
Au cours de votre enquête, vous rencontrez certains membres d’AD, dont Nathalie Ménigon. C’était un peu le Graal de votre enquête. Vous y êtes allée naïvement…
… et avec une sorte d’énergie furieuse, aussi. Il y avait là quelque chose d’impérieux. C’est comme si j’avais une question à lui poser, et que c’était pour moi essentiel. C’était sans doute une question que je voulais poser à mon père. Je voulais qu’elle apaise quelque chose en moi. Evidemment, je ne le formulais pas de cette façon-là. Par la suite, je ne pense pas qu’il était question de naïveté, parce que je la perds au fur et à mesure de l’enquête. Je commence à percevoir la complexité humaine, le fait qu’il n’est pas si simple de trancher entre le bien et le mal, à me rendre compte du danger également ; du danger de blesser les proches de Georges Besse ou des autres victimes, du danger de heurter ma propre famille. Le danger peut-être envers moi-même, aussi, de me promener à nouveau dans des lieux périlleux pour moi. Je perds beaucoup de cette naïveté mais, en revanche, j’ai cette espèce d’énergie, qui était tendue vers un objectif qui n’avait pas de nom, mais une sorte de recherche de la vérité, quelle qu’elle soit, et qui faisait que je pouvais déplacer des montagnes. Je n’avais peur de rien.
Forcément, vous êtes amenée à parler des années 1980. En ce moment, énormément de séries, de livres – y compris dans cette rentrée littéraire – évoquent cette période. A vous lire, on se rend compte qu’elles n’étaient pas aussi «fun» qu’on a voulu le faire croire…
En fait, on a oublié la violence de cette époque. J’ai eu la sensation, en me penchant sur les années 1980, que tout ce qui constitue notre monde aujourd’hui est né à ce moment-là. C’est-à-dire le mythe de l’entrepreneur «winner», la société de l’argent, de la réussite, du divertissement, la dilution du collectif, l’abandon des utopies et, oui, la réussite individualiste. J’ai remarqué, par exemple, que l’expression «lutte des classes» a totalement disparu de notre langage, comme si cette lutte avait elle-même disparu – quand des mots ne sont plus prononcés, ils n’existent plus. Or, elle n’a bien sûr absolument pas disparu. Nous vivons dans un monde où les inégalités ne cessent de s’accroître et les ressources de se raréfier… Il y a quelque chose qui se tend de ce côté-là, entre les plus riches et les plus pauvres. Les années 1980 étaient cette période où on ne voulait plus en entendre parler, ce n’était plus un sujet. Et puis, la violence de l’époque! On l’a oublié, mais il y avait énormément d’attentats, tout le temps.

Ces choses disparues dont vous parlez constituent l’ADN d’Action directe. On pourrait trouver leur cause belle et romantique, mais c’est compliqué ; ils vont jusqu’à tuer au nom de ce collectif, pour leurs idéaux, aussi nobles soient-ils.
En effet, c’est compliqué. Des gens qui sont pour une société plus juste, qui rêvent d’un monde plus égalitaire, sont aussi capables, pour certains, d’une grande violence. La question est: comment finit-on par adopter la violence alors qu’à l’origine, on veut se battre contre celle exercée par la société à l’égard des plus faibles? Je crois que tout mon livre est construit autour de l’idée du glissement: le glissement vers le meurtre pour AD, le glissement vers la faute pour mon père, le glissement de mon livre vers le lieu où il voulait m’emmener.
Sans dévoiler le dénouement de votre roman, vous ne trouvez pas de véritables réponses à vos questions. Malgré tout, on sent un certain apaisement à la fin. C’est un cliché, mais on entend souvent que la littérature sauverait. Vous confirmez?
Je confirme. La littérature m’a sauvée et continue de me sauver. Aussi bien dans la lecture que dans l’écriture.
Dans ce roman, il y a la violence d’Action directe, la violence de ce flash-back intime, parce que vous creusez très profond dans votre passé pour trouver ce que vous cherchiez sans le savoir…
Oui, c’est ça, ce que je cherchais sans le savoir… Je ne sais pas si on peut parler de difficulté ou de violence ressentie. Finalement, j’ai l’impression de me promener dans ces espaces-là dans chacun de mes livres, d’une façon ou d’une autre. Je tourne autour de ce passé. Cela fait partie de mes motifs. Ce ne sont pas des motifs confortables, mais je ne peux m’empêcher d’y retourner. Il y a toujours quelque chose à transformer, à polir. A dompter, peut-être à apprivoiser ou à accepter de vivre avec, pour pouvoir reprendre la main. Ce livre-ci en est une variation supplémentaire. Alors oui, je vais plus loin, mais peut-être que le cheminement mené avec les livres précédents m’aide à pousser de l’avant. Ce sont autant de petits cailloux – qui grossissent à chaque texte. Donc je dirais plutôt que c’est mon univers familier, et que j’essaie de contrebalancer avec un aspect plus fantaisiste et plus loufoque, parce que je crois que ma vie est pas mal entre ces deux pans, entre la fantaisie comique et la tragédie.
Parler est compliqué. Je peux le faire par la littérature, dans mon abri, protégée dans le silence, dans un temps qui est le mien.
On pourrait voir dans ce livre la fin d’un cycle. C’est le cas?
Effectivement, j’ai la sensation que c’est la fin d’un cycle. Mais à la fois, méfiance, parce que je pense toujours en avoir fini avec ces sujets et finalement, de livre en livre, j’y reviens. Donc qui sait?
Pour vous, c’est la littérature qui a permis de libérer la parole, pour d’autres, ce fut le mouvement MeToo…
La libération de la parole, c’est une chose, mais pour autant, je ne sais pas si on ne parlait pas avant. Peut-être qu’on n’était juste pas entendues. Il faut aussi que justice soit faite, et on en est encore bien loin. On m’a demandé si le mouvement MeToo m’avait aidée à écrire ce livre. Je pense plutôt que c’est un cheminement très intime, le cheminement d’une vie, qui a rencontré MeToo – mouvement qui me sidère par l’ampleur des faits. Ça brise un sentiment de solitude, ça donne la sensation d’avoir des choses en commun avec d’autres femmes. Cela permet, par ailleurs, de sortir de cette espèce de sensation d’avoir quelque chose à cacher et de la honte qui l’accompagne: si j’ai quelque chose à cacher, c’est parce c’est vraiment quelque chose de monstrueux. Ce qui se passe aujourd’hui, et qui est historique, commence à diluer ces sentiments-là. Mais pour s’en défaire, il faut tellement longtemps… MeToo aide, c’est vrai. Le sentiment d’être ensemble aussi.
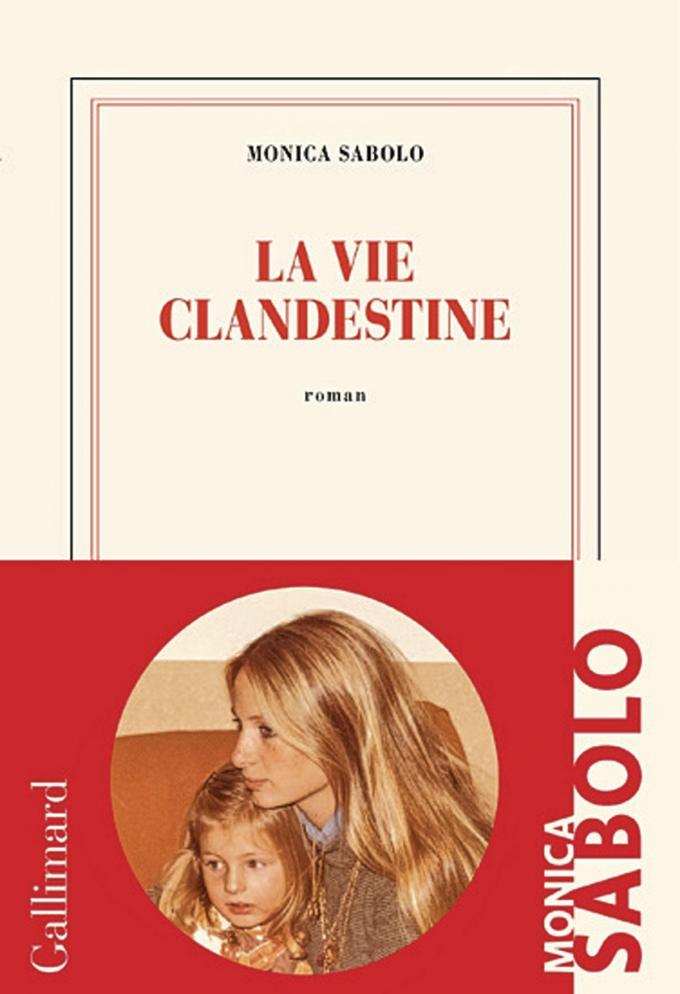
Le milieu bourgeois, que vous abordez dans le livre, force lui aussi au silence.
Je pense que, quel que soit le milieu, on est toujours forcé au silence. La solitude est extrême, aride, désertique. Avec le mouvement MeToo, il y a quelque chose de l’ordre de la solidarité, du partage de ce qui nous constitue, avec justement le traumatisme, la honte, la culpabilité, la rage, l’incapacité à se défendre. Le fait de pouvoir parler de ça, de se comprendre, de sentir qu’on n’est pas seule, et que l’on n’est plus cet être bizarre qui doit juste cacher ce qui est arrivé. Parce que c’est quelque chose qui ne se formule même pas, mais c’est une espèce de sensation, d’instinct. Et l’instinct, dans ces cas-là, ne vous pousse pas vers l’acceptation de soi. A mes yeux, l’un des aspects les plus intéressants de ce mouvement, c’est ça. Et de donner du courage… Sans cela, je ne sais pas s’il aurait été possible que je parle de cette manière. C’est déjà difficile pour moi de parler, mais malgré tout je peux le faire à travers la littérature. C’est beaucoup plus difficile de le faire à voix haute. Maintenant, il y a toutes ces autres voix, qui ont révélé des choses que j’avais pu ressentir. Cela m’a énormément réconfortée.
Lorsque vous êtes interviewée, vous reparlez régulièrement de ces moments terribles de votre passé. Cela ne doit pas être facile…
Parler est compliqué. Comme je vous le disais, je peux le faire par écrit, je peux le faire par la littérature, dans mon abri, protégée dans le silence, dans un temps qui est le mien. Les questions frontales, qui s’acharnent parfois à voir en mon texte un témoignage, ce qu’il n’est pas, sont blessantes. C’est un texte de littérature. Il est vrai que ça me demande de prononcer des mots à haute voix que je n’ai jamais prononcés, comme si ce lieu était resté très longtemps dans l’ombre, et là, soudain, il est éclairé d’une lumière vive et brutale. Dans le même temps, si j’ai écrit ce livre, c’est qu’il y avait une nécessité qu’il soit posé. Mais protégée de ce grand châle de littérature, ça change tout. Je ne veux pas avoir l’air de me plaindre, dans la veine: «Je ne veux pas en parler, c’est trop difficile, etc.» ; c’est normal, vous comprenez? En revanche, ce que je peux dire, c’est que prononcer ces mots à haute voix est encore compliqué.
Vous êtes sur la première liste du prix Goncourt. Que ressentez-vous? Vous y croyez, ou ça ne vous intéresse pas?
Ah non, on ne peut pas dire que ça ne m’intéresse pas. Déjà, d’être sur la liste pour le Goncourt, c’est comme si on me l’avait donné. Je suis tellement contente! Pour autant, je ne peux pas dire que j’y crois.
C’est la deuxième fois, quand même?
Oui. Je l’ai eu deux fois donc! C’est très rare! (Rires)
Bio express
1971 Naissance, à Milan, le 27 juillet.
2000 Publie son premier roman, Le Roman de Lili (JC Lattès).
2013 Remporte le prix de Flore pour Tout cela n’a rien à voir avec moi (JC Lattès).
2014 Quitte le journalisme pour se consacrer à l’écriture.
2016 Obtient le Grand prix du roman SGDL (Société des gens de lettres) pour Crans-Montana.
2017 Est nommée sur les listes du prix Goncourt, avec Summer (JC Lattès).
2022 Est une nouvelle fois présente sur la première liste du Goncourt avec La Vie clandestine.
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici