
«Le discours écologiste est trop souvent habité par des passions tristes»
La lecture de Le Sens de la Terre. Penser l’écologie avec Nietzsche, de Benoît Berthelier, obéit à trois temps. D’abord, on fronce le sourcil et on s’indigne. Ensuite, le doute s’immisce. Enfin, on acquiesce – en partie du moins.
On s’indigne quand on découvre que ce tout jeune philosophe français fait l’éloge du surhumain, appelle de ses vœux une écologie de la puissance, et ce, en des temps d’aggravation du changement climatique et de catastrophes sanitaires qui appellent plutôt la sobriété et la modération. Mais assez vite, l’indignation cède joyeusement le pas au doute dès lors qu’on saisit que ce nietzschéen d’à peine 27 ans, déjà agrégé de philosophie, à l’escarcelle chargée de distinctions académiques et dont le CV ferait rougir nombre de ses pairs aînés, réinvestit la conception de la puissance d’un nouveau sens, totalement adapté à l’ère de l’Anthropocène. Renvoyant dos à dos l’idéal ascétique de la sobriété écologique et la conception écomoderniste et techniciste de la puissance, Benoît Berthelier, puisant dans la philosophie de Nietzsche, appelle à concilier écologie et puissance. La puissance est substantielle à l’être humain, il est donc vain de s’obstiner à la réprimer ou la nier. «Ce qui compte, c’est la manière dont la puissance s’exprime», clame-t-il.
Nietzsche permet de penser les conditions d’une incorporation joyeuse des savoirs de l’écologie.
Nietzsche, philosophe de la volonté de puissance et théoricien du surhumain, n’est pas le premier auteur qui vient à l’esprit quand on pense écologie. Comment vous est venue l’idée d’envisager la question environnementale à l’appui de Nietzsche?
L’idée m’est venue pendant mes études en histoire de la philosophie. Je travaillais sur Nietzsche et les questions écologiques me préoccupaient. Mais la conjonction de ces deux centres d’intérêt n’allait pas de soi. D’un côté, je me demandais si la philosophie de Nietzsche n’était pas, en quelque sorte, «périmée» à l’heure de la crise écologique. En effet, valoriser la surabondance, l’ivresse et la force qui croît, avec son lot de gaspillages et de destructions, a aujourd’hui quelque chose de déplacé, d’inaudible. D’un autre côté, l’écologie ne me donnait pas beaucoup plus de satisfaction: je voulais prendre très au sérieux la gravité et l’urgence des problèmes mais, en même temps, je me sentais un peu perdu, désorienté, j’avais du mal à trouver un sens à cette situation, et j’oscillais entre déni, cynisme, malaise et culpabilité. C’est là que je retrouvais Nietzsche: parce que ces affects «négatifs» sont précisément ceux qu’il veut nous apprendre à surmonter. J’ai donc fait le pari que Nietzsche pouvait jeter une lumière salutaire sur l’écologie. En commençant à travailler sur les textes, je me suis rendu compte que le prisme écologique faisait également ressortir des images et des concepts nietzschéens qu’on n’avait pas, ou peu, l’habitude de commenter.
L’écologie est aujourd’hui associée à l’imaginaire et au champ lexical de la sobriété, de la modération, de la frugalité. Selon vous, pourquoi faut-il dépasser cette conception de l’écologie?
Le principal problème, c’est que ce lexique est encore associé à des valeurs et à des affects négatifs. Il existe un risque que cet idéal de sobriété reste vide, qu’il ne mobilise personne. Mais il y a aussi un risque qu’il mobilise de la mauvaise manière: par le réinvestissement de vieux affects de culpabilité, de cruauté contre soi-même ou de ressentiment contre l’existence, bref tout l’arsenal à l’arrière-plan de ce que Nietzsche appelle «les idéaux ascétiques». Je ne veux pas dire par là que «la sobriété, c’est mal». L’enjeu est de regarder de plus près à quelles valeurs nous tenons, ce qui se cache derrière les étendards que nous brandissons parfois un peu trop vite. Il faut se demander de quels idéaux l’écologie a besoin.

Vous appelez de vos vœux une pensée écologique qui soit associée à une philosophie de la puissance. Quels en seraient les grands fondements et principes?
L’écologie n’a ni besoin d’une philosophie de l’impuissance, de l’effondrement programmé, ni d’une philosophie qui stigmatise et culpabilise la puissance en tant que telle. Elle a besoin d’une philosophie de la puissance. Mais tout dépend de la manière dont on comprend le mot «puissance». Chez Nietzsche, il s’agit de la volonté de puissance, c’est-à-dire de la dynamique d’expansion de la vie elle-même, qui cherche toujours non seulement à se conserver mais aussi à s’accroître.
Vous estimez qu’il existe plusieurs types de puissances. Lequel est le plus adéquat à l’ère de l’Anthropocène?
Si l’on suit Nietzsche, le type humain dominant aujourd’hui est un type nihiliste, un type malade donc, dont la capacité d’organisation et d’épanouissement vital est considérablement affaiblie. C’est pourquoi Nietzsche a à cœur de nous enseigner le dépassement du nihilisme: il nous enseigne l’au-delà de l’humain, ce qu’il appelle «le surhumain». C’est une invitation à explorer les voies d’une nouvelle vitalité, proprement terrestre. En effet, la quête d’une puissance supérieure passe par une sensibilité accrue à notre condition terrestre. On ne guérira pas du nihilisme sans accepter d’abord que la Terre est notre seule demeure, sans ailleurs et sans au-delà. La puissance ne peut croître qu’en retrouvant le goût des choses proches, ces choses terrestres que nous avons toujours eu tendance à négliger, en préférant fuir dans les cieux lointains de la métaphysique ou de la religion.
Vous soutenez qu’il ne faut pas chercher à réprimer, contourner ou juguler la puissance, mais plutôt à composer avec elle…
Si l’on dit que la volonté de puissance est le propre de la vie elle-même, alors il n’y a pas de sens à inventer sans cesse de «bonnes raisons» de limiter la puissance. La puissance ne peut pas ne pas s’exercer, ne pas chercher son excès. La tâche du philosophe n’est donc pas de trouver la meilleure justification d’un impératif de contention ou de répression de la puissance humaine. D’abord, parler de la puissance humaine est trompeur, trop général: il faut regarder de plus près à quel type de puissance nous avons affaire, quelles valeurs et quelles forces sont en présence et s’expriment derrière telle action ou tel discours. Ce qui compte, c’est la manière dont la puissance s’exprime. Plutôt que de définir les limites que nous devrions respecter – la liste risque d’être longue… – essayons de nous demander à quoi ressembleraient des existences vraiment terrestres et quelles conditions devraient être réunies pour que nous soyons capables et désireux de les mettre en œuvre.
Vous critiquez la conception écomoderniste et technique de la puissance…
L’ambition des écomodernistes est de développer encore plus nos capacités techniques, financières et sociales pour éviter l’effondrement. Pas de changement de valeurs, donc: pour les écomodernistes, il va de soi que les intérêts humains, et peut-être plus précisément les intérêts d’une poignée d’acteurs de l’économie mondiale, priment sur les intérêts des autres vivants et de la planète. Une telle approche tend à minimiser l’urgence d’un changement qualitatif de nos formes de vie. Aujourd’hui, il ne s’agit pas d’avoir plus de puissance, mais de transformer le type de puissance que nous valorisons.
Vous mettez aussi en garde contre les formes mystiques de l’écologie profonde ou de la reconnexion immédiate et sans filtres avec la nature. Que reprochez-vous à ces approches?
En soi, la reconnexion avec la nature n’est pas une illusion. Le problème est plutôt qu’une véritable reconnexion avec la nature et les autres vivants serait complètement invivable. Compatir avec tout ce qui vit, s’éprouver soi-même comme une partie de la nature, cela va à l’encontre des tendances les plus fondamentales de la vie. L’écologie profonde rêve d’un «élargissement du soi» à toute la nature, mais le problème est que la vie, selon Nietzsche, veut rester en surface, parmi les belles apparences. En effet, la vie a besoin d’illusions, d’artifices, de filtres et de détours. D’où le risque que l’élargissement du soi dégénère en oubli ou en négation de soi.

Quelle place pour les animaux, et la biodiversité en général, dans cette philosophie de la puissance?
Ainsi parlait Zarathoustra est peuplé d’animaux: aigle, serpent, chameau, lion, mouche, papillon, hérisson, sangsue, et bien d’autres encore! Au-delà de ce bestiaire impressionnant imaginé par Nietzsche, je crois que lorsque Zarathoustra nous enseigne le surhumain, il veut d’abord nous faire comprendre que la vie est possible de multiples manières. Le monde est traversé de multiples perspectives, pas seulement humaines. Vouloir le surhumain, c’est vouloir rendre la Terre habitable pour de multiples formes de vie. C’est se soucier, pourrait-on dire, du potentiel d’évolution des vivants sur le temps long et dans des directions inattendues.
Nous avons affaire à un nihilisme environnemental, qui peut prendre plusieurs formes.
Vous parlez souvent de nihilisme. Qu’entendez-vous précisément par là?
Il me semble utile de penser la situation que nous traversons aujourd’hui à partir de la notion de nihilisme. Le nihilisme renvoie au sentiment d’une absence de sens, à l’impression que nos valeurs se sont vidées de leur substance, qu’elles ne valent plus rien, et que plus aucun but ne mérite d’être poursuivi ici-bas. Le nihilisme est un processus de dévaluation des valeurs millénaires de l’Occident (la vérité, la piété, etc.) qui parcourt toute l’histoire de notre culture.
Dans le livre, vous parlez de «nihilisme environnemental». De quoi s’agit-il?
Aujourd’hui, nous avons affaire à un nihilisme proprement environnemental, qui peut prendre plusieurs formes. Il y a en effet autant de figures du nihilisme environnemental que de manières de réduire à «rien» (du latin «nihil») ce qu’est la Terre: en la voyant comme un simple stock de ressources, en détournant le regard de la catastrophe en cours, en étant au contraire complètement écrasé par l’urgence climatique, découragé et épuisé par l’inertie de nos sociétés, ou plein de rancœur contre un tel désastre, quitte à rêver d’une Terre enfin libérée du fléau humain.
Vous qualifiez votre approche de thérapeutique et non de métaphysique.
C’est une manière de dire qu’il faut soigner notre capacité à faire sens. Il s’agit de comprendre comment intégrer les données de l’écologie et de la climatologie, comment en faire des conditions de vie. Une telle approche doit permettre d’articuler un souci de soi – une tâche d’individuation – et la relation de l’individu à sa culture.
L’écologie doit devenir un «gai savoir», écrivez-vous. Pensez-vous que les affects de joie, comme disait Bruno Latour, manquent au discours de l’écologie politique aujourd’hui?
Effectivement, l’écologie, dans ses discours et sa pratique, est trop souvent habitée par des passions tristes. Bruno Latour, dans son Mémo sur la nouvelle classe écologique (coécrit avec Nikolaj Schultz, éd. La découverte, 2022) a raison d’appeler à investir le combat écologiste d’affects positifs et mobilisateurs. Il faut que l’écologie soit suffisamment enthousiasmante si elle entend changer la vie en profondeur. Mais je ne suis pas certain que le réinvestissement de la figure menaçante de Gaïa soit le meilleur moyen d’atteindre cet objectif. Dans Face à Gaïa (éd. La découverte, 2015), c’était Latour lui-même qui distinguait le «savoir de Gaïa» de la «gaya scienza» (le gai savoir) de Nietzsche. Or, il me semble que Nietzsche nous permet précisément de penser les conditions d’une incorporation joyeuse des savoirs de l’écologie. Il ne nous invite pas seulement à changer de cosmologie mais à soigner directement notre capacité à donner un sens à la Terre et à nous doter de nouvelles valeurs.
Bruno Latour considérait également l’Anthropocène comme un état de guerre. Pourquoi réfutez-vous ce diagnostic? La question climatique n’a-t-elle pas atteint un tel niveau d’urgence qu’il devient désormais salutaire d’envisager ainsi l’Anthropocène?
Bruno Latour parle de l’Anthropocène comme d’un «état de guerre généralisé» avant tout pour souligner que nous ne sommes pas du tout aujourd’hui dans un état de paix, que les conflits se multiplient sur tous les fronts, et que la solution au changement climatique ne se fera pas sans luttes et sans sacrifices. De fait, notre époque est bien traversée, à diverses échelles, par des rapports de forces et des conflits en tous genres (sociaux, économiques, politiques et géopolitiques). Mais tous les conflits ne sont pas des guerres. Je ne suis donc pas certain que le terme de «guerre» soit le plus juste aujourd’hui, parce qu’il est un peu imprécis et parce qu’il charrie aussi un imaginaire dangereux, comme Latour le reconnaît lui-même. Insuffler un nouveau sens à l’engagement écologique n’implique pas forcément de conflictualiser cet engagement en se trouvant un ou des ennemis, en distinguant des camps, des alliés et des traîtres: tout ce vocabulaire qui n’est pas seulement politique mais aussi directement moral peut-il vraiment déclencher un changement de valeurs et d’affects sans nourrir le ressentiment? Il ne s’agit pas de rester aveugle aux conflits et à la domination, bien au contraire. Mais le but principal est plutôt de guérir du nihilisme – le douloureux «à quoi bon?» – et de sortir de la grande fatigue qui nous fait envisager les idées mêmes de combat et de lutte avec lassitude, désespoir ou ironie.
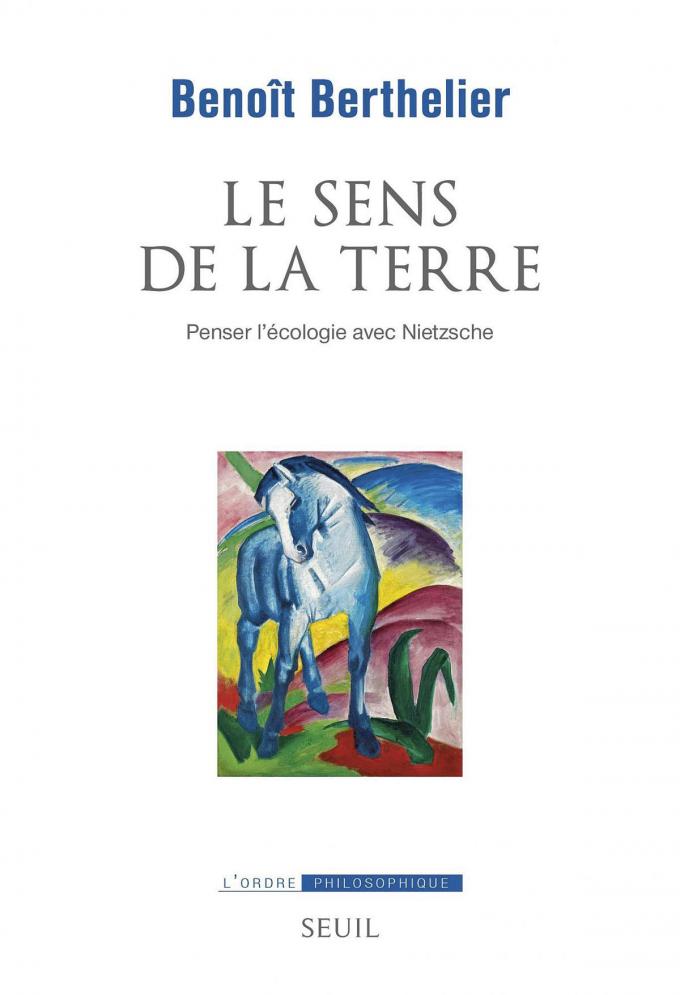
Comment expliquez-vous le décalage entre l’énorme prise de conscience de la crise environnementale dans l’opinion publique et le peu d’enthousiasme que suscitent les partis écologiques? L’écologie politique, telle qu’elle s’exprime aujourd’hui, serait-elle un peu rabat-joie?
Je crois en effet que les gens ne sont pas du tout indifférents à la question écologique. C’est plutôt qu’ils ne savent pas quoi faire de ce qu’on leur annonce (réchauffement climatique, sixième extinction de masse, etc.). Les individus ne sont pas apathiques mais assaillis par de multiples affects contradictoires: lassitude, anxiété, incompréhension, défiance, colère, désespoir, espoir… Le bon diagnostic, à mon sens, c’est le nihilisme. L’écologie politique doit être une manière de surmonter le nihilisme et pas de le prolonger ; c’est là toute la difficulté. On dit souvent que l’écologie est d’abord un enjeu collectif et politique, au sens où l’on ne résoudra pas la crise à l’échelle individuelle, par une accumulation de «petits gestes» bien intentionnés comme trier ses déchets ou réduire sa consommation de viande. C’est vrai en un sens, mais je crois qu’il ne faut pas forcer l’opposition entre le collectif et l’individuel, entre le politique et l’existentiel. L’écologie doit avoir une dimension existentielle pour engager un changement politique, et la dimension existentielle, pour ne pas être qu’un discours vide, doit avoir une traduction politique.
Dans le paysage politique actuel, qui vous semble incarner, ou en mesure de le faire, une écologie de la puissance?
C’est une bonne question, je ne suis pas certain de pouvoir y répondre! Beaucoup de mouvements écologistes considèrent aujourd’hui que leur tâche n’est pas seulement de défendre la nature mais de proposer une réforme plus globale de la culture. C’est une bonne chose. Je crois cependant que l’écologie politique n’a pas à nous dicter un mode de vie tout fait, conforme aux exigences du respect de la planète. Souvent, on voudrait qu’il en soit ainsi: qu’on nous dise quoi faire et comment vivre. Comme si nous avions encore besoin de prêtres et de directeurs de conscience. Justement, Nietzsche ne nous dit pas ce qu’il est bien ou mal de faire. Il ne nous indique pas le chemin à prendre. Le travail qu’il nous invite à faire est plus fondamental: il s’agit de reconstruire notre capacité à nous orienter, à trouver un chemin et à y avancer, pas à pas. Ce chemin sera propre à chacun, mais cela n’exclut pas que sa valeur soit reconnue par d’autres. Surmonter le nihilisme, c’est à la fois un travail sur soi-même et un travail en vue d’une politique. Avant même de savoir pour quoi s’engager, il faut d’abord apprendre à ne pas tourner le dos à la société, apprendre à cultiver et à fortifier une aspiration à vivre avec ou contre une certaine culture.
Quelle serait la traduction politique d’une pensée écologique de la puissance? A quoi ressemblerait-elle concrètement, politiquement et institutionnellement selon vous?
J’ai tenu la politique à distance dans ce livre. Cela dit, je ne me reconnais pas dans un technocratisme qui viserait à «écologiser» la société par le haut, par ses élites, ni dans l’imaginaire de la zad (NDLR: zone à défendre, soit l’occupation militante d’un territoire ou d’un lieu, destinée à s’opposer à son aménagement), du moins pas dans tous ses aspects, malgré ce que cela comprend d’extrêmement inventif. L’enjeu pour moi serait plutôt de penser l’écologie comme une charge commune que chacun devrait faire sienne, et qui soit une dimension intégrale de la citoyenneté et de la solidarité. Concernant la sobriété par exemple, il est évident qu’il ne s’agit pas que d’une question de consommation et de performance énergétique. Le mot lui-même, «sobriété», a une lourde dimension morale, il engage des valeurs. Renoncement, sacrifice, sobriété… on ne peut pas employer un tel lexique en toute innocence et espérer qu’il soit mobilisateur. Ce qui est crucial, c’est le mode d’appropriation de ce discours par les individus, le type d’épanouissement et de liberté qu’il y a derrière.
Nietzsche est également le philosophe qui a réhabilité Dionysos, dieu de la fête, du vin et de l’exubérance. Peut-on conjuguer la fête, et le plaisir en général, comme l’appelle de ses vœux le philosophe Michaël Fœssel, entre autres, à notre conjoncture de crise environnementale et d’épuisement des ressources?
Je suis d’accord avec Michaël Fœssel sur deux points qui me semblent très importants: d’abord, l’idée que le plaisir et l’abondance ne doivent pas être congédiés au nom de l’écologie mais plutôt redéfinis ou réinterprétés ; ensuite, l’idée que le catastrophisme, c’est-à-dire la tendance à envisager l’avenir sous l’angle du pire, est une boussole éthique et politique peu à même de nous aider à nous orienter dans le monde d’aujourd’hui. L’enjeu actuel est donc d’inventer une écologie qui ne nous permette pas seulement de survivre mais qui nous incite, profondément et intensément, à vivre.
Le Sens de la terre. Penser l’écologie avec Nietzsche, par Benoît Berthelier, Seuil, 304 pages.
Bio express
1996
Naissance, le 4 mars, à Clermont-Ferrand (France).
2015
Entre à l’Ecole normale supérieure de Paris.
2019
Master 2 à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sur les lectures écologistes de Nietzsche.
2020
Reçu premier à l’agrégation de philosophie.
2021
Lecteur à l’université d’Oxford.
Septembre 2021
Inscription en thèse à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne: «Wittgenstein/Nietzsche: les maladies du non-sens».
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici