
Comment l’activité du corps stimule celle de l’esprit

La physique «moderne» a permis le dépassement radical des limitations premières de notre corps et de notre esprit, décrit le physicien Etienne Klein dans Transports physiques.
Entre ceux qui estiment qu’«on ne peut penser et écrire qu’assis» (Gustave Flaubert) et ceux pour lesquels «il faut que [leur] corps soit en branle pour y mettre [leur] esprit» (Jean-Jacques Rousseau), il n’y a pas photo pour le physicien et philosophe des sciences Etienne Klein. Il fait partie de la seconde catégorie. Et il explique, entre autres transmissions de savoir, dans Transports physiques (1) tout le bénéfice que l’humain peut tirer de cette symbiose entre le corps et l’esprit. «Evidemment, il ne suffit pas de mettre son corps en action pour que jaillissent les idées. Et une fois cette idée surgie grâce à l’activité du corps, sans doute est-il nécessaire de s’arrêter pour l’accueillir et la travailler», écrit l’auteur. Mais c’est indubitable, selon lui: «L’activité physique stimule la pensée, la décale, la transporte.»
«Notre corps et notre esprit ne sont pas naturellement équipés pour comprendre le monde.»
Au rang des arguments pour promouvoir l’activité physique, Etienne Klein rappelle que «nos capacités d’endurance à la marche et à la course sont remarquables, et même exceptionnelles dans le monde animal», qu’«il ne fait guère de doute que nous autres les humains avons mis sur pied, de façon exclusive, un véritable art de la dynamique de la chair» (pour preuves, les sauts en hauteur de Dick Fosbury, créateur en 1968 à Mexico du saut en rouleau dorsal, et de l’athlète paralympique fidjien Iliesa Delana aux JO de Londres en 2012), et qu’«il est désormais établi que les activités physiques irriguent le cerveau, l’oxygènent, le nourrissent et que le cerveau renvoie l’ascenseur en offrant au corps des informations et des impressions –bien-être, exultation, désirs de vie ardente, inépuisables pistes de gestes et de chorégraphies».
L’auteur observe que «le mot « physique » a ceci de rare qu’il existe au masculin et au féminin: il y a le physique et il y a la physique. D’où deux sortes de « culture physique », aux contenus fort différents, d’ailleurs bien séparées dans le système éducatif, voire opposées l’une à l’autre». On l’aura compris. En chantre du décloisonnement des savoirs, Etienne Klein plaide pour plus d’interconnexions entre les deux. «Confinés dans l’univers des apparences, notre corps et notre esprit ne sont pas naturellement équipés pour comprendre le monde ni pour y marcher toujours droit», constate-t-il. Son essai vise à expliquer comment la physique dite «moderne» a permis le «dépassement radical de nos limitations premières», une «percée fantastique».
(1) Transports physiques, par Etienne Klein, Gallimard, 288 p.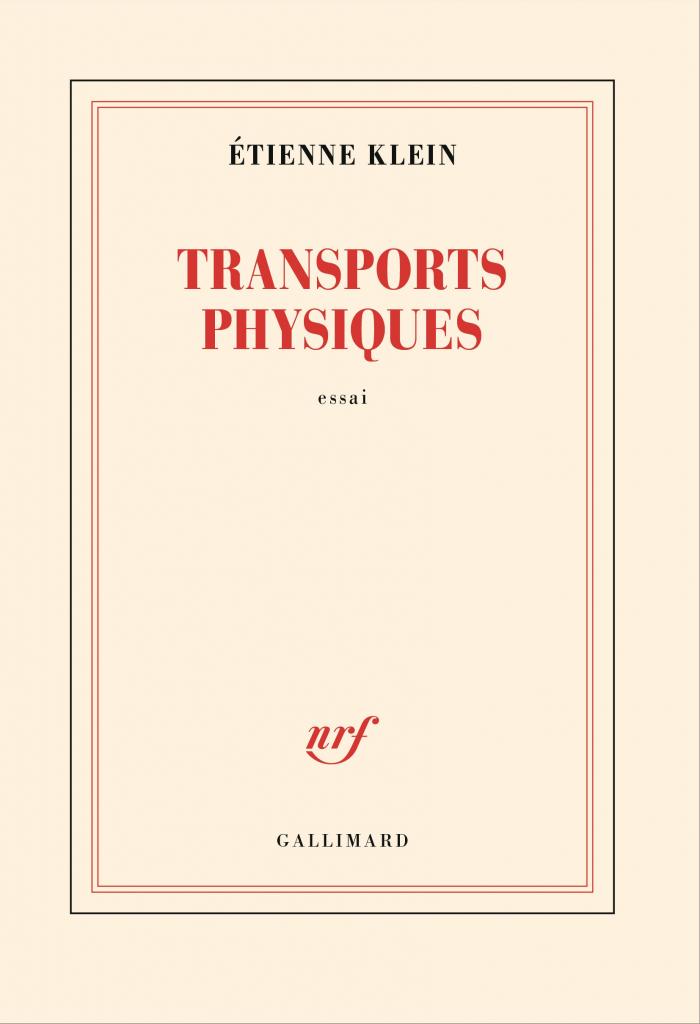
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici