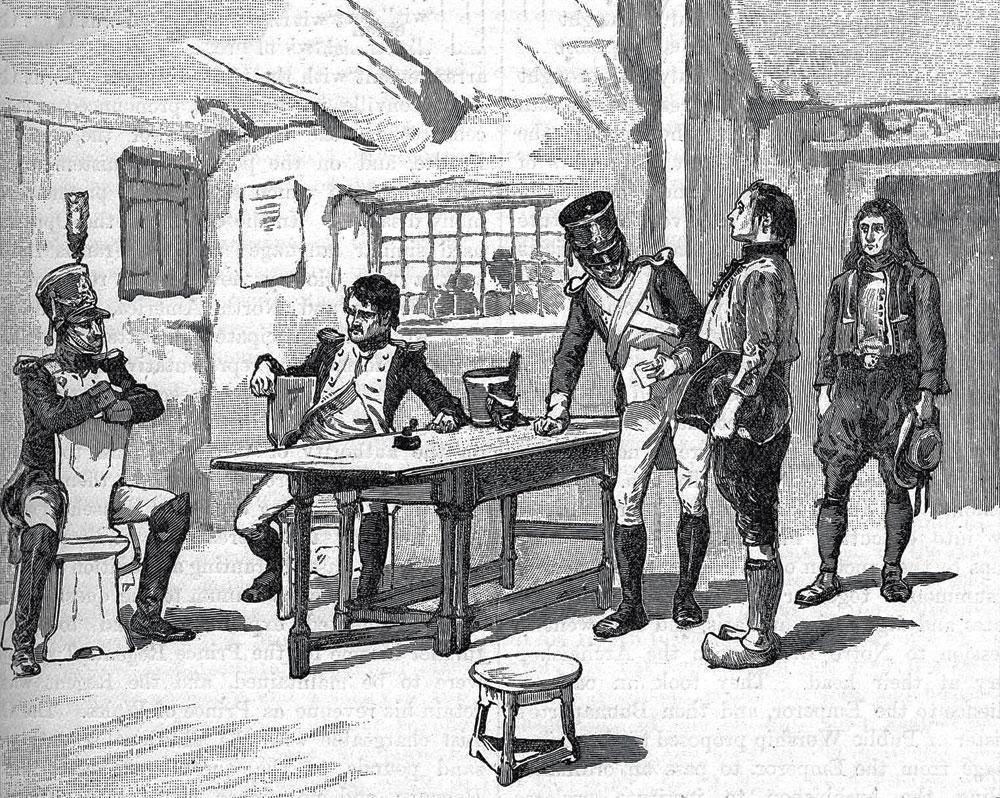« La contribution belgo-hollandaise à la chute de Napoléon a toujours été minimisée par les Anglais »
Bien que tout – ou presque – ait été dit et écrit sur la défaite définitive de napoléon, l’apport hollando-belge dans la victoire des forces alliées à Waterloo n’a, jusqu’à présent, pas été mis suffisamment en lumière. Ce fait s’explique surtout par la falsification historique dont s’est rendu coupable Wellington, le commandant en chef, et à laquelle les historiens britanniques n’ont, par la suite, pas manqué de contribuer.
Il était presque huit heures et demie, le soir du 18 juin 1815. Les champs de Waterloo étaient jonchés de cadavres, de soldats agonisants et de chevaux mutilés. Toute la journée, ils avaient été le théâtre de combats violents, mais sans véritable résultat. Napoléon lui-même se rendait bien compte qu’il devait à présent miser le tout pour le tout. Durant six longues heures, il a tenté de briser la défense de Wellington. L’empereur se décide enfin d’engager huit des bataillons encore disponibles de sa Garde pour mener l’attaque vers Mont-Saint-Jean, le coeur du champ de bataille, là où se dresse aujourd’hui la butte du Lion. Ce qui compte à ce moment-là, ce n’est pas le nombre, ni même l’expérience, mais la force morale. Après une campagne de trois jours et huit heures de combats ininterrompus et éreintants, la bataille serait remportée par la partie la plus forte moralement. A cet égard, Bonaparte a vu juste. L’infanterie alliée est abattue et au moins aussi exténuée que ses propres troupes. De plus, il y a la réputation de la Garde Impériale, un avantage profondément ancré dans l’esprit de tous les militaires, même des soldats les plus humbles. Que se passerait-il si les alliés pouvaient regarder les soldats de la Garde dans les yeux ? La question préoccupe tous les officiers britanniques et alliés, qui craignent la débandade de leurs lignes à la simple vue des fameux bonnets à poil. Les formations suivantes n’oseraient plus tirer et prendraient également la fuite. L’armée de Wellington se dissoudrait en un flux incessant de fuyards hagards cherchant leur salut dans la forêt de Soignes et qui ne pourraient plus jamais former une armée digne de ce nom. Ce spectre a hanté tous les esprits.

WELLINGTON INFORMÉ
Inquiet, le duc de Wellington parcourait ses premières lignes de gauche à droite, donnant des ordres par-ci, déplaçant des formations par-là, et voyant entre-temps ses adjudants s’effondrer l’un après l’autre à ses côtés. Toute la journée, il n’avait fait pratiquement qu’assurer la défense et que tenir Bonaparte à distance, mais à présent, la dernière heure de son armée avait sonné. Les canons alliés s’étaient quasiment tus et les régiments de ligne établis à flanc de colline n’avaient presque plus d’officiers supérieurs. Un flux incessant de blessés se dirigeait vers la forêt de Soignes. La grande ferme de Mont-Saint-Jean était déjà pleine à craquer de soldats blessés. » A présent, il faut qu’arrivent ou la nuit, ou les Prussiens « , soupire Wellington qui, sur un point crucial, possédait un sérieux avantage sur Napoléon : il connaissait exactement les intentions de son adversaire.

Une demi-heure plus tôt, à dix-neuf heures, un cavalier français s’était présenté devant sir John Colborne, commandant du 52e régiment d’infanterie. » Vive le roi « , avait-il crié sans cesse en s’approchant de la ligne de Colborne. Il s’agissait d’un officier des cuirassiers qui venait révéler que Napoléon avait l’intention de forcer avec sa Garde une percée entre Hougoumont et La Haie Sainte. Wellington avait exactement une demi-heure pour se préparer à l’ultime offensive. La première chose qu’il fait, c’est donner au général hollandais Chassé l’ordre d’avancer ses 7 000 soldats.
L’OFFENSIVE NÉERLANDAISE
Chassé, un ancien officier supérieur de l’armée napoléonienne et baron d’Empire, commandait la 3e division d’infanterie néerlandaise. Ses troupes s’étaient tenues toute la journée à Braine-l’Alleud, à l’endroit où se dresse aujourd’hui la gare de chemin de fer. Wellington les avait gardées là à l’extrémité de son flanc droit et loin du feu de l’action, officiellement pour parer à une manoeuvre française éventuelle sur le flanc ouest, même si ce scénario était peu probable. La vraie raison était toutefois qu’il ne tenait pas les troupes de Chassé en haute estime. De plus, il s’en méfiait. Dans le courant de l’après-midi, il avait déjà déplacé Chassé un peu plus derrière le centre. A cet endroit, les Hollandais et les Belges avaient déjà dû se mettre plusieurs fois en carré pour repousser des cavaliers du maréchal Ney ayant percé jusqu’à eux, mais à part cela, ils n’avaient pas encore dû entrer en action.

A présent, Wellington était bien obligé de se fier aux troupes de Chassé car les informations du transfuge français indiquaient que leur aide serait indispensable. La division hollando-belge était le dernier espoir de préserver le centre de sa défense face aux troupes les plus redoutables de l’armée française. Le duc ordonne à Chassé de prendre position à 200 mètres à l’ouest du carrefour de la chaussée de Nivelles.
HUIT HEURES ET DEMIE DU SOIR
Pendant ce temps, pas à pas, la Garde s’approche du flanc de la colline. Les soldats avancent le fusil à l’épaule, la baïonnette tirée ; les tambours marchent au centre des carrés et marquent sans cesse la cadence rythmée et effrayante du pas de charge. Régulièrement, les cris de » Vive l’Empereur » montent des rangs jusqu’à l’arrivée soudaine de la batterie légère belge commandée par le major van der Smissen, arrivé en renfort. Van der Smissen vise quasiment à la perfection et ses quelques canons percent des brèches profondes dans les bataillons.
Ensuite, c’est au tour du général néerlandais Chassé d’entrer en action. Il voit approcher la Garde, ce corps d’élite dans lequel il a servi durant tant d’années. A présent, cette expérience lui vient bien à point. » Je m’aperçus que l’artillerie placée devant nous sur la hauteur ralentissait considérablement son feu, sans cependant le cesser tout à fait ; je m’y rendis au plus vite pour m’informer et j’appris que les munitions commençaient à manquer. Voyant, en même temps, que la garde française faisait un mouvement pour attaquer cette artillerie, je n’hésitai pas un instant et je fis porter sur la crête notre artillerie, commandée par le major van der Smissen, qui entama un feu violent. » Ensuite, Chassé informe le commandant de cavalerie Trip qu’il doit lancer ses dernières ressources dans la bataille. Chassé lui-même envoie aussitôt ses 7 000 soldats d’infanterie sur le champ de bataille. Débouchant de l’arrière, ceux-ci apparaissent en criant devant les yeux étonnés des Français. Les cris de » Oranje boven ! » et » Vive le roi ! » résonnent de partout.

Au centre de la ligne de bataille, à l’endroit où se dresse aujourd’hui la butte du Lion, le prince Guillaume d’Orange, âgé de 22 ans, est le seul officier supérieur toujours en selle. Il se met à la tête des troupes et les jeunes soldats se laissent entraîner par l’enthousiasme du prince. Ils attaquent l’ennemi à la baïonnette. Il n’en faut pas plus pour troubler le carré du 3e Grenadiers de la Garde, même si le prince paye aussitôt sa bravoure de sa personne. Le chef d’état-major Jean Victor de Constant-Rebecque, qui suivait à 100 mètres, voit comment les tirailleurs français le prennent en mire. Une balle l’atteint à l’épaule. Constant Rebecque se précipite vers lui. » Un second officier l’atteignit juste avant moi. Son Altesse Royale était pâle et perdait beaucoup de sang. Il prenait appui sur le cheval de l’officier. «

A présent, les soldats de Chassé tirent massivement sur les carrés français. La batterie légère belge du capitaine Krahmer de Bichin avance jusqu’aux premières lignes et envoie une décharge de mitraille meurtrière dans les rangs français. Les fantassins hollandais et belges de Chassé avancent progressivement, au-devant de la Garde. Les lignes se sont à présent rapprochées à tel point qu’on peut entendre comment les officiers français regroupent leurs hommes et les incitent à ne pas abandonner.
LA GARDE RECULE !
Les deux derniers carrés français font une nouvelle tentative. Malgré toutes leurs pertes, ils repartent à l’attaque, et cette fois, les régiments britanniques leur opposent moins de résistance que lors du premier assaut. Une fois de plus, l’infanterie hollandobelge se précipite à leur secours. La brigade du colonel Detmers reçoit du général Chassé l’ordre d’attaquer la Garde à la baïonnette. La plupart de ces soldats étaient sous les armes depuis dix mois à peine. Detmers lance ses cinq bataillons hollandais et belges sur les Français et, entre-temps, les huit canons belges du major bruxellois van der Smissen foudroient les carrés de mitraille. La manoeuvre néerlandaise est une réussite. Pour la première fois de l’histoire de la Garde Impériale, un de ses bataillons se retire sous une attaque à l’arme blanche. Sous le regard étonné des Anglais, les fantassins belges et hollandais foncent en avant avec un enthousiasme sauvage, certains avec leur shako à la pointe de leur baïonnette, sous le battement des tambours. » Leve de koning ! Oranje boven ! « , crient-ils. L’enseigne britannique Macready et ses compagnons survivants n’en comprennent pas un mot mais s’étendent dans l’herbe et sont secoués d’un rire nerveux. Peut-être bien qu’ils vont survivre à ce cauchemar ! » Ils tambourinaient et hurlaient comme des fous « , précisera Macready à propos de ses frères d’armes alliées, dont il ne sait pas d’où ils viennent, ni comment soudain ils se trouvent là. Mais il est soulagé.

Les hommes de Chassé tombent par dizaines. Le capitaine Veeren et le lieutenant Akersloot van Houten, blessés, sont évacués du champ de bataille. Le lieutenant Van Hasselt a le genou broyé et est soutenu par un tambour pendant qu’il continue à haranguer ses troupes. Une attaque de quelque 300 cuirassés français est contrée sous le commandement du capitaine De Haan. La tâche avait été dure, mais le moment avait été propice à Chassé. Ses hommes étaient au moins aussi frais que la Garde. A Braine-l’Alleud, ils avaient été bien nourris par les habitants et abondamment abreuvés de bière et d’eau-de-vie. Entretemps, les brigades britanniques de Maitland et Adam progressent. Les bataillons français qui avaient été pris sous un feu nourri et qui avaient brièvement espéré avoir enfin défait l’ennemi reçoivent à présent un coup au moral par l’attaque de Chassé. Ils succombent sous la pression inattendue des milliers de soldats frais.

L’ultime assaut de Napoléon tourne à la catastrophe. Alors que les balles sifflent de tous côtés, Chassé crie au colonel Speelman : » Speelman, en avant, chargez vite à la baïonnette, les Français vacillent, ils cèdent ! » Le soldat Adriaan Munter du 4e bataillon de milice se trouve pour la première fois de sa vie sur un champ de bataille et voit les meilleurs soldats du monde fuir devant lui. » Les Français fuyaient dans le chaos. Ils jetaient leurs fusils, gibernes, havresacs et même leurs bonnets à poil « , relatera la jeune recrue à ses parents quelques jours plus tard. Les Alliés poussent encore leur action et les Français fuient. Ils sont poursuivis par les troupes du colonel Detmers jusqu’au-delà d’Hougoumont. Le jeune Munter ne compte plus les victimes à terre. » Je pense qu’il devait y avoir 30 ou 40000 morts et blessés autour de nous. Parfois, les vivants étaient ensevelis sous les morts. C’était effrayant. » Lorsque les troupes d’infanterie britanniques des généraux Adam et Maitland ont de nouveau rassemblé leurs forces et repassé à l’attaque, le courage de la Garde s’est éteint comme la flamme d’une bougie. Il est alors très exactement huit heures moins cinq du soir.

Moins de 20 minutes après l’ordre d’attaque, la dernière grande offensive de la Garde Impériale est déjà terminée. Au même moment, les Prussiens arrivés en début de soirée prennent à l’extrémité orientale du front les fermes de la Papelotte et de La Haie Sainte. Ce sont les deux derniers obstacles pour les Prussiens, qui envahissent à présent le champ de bataille tel un raz-de-marée. » La Garde recule ! « , crie-t-on de toutes parts. C’est un éclair qui s’abat, un cri de désespoir comme on en a rarement entendu sur un champ de bataille. La panique se répand à une vitesse fulgurante parmi les lignes françaises.
L’HISTOIRE FALSIFIÉE
L’histoire prend définitivement un tour différent, et au cours des prochaines heures, tous les membres de gouvernement et hommes d’affaires importants prennent connaissance du rapport officiel que fait Wellington de la bataille. » My Lord » : c’est par ces mots que Wellington commence son Waterloo Despatch, dans lequel le duc relate par le menu les actions de » Buonaparte « . Ensuite, il consacre au moins autant de place à ses propres prestations, en falsifiant l’histoire de telle manière que les générations suivantes ont cru que l’armée anglaise avait remporté la bataille de Waterloo seule. Wellington a omis dans son rapport de préciser que c’est le chef d’état-major néerlandais Constant-Rebecque qui, le 16 juin, avait ignoré ses ordres et envoyé des troupes qui ont sauvé l’armée de la débâcle. Pas un mot non plus sur la charge de cavalerie courageuse du général belge Van Merlen deux jours avant la bataille des Quatre-Bras. » J’ai envoyé toute l’armée aux Quatre-Bras « , écrit-il littéralement. Sur la bataille de Waterloo, il fait preuve d’une malhonnêteté encore plus grande. Ainsi, l’attaque décisive de la 3e division néerlandaise ne figure pas dans le Waterloo Despatch de Wellington, à la grande colère et déception du général Chassé et d’autres officiers hollandais et belges. La part hollando-belge dans la victoire est complètement passée sous silence. En apprenant cette omission le 4 juillet, Chassé prend aussitôt la plume et adresse au commandement britannique une lettre très directe pour protester contre l' » oubli » de Wellington et pour exiger que l’honneur de l’attaque décisif contre la Garde Impériale lui revienne. Mais les Britanniques n’avaient pas l’intention de faire l’éloge d’autrui. La communication sera quelque peu ajustée, mais sans gaieté de coeur.

L’erreur n’a jamais été redressée, au contraire. Sous l’influence des historiens britanniques comme William Siborne, c’est à peine si l’action de la division Chassé est mentionnée, et les Dutch-Belgians apparaissent dans tout le récit de la bataille de Waterloo comme une bande d’incapables qui, en outre, s’étaient comportés en lâches dans le feu de l’action. Siborne a fait croire à des millions de personnes le récit méprisant suivant : » Toutes les troupes de Wellington se sont comportées de la manière la plus courageuse et la plus exemplaire, à l’exception des cinq bataillons Dutch-Belgian, qui se sont retirés précipitamment lorsque les Français se sont approchés et ont lancé leur première grande attaque sur le centre anglo-allié et sur l’aile gauche, et qui n’ont pas pris une part active aux combats. «

Ce mépris pour les soldats belges et hollandais, les Britanniques l’éprouvent toujours 200 ans plus tard. En 1990 est paru un roman historique dans lequel le romancier à succès Bernard Cornwell assène de nouveau à ses lecteurs l’histoire de la lâcheté des Belges et des Hollandais et de la trahison du prince d’Orange – the little Dutch boy. Bien entendu, si ce genre d’invention ne peut pas directement être imputé à Wellington, le fait est que le duc n’a jamais vraiment été transparent sur les événements de Waterloo. Tout indique qu’avec son Despatch, il ait voulu avoir le dernier mot sur la bataille. Durant le reste de ses jours, il a critiqué, découragé ou intimidé quiconque voulait écrire la vérité sur la bataille.
Les conscrits
Chaque année, des conscrits étaient appelés sous les drapeaux dans les départements de l’Empire, dont les neuf belges. Cette obligation de service militaire dérivait en ligne directe des évolutions sociales. Les républicains français avaient établi le concept de » souveraineté du peuple » : ce n’était plus l’Etat qui était souverain, mais bien la Nation. Il s’agissait là d’une idée entièrement neuve dans laquelle l’Etat rejoignait le peuple. C’étaient les prémisses d’un nouveau concept : la démocratie telle que nous la connaissons aujourd’hui.
Cela supposait que le peuple jouisse certes désormais de certains avantages, mais qu’il ait aussi des devoirs. Un de ces devoirs était d’avoir à s’engager quand c’était nécessaire. Si le pays appartenait à tous les citoyens, il fallait aussi que sa protection soit du ressort du peuple et ne dépende plus de mercenaires qui se battent pour compte du roi. C’est ainsi qu’est apparu le service militaire, fondement des idées républicaines et composante intrinsèque du régime napoléonien. Le recrutement des conscrits se passait selon les dispositions de la loi du 5 septembre 1798 qui reste encore relativement actuelle deux siècles plus tard. Les jeunes hommes de 20 à 25 ans devaient obligatoirement effectuer un service militaire, une idée que l’on appelait » conscription » à l’époque. Basé à Paris, le ministère de la Guerre déterminait chaque année le nombre de soldats nécessaires, et répartissait ce nombre sur les divers départements de l’Empire, en fonction de leur population. Comme le territoire de la Belgique – et plus tard aussi de la Hollande – faisait officiellement partie de l’Empire français, ses citoyens étaient des ressortissants français et étaient donc soumis à ses lois.
Si, par exemple, un département devait fournir 1 000 soldats et qu’il y avait 1 500 candidats disponibles, on tirait au sort ceux qui devraient y aller ou non. Cela se passait le plus souvent en février. Une liste était affichée dans chaque commune et les jeunes gens dont le nom y figurait devaient se présenter à une date déterminée au chef-lieu du canton où le tirage au sort aurait lieu.
En France, les jeunes hommes tiraient un numéro dans une urne. Dans les plus petites communes belges, le bourgmestre mettait parfois les noms des candidats appelés dans de petits étuis que l’on déposait dans un tambour de bois assorti d’une manivelle. On tirait ensuite un par un les noms des jeunes hommes jusqu’à ce qu’on arrive au nombre requis. Tout cela se faisait sous l’oeil attentif d’une commission de contrôle composée du préfet ou de son inspecteur, d’un officier de l’armée et du commandant de la gendarmerie locale. Des membres de la famille et des amis assistaient souvent au tirage, anxieux de voir qui ou non serait désigné par le sort. Celui que le sort ne désignait pas devait se représenter l’année suivante. Ceci dit, ce système était moins démocratique qu’il n’y paraissait car les candidats possibles pouvaient se libérer de leur obligation militaire en payant un jeune moins fortuné pour prendre leur place. Ce système serait en vigueur jusqu’à la fin xixe siècle, tant aux Pays-Bas qu’en Belgique. Le service militaire obligatoire, quant à lui, a perduré jusqu’en 1994.
La loi française sur la conscription ne faisait pas mention de la durée du service militaire. Très vague et donc plutôt inquiétant, son article 9 offre peu de sécurité juridique : » Tout citoyen doit ses services à la patrie et au maintien de la liberté, de l’égalité et de la propriété, toutes les fois que la loi l’appelle à les défendre « . L’obligation impliquait toutes les couches de la population, mais tous les jeunes n’étaient pas incorporés. Les hommes qui étaient le seul fils d’une veuve ou le fils le plus âgé d’une fratrie de trois orphelins au moins n’étaient pas concernés. De même d’ailleurs que le fils dont le père exerçait un métier manuel et avait plus de 71 ans.
En Hollande, la conscription était particulièrement impopulaire, surtout à la campagne où les gens ne bénéficiaient que bien peu du système français d’améliorations sociales et n’étaient donc guère motivés à partir à la guerre pour » l’occupant étranger « .
La vérité était cependant plus nuancée qu’on ne voudrait quelquefois le faire croire. Tous les conscrits n’étaient pas rebelles au service militaire, loin de là. Certains rejoignaient l’armée française volontairement et même par conviction. D’autres avaient simplement envie de vivre une vie moins banale et désespérée. » Même si j’en avais été dispensé, j’aurais voulu faire mon service « , écrivait le soldat de l’infanterie hollandaise Van Dodewaard. » J’avais envie de découvrir le monde et Napoléon m’offrait cette chance. «
Beaucoup d’autres conscrits prenaient le maquis. Ils étaient poursuivis et la plupart se faisaient capturer par les gendarmes, après quoi ils passaient des années dans des prisons françaises. D’autres allaient jusqu’à l’automutilation : ils se faisaient couper l’index ou se versaient un peu d’acide sur les dents pour les rendre inaptes à ouvrir les cartouches. Mais cela ne servait généralement à rien. Les blessures fraîches étaient rapidement détectées et les conscrits récalcitrants étaient envoyés à la division du général Durutte, un vétéran impitoyable, spécialisé dans les cas difficiles. Dans ses régiments disciplinaires, la vie était encore beaucoup moins plaisante que dans les unités militaires ordinaires. Au cours de la période de 1791 à 1813, plus de 223 000 Belges ont été incorporés, et un tiers environ y laissa la vie.
Le Champ d’Honneur
La question subsiste de savoir ce qui incitait les soldats à se rendre au plus chaud des combats, assurés d’une mort certaine, alors même qu’ils voyaient périr leurs camarades. Pour y répondre, les témoins de l’époque font régulièrement référence à » l’honneur « , un concept qui, dans la société que nous connaissons, semble désuet. Au siècle dernier, nous avons appris à considérer la notion d’honneur comme une relique du Moyen Age, une idée irrationnelle, périlleuse et même immorale qui ne trouve sa place que dans une rhétorique parlant de meurtres commis au nom de l’honneur et d’attentatssuicides. Il en était tout autrement il y a deux cents ans. » Honneur » était le nom que les militaires donnaient à leur volonté de s’identifier à une question d’intérêt public, à la disposition à y offrir le sacrifice ultime. Tous les enfants savent aujourd’hui ce que signifie le fait de perdre la face et d’être moqué, bien qu’ils n’aient aucune idée de ce qu’est l’honneur. Il s’agit pourtant exactement de la même chose. La culture de l’honneur militaire revenait à se considérer comme moralement supérieur à l’ennemi. Cette supériorité, on l’exprimait en restant avec ses camarades sur un champ de bataille, en courant derrière une bannière et en restant loyal à son maître, quoi qu’il en coûte.
Tout le monde a besoin d’un sentiment de dignité, et ces soldats le trouvaient dans l' » honneur » de se battre pour la patrie. Dans les récits de la fin de la bataille de Waterloo, on ressent la honte des soldats français mais aussi la véritable émotion qu’ils éprouvent à voir des hommes courir consciemment au-devant de leur mort. » J’étais ému plus que je ne puis l’exprimer « , écrivait le colonel Trefcon en décrivant les dernières offensives de l’armée française pendant la bataille de Waterloo. » Malgré les dangers que je courais moimême, j’avais les larmes aux yeux et je leur criais mon admiration ! Les carabiniers surtout me frappèrent. Je vis leurs cuirasses dorées et leurs casques briller sous le soleil, ils passèrent à côté de moi et je ne les revis plus ! «
A Waterloo, ce sens de l’honneur était à son sommet. Les partisans de Napoléon admiraient sa ténacité. Ils avaient le sentiment que, dans la vie, il est toujours possible de connaître un renouveau, contre tout et tout le monde. Ceux qui l’exécraient considéraient qu’ils n’avaient pas d’autre choix que de le suivre parce qu’ils savaient qu’autrement, leur pays serait de nouveau occupé avec, probablement, des conséquences plus graves encore. Quoi qu’il en soit, il régnait dans les rangs des Français un sentiment élevé de l’honneur et une conviction que cette bataille était plus que jamais » une question de vie ou de mort « . De plus, la plupart partageaient l’idéal d’une société républicaine modèle car il régnait dans cette armée une grande conscience politique.
Quelle que soit l’explication qu’on lui donne, le courage et l’abnégation de ces gens semblent mériter le plus grand respect. Plus tard, Napoléon a rendu hommage à ce sentiment d’honneur des vétérans de Waterloo. Et pas seulement en paroles : il a été le seul des commandants des armées à proposer une compensation concrète. Dans son testament, établi les 15 et 24 avril 1821, il distribuait une partie de sa fortune aux blessés de Ligny et de Waterloo.
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici