
AB InBev, une histoire de bières, de familles et de risques mais surtout une histoire belge
AB InBev est aujourd’hui un géant mondial. Pourtant,tout a commencé dans nos contrées, avec de petites brasseries locales. Becoming the World’s Biggest Brewer plonge dans les archives du groupe pour dévoiler une histoire de familles, de bières et de risques.
Pour retracer l’histoire d’AB InBev, les auteurs de Becoming the World’s Biggest Brewer (1) en ont exploré les archives durant plusieurs années, et rencontré de nombreux témoins. Le livre nous ramène au milieu du xixe siècle. Au coeur de l’Europe, un nouveau pays vient de naître. La Belgique, terre de bière ? Oui… et non. Oui, car le nombre de brasseries y est impressionnant. Si chaque village a son clocher, il a aussi son brasseur. On en recense 2 894 en 1850. Soit un pour 1 500 gosiers. L’ouvrier moyen dépense jusqu’à 20 % de ses revenus en boissons alcoolisées. En fait, il n’y a pratiquement qu’en Bavière que l’on boit autant de bière. Mais quantité ne rime pas toujours avec qualité. Le breuvage de chez nous se laisse boire, mais il ne se déguste pas vraiment. Nos brasseurs sont surtout des amateurs, engagés dans une autre profession par ailleurs. Révélateur : au total, le secteur n’emploie que 6 766 travailleurs. Et leurs méthodes sont franchement artisanales. En cette aube d’ère contemporaine, on brasse encore comme au Moyen Age.
L’incroyable est imaginé : marier piedboeuf et Artois dans le plus grand secret.
Plus d’argent, c’est plus d’alcool
Vers 1880, tout s’accélère. Avec les nouveaux moyens de communication, les distances raccourcissent. Le train est sur les rails, le bateau et le camion commencent aussi à avoir leur petit succès… Venant de plus loin, les breuvages sont véhiculés plus rapidement. Et mieux conservés. Celui qui en profite, c’est le cabaretier ! Car chez nous, le succès de la bière, c’est celui des estaminets, souvent ouverts par les brasseurs eux-mêmes, quand ils ne signent pas un contrat d’exclusivité avec les tenanciers. C’est donc dans les cabarets que l’on boit. Et qu’on débat : tout qui entend compter sur la scène politique organise son meeting dans un café. Succès assuré. D’autant que le niveau de vie tend à augmenter. Plus d’argent ? C’est plus d’alcool ! A la veille de la Première Guerre mondiale, près de 3 400 brasseries sont ouvertes. Le Belge boit plus de 230 litres chaque année. Il est champion du monde.

Mais de plus en plus, la bière belge doit se méfier de ses rivaux : thé, vin, café, liqueurs ou bières venues de l’étranger. Pour rester concurrentiels, certains brasseurs réduisent la qualité de leurs produits. Un mauvais calcul, puisque la médiocrité de la boisson contribuera à une diminution de la consommation dans les années qui suivent. Vient alors la guerre. Pénurie de matières premières, confiscation de matériel… Tout le monde ne s’en remettra pas : la Belgique compte 3 214 brasseries en 1913, contre 2 109 en 1919. Et l’une d’elles commence à sortir du lot. Fondée en 1366, Artois est déjà une (très) vieille dame. Au lendemain du conflit, elle voit grand : bâtiments flambant neufs, méthodes inédites, augmentations de capital… La société louvaniste multiplie les acquisitions et crée aussi de nouvelles marques. En 1926, la Stella voit le jour. Quelques années plus tard, Artois est le premier brasseur du pays.
De l’autre côté de la frontière linguistique, ça bouge aussi. Au départ, Piedboeuf n’avait rien d’une success story. Il fallut même plusieurs tentatives avant que la brasserie puisse démarrer, en 1892. Mais dans l’entre-deux-guerres, le groupe fait des bonds de géant sous la houlette du très dynamique Albert Van Damme. » Bières Piedboeuf, bières parfaites « , commence-t-on à lire. Le groupe de Jupille n’est encore que dans le top 20 des plus grands brasseurs. Mais sa progression s’annonce continue.

Le pacte secret
La Seconde Guerre mondiale sera fatale à plus de trois cents enseignes. En outre, pour investir dans du matériel (toujours plus) automatisé, il faut disposer de moyens (toujours plus) importants et faire des économies d’échelle. Artois l’a bien compris. Alors que sa Stella devient la reine des golden sixties, la firme rachète à tout va, y compris à l’étranger. En 1957, elle investit dans un premier café aux Pays-Bas, donnant bientôt des sueurs froides à Heineken, le géant batave…
Croître encore ? En Belgique, le marché est saturé. Seule option pour Artois : une acquisition. Ou un mariage. Si diverses options sont envisagées – Maes est approchée – c’est Piedboeuf qui retient l’attention des Louvanistes. La marque de Jupille est devenue le deuxième brasseur du pays en 1965. Et sa » Jupiler 5 » (pour 5 degrés) est la rivale de la Stella. L’incroyable est alors imaginé : marier les deux sociétés… dans le plus grand secret ! » Ces deux brasseries étaient de véritables concurrentes, contextualise Arnoud de Pret, longtemps administrateur d’AB InBev, et si l’accord est resté secret, c’est parce qu’on considérait que le maintien de cette concurrence constituerait un facteur de croissance pour chacune des deux. » En janvier 1971, des actions sont discrètement échangées. Outre les actionnaires, à peine cinq ou six personnes sont dans la confidence. » Que deux sociétés si différentes s’engagent dans une union secrète et, surtout, parviennent à maintenir le secret pendant quinze ans m’a impressionnée « , signale l’économiste Eline Poelmans (KULeuven), coauteure de Becoming the World’s Biggest Brewer.
Si, dans les supermarchés, Stella et Jupiler se font la guerre, dans les coulisses, les stratégies sont télécommandées. Absurde ? C’est manifeste : l’arrangement de 1971 ne peut durer. Outre des arguments juridiques, des motifs économiques jouent aussi. » A l’époque, j’ai fait un calcul extrêmement précis sur le coût de la non-fusion, se souvient Arnoud de Pret, et il était assez facile de prouver qu’il fallait faire quelque chose « . En 1987, une affaire de fraude fiscale vient placer les débats sur un autre plan : c’est l’ensemble de la gouvernance qui doit être revue. Tandis qu’Artois se voit imposer de rendre publique la composition de son actionnariat, le pacte secret est révélé.
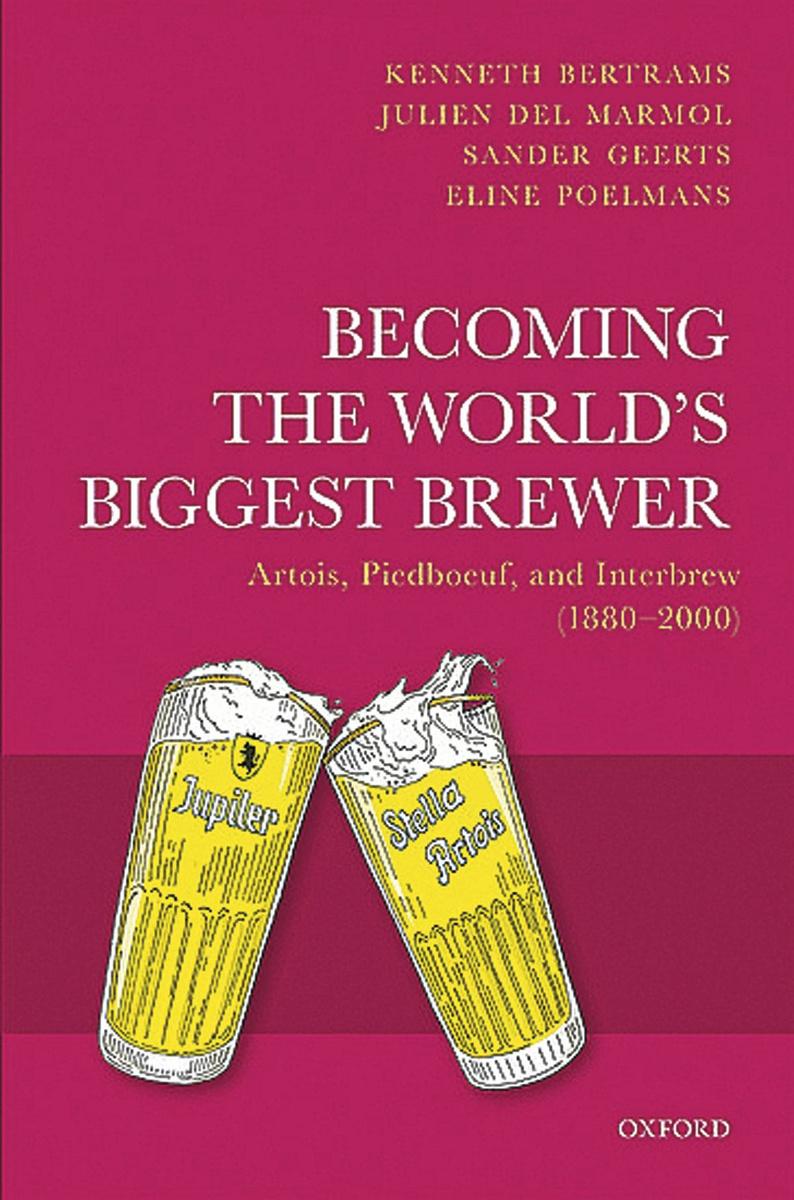
Mondial et… toujours belge ?
Interbrew voit donc le jour mais, entre les deux marques, l’hostilité est forte. » Albert Van Damme considérait qu’Artois et sa Stella étaient malades et il craignait que sa Jupiler soit victime d’un phénomène de contagion « , peut-on lire dans l’ouvrage. Le groupe connaît des années difficiles. » Entre 1987 et 1993, c’est une période d’apprentissage, observe un des coauteurs, le professeur Kenneth Bertrams (ULB), Artois et Piedboeuf avaient des cultures complètement différentes. » Des consultants externes sont sollicités, qui suggèrent à Interbrew de se concentrer sur le marché belge, afin de » fortifier la citadelle « .
Très influent, le conseil d’administration voit cependant les choses autrement. Et pousse Interbrew au-delà des frontières. En 1995, le groupe double son volume en achetant le canadien Labatt. Financièrement, le risque est considérable : c’est la plus grande acquisition jamais réalisée par une société belge ! » Jusqu’alors, Interbrew n’était pas un acteur réputé sur le marché international, souligne Kenneth Bertrams, mais à partir de 1995, il devient incontournable. » La suite sera fulgurante : le groupe belge acquiert le brésilien Ambev en 2004, Anheuser-Busch en 2008 et SABMiller en 2016. Regret pour le lecteur : l’étude ne va pas au-delà de 2000, ne faisant qu’effleurer l’évolution plus récente du groupe. Problème d’accès aux archives et délicatesse de traiter d’une actualité trop fraîche.
Pour autant, l’histoire continue. Mais au fond, le géant AB InBev est-il encore vraiment belge ? Pour le professeur Bertrams, la réponse ne fait aucun doute : » Oui ! Regardons l’actionnariat : c’est le groupe belge qui est le plus important. Au-delà, AB InBev est un catalyseur formidable pour des marques belges qu’on n’aurait jamais retrouvées en Amérique latine par exemple, si elles n’appartenaient à ce groupe. «
A la veille de la Première Guerre mondiale, notre pays comptait plus de 3 300 brasseries. Vers l’an 2000, il n’y en avait plus qu’une grosse centaine. La raison du déclin ? La professionnalisation et l’internationalisation, qui ont conduit à de vastes concentrations. Mais la tendance s’est récemment inversée : en vingt ans, le nombre de brasseries belges a doublé, et on en recense aujourd’hui plus de 300. La majorité d’entre elles sont des » microbrasseries « . Leurs méthodes sont artisanales et leur production n’est pas énorme, mais ce sont bien des professionnels qui les font tourner. Et qui ne manquent pas, souvent, de vendre leurs produits à l’étranger.
Une tendance qui s’inscrit dans le retour en force du terroir, nombreux étant ceux qui souhaitent retrouver le goût des produits locaux et savoir ce qu’il y a dans leur assiette (ou dans leur verre). Produit ancré dans la terre, la bière leur en offre une belle occasion. La mode est aussi aux circuits courts. Acheter directement chez le producteur est écolo et tendance. Reste que le modèle économique est fragile. Si elle croît, la petite brasserie indépendante risque de susciter la convoitise. Si elle ne grandit pas, elle risque de mettre sa comptabilité en danger. De nouveaux brasseurs se lancent chaque année mais c’est aussi à un rythme élevé que les petites brasseries se font racheter.

Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici
