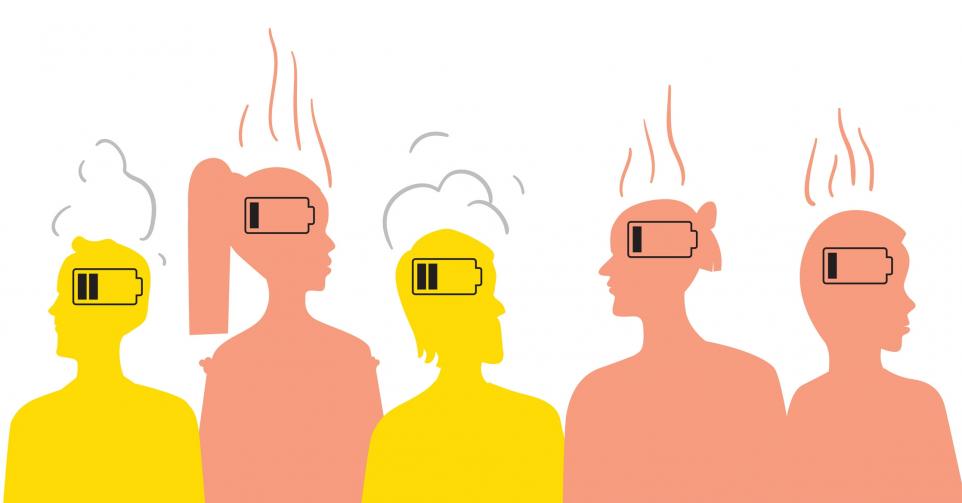
«L’écrasante majorité des personnes en arrêt de travail pour maladie se sentent coupables» (interview)

Pour Thomas Périlleux, expert en sociologie clinique du travail, les malades de longue durée sont désireux de retourner au travail. Mais pas dans n’importe quelles conditions ni avec n’importe quelle intensité. Les employeurs devront prendre le pli de ciseler des postes en fonction de leurs capacités.
La Belgique compte aujourd’hui 526.507 personnes reconnues comme incapables de travailler, pour des raisons de santé. Elles étaient 471.040 à la fin de 2020. Comment expliquer la forte augmentation des malades de longue durée? Entretien avec Thomas Périlleux, professeur de sociologie clinique du travail et des organisations à l’UCLouvain et auteur de l’ouvrage Le Travail à vif (1).
Quels sont, selon vous, les facteurs qui expliquent le grand nombre de travailleurs en maladie en Belgique?
Ils sont multiples. Du côté des organisations du travail, on assiste à des phénomènes massifs d’intensification du travail: faire plus en moins de temps est attesté par les enquêtes sociologiques. Il y a aussi une difficulté à continuer à constituer des collectifs de travail et des équipes qui permettent des solidarités proches. On est donc dans une individualisation très forte des conditions de travail, ce qui peut renforcer les difficultés dans de nombreux cas. De nombreux travailleurs sont aussi en sous-effectif: des surcharges objectives de travail pèsent donc sur eux. Cela amène parfois certains salariés à tenir au-delà des limites jusqu’au moment critique où ils craquent. Il est alors difficile pour eux de reprendre le travail, en tout cas avant une longue période de récupération. Ce dont je peux témoigner à partir de mes consultations, c’est à quel point les épisodes d’arrêt, en tous cas du point de vue des charges psychosociales, sont critiques. Quand un travailleur mobilise des ressources à l’excès pendant de longues périodes pour tenir malgré tout, l’effondrement est catastrophique au moment où ces mécanismes de résistance s’épuisent.
Avez-vous le sentiment que les employeurs sont suffisamment conscients, ou conscients tout court, du fait que le travail peut rendre malade?
Je ne crois pas. Là, je généralise beaucoup, mais il y a une tendance à considérer que c’est le travailleur qui est en cause et un peu moins le travail. Alors, nous nous référons à l’idée d’une pathologie du travail. Cette expression volontairement un peu énigmatique consiste à dire que le travail peut rendre malade, mais qu’il est peut-être lui-même malade et que c’est lui qui serait à soigner. Il y a donc un double mouvement entre les incidences personnelles sur le travailleur et le soin apporté au travail et à son organisation. Mais très souvent, du côté de l’employeur, il y a une tendance à individualiser la problématique et à considérer que quand quelqu’un n’est plus en mesure de continuer le travail du point de vue de sa résistance psychique, ce problème est strictement individuel. Les entreprises évoquent des facteurs explicatifs relevant de la sphère privée –qui sont également une réalité. Mais c’est une manière de ne pas interroger ce qui se joue dans l’organisation et de ne pas prendre au sérieux les symptômes organisationnels qui apparaissent.
Quel serait l’intérêt, pour les employeurs, de fermer les yeux sur ces symptômes, qui risquent de réapparaître?
Ouvrir les yeux, c’est forcément remettre en cause des fonctionnements collectifs. Et ça, c’est difficile. On préfère parfois rester dans une forme de déni, considérer que le système doit continuer et qu’on va colmater les brèches vaille que vaille plutôt que de remettre en question plus profondément des manières de faire des organisations collectives. Et puis, dès lors que les personnes en arrêt de travail de longue durée ne sont plus à charge, financièrement, des employeurs, ceux-ci sont moins concernés.
Certains employeurs ne sont pas toujours prompts à réintégrer leurs travailleurs après leur maladie, notamment parce qu’ils ne sont plus capables d’occuper le même poste ou plus qu’à temps partiel. Est ce à dire qu’un travailleur considéré comme moins performant ne trouve plus sa place dans le système?
Est-on moins performant quand on est en mesure de reprendre le travail, mais à temps partiel? Cette formule de reprise progressive, sous la forme du mi-temps médical, devrait pouvoir s’étendre. Mais cela demande une réflexion sur ce parcours de réintégration. Ce que l’on constate dans nos consultations, c’est que les personnes qui ont été malades sont, dans une majorité écrasante de cas, désireuses de reprendre le travail, mais pas à n’importe quelles conditions, pas n’importe quand et pas avec n’importe quelle intensité. Donc cela requiert de la part de l’entreprise une réflexion sur les modalités d’aménagement. Or, souvent, les cadres sont eux-mêmes débordés, sous pression et ne peuvent pas prendre le temps de se demander comment réaménager le poste. Partager autrement les tâches qui permettent cette reprise progressive, ça devient un problème alors que ça pourrait être une solution. C’est tout l’enjeu.
Dans le cadre de la réforme que veut lancer le nouveau gouvernement fédéral, avez-vous le sentiment qu’il importe d’abord de détecter une éventuelle fraude sociale ou qu’il faudrait plutôt s’interroger sur les raisons pour lesquelles autant de personnes décrochent à un moment du marché du travail?
Il est tout à fait certain pour nous que la deuxième approche est la bonne. D’abord, je tiens à dire que dans nos consultations, l’écrasante majorité des personnes en arrêt s’en sentent coupables. Cette culpabilité massive s’exprime à travers des propos comme «Je n’ai jamais été malade» ou «Je ne veux pas vivre aux crochets de la société.» J’observe, de ce point de vue, une vraie souffrance de l’arrêt de travail. Or il existe un risque de redoubler cette culpabilité par une stigmatisation. Tout dépendra de la manière dont on envisage les processus de réintégration. Mais si on ne questionne pas aussi le régime de travail, cela risque de faire un mélange un peu explosif de honte et de culpabilité pour les gens: la honte de ne pas avoir tenu le coup et de ne pas être à la hauteur des exigences de performance et la culpabilité de peser sur les autres. D’abord sur les autres collègues qui sont encore au travail et sur les mécanismes de solidarité sociale et les mutualités.
Cela reste intéressant de réfléchir aux perspectives de reprise du travail mais il faut veiller à ce que ces mécanismes de culpabilité soient atténués. Il y a sur ces questions une dimension idéologique très forte qui fait craindre des dérives dans la stigmatisation: on reste dans une idéologie néolibérale selon laquelle les individus doivent être responsables à la fois de leur santé et de leur employabilité. Cette approche tourne autour de l’idée d’exploiter son potentiel, même en situation de fragilité ou de relative incapacité. Cette notion de capacité peut être comprise dans deux sens différents: l’un qui renforce la responsabilisation individuelle et selon lequel chacun doit se prendre en main, saisir les bonnes opportunités et se relancer sans cesse. L’autre, plus intéressante à mes yeux, permet d’éviter la dichotomie entre ceux qui sont capables et ceux qui ne le sont pas: on peut être plus ou moins capable…
D’aucuns affirment que ne pas travailler est pire que travailler, le travail –même s’il peut rendre malade–étant supposé donner un sens à l’existence, favoriser les contacts sociaux et le sentiment de se sentir utile. Qu’en pensez-vous?
D’abord, c’est au cas par cas. Il est vrai que la reprise de travail peut constituer un levier d’une perspective de santé. Mais retrouver du sens au travail n’est possible que si les conditions le permettent, parce que c’est justement la perte de sens qui, dans de nombreux cas, a mené à l’arrêt. Ce que j’entends en consultation, c’est: «Je ne peux plus exercer mon métier», «Ce qu’on nous fait faire n’a pas de sens» ou, pire, «C’est contraire à mes propres valeurs et ça me met en porte-à-faux». Je suis donc d’accord de dire que le travail peut être un levier pour reprendre pied dans la vie collective et retrouver le goût de la création par exemple, mais à condition que les conditions de travail et son organisation le permettent. Je dis souvent aux patients que s’ils reprennent le travail, ça ne peut absolument pas être dans les mêmes conditions que celles qui vous ont amené à l’arrêt, sinon c’est l’impasse garantie. Et les dégâts pour un travailleur contraint d’arrêter une nouvelle fois sont pires encore.
A moins d’espérer un changement radical de la manière dont fonctionne le marché du travail ou le travail lui-même, que vous voyez comme solutions à court terme?
D’abord, localement, dans les solidarités proches, il faut pouvoir reconstituer des façons de se parler du travail. C’est parfois la première étape à franchir: elle ne demande pas des moyens démesurés, mais elle requiert une démarche d’écoute et d’humilité du point de vue du management, pour que les travailleurs puissent exprimer les difficultés qu’ils rencontrent et élaborer ensemble des pistes de solution. Ce premier pas en avant peut changer assez radicalement les choses, notamment dans des équipes de soignants, par exemple. On a pu constater dans nos interventions collectives que quand des professionnels parviennent à retrouver des lieux où ils peuvent parler ensemble de leurs métiers et identifier les obstacles qu’ils rencontrent pour imaginer des issues, il y a un plaisir de travailler qui revient.
Après, il y a d’autres questions institutionnelles et politiques qui se posent, entre autres sur les rythmes de travail et son intensification. Mais ce registre-là demande des modifications systémiques.
Certains employeurs assurent ne pas avoir conscience des problèmes qui se posent dans l’entreprise, que ce soit en termes de charge de travail et qui vont plutôt déboucher sur des troubles psychiques ou sur des troubles physiques, comme les troubles musculo-squelettiques. Selon vous, y a-t-il suffisamment de possibilités et d’outils pour sonner l’alarme à temps quand des problèmes surgissent, et avertir l’employeur?
Je ne voudrais pas généraliser mais les patients que je reçois en consultation me disent qu’avant de craquer, ils ont tiré un certain nombre de sonnettes d’alarme, aussi bien auprès des conseillers en prévention de la médecine du travail que de leurs représentants syndicaux, ou de leur hiérarchie. Et que cela n’a pas été suivi d’effet. Il est possible, quand on est pris dans l’engrenage d’une sorte d’activisme, qu’on ne se rende pas compte des signaux que le corps nous adresse ni de tous ces symptômes qui apparaissent. Il y a peut-être, alors, une parole qui n’est pas dite. Mais dans les autres cas, lorsqu’on en arrive à des situations extrêmes avec des épuisements professionnels gravissimes, on constate quand même que les travailleurs avaient fait des démarches pour alerter. Cela dit, je pense que pour les cadres de premier niveau et les cadres moyens, les pressions sont telles qu’ils sont eux-mêmes coincés dans le même étau et se rendent donc peu disponibles pour des interpellations qui les mettent eux-mêmes en question par rapport à leur situation personnelle et dans l’entreprise. Le pire, je pense, c’est d’ouvrir des espaces de paroles, dans de grandes institutions publiques ou marchandes, puis de n’en tirer aucune leçon. Ou de lancer des enquêtes sur le bien-être au travail, dont on ne communique pas les conclusions au personnel ou qui ne donnent pas lieu à des mises en action. C’est assez fréquent, malheureusement.
Le gouvernement prévoit qu’à l’avenir, les employeurs prennent à leur charge 30% de l’indemnité de maladie qui est actuellement payée aux travailleurs malades par les mutualités pendant les deux mois suivant leur arrêt de travail. Une bonne idée?
Oui, c’est un point essentiel pour nous, qui implique les employeurs sur le volet de la prévention. Si cette disposition est un levier pour inciter les employeurs à éviter les arrêts-maladies, ce serait vraiment très fructueux. Mais je pense qu’en matière de risques psychosociaux et de prévention, il importe de ne pas en rester à des dispositifs formels, comme des enquêtes ou des sondages ponctuels sur le bien-être du personnel. Il faut vraiment traduire ces dispositifs dans des prises en charge sur le plan du réel du travail, c’est-à-dire ce que les gens vivent et rencontrent comme obstacles dans l’exercice de leur métier. Et d’en assurer le suivi. Sinon, on perd la portée même de cet esprit de prévention.
(1) Le Travail à vif – Souffrances professionnelles: consulter pour quoi? Ed. Eres – Collection Clinique du Travail, 280 p.
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici