
Pierre Rosanvallon: «Considérer chacun est la clé de voûte pour limiter la dérive populiste» (entretien)

L’historien et sociologue poursuit son étude de la démocratie en s’interrogeant sur la place actuelle de la confiance, de l’autorité et de la légitimité dans le fonctionnement des sociétés. Eloquent.
Une connaissance même sommaire du processus politique confirme sans grandes hésitations que l’absence de la confiance entre gouvernants et citoyens, d’autorité reconnue des dirigeants, de leur légitimité respectée… peut gravement nuire à la santé de la démocratie. Plus compliqué est de déterminer par quels mécanismes s’opère cette influence. Pierre Rosanvallon livre une étude approfondie sur cette relation de cause à effet en nommant la confiance, l’autorité, et la légitimité Les Institutions invisibles (1). «Ces différents éléments, argumente-t-il, peuvent être caractérisés comme étant de l’ordre d’institutions au sens où ils sont des facteurs d’intégration, de coopération et de régulation structurant le monde social», et de l’ordre d’institutions invisibles, «car elles ne sont pas définies par des statuts ni gouvernées par des instances autorisées, et ne sont pas dotées de machines de mise en ordre». Comprendre combien ces institutions invisibles sont aujourd’hui malmenées et comment y remédier est une façon de se donner les moyens de lutter contre le populisme qui, on n’a cessé de le constater en 2024, prospère sur cette altération de la démocratie.
Comment expliquer que ces institutions invisibles ont été dévalorisées à l’âge de la modernité démocratique?
Elles l’ont été pour plusieurs raisons. La confiance est ce qui permet de réduire les risques dans l’engagement envers des personnes ou des institutions. Dans la modernité démocratique, on a pensé qu’on avait dépassé la nécessité de ces relations personnelles pour tendre vers une objectivation du monde social et que l’assurance et l’organisation rationnelle, par exemple, étaient deux façons modernes de régulariser le fonctionnement de collectifs. L’autorité se distingue du pouvoir dans le sens où elle indique une direction alors que le pouvoir est une capacité d’agir de haut en bas sur la société. Une parole d’autorité n’a pas une capacité de commandement, elle a une faculté d’influence. Dans le monde moderne, on a dit que cette dissociation entre le pouvoir et l’autorité n’a plus lieu d’être à partir du moment où c’est le peuple qui est le sujet de la souveraineté: il est à la fois l’autorité et le pouvoir. C’est un peu la même chose qui s’est passée en ce qui concerne la légitimité. On a cru que la distinction entre la légalité et la légitimité, qui renvoie à des justifications d’ordre moral, n’a plus de raison d’être, que les deux se superposent. On observe cependant que ces trois présupposés du monde moderne pour rejeter le caractère archaïque des institutions invisibles ne fonctionnent pas vraiment.
Le déclin des partis, des syndicats, des Eglises… a-t-il joué un rôle dans cette dévalorisation des institutions invisibles?
Oui, parce que, d’un certain point de vue, ces corps intermédiaires se définissent dans le rapport à leurs membres et à leurs actions comme des metteurs en forme de ces institutions invisibles. C’est très clair pour les Eglises: elles sont des pourvoyeuses de sens. A leur façon, en créant de la proximité avec leurs membres, les corps intermédiaires sont des agents actifs de production de la confiance, notamment.
Comment expliquer le déclin de la «performance démocratique» de l’élection?
Ce déclin doit s’appréhender à partir d’une compréhension profonde de ce que veut dire l’élection. Celle-ci pose deux types de problèmes. D’abord, elle élit des représentants ou des gouvernants, selon les cas. Le propre de l’élection est donc d’avoir un caractère temporaire: elle désigne une personne mais elle ne garantit pas que celle-ci se comportera conformément aux désirs de l’électeur. Il y a un écart de temporalité. La temporalité du vote est intermittente alors que la temporalité des électeurs est permanente. Et puis, il y a un autre écart, important. On voit beaucoup l’élection comme un moment de choix, entre des politiques ou entre des personnes. En réalité, la démocratie de l’élection s’inscrit dans une vision plus large que le vote, par exemple avoir une fonction de représentation, produire un processus de contrôle des pouvoirs, rendre des comptes… La performance démocratique de l’élection est affaiblie sur ces deux tableaux, les temporalités différentes, et l’écart entre le choix des personnes et les attentes à l’égard d’autres grandes fonctionnalités démocratiques. Jeremy Bentham (NDLR: penseur du parlementarisme britannique, 1748 – 1852) avait cette formule très juste: «La démocratie, ce n’est pas simplement la voix du peuple, c’est aussi l’œil du peuple.»

Quelle en est la conséquence?
La voix du peuple est intermittente, elle s’exprime par les élections, par des protestations ou des manifestations particulières… L’œil du peuple s’exerce dans toutes les fonctions permanentes, de contrôle, de reddition de comptes, de représentation… Conséquence: ce ne sont pas seulement les changements de procédures électorales ou les réformes constitutionnelles qui permettront de surmonter le désenchantement démocratique constaté dans beaucoup de pays aujourd’hui. Le problème est davantage de trouver les moyens de faire vivre ces fonctionnalités démocratiques. Prenons l’exemple de la représentation. Représenter, ce n’est pas simplement avoir un porte-parole. C’est trouver les mécanismes par lesquels la vie des gens se trouve prise en compte. C’est, me semble-t-il, le grand sujet de réflexion à développer à propos de la démocratie: comment faire vivre toutes ces fonctionnalités démocratiques hors des élections qui sont, bien sûr, indispensables.
Cela passe-t-il par la promotion de la délibération générale?
La délibération est aussi une des fonctionnalités de la démocratie. Toutes les expérimentations actuelles de conférences de citoyens, par exemple, sont intéressantes. Il faut en trouver les modalités. Autant la question de l’élection est relativement simple, même si on peut discuter ses procédures, autant quand on parle de délibération, de représentation, de reddition des comptes, de contrôle, on entre dans un univers où beaucoup d’éléments doivent encore être expérimentés, y compris l’articulation entre ces conférences –il y en a eu deux en France récemment, une sur le climat, l’autre sur la fin de vie, et le travail des parlementaires. Mais le plus important est d’avoir conscience que c’est dans cette direction qu’il faut aller.
«L’attelage entre Elon Musk et Donald Trump fait sens.»
Et par la production de nouvelles «évidences partagées»?
Oui. C’est un des grands problèmes de notre société: ses divisions qui reposent sur des appréhensions antagoniques de la réalité. Dans la démocratie rationnelle, on arbitre les intérêts divergents sur la base d’une vision objective des conflits à gérer. Or, aujourd’hui, dans la plupart des sociétés que ce soit en Europe, aux Etats-Unis, en Amérique latine ou en Asie, une partie du désarroi naît du fait qu’il y a des vérités en compétition. Pour beaucoup, proférer des contre-vérités est porteur d’identité. La campagne présidentielle américaine fut typique à cet égard. Lorsque Donald Trump a prétendu que les Haïtiens qui habitaient Springfield mangeaient des chats et des chiens, beaucoup n’ont pas forcément cru cela comme une réalité objective. Mais ils ont pensé que c’était bien le sens qu’il fallait donner à la présence des Haïtiens aux Etats-Unis, à savoir qu’ils sont, en quelque sorte, des «dévoreurs d’identité». C’est ce qui menace le plus les démocraties: la perte des conditions de formation d’un socle rationnel pour traiter ses divisions. La démocratie est un régime qui essaie de trouver des compromis entre des différences de statuts sociaux, de valeurs, de visions, d’intérêts… Cela n’est possible que si on a une objectivation de ces valeurs, de ces intérêts en compétition. Au cœur de cette question, figure le constat qu’un certain nombre de personnes ont le sentiment qu’elles ne sont plus considérées et prises en compte par une autre partie de la société. Partout, ce sentiment d’abandon fait prospérer les partis populistes et leur fait gagner dans bien des cas les élections, comme on l’a vu récemment en Argentine ou aux Etats-Unis. Paradoxalement, les gens qui ont voté en faveur de Javier Milei lors de la présidentielle en Argentine sont ceux qui, pour un grand nombre, ont été plongés dans une précarité encore plus grande. Mais au moins ont-ils le sentiment, dans leur entendement, d’avoir été entendus et considérés. C’est pour cela que la prise en compte des réalités vécues par chacun dans les sociétés est aujourd’hui la clé de voûte pour limiter la dérive populiste qui détruit l’esprit même des démocraties, et leur fonctionnement.
La situation actuelle de certains Etats européens présente-t-elle des similitudes avec celle de la république de Weimar, le régime politique en Allemagne dans les années 1930 qui a abouti à l’arrivée au pouvoir du nazisme, dont vous parlez dans votre livre?
C’est très différent. L’évolution de la république de Weimar s’explique par un usage répété de la législation d’urgence. On a glissé progressivement d’un recours «pragmatique» à cette loi à une acceptation d’un régime autoritaire. Il faut ajouter à cela une forme de compétition pour exprimer l’identité du pays et sa grandeur. Après la Constitution de 1919, les sociaux-démocrates sont la première force politique du pays. Mais, peu à peu, ils ont été supplantés par le parti nazi parce que celui-ci a proposé une identité qui a semblé plus valorisante que celle des sociaux-démocrates. Aujourd’hui, on n’en est pas là. Ce qui menace les démocraties n’est pas un grand basculement comme celui observé pendant les années 1930 en Allemagne, c’est davantage un processus de désagrégation, de décomposition de la société. Sur ce terreau-là, peuvent naître des demandes d’autorité perçues comme un dernier recours afin d’offrir une orientation à une société.
La situation de la France illustre-t-elle cette désagrégation? En matières de confiance, d’autorité, de légitimité, quel est le bilan d’Emmanuel Macron?
Le style de gouvernement du président de la République française se caractérise par le fait qu’il a une vision rationaliste du monde que les citoyens, considère-t-il, ne sont pas suffisamment capables de comprendre et de considérer. Est en cause son rapport à la société. Emmanuel Macron se veut l’instituteur et le professeur de la société, mais il ne considère pas qu’il a à l’écouter pour une raison très simple: il pense qu’il connaît mieux ses problèmes que la société elle-même. Or, la démocratie est avant tout le régime où les pouvoirs sont à l’écoute des sociétés et les comprennent. Paradoxalement pour un libéral, lui n’a pas du tout cette compréhension. Récemment, on a vu le chaos électoral qu’a provoqué la dissolution qu’il a décidée. Il a considéré que les Français avaient mal compris le sens de cette dissolution et ce qu’il fallait faire. Emmanuel Macron fait preuve d’un aveuglement presque d’ordre cognitif. Cet aveuglement est typique d’une forme de rationalisme à la française qui pense que tout peut être analysé en matière d’objectivité. Dans cette attitude, on fait fi des passions, des émotions, des attentes, et on ne considère pas que les questions de respect, de dignité, sont aussi importantes que celles qui ont trait aux rapports économiques.
«Emmanuel Macron fait preuve d’un aveuglement presque d’ordre cognitif.»
Emmanuel Macron a tout de même initié les conventions citoyennes sur le climat et sur la fin de vie…
A divers moments, il a lancé ou a accepté des idées très positives. Après la crise des gilets jaunes, il a engagé un grand débat national. C’était une idée qui aurait pu avoir énormément de conséquences intéressantes. Il a participé à de nombreuses réunions publiques avec beaucoup de courage. Il a parfois passé cinq ou six heures au milieu d’une assemblée de plusieurs centaines de personnes. Mais très vite, on s’est aperçu qu’il pensait qu’il devait expliquer aux gens leurs situations. L’écoute était secondarisée par rapport à la dimension didactique. Le grand débat national a donné lieu à des «cahiers de doléances» qui, en définitive, ont été enfermés dans des archives départementales. Le président n’a pas souhaité qu’ils soient traités en tant que tels. L’exemple est archétypique. A propos de la convention citoyenne sur le climat, il a fait une proposition extrêmement audacieuse qui consistait à dire que ses conclusions constitueraient la base du travail parlementaire. Cela allait donc très loin, peut-être même trop. Mais cela n’a absolument pas été le cas. Emmanuel Macron a ostensiblement pensé qu’il fallait faire quelque chose pour raviver la démocratie. In fine, il a agi comme si les Français étaient de grands enfants qui ont besoin de retourner à l’école dont il est l’instituteur.
L’irruption d’une personnalité comme Elon Musk dans le champ politique est-elle de nature à changer la perception de la confiance, de l’autorité, de la légitimité?
Elon Musk représente deux choses. D’abord, une vision libertarienne poussée à l’extrême. Pour lui, la diversité des opinions est absolue. Il met sur le même plan une opinion et une vision du monde. C’est problématique. En démocratie, la diversité des opinions prend complètement sens si elle sert la diversité de visions du monde. Ensuite, Elon Musk apporte un élément très positif: dans un monde désorienté, il apparaît comme celui qui dessine favorablement l’avenir. Il est la promesse de la science. Il n’est pas simplement l’homme du monde présent, il est celui des lendemains qui chantent. L’attelage avec Donald Trump fait sens.
Néanmoins, n’est-il pas dangereux de tout miser sur la science?
Oui, parce qu’in fine, les sociétés ne survivent à leurs difficultés que si elles les identifient et les traitent au lieu de penser la science comme une forme de nouvelle religion qui va magiquement tout changer. Le paradoxe est qu’Elon Musk a des accents climatosceptiques très prononcés alors qu’objectivement, nous sommes confrontés à la réalité du dérèglement climatique. Parler d’envoyer les humains sur Mars comme solution aux problèmes de l’humanité, c’est oublier qu’on a aujourd’hui à gérer ces défis climatiques. Dans ce cas-là, on peut affirmer que l’optimisme scientifique de long terme sert à justifier l’aveuglement sur les difficultés actuelles.
(1) Les Institutions invisibles, par Pierre Rosanvallon, Seuil, 336 p.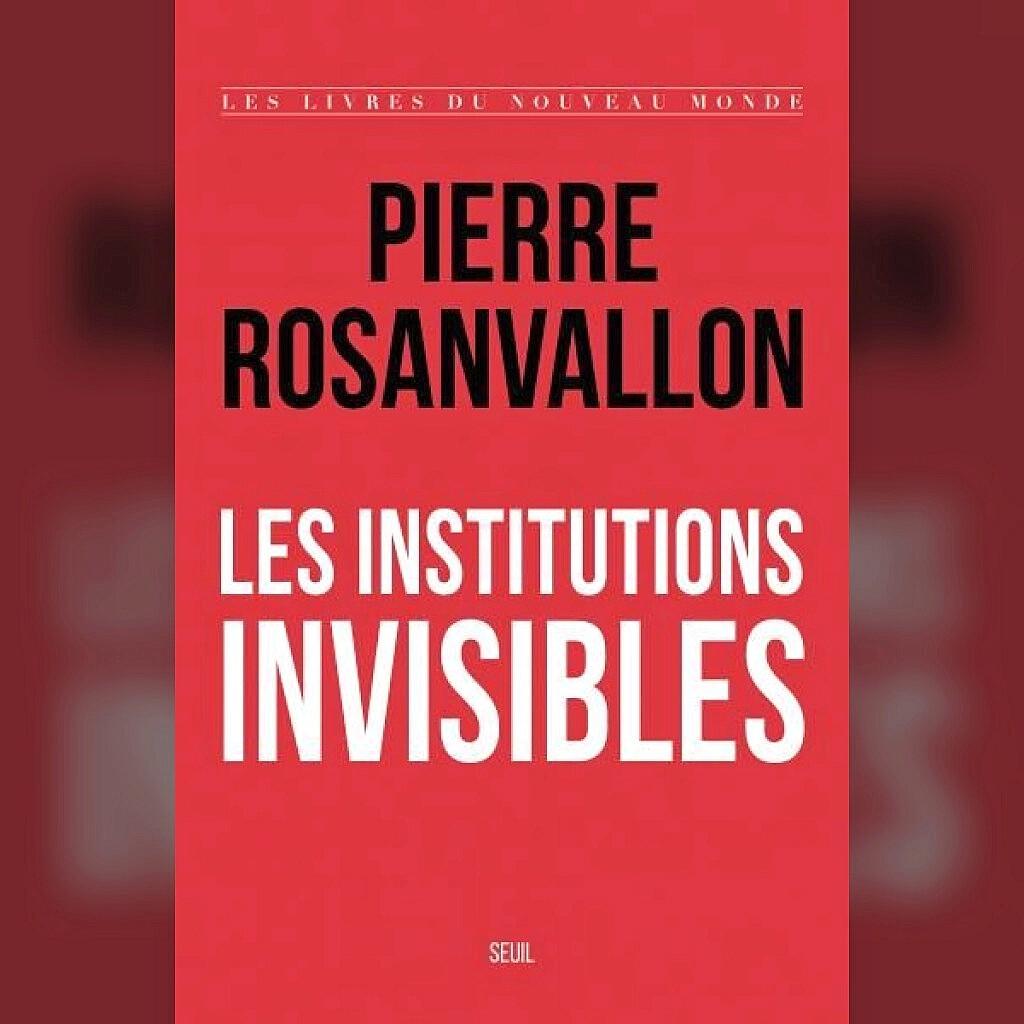
Bio express
1948
Naissance, à Blois (France).
2001
Titulaire de la chaire «Histoire moderne et contemporaine du politique» au Collège de France.
2002
Crée le cercle de réflexion La République des idées.
2006
Publie La Contre-démocratie. La politique à l’âge de la défiance (Seuil).
2015
Le Bon Gouvernement (Seuil).
2020
Le Siècle du populisme. Histoire, théorie, critique (Seuil).
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici