
Pensions, santé, école, climat…: comment les pauvres gâtent les riches

Contrairement à une idée reçue, les classes supérieures profitent davantage de nombreuses politiques publiques, sans nécessairement y contribuer davantage que les catégories moins favorisées. Fiscalité, pensions, santé, enseignement, mobilité, logement, aides diverses et variées: l’effet Matthieu, c’est quand on ne prête (presque) qu’aux riches. Y compris quand on est pauvre…
Il paraît qu’il ne faut pas toujours prendre ce que disent les hommes de science pour parole d’évangile. Cela n’empêche pas, parfois, les scientifiques de s’inspirer d’un évangéliste.
Dans les années 1960, le sociologue américain Robert King Merton appliquait un verset de l’évangile selon Matthieu au milieu de la recherche et de l’enseignement supérieur, où les universitaires reconnus s’appropriaient indûment des recherches menées par de plus jeunes confrères, et monopolisaient les positions, «car on donnera à celui qui a, et il sera dans l’abondance, mais à celui qui n’a pas on ôtera même ce qu’il a» (chapitre 12, verset 13).
Matthieu aurait pu écrire qu’on ne prête qu’aux riches.
Les mieux organisés obtiennent par priorité la satisfaction de leurs besoins.
Une décennie plus tard, en 1978, un économiste de l’UAntwerpen, par ailleurs mandataire du CVP et de l’ACW, le pendant flamand du Mouvement ouvrier chrétien, Herman Deleeck, élargissait l’analogie aux politiques sociales.
Dans L’Effet Matthieu: de la répartition inégale des biens et services collectifs, l’Anversois observait qu’on ne donnait, à peu de choses près, qu’aux riches, ou aux moins pauvres, en matière de sécurité sociale.
«Une série de mécanismes, écrivait-il, agissent de manière telle que les classes sociales supérieures ont tendance à bénéficier proportionnellement plus des avantages de la politique sociale que les classes défavorisées», ce qui implique que «l’influence sociale globale de l’Etat (impôts, allocations sociales, biens et services collectifs) sur les positions respectives des groupes sociaux par rapport à la prospérité et au bien-être est moins importante, ou en tout cas autre que ce que l’on aurait pu supposer au départ».
En d’autres termes, les riches profitent plus de l’Etat social que les pauvres qui, proportionnellement, y contribuent davantage.
Herman Deleeck évoque la sécurité sociale, les soins de santé, l’enseignement supérieur, le logement social, les politiques environnementales et les impôts.
Il écrit – et milite – à une époque où les critiques de l’Etat-providence se font de plus en plus virulentes. Ses adversaires dans les champs académiques et politiques lui opposèrent, à juste titre, qu’il servait ainsi l’agenda néolibéral que mettrait en œuvre, un peu plus tard, les gouvernements Martens-Gol des années 1980 au nom d’une insatiable injonction à davantage d’efficacité – c’est même plus chic encore de dire «efficience» – des politiques publiques en général et sociales en particulier.
Mais les constats de l’ancien sénateur CVP, comme son explication, que «notre politique sociale est le plus souvent, inconsciemment, l’expression de la manière dont les groupes sociaux dominants considèrent l’évolution sociale», ne seront guère remis en cause sachant que la distribution et la redistribution de ces biens et de ces services font toujours aujourd’hui «l’objet d’une concurrence entre groupes sociaux, et ce sont ceux qui sont les mieux organisés qui obtiennent par priorité la satisfaction de leurs besoins». C’est ainsi que le constat et l’explication de Herman Deleeck ont sans doute autant de pertinence dans la Belgique d’avant Wilfried Martens que dans celle d’après Charles Michel, et ça n’a rien à voir avec le prénom de son frère: l’effet Matthieu joue toujours à plein régime chez nous.
Les mieux situés socialement profitent généralement davantage de services publics et des prestations sociales prétendument universels et accessibles à tous, comme ils sont proportionnellement plus favorisés par des exonérations, des dégrèvements et des niches.
Pourtant, un certain politiquement correct, en Flandre surtout mais pas uniquement, postule qu’en Belgique les plus faibles sont suffisamment aidés, voire trop, et que ces aides se financent aux dépens des plus méritants, ceux qui gagnent bien leur vie, qui sont suffisamment ponctionnés, voire trop. Il y a même une certaine tendance, pas toujours discrète, à considérer les plus précaires comme des profiteurs, et les plus laborieux, tous rangés dans une gigantesque «classe moyenne» qui se ferait «matraquer», comme les «pigeons du système».

Un chiffre est souvent invoqué pour illustrer cette injustice alléguée. Selon une étude de 2019 de l’OCDE, la classe moyenne contribuait en 2015 à 76% des recettes fiscales nationales, alors qu’elle comptait pour 65% de la population.
Cette classe moyenne regroupe les individus dont le revenu se situe entre 75% et 200% du salaire médian (soit, pour 2020, entre 2 662 euros et 7 100 euros bruts mensuels). Elle contribue davantage que son poids démographique, certes.
Mais le régime fiscal ne permet pas, en Belgique, d’imposer plus équitablement les plus hauts revenus, qui s’exonèrent habilement de leur juste part. Ce qui les fait éviter de participer à certains coûts.
Depuis la réforme fiscale du premier gouvernement Verhofstadt, la plus haute tranche d’imposition est limitée à 50%. Elle sera atteinte, pour 2022, à partir de 41 360 euros annuels brut, ce qui signifie que le salaire médian y parvient déjà (les autres tranches de revenus du travail sont taxées à 25% jusqu’à 13 540 euros, à 40% jusqu’à 23 900 et à 45% jusqu’à 41 360 euros), et que les revenus supérieurs, eux, ne sont pas davantage imposés.
L’OCDE, et pas seulement, recommande de renforcer la progressivité de l’impôt en augmentant les taux des tranches supérieures. Il faut dire qu’alors que les revenus du «top 1%» n’étaient que six fois plus élevés que le salaire médian au début des années 1980, ils sont aujourd’hui environ douze fois plus importants. Mais en Belgique donc, au régime général, le salaire du millionnaire est taxé de la même manière que celui du travailleur ordinaire.
On entre vite dans la classe moyenne pour l’OCDE, tandis que, pour le fisc belge, personne n’en sort jamais suffisamment pour mériter de payer davantage d’impôts. On n’est donc pas vraiment plus «matraqué» quand on gagne beaucoup que quand on gagne peu, tandis qu’il n’y a que les revenus d’intégration sociale qui ne sont pas imposés. Les revenus de remplacement (pension, maladie, chômage) sont aussi éligibles à l’IPP que les revenus du travail.
Il est, de surcroît, très fréquent que les plus gros revenus les préservent, par des stratégies d’évitement fiscal auxquelles les classes moyennes et populaires n’ont, elles, que fort peu accès, comme l’acquisition du statut d’indépendant ou le passage en société.
C’est une portion, toujours croissante, de la richesse créée qui n’est pas disponible pour être redistribuée ou socialisée dans des services publics: revenus du travail et revenus de remplacement sont donc soumis à un impôt progressif, mais dont le taux ne varie plus à partir d’un certain seuil.
Tandis que les revenus du capital (impôt sur les sociétés, précompte mobilier, deuxième et troisième piliers de pensions, etc.), eux, ne sont généralement grevés que d’un taux fixe, qui plafonne donc la contribution des plus riches à la collectivité.
Le régime fiscal ne permet pas, en Belgique, d’imposer plus équitablement les plus haut revenus, qui s’exonèrent habilement de leur juste part.
Les impôts indirects, comme la TVA ou les accises, étant en outre les mêmes pour tout le monde, ils pèsent bien davantage sur les ressources des ménages modestes que sur celles des patrimoines les mieux dotés: le paquet de cigarettes du millionnaire rapporte à l’Etat autant d’argent que celui de l’allocataire.
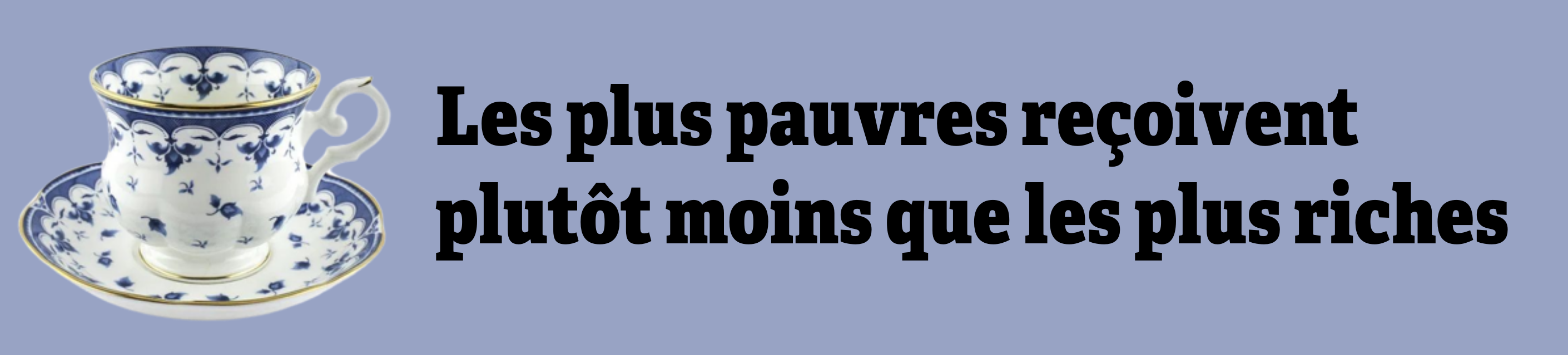
Dans l’autre sens, deux phénomènes réduisent la part des prestations publiques dévolues aux plus pauvres.
D’abord ce que les spécialistes appellent le «non-recours aux droits» voit des bénéficiaires potentiels d’aides sociales, ignorant pouvoir y émarger, ne pas les réclamer. Beaucoup ne sont pas octroyées automatiquement, au contraire du tarif social de l’énergie, par exemple, si bien qu’elles échappent à une proportion importante de personnes éligibles.
Le nombre de non-recours aux droits est difficile à estimer, mais le projet Belmod, mené à l’initiative du Service public de programmation intégration sociale, a identifié, dans un rapport publié en juin 2022, un peu plus de 13% de profils susceptibles de percevoir une allocation d’intégration ou une allocation de remplacement des revenus de personne handicapée, et près de 70% des ayants droit potentiels à la Garantie de revenu pour les personnes âgées qui ne se sont pas manifestés… C’est que l’expertise en ces matières est, contrairement à ce que voudrait faire croire une tenace idée reçue, proportionnelle aux revenus: plus on est riche, plus on connaît le droit, qu’il soit social ou fiscal, ou plus on est capable de s’entourer de gens qui le connaissent.
Ensuite, une série de biens et de services publics théoriquement accessibles à tous sans condition de revenu ne sont pas ou peu utilisés par les classes populaires, qui pourtant contribuent à leur financement par l’impôt ou par la cotisation. Ce qui les fait éviter de participer à certains bénéfices.
Ceux-ci sont plutôt l’apanage des classes moyennes et supérieures, hormis, peut-être, la frange la plus privilégiée de ces dernières, qui peut faire société à part, en payant elle-même ses prestations, son éducation, sa sécurité, ses transports, ses soins et même sa justice.
Cette loi sociologique, qui se pare d’un prestige scripturaire, c’est donc l’effet Matthieu. Il postule que c’est surtout aux riches que l’on prête. Y compris quand on est pauvre.
Matthieu meurt avant de devenir vieux
Les trois régimes de pension légale illustrent assez bien l’intuition de Herman Deleeck selon laquelle les groupes les mieux organisés «obtiennent par priorité la satisfaction de leurs besoins», puisque les retraités de la fonction publique sont, pour ce qui relève du premier pilier, mieux lotis par rapport aux salariés et aux indépendants, tandis que ces derniers sont, depuis deux décennies, en train de rattraper à un rythme soutenu les autres travailleurs.
Ce sont du reste les salariés, dont le calcul de la pension est limité par un plafond salarial fictif, mais pas les cotisations, qui comblent d’ailleurs le trou dans la caisse des indépendants pensionnés (l’Inasti). Les plus prospères de ceux-ci, en effet, sont dispensés de toute cotisation sur leurs revenus supérieurs à 89 000 euros. Cette forme d’avantage des détenteurs de capital sur le travail salarié s’amplifie encore pour les autres piliers de pension, auxquels ne sont pas éligibles les fonctionnaires – dont la retraite, comme toutes les pensions légales est imposée à l’IPP – car les pensions complémentaires, qui sont une capitalisation, ne sont imposées qu’à 10%, forfaitairement.

Mais indépendamment du statut social, c’est surtout par l’économie qu’ils autorisent à l’ensemble du système des pensions que les plus pauvres, en ce domaine, renforcent l’hypothèse d’un effet Matthieu. Ceux-ci cotisent, en effet, comme tout le monde, toute leur vie.
Même la très fictive exception d’un retraité qui, de 18 à 65 ans (66 ans en 2025, 67 ans en 2030), aurait émargé au revenu d’insertion, à l’assurance maladie ou au chômage, n’est pas celle d’une vie sans contributions puisque les impôts indirects (la TVA, principalement) abondent aussi le budget de la sécurité sociale, donc les pensions.
Les contributions des précaires alimentent la caisse collective, mais leur faible espérance de vie les empêche d’en bénéficier.
Mais leur vie étant plus courte que celle des autres, ils profitent fatalement moins de leur pension légale. Selon une toute récente étude de Solidaris sur le «non-recours mortel aux pensions», plus d’un quart des hommes les plus pauvres (les 5% des revenus les moins élevés) n’atteindront pas l’ âge de la pension, «alors qu’ils sont près de 9 sur 10 (86,9%) à l’atteindre chez les hommes les plus riches. Le différentiel, pour les femmes, est de sept points de pour cent (85,4% des femmes les plus pauvres ne meurent pas avant 67 ans, contre 92,3% des plus riches).
Les contributions des précaires alimentent donc la caisse collective, mais leur faible espérance de vie les empêche d’en bénéficier.
Et allègent d’autant la coûteuse facture de notre système de pensions légales. «Cela représente à l’âge de 67 ans un montant total de pensions non perçues s’élevant à plus de 179 millions d’euros et plus de 7 milliards d’euros lorsqu’on calcule ce montant en tenant compte de l’espérance de vie pour toute la cohorte», précise la note. La mutualité socialiste, bien sûr défavorable à la hausse de l’âge légal de la retraite à 67 ans, souhaite, en conséquence, «rouvrir le débat sur l’âge de la pension en tenant compte de la pénibilité des métiers et des inégalités sociales en matière de santé et de mortalité».
Mais elle souhaite surtout renforcer les prestations d’assurance maladie-invalidité, ce qui, en liant davantage le revenu de remplacement à la situation médicale de l’allocataire, «devrait permettre d’évaluer au cas par cas la capacité à travailler des travailleurs âgés».
Matthieu fume et est malade
Avant de mourir trop tôt, les plus pauvres encore vivants sont plus souvent malades, mais ils ne le font pas payer tout de suite.
Certes, leur plus faible espérance de vie et leur plus faible espérance de vie en bonne santé leur font consommer moins de soins remboursables dans le courant de leur existence. Herman Deleeck signalait déjà que les patients des classes moyennes et supérieures, consultant davantage, étaient davantage remboursés par l’assurance maladie-invalidité.
Mais ce sont les deux dernières années de la vie, peu importe l’âge auquel elle se termine, qui concentrent l’essentiel des dépenses de soin de santé d’un individu.
En outre, le «Health Status Report», réalisé chaque année sous l’égide de Sciensano, démontre avec un systématisme rageant que les patients dont le capital culturel et économique est le plus bas sont ceux qui souffrent le plus de maladies chroniques, ravageuses pour le malade et coûteuses pour la collectivité.
Dans les derniers chiffres, portant sur 2018, on constate un différentiel significatif entre les sujets, distingués selon le niveau d’instruction: 31,2% des patients à faible niveau d’instruction déclaraient alors une maladie chronique, contre 27,3% des patients à niveau d’instruction élevé, et les taux étaient respectivement de 19,1% et 13,3% pour les comorbidités (soit la présence d’au moins deux des maladies suivantes: maladie pulmonaire chronique, maladie cardiaque, hypertension, diabète, cancer et arthropathie).
L’effet Matthieu joue ici plutôt au départ qu’à l’arrivée, puisque, d’une part, les soins de santé sont majoritairement financés par des cotisations obligatoires, sociales et patronales, qui ne varient pas selon la hauteur du revenu, le gros salarié finançant donc proportionnellement autant l’hôpital que le petit.
Et, d’autre part, l’introduction, au milieu des années 1990, de l’indice santé, qui extrait le tabac, l’alcool et l’essence du calcul de l’indexation des salaires et des allocations, et les différents dispositifs de taxation des comportements nocifs à la santé (accises sur le tabac, l’alcool, les produits sucrés, etc.) ont contraint le revenu réel des ménages les plus pauvres, et ont, tout en ne les empêchant pas de se ruiner la santé, renfloué les caisses de l’Etat.
L’enquête de Sciensano démontre combien les «inégalités dans les déterminants de la santé» sont encore aujourd’hui prégnantes: 13,9% des personnes à niveau d’instruction élevé consomment chaque jour des boissons sucrées, contre 29,3% de celles à niveau d’instruction faible, tandis que 12% des premiers et 22% des seconds sont en situation d’obésité, et que 9,4% des premiers et 27,5% des seconds fument quotidiennement.
Somme toute, les seconds paient ainsi deux fois très cher leur mauvaise santé: une fois, au sens propre, à l’Etat avec des taxes, une autre fois, au sens figuré, à l’hôpital avec leur maladie.
Seule une mobilisation massive de moyens de prévention pourrait réduire ce coût, pour les consommateurs précaires, de ces habitudes pathogènes et, pour l’autorité publique, de ces maladies chroniques. Mais cela nécessiterait, aussi, d’en finir avec l’effet Matthieu qui mine, notamment, notre système éducatif.
Matthieu ne va pas à la crèche ni à l’université
Les compétences et le mode de financement de la Fédération Wallonie-Bruxelles incarnent, avec une matérialité presque caricaturale, la prophétie de l’évangéliste synoptique.
Les communautés en Belgique sont en effet financées par l’impôt le plus désavantageux pour les pauvres, tandis que leurs compétences sont très substantiellement exercées inégalitairement.
Le budget, gravement déficitaire (il prévoit 12,9 milliards de recettes et 14,148 milliards de dépenses), de la Fédération Wallonie-Bruxelles est abondé par l’argent de l’impôt le plus injuste, celui sur la consommation, pour payer des services absolument nécessaires, mais notoirement inégalitaires, comme l’enseignement, y compris universitaire, la culture, y compris la plus pointue, ou l’accueil de la petite enfance, y compris dorée.

Dépourvue de pouvoir fiscal, la Fédération Wallonie-Bruxelles reçoit le plus gros de sa dotation d’une rétrocession, par le fédéral, des sommes perçues sur la TVA (9 milliards, contre 3,4 milliards de dotation IPP), soit sur la consommation, y compris celle des plus pauvres. Les trois quarts de ses dépenses sont consacrées à l’enseignement, dont les inégalités de financement, d’accès et de qualité sont une spécificité belge, spécificité dont les enfants des familles modestes sont les laissés-pour-compte presque systématiques.
Avant l’école, dès après la naissance, l’accueil de la petite enfance dégage déjà des moyens au profit des mieux nés, ce qui a justifié une récente réforme des tarifs et des aides. C’est en fait à partir de la classe moyenne que la fréquentation des crèches devient relativement plus importante. En effet, alors que 42% de la population active gagne moins de 20 000 euros par an, seuls 7% des enfants issus de ces ménages sont en milieu d’accueil, et 17% de la descendance de ceux percevant un revenu compris entre 20 000 et 40 000 euros (35% de la population active), contre 13% des enfants de ceux gagnant entre 80 000 et 100 000 euros (3% de la population active), 9% des enfants de ceux qui gagnent plus de 100 000 euros (3% de la population active), 30% des enfants de ceux gagnant entre 60 000 et 80 000 euros (6% de la population active), et 24% des enfants de ceux gagnant entre 40 000 et 60 000 euros (24% de la population active).
Le paquet de cigarettes du millionnaire rapporte à l’Etat autant d’argent que celui de l’allocataire.
En proportion, la collectivité subsidie davantage les niveaux scolaires auxquels ils ont toujours moins accès. Les enquêtes Pisa montrent des résultats dramatiquement opposés selon les origines sociales, mais notre système investit moins dans le niveau maternel (4 415 euros par écolier et par an), dont une arrivée précoce et des moyens plus importants pourraient compenser un peu les inégalités familiales que dans le primaire (4 938 euros par écolier et par an), où elles sont déjà pratiquement irréversibles. Et que dans le secondaire (8 006 euros par élève et par an). Dans le supérieur, que ne fréquente pas avec succès la moitié la moins dotée des 18-24 ans, un étudiant à l’université, structure la moins favorisée par les défavorisés susceptibles d’y parvenir, coûte 7 811 euros annuels à la communauté, contre 6 822 euros pour une année de haute école.
Lire aussi | Cinq pistes pour briser les inégalités scolaires
Un remède d’essence néolibérale à ces coûts différenciés cumulerait restriction à l’accès, par des concours et des quotas, facteurs d’économies, et renchérissement substantiel des droits d’inscription, pourvoyeurs de recettes.
Une impulsion plus égalitaire prônerait, elle, plutôt une moindre sélection et un élargissement des bourses pour les étudiants issus des classes populaires, voire une allocation étudiante inconditionnelle lestée de bourses inversées, pour les plus riches, qui la percevraient moins ou pas du tout. L’état des finances de la Communauté française lui barre le second type de piste, le rapport de force politique lui interdit le premier. Mais en attendant, c’est la Cara Pils du damrémois qui paie pour le master du jeune Ucclois. Et pour la visite au musée de ses parents.

Matthieu n’est pas très entreprenant
En matière de transferts de charges d’un groupe mieux organisé vers un groupe moins organisé, un essai français vient, cet hiver, de poser un brutal constat, dont le titre témoigne des intentions non évangéliques. Parasites, du sociologue Nicolas Framont (lire la critique), expose comment, en France, des décennies de décisions de politique économique ont progressivement déchargé les propriétaires des moyens de production du financement des services publics et sociaux, aux dépens des ménages, forcés de compenser les trous ainsi creusés.
Les aides aux entreprises, qu’elles soient directes par des subsides ou indirectes par des réductions d’impôts et de cotisations, dit-il, paraphrasant Emmanuel Macron, «coûtent un pognon de dingue» sans que leurs «effets retour», et ici on paraphrase Charles Michel, ne suffisent à combler le manque à gagner induit dans les comptes publics.
Les aides aux entreprises, en Belgique, sont peu évoquées dans un débat politique pourtant, légitimement, fort préoccupé des déficits et des dettes des différents niveaux de pouvoir.
Mais selon une étude du Bureau du plan, l’ensemble des «réductions de charges sur le travail dans l’industrie marchande» (les réductions de cotisations, les subventions salariales, les primes à l’emploi, etc.) s’élevait, fédéral et entités fédérées inclus, à quelque 19 milliards d’euros en 2021 pour toute la Belgique.
L’institut Minerva, lié à la gauche flamande, agrégeant différemment ces différentes catégories, évaluait ces aides aux entreprises à un peu moins de 13 milliards d’euros.
Tant le think tank Minerva que les têtes grosses du Bureau du plan s’accordaient pour dire que ces aides, qui «définancent» la collectivité, augmenteront à l’avenir: quand le premier pronostique un montant de 16,5 milliards en 2027, le second augure une somme de 24,5 milliards pour le même exercice.
Les pauvres paient deux fois très cher leur mauvaise santé: une fois, au sens propre, à l’Etat avec des taxes, une autre fois, au sens figuré, à l’hôpital avec leur maladie.
La collectivité, alors, doit reporter sur les ménages la charge de compenser ces aides.
L’autorité peut, dans cette optique, prendre trois chemins. Ils sont tous coûteux pour les ménages les plus modestes, ceux qui ne disposent pas d’un capital financier.
Soit des économies sont imposées dans les services sociaux et publics, soit la fiscalité, sur la consommation plutôt que sur les patrimoines, et sur les salaires plutôt que sur les capitaux, est augmentée, soit la dette publique gonfle. Celle-ci verra ceux, parmi les générations suivantes, qui paient des impôts, à savoir les moins riches et leurs descendants, rembourser ceux qui disposent d’un patrimoine financier notamment sous la forme d’emprunts d’Etat, à savoir les plus riches et leurs descendants. Les trois chemins ne sont, bien sûr, pas mutuellement exclusifs. L’effet Matthieu impose même, souvent, en ce cas, de les emprunter tous les trois en même temps. Quel que soit le moyen de locomotion.
Matthieu ne se déplace pas beaucoup
Ça date au moins de la Palestine romaine, quand les uns pouvaient monter un âne tandis que les autres se salissaient les pieds à escalader le mont des Oliviers: la mobilité est très socialement déterminée. En gros, plus on est pauvre, moins on se déplace, et l’adage vaut toujours dans la Belgique d’aujourd’hui. Ce qui a changé, en revanche, c’est que les politiques publiques, qu’il faut payer, favorisent ou défavorisent certains modes de transport.
A cette aune, et pour aller d’un extrême à l’autre, le contribuable uniquement piéton, voire casanier jusqu’à l’érémitisme, financera les trottoirs de ses camarades piétons, mais aussi la piste cyclable de son concitoyen cycliste, le bus de son voisin abonné, les rails et le train de son égal navetteur, la route de son compatriote automobiliste, et la piste de son frangin aviateur, celui-ci ne payant, c’est l’unique mode de déplacement dans ce cas, aucune taxe sur le carburant de son engin, le kérosène en étant exonéré.
De la semelle de chaussure au jet privé, ces moyens de transport sont le progressif apanage des catégories les plus privilégiées: plus on est pauvre, moins on a de chances d’avoir un jet privé, et plus on est riche, moins on a de chances de ne se déplacer qu’à pied. Il y a là une bonne base pour un effet Matthieu des plus délétères.
Le cas isolé de l’automobile, qui est le mode de déplacement privilégié des Belges, le démultiplie. En effet, en 2021, 27% des ménages n’avaient pas de voiture tout en payant des impôts servant à entretenir les routes, 47,1% une, 20,3% deux et 5,6% plus de deux. Cette possession est proportionnelle au statut social, comme en témoigne le fait que 30% des familles monoparentales – donc des mamans solos – ne disposent pas de voiture, et que ce taux s’élève à près de 50% pour les personnes isolées. La fiscalité automobile, que beaucoup d’automobilistes trouvent, non sans raison, prohibitive, renforce ce paradoxe biblique qui fait que ceux qui n’ont pas de voiture paient pour ceux qui en ont, et que, parmi ceux qui en ont, ceux qui en ont une moche paient pour ceux qui en ont une belle.
Le régime fiscal des voitures de société, controversé entre deux campagnes électorales mais défendu au moment où se rapproche l’isoloir, profite à 650 000 conducteurs, et est subsidié par tous les autres, motorisés ou pas. Cet avantage de toute nature à quatre roues est de moins en moins systématique au fur et à mesure que l’on descend sur l’échelle des salaires, même si certains revenus moyens en disposent parfois. Les quelque cinq millions d’autres contribuent à combler le manque à gagner du système, qui n’est désormais plus accessible qu’aux voitures électriques, et que le Bureau du plan estime à trois milliards d’euros d’ici à 2030. C’est comme ça, en payant ses impôts, sa TVA et ses accises, qu’au volant de sa vieille caisse diesel, Matthieu sponsorise la belle électrique avec laquelle il est coincé dans son embouteillage matinal.
Matthieu a une vieille maison
Avec le transport qu’il faut verdir, le logement qu’il faut isoler est une des pierres angulaires de la lutte contre le réchauffement climatique. Sur cette pierre, Matthieu bâtit son effet. Et le dédouble, même.
Avant l’anthropocène, Herman Deleeck remarquait déjà en politique environnementale deux manières de distorsion en faveur des couches supérieures de la société: «Les dépenses relatives à l’environnement peuvent prendre la priorité sur d’autres objectifs tels que, par exemple, la lutte contre la pauvreté», et «ces dépenses peuvent en fait contribuer surtout à l’amélioration de la qualité des couches sociales supérieures».
Les nombreuses déductions, primes, incitants et autres conseils gracieux visant à encourager la rénovation énergétique du bâti procèdent précisément de cet effet du deuxième type, puisque ces initiatives publiques, généralement régionales (la Région wallonne consacre ainsi 72 millions, entre 2022 et 2024, à favoriser les travaux d’isolation des particuliers), mais pas seulement – les communes s’y mettent aussi, et le fédéral a réduit depuis juillet à 6% la TVA sur les panneaux solaires et les pompes à chaleur, financés par les contribuables qui n’en profitent pas directement.
Les 30% de ménages wallons et les 40% de ménages bruxellois locataires de leur habitation, et qui en outre paient, sur leur facture d’électricité, une taxe profitant aux propriétaires qui ont installé des panneaux solaires, sont exclus par essence de ces procédures, tout en devant assumer les charges énergétiques d’un logement qu’il leur est impossible, financièrement et juridiquement, de transformer.
Il y a également, entre les propriétaires, un fossé entre ceux à qui cette transition coûte et ceux à qui elle profite, autrement dit entre ceux qui louent d’autres biens, qu’ils n’ont aucun intérêt à rénover, et ceux qui ne possèdent que leur logement, dont, en Wallonie, près de 80% ont été construits avant 1991. Ceux-ci aussi, qui ne peuvent mobiliser suffisamment de capitaux pour rénover le leur, alors qu’ils aident, par leurs taxes, suppléments et surtaxes, à transformer l’habitat des plus riches qu’eux, sont écrasés par la pierre angulaire d’un effet Matthieu.
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici