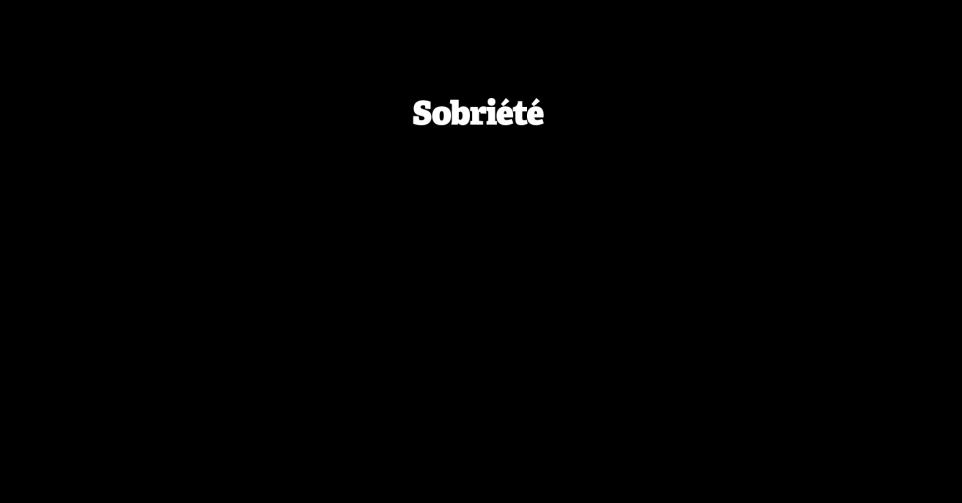
Finie, l’abondance: pourquoi nos modes de vie doivent tendre vers la sobriété (analyse)
Faut-il mettre fin au règne de l’abondance? Comment? Avec les nouvelles alertes lancées par l’ONU et le Giec, le débat politique sur la sobriété ne peut plus être évité, même s’il s’annonce difficile et controversé. Mais quelle sobriété? Et quelles mesures sont-elles déjà prises ou pourraient l’être rapidement?
Au début de l’invasion russe en Ukraine, plusieurs instances politiques, notamment européennes, ainsi que l’Agence internationale de l’énergie (AIE), ont encouragé les consommateurs à diminuer leur thermostat d’un degré pour réduire la dépendance au gaz importé de Russie. S’il s’agissait d’inciter à un effort de guerre, certes temporaire, cela s’est également révélé insolite sur le thème de la sobriété énergétique.
On n’avait plus vraiment entendu ça depuis le choc pétrolier des années 1970, lorsque la Belgique avait instauré le dimanche sans voiture, que la France lançait la chasse au gaspi et que le président Jimmy Carter priait les Américains de porter un gros pull-over et de moins chauffer leur habitation. A l’époque, le contexte était celui d’une guerre éco- nomique, plusieurs pays arabes exportateurs d’or noir ayant décrété un embargo contre les gouvernements jugés trop proisraéliens. Ici encore, les circonstances sont celles d’une guerre doublée d’une relance postcrise sanitaire. Mais l’enjeu climatique donne une résonance particulière à cet appel à la modération énergétique.
Il y a quinze ans, la décroissance était vue comme un mouvement antisystème. Mais on s’est aperçu que ce n’est pas une idéologie.
Christian Arnsperger, économiste et professeur en durabilité à l’université de Lausanne.
C’est d’autant plus vrai que l’ONU vient de lancer un cri d’alerte peu banal sur « la spirale d’autodestruction » dont l’activité humaine est responsable et qu’il est urgent d’enrayer. Le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec), publié en trois volets au début de cette année, est également plus préoccupant que jamais, puisqu’il annonce un changement climatique plus rapide que prévu, ce qui nous laisserait, en gros, trois ans pour agir. Ce sixième rapport préconise – et c’est nouveau – de limiter tout type de gaspillage, en particulier alimentaire, et de réaliser les modifications structurelles nécessaires pour réduire la demande d’énergie.

S’il ne figure pas dans le texte du Giec (constitué, rappelons-le, de scientifiques et de représentants des gouvernements), le mot « sobriété » n’a jamais été aussi prégnant dans le discours des défenseurs de la cause climatique. Même le terme « décroissance », s’il garde encore un potentiel répulsif, parvient à s’insérer dans le débat sur la sauvegarde de la planète. Pourtant, cela fait cinquante ans qu’on en parle. En 1972, le rapport Meadows du Club de Rome, prestigieux laboratoire d’idées international, prônait une croissance nulle pour éviter que l’épuisement des ressources naturelles ne mette l’humanité en péril. Ses rédacteurs avaient été qualifiés de catastrophistes et ce rapport n’a guère eu de suites.
Banal constat comptable
Un demi-siècle plus tard, la sobriété n’est plus taboue ni choquante. « Il y a quinze ans, la décroissance était encore vue comme un mouvement contestataire, radical et antisystème, dépeint Christian Arnsperger, économiste belge et professeur en durabilité à l’université de Lausanne. Mais on s’est aperçu que la décroissance ou la sobriété – peu importe le terme – n’est pas une idéologie. Sa nécessité résulte d’un banal constat comptable. On ne pourra plus vivre longtemps en continuant à consommer trois équivalents-planète comme on le fait en Belgique ou en Suisse. Lorsque votre compte en banque est à découvert depuis trop longtemps, votre banquier exige que vous limitiez vos dépenses. Idem pour la planète! »

Cela semble logique mais reste controversé. D’autant qu’un expert internationalement reconnu comme le prix Nobel William Nordhaus, spécialiste américain de l’économie de l’environnement, soutient, lui, que l’écologie est compatible avec la croissance, grâce au développement technologique et à la recherche. « Deux courants s’affrontent sur la question, clarifie Christian Arsnperger. D’un côté, celui de l’économie de l’écologie qui considère que la finitude des ressources naturelles oblige à réfléchir au changement du système économique et de consommation. De l’autre, celui, néoclassique, de l’économie de l’environnement, dont fait partie William Nordhaus, selon lequel on peut substituer des innovations technologiques aux ressources naturelles qui viennent à manquer ou qui menacent le climat. »
Si l’usage sémantique de la sobriété n’est plus tabou, son usage politique reste extrêmement timide.
Bruno Villalba, professeur en science politique à l’école AgroParis Tech.
Le fameux effet rebond
Nombre d’experts en écologie et durabilité soutiennent néanmoins que la sobriété considérée en matière d’efficience et non de décroissance comporte un risque majeur: celui de l’effet rebond. « On trie de plus en plus les déchets mais leur tonnage global ne cesse d’augmenter, on fabrique des moteurs thermiques moins énergivores mais la production de voitures reste en hausse, de même que le nombre total de kilomètres parcourus, sans compter les infrastructures qui se multiplient comme les routes, les parkings, etc., illustre Bruno Villalba, professeur en science politique à l’école AgroParis Tech qui a codirigé le livre Sobriété énergétique. Contraintes matérielles, équité sociale et perspectives institutionnelles (éd. Quae, 2018). A cause de cet effet rebond, aucun indicateur écologique ne s’est amélioré ces dix dernières années malgré les progrès technologiques, parce qu’on consomme toujours plus. »

Bref, tant qu’on ne joue pas sur la demande globale, on n’y arrivera pas. La sobriété ne vaut que si elle est massifiée et « systémique », selon Bruno Villalba. « Le consommateur est en face d’une multiplicité de choix qui fait que, même s’il est sobre dans un domaine, il compensera par de l’ébriété dans un autre, développe-t-il. On mangera moins de viande mais on voyagera plus. En réalité, il y a une contradiction absolue entre notre système économique productiviste et les enjeux écologiques. N’est-il pas temps d’interroger la finalité productive de l’entreprise? » Et de pointer l’exemple de l’industrie du luxe, un secteur économiquement très performant qui n’a aucune utilité sociale fondamentale, si ce n’est, comme l’observait déjà en son temps Jean-Jacques Rousseau, de rendre les inégalités plus visibles.
La grande accélération
Le problème, embraie Christian Arnsperger, est qu’ « on est piégé dans un système consumériste » qui a créé de nombreux nouveaux désirs qui se sont transformés en besoins. « L’imaginaire de l’abondance imprègne profondément nos sociétés depuis la révolution industrielle, voire depuis l’ère des découvertes, analyse Bruno Villalba. Les Trente Glorieuses sont l’aboutissement de ce processus. » Le spécialiste australien du climat Will Steffen nomme cette période « la grande accélération » qui, selon l’économiste belge Isabelle Cassiers, a transformé profondément, en l’espace d’une génération, les conditions de vie et la mentalité de millions d’Européens (« La Croissance, une addiction? », dans la revue Projet de février 2018).
L’abondance est même ancrée dans l’idéal démocratique. C’est d’ailleurs depuis la révolution que des cornes d’abondance ornent certaines façades parisiennes ou bruxelloises. « La sobriété est davantage une valeur ancienne prescrite par les religions, remarque Edwin Zaccaï, fondateur du Centre d’études du développement durable à l’ULB. Il est significatif que, dans son encyclique climatique, le pape François engage le monde riche à la sobriété. » A l’ère chrétienne, la modération était une obligation morale. Elle a joué un rôle essentiel dans l’organisation sociale au Moyen Age. « Aujourd’hui, pour être efficace, la sobriété permanente doit être choisie, négociée démocratiquement, faire l’objet d’une adhésion collective, poursuit le Pr Arnsperger. C’est là toute la difficulté. »

Le risque populiste
Le monde politique n’est pas vraiment prêt à mener ce débat de fond, d’autant que les périodes de crise ne semblent pas le bon momentum pour cela. « On a vu pendant la campagne présidentielle française, la place qu’ont pris les thèmes de l’écologie et du pouvoir d’achat dans les programmes et les débats, relève Bruno Villalba. Si l’usage sémantique de la sobriété n’est plus tabou, son usage politique reste extrêmement timide. » La peur de la réaction populiste constitue aussi un frein. Dans son livre Un étrange renoncement (Albin Michel, 2021), l’essayiste et directeur général du journal Libération Denis Olivennes, qui ne croit pas à la décroissance, avertissait que moins de croissance égale plus de Zemmour…
Le monde économique n’aime pas ce discours car il signifierait de produire moins. Mais on peut aussi produire autrement.
Edwin Zaccaï, fondateur du Centre d’études du développement durable à l’ULB.
Le débat démocratique devient pourtant de plus en plus inévitable. Il permettrait d’évaluer les enjeux de la sobriété et d’en circonscrire les objectifs. Dans un entretien récent au Monde, Jean-Marc Jancovici, de l’influent groupe de réflexion Shift Project, avance qu’il faudra probablement concilier sobriété et capitalisme. « Où met-on le curseur entre ce qui relève de la collectivité, qui contraint, et ce qui relève du privé, où l’on fait ce qu’on veut? », interroge-t-il. « Personnellement, je pense que la décroissance doit signifier la réduction de notre empreinte écologique à un équivalent-planète, tranche le Pr Arnsperger. Cela pourrait se faire progressivement. Une fois qu’on y parvient, il suffirait de maintenir l’équilibre« .

Indicateur d’espérance de vie
Pour Edwin Zaccaï, le discours de la sobriété est délicat car il peut effrayer. « Le monde économique n’aime pas ce discours, car il signifierait de produire moins, note-t-il. Mais il faut rappeler qu’on peut aussi produire autrement, soit produire de la richesse en quantité sans nécessairement augmenter la consommation matérielle, en développant des activités qui améliorent la qualité de vie, comme les soins, le culturel, la psychologie, l’éducation… tout ce qui concerne l’humain et qui est, par ailleurs, pourvoyeur d’emplois. »
Dans un livre au titre explicite Et si la santé guidait le monde? L’espérance de vie vaut mieux que la croissance (Les Liens qui libèrent, 2020), Eloi Laurent, chercheur au très officiel Observatoire français des conjonctures économiques, propose de remplacer le PIB par une autre boussole permettant d’orienter les politiques publiques et les choix économiques, et qui serait l’espérance de vie. Cela fait longtemps qu’on évoque un changement d’indicateur. En vain? « Cela évolue un peu, se réjouit Edwin Zaccaï. Voyez l’IDH ou Indicateur de développement humain de l’ONU, qui intègre l’espérance de vie – donc la santé – et l’éducation. C’est une évolution intéressante. »
Mais trop lente, sans doute. Inverser la logique de l’abondance relève d’un travail herculéen, tant la mentalité consumériste est confortablement installée dans nos sociétés. En outre, la justice sociale est un enjeu majeur de la sobriété. Tout le monde n’a pas la même empreinte écologique. On ne peut exiger une même modération de ceux qui sont moins aisés et émettent moins de CO2. Christian Arnsperger et ses collègues suisses, dont le célèbre philosophe de l’environnement Dominique Bourg, qui n’a rien d’un marxiste, réfléchissent à un système égalitaire où chaque citoyen aurait droit à un même quota fixe de ressources, suffisant pour assouvir les principaux besoins. « Ces quotas ne seraient pas échangeables et ils remplaceraient la monnaie », dévoile-t-il, en précisant que ses travaux ne sont pas encore entrés dans le détail de la faisabilité d’un tel système.
On le devine, tout cela rend le débat épineux. « Mais plus on le diffère, plus on sera dans une situation de contrainte écologique renforcée et plus on risque de devoir prendre des décisions davantage autoritaires », prévient Bruno Villalba, qui souligne que les citoyens acceptent sans rechigner des normes communes contraignantes comme le code de la route, au nom de la santé justement. Pourquoi n’accepteraient-ils pas des restrictions collectives, négociées démocratiquement, au nom de l’intérêt commun sur le plan écologique et de la santé?
Retrouvez via ces liens les interviews intégrales de Christian Arnsperger, Bruno Villalba et Edwin Zaccaï
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici