
Bruno Latour: « La pandémie nous fait réaliser que notre avenir sera pour toujours viral » (entretien)
Sociologue, philosophe et anthropologue français, Bruno Latour est décédé dans la nuit du 8 au 9 octobre. En mars 2021, il nous accordait ce grand entretien.
Et si le confinement n’était pas ce qu’il semblait être? Dans Où suis-je? , son dernier livre, Bruno Latour pose la question, en nous rappelant à l’urgence de mesurer enfin ce que signifie être terrestre à l’âge des pandémies et des crises climatiques.
Bruno Latour est une star. Une de ces stars discrètes, qui commencent par transformer de fond en comble leur domaine de savoir avant de rencontrer le grand public. Le philosophe bourguignon, devenu anthropologue et sociologue des sciences, que ses travaux ont propulsé penseur francophone vivant le plus cité dans le monde, a bouleversé la recherche en sciences sociales en introduisant, au début des années 1980, un point de vue nouveau. Là où l’époque était aux structures, aux facteurs déterminant du dehors la trajectoire des êtres et des choses, il a restitué aux « acteurs eux-mêmes » le sens de l’initiative, de la créativité et de la construction des collectifs auxquels ils prennent part. Plus tard, voulant défendre les sciences contre les discours de toute-puissance qu’elles ne cessent de promouvoir, il a entrepris un grand travail de description de ce que signifie construire un fait scientifique – entreprise qui a suscité la rage de Alan Sokal et Jean Bricmont (ils l’ont brocardée dans leur livre Impostures intellectuelles). Cela n’a pas empêché Latour de recevoir le Holberg Prize, l’équivalent du Prix Nobel pour les sciences humaines. Aujourd’hui, plus préoccupé que jamais par le sort de la Terre et des vivants qui s’y ébattent, le professeur retraité de Sciences Po multiplie les appels pour une prise de conscience de ce qu’est véritablement notre planète – et du rôle que nous y jouons. L’ expérience du confinement, de manière inattendue, lui a fourni la métaphore parfaite de notre condition: et si être terrestre ne consistait en rien d’autre qu’être confiné?
Etre terrestre, cela implique de se demander comment parvenir à réconcilier le monde où je vis et le monde dont je vis.
Comment se passe votre confinement?
Je le subis avec stoïcisme et râlerie en même temps. Je suis les règles. Même si, en France, elles sont insupportables: personne n’en comprend le quart. Il faut avouer qu’il est pénible de se retrouver en situation autre que celle de citoyen – en l’occurrence, en situation d’infantilisation. Si ce confinement constitue une préparation à ce qui se produira lorsque nous nous apercevrons enfin que nous sommes par définition confinés sur la Terre, il n’est pas encourageant. Car il faudra bien un jour comprendre que le confinement n’est précisément pas une situation, mais un état: notre état de terrestre. Si les décisions prises pour affronter cet autre confinement, bien plus grave, participent de la même infantilisation, la réaction, je crois, sera brutale. Pour l’instant, nous acceptons la situation parce qu’elle participe d’une forme ancienne de politique. Mais c’est d’une forme nouvelle de politique dont nous avons besoin si nous voulons affronter la question écologique. Or, il semblerait que l’expérience de la pandémie ne nous apprenne rien pour la suite. Alors que des dizaines de millions de personnes sont en train de faire attention aux dizaines de millions d’autres, le rebrassage de la solidarité qu’implique le confinement ne conduit pour l’instant à aucune réflexion plus grande.
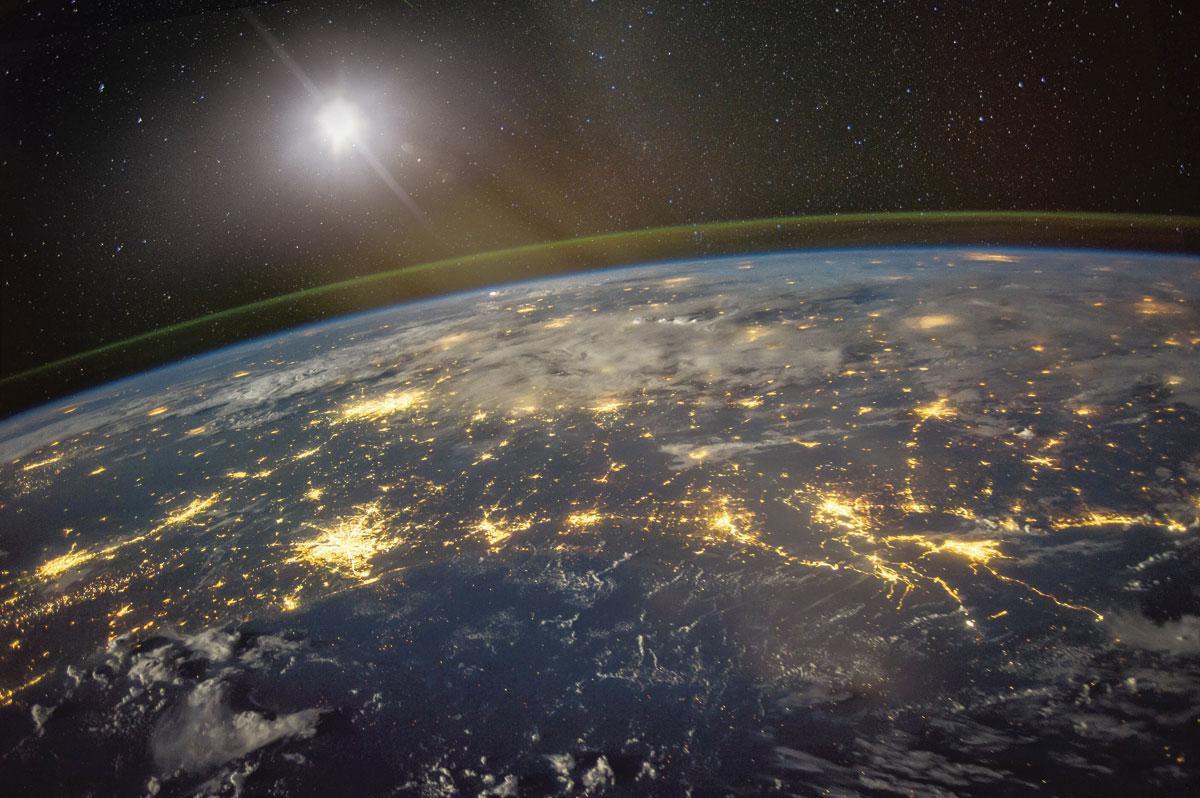
Pourquoi dites-vous que notre condition de terrestre est une condition de confiné?
J’utilise l’expérience existentielle du confinement dans le but de conférer une intensité supplémentaire à ce qu’on sait depuis longtemps: que la Terre est notre seul milieu de vie, que la planète est limitée, que la vie n’y concerne qu’une petite frange de sa surface, etc. Grâce à la pandémie, nous nous rendons mieux compte que l’agent qui en est à l’origine constitue un spécimen typique du genre d’êtres contribuant à la constitution du tissu limité à l’intérieur duquel nous trouvons des possibilités de vie. Non seulement la pandémie nous rappelle à notre condition de confinés, mais elle fait réaliser que notre avenir sera pour toujours viral: un avenir à négocier avec une multitude d’êtres imprévisibles, réagissant à nos actions à toute vitesse, interagissant entre eux pour aménager leurs propres conditions d’existence, etc. C’est le thème de Gaïa sur lequel j’insiste depuis une quinzaine d’années (NDLR: au-delà du nom mythologique, Gaïa est pour Bruno Latour un concept qui propose un cadre pour penser sans la dichotomie nature/culture. Si nous n’agissons pas plus vite pour chercher des solutions aux problèmes écologiques, ce serait à cause de cette dichotomie): le fait que la zone de Terre vivable, ce que les géochimistes appellent « zone critique », est le produit de l’activité des vivants eux-mêmes. Or, pour l’essentiel, Gaïa est faite de virus. En tout cas, elle est faite de plus de virus que d’éléphants, de briques ou quoi que ce soit d’autre. Pendant trop longtemps, nous avons cru que, parce que la nature était quelque chose d’étranger à nous, cette réalité ne nous concernait pas. Avec la pandémie, tout change.
Dans quel sens?
Nous prenons conscience de la différence qui existe entre autotrophes et hétérotrophes – ainsi que du fait que, dans un certain sens, il n’y a pas d’autotrophes. « Autotrophe », cela signifie: qui ne vit que de ce qu’on produit soi-même. S’il est vrai qu’une fleur est un peu plus autotrophe qu’un banquier de Wall Street, la seule chose qui le soit vraiment est Gaïa. Grâce à l’équivalent de 0,14% de l’énergie du soleil, elle a produit son propre monde. Mais, à l’intérieur de la couche où ce monde s’est développé, il n’y a pas d’être autonome. Le concept d' »holobiome » qui a été forgé par les biologistes permet de le comprendre. Nous savons qu’en tant qu’organisme, nous sommes recouverts de bactéries et de virus, dont la plupart ne sont pas dangereux. Pour nous aider à digérer, par exemple, il y a littéralement des kilos de micro-organismes dans nos intestins. Parler d’holobiome, ça permet de compliquer l’idée que nous serions des individus protégés à l’intérieur de notre frontière. En réalité, l’individu n’existe pas – pas plus que l’autonomie. Ce qui existe, ce sont des formes de dépendance plus ou moins croisées, donnant lieu à des régimes complexes de coexistence. C’est l’expérience même de la pandémie: si je suis bloqué chez moi, c’est pour protéger d’autres gens, dont je dépends et qui dépendent de moi.
Qu’est-ce que cette expérience change?
A nouveau, il s’agit d’une question d’intensification. Pour la première fois, nous traversons une situation globale créée par un phénomène qui n’est ni un volcan, ni une guerre, ni une catastrophe financière mais une forme vivante, invisible sans équipement spécialisé. Les modes habituels de globalisation ont été remplacés par quelques acides aminés mutants, qui ont globalisé en trois semaines – c’est-à-dire qui ont littéralement refait le globe. Il ne s’agit pas du tout d’une crise passagère, à la manière de la grippe espagnole, mais d’un moment historique, remettant en cause l’image que nous avions du globe. J’en ai souvent fait l’expérience dans des ateliers que j’organise depuis plusieurs années. Confrontés à la question « Qu’est-ce qui vous permet de subsister? », la plupart des participants se grattaient à la tête. Aujourd’hui, cette question, qui paraissait très abstraite, devient concrète. Nous voyons soudain très bien ce qui nous permet de subsister, et la manière dont les conditions de cette subsistance reposent sur des situations sociales inégales. Avec la pandémie, on a enfermé les privilégiés, et on a poussé les appauvris dehors pour continuer à faire tourner l’organisation traditionnelle des choses. Cependant, un doute s’est fait jour. On se rend lentement compte que cette organisation doit être repensée de bout en bout, à commencer par sa relation à l’économie. D’un seul coup, toutes les règles de bonne gestion qui étaient présentées comme des dogmes impossibles à transgresser ont été mises à la poubelle, de l’argent a été créé, etc. Bien sûr, le discours de la dette est en train de faire son retour – mais c’est déjà trop tard. Comme l’économie est une religion, elle ne tenait que par la certitude qu’il n’y avait pas d’autre voie possible. Or, la pandémie a démontré qu’on pouvait transformer tout le monde (ou presque) en fonctionnaire sans que la société ne s’effondre. C’est tout ce qui était nécessaire pour briser l’autel.

Dans Où suis-je? , vous dites de l’économie qu’elle est « hors-sol »…
Elle est hors-sol parce qu’elle se soucie du monde où on vit, et pas du monde dont on vit. Le modèle extractiviste de l’économie est un modèle qui ne cesse de dénier ses conditions d’existence – de faire semblant d’oublier qu’elle aussi dépend d’autre chose pour exister. Etre terrestre, à l’inverse, cela implique de se demander comment parvenir à réconcilier le monde où je vis et le monde dont je vis – comment en faire une même entité juridique, administrative, politique, etc. L’économie nous a amenés au XXe siècle, il ne faut pas le nier. Elle a apporté une forme inédite de prospérité et d’autonomie. Mais ce qu’elle a accompli de meilleur est aussi ce qu’elle a accompli de pire, dans la mesure où la promotion de l’autonomie nous a masqué notre hétéronomie fondamentale, et où la défense de la prospérité a abouti à nous appauvrir tous, ou presque, en fin de compte. D’où la nécessité, de plus en plus urgente, de se reposer la question d’un certain nombre d’inventions, comme celle des communs ou celle du droit international, qui, parce qu’elles posent la question des dépendances, peuvent contribuer à mieux affronter l’ensemble des menaces qui pèsent aujourd’hui sur Gaïa.
Nous sommes en train d’assister à l’émergence de nouvelles classes géosociales, qui remplacent les anciennes classes sociales.
C’est pourquoi vous opposez les « Ravaudeurs » aux « Extracteurs »…
Je crois que nous sommes en effet en train d’assister à l’émergence de nouvelles classes géosociales, qui remplacent les anciennes classes sociales. Norbert Elias (NDLR: 1897 – 1990, écrivain et sociologue allemand) a très bien décrit comment les questions de « manières » ont pu jouer un rôle dans l’émergence d’un processus de civilisation dans la modernité occidentale. Aujourd’hui, nous assistons à une brutalisation extrême des discussions sur les questions de manière. Il y a quelques semaines, la mairie de Lyon a annoncé que les cantines scolaires prévoiront à l’avenir un jour sans viande chaque semaine. Cela a déclenché un tollé sans précédent. Pourtant, il ne s’agit de presque rien. Mais, aujourd’hui, même les plus petits changements de manière se transforment en enjeux géopolitiques impliquant la Terre tout entière. Et de nouvelles classes se font jour, qui souhaitent prendre au sérieux ces enjeux, qui souhaitent défendre de nouvelles manières – des classes qui s’opposent à celles qui continuent à penser en termes d’individualité, d’autonomie ou d’indépendance. On les trouve chez les militants décoloniaux, les zadistes, etc. – toute une coalition de Pieds Nickelés. La question importante, pour eux, n’est plus celle de la prise de pouvoir ou de l’égalité financière, mais celle des manières qu’il faudrait adopter pour ravauder les liens distendus de nos dépendances.
Paradoxalement, l’instrument qui vous paraît essentiel dans ce but est celui de la « description ». Pourquoi?
Nous éprouvons une extraordinaire difficulté à décrire nos territoires d’une manière qui rende perceptible ce qui nous y permet de subsister. C’est encore plus vrai lorsque s’y surajoute la question du maintien de l’habitabilité de l’endroit où l’on se situe. La complexité des réseaux logistiques, le feuilleté de la mondialisation, les rapports d’échelle entre le local et le global, le combat idéologique des Extracteurs pour nous faire oublier nos dépendances: tout ça est infiniment difficile à saisir dans un seul geste. C’est surtout vrai dans un pays comme la France où, dès qu’on voit une raison de se plaindre, on lève les yeux vers le ciel, dans l’espoir que l’instance mystérieuse et inefficace, pourrie par le néolibéralisme, qu’est l’Etat, y fasse quelque chose. Face à ces deux difficultés, nous avons besoin d’instruments qui nous autorisent à dresser un portrait de là où on est permettant de tracer les tenants et les aboutissants des actions qui en ont fait ce qu’il est. Dès lors qu’on pose la question de la description, on modifie la perspective politique – et donc les relations entre sujet et objet.

Au vu de la gravité de la situation, cet impératif de redescription peut sembler un peu léger, non?
C’est vrai. La situation est grave. Chaque année, c’est le scénario le plus pessimiste proposé par les scientifiques qui devient le plus réaliste. Et, encore une fois, la réaction politique face à la pandémie n’aide pas à faire preuve d’optimisme. Pourtant, la question climatique, non seulement est d’une urgence égale, mais est d’une tout autre échelle. Je n’en suis pas pour autant collapsologue (NDLR: qui se livre à l’étude de l’effondrement de la civilisation industrielle et de ce qui pourrait lui succéder) – mais je ne le suis pas pour des raisons religieuses, des raisons d’espoir. Il n’en demeure pas moins qu’aujourd’hui, être collapsologue ou climatosceptique sont les deux possibilités les plus rationnelles. Le problème de cette raison est que son horizon est celui des individus qui soutiennent qu’il est possible d’agir comme on a pu le faire par le passé, lorsque le monde a été redressé à toute vitesse après la Seconde Guerre mondiale. C’est pour ça que je préfère me soucier de description et de classes géosociales. Prétendre en passer par les instruments légaux traditionnels, comme l’inscription de droits de la Terre dans la Constitution, équivaut à tenter de poser une pyramide sur sa pointe. Il ne peut s’agir que d’un moment ultime: celui qui aura lieu une fois que tout le reste aura été remis en place. Or, pour entamer ce travail, c’est au niveau des affects qu’il faut se placer: au niveau de la construction de nos relations affectives avec le problème de la Terre – nos relations existentielles, qui impliquent à la fois nos dépendances et une compréhension plus fine du lieu où on vit. Pour l’instant, c’est sur ce point que les choses achoppent. Nous demeurons indifférents aux annonces catastrophistes que nous lisons dans les journaux parce que nous restons incapables de répondre à la question: « Où sommes-nous? Quand? Et qui? »
Vous ne croyez pas à la possibilité que cette Terre qui a été faite puisse un jour être refaite?
Cela me fait penser à Marinetti (NDLR: Filippo Tommaso Marinetti, 1876 – 1944, écrivain italien, fondateur du mouvement futuriste) qui, dans les années 1910, voulait transformer Venise en terrain d’atterrissage. On lit ça avec effroi et amusement aujourd’hui. En réalité, de tels fantasmes ne concernent pas les milliards d’humains. Ils concernent deux cents personnes et les médias. Dernièrement, on s’est passionné pour Mars et les frasques spatiales d’Elon Musk. Mais si on regarde les détails, on se rend compte que l’horizon effectif de ces expéditions est l’éventuelle installation temporaire sur Mars, dans quarante-cinq ans, de trois personnes accompagnées d’un équipement gigantesque. Même s’il s’agit d’un projet magnifique du point de vue technique, il est insensé de celui de la politique. Pourquoi? Parce que ce n’est pas un projet de civilisation. Ce sont les Ravaudeurs qui, désormais, en sont les dépositaires. En disant ça, toutefois, je ne voudrais pas donner à croire que l’opposition entre Ravadeurs et Extracteurs serait de nature ontologique. Ce dont il faut se rendre compte, c’est que ce sont les mêmes personnes qui sont à la fois les uns et les autres, et que le combat doit d’abord avoir lieu à l’intérieur de chacun. S’il ne s’agit pas de s’opposer aux innovations techniques, il convient en revanche de remettre au premier plan la question de savoir ce que nous voulons faire des innovations en question – la question politique de savoir quel monde nous voulons, après avoir pris conscience de ce qu’il est.
Bio express
- 1947: Naissance à Beaune dans une grande famille de négociants en vin.
- 1979: Publie son premier livre, en anglais, La Vie de laboratoire.
- 1982: Devient professeur à l’Ecole des Mines.
- 1997: Est attaqué par Alan Sokal et Jean Bricmont dans Impostures intellectuelles (Odile Jacob).
- 2010: Crée l’Ecole des arts politiques à Science Po Paris.
- 2013: Reçoit le prestigieux Holberg Prize.
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici