
Les 35 romans incontournables de la rentrée littéraire
La rentrée littéraire approchant à grands pas, c’est l’occasion de dresser une liste des livres les plus attendus de cette année. La sélection comporte tant des écrits de langue français qu’étrangères, mais aussi les premiers romans, ainsi que les polars.
FRANÇAIS
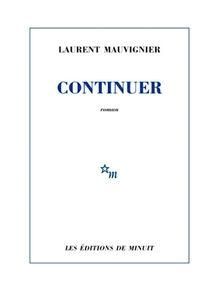
Continuer, par Laurent Mauvignier, éd. de Minuit, 238
p.
Un seul et unique titre au catalogue de rentrée des éditions de Minuit, il fallait donc que ce soit une valeur sûre : un nouveau Laurent Mauvignier, romancier et dramaturge dont on ne rate aucun livre. Voyant son fils Samuel sombrer dans la délinquance (il s’est rendu complice d’un viol collectif), Sibylle décide d’emmener l’ado pour un voyage de plusieurs mois au Kirghizistan, pays des Chevaux célestes. Fort dans les silences autant que dans les interactions, l’auteur de Dans la foule embarque littéralement son lecteur dans les montagnes et une aventure humaine de haut souffle, tranchante et puissante.
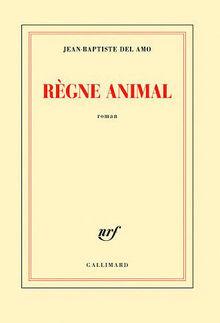
Règne animal, par Jean-Baptiste Del Amo, éd. Gallimard, 432 p.
On va beaucoup parler de Jean-Baptiste Del Amo (Le Sel, Pornographia) dans les semaines qui viennent. A raison. D’ores et déjà lauréat du Premier Prix de la rentrée littéraire, son Règne animal raconte une exploitation agricole du sud-ouest de la France à deux époques clés de son histoire. Huis clos suffocant et anxiogène qui progresse dans la fange et confine au consanguin, Règne animal est un voyage sensoriel puissant au cours duquel Del Amo scrute la bestialité des hommes, l’industrialisation et le déterminisme à l’oeuvre dans une famille chevillée à la terre. Sensation forte de la rentrée.

Cannibales, par Régis Jauffret, éd. du Seuil, 208 p.
Cannibales
Changement de registre radical pour Régis Jauffret. Après trois incursions dans le fait divers ultramédiatisé (comme l’affaire DSK), l’auteur des mémorables Microfictions signe un roman épistolaire délicieusement pervers. Les correspondantes sont deux femmes reliées par un homme, ex de la première et fils de la seconde. Si, au départ, les échanges ont le goût acide du règlement de comptes, très vite, le ton vire à la complicité féroce, scellée autour d’un projet criminel : éliminer l’intrus… Quand Les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos rencontrent Les Diaboliques de Clouzot.
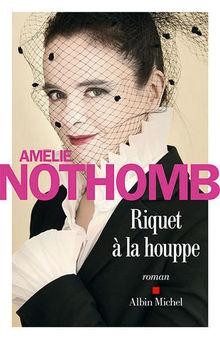
Riquet à la houppe, par Amélie Nothomb, éd. Albin Michel, 195 p.
Aussi ponctuelle que le beaujolais nouveau, Amélie Nothomb ne manque pas à l’appel de la rentrée. Et comme le vin de primeur, son roman ne laissera pas un souvenir impérissable. Vite avalé heureusement, ce détournement du conte de Perrault met en bouteille les péripéties, du berceau au coup de foudre, d’un être repoussant mais supérieurement intelligent, et d’une belle un peu tarte. Les mots savants et le vernis philosophique ne suffisent pas à masquer la vacuité des idéaux moraux que la dame aux chapeaux nous assène. Du genre le monde est cruel et les moches et les purs ont droit aussi au bonheur. Bref, comme la piquette, à consommer avec modération.
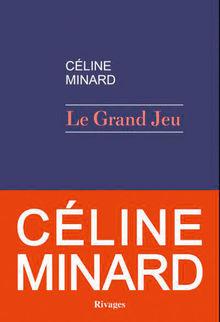
Le Grand jeu, par Célune Ménard, éd. Rivages, 192 p.
Elle ne tient pas en place, Céline Minard. Après le récit d’anticipation (Le Dernier monde) ou le western (Faillir être flingué), la défricheuse romancière secoue une nouvelle fois la littérature française en s’emparant du genre du survival avec Le Grand Jeu, journal de la villégiature radicale d’une femme partie goûter à l’autarcie en pleine montagne. Interrogeant les notions de détresse et d’endurance, hésitant entre nature writing et traité philosophique sur la solitude, un livre minéral et âpre comme les éléments quand ils se déchaînent à 3 000 mètres d’altitude.

La Sainte famille, par Florence Seyvos, éd. de l’Olivier, 180 p.
Compagne du cinéaste Arnaud Desplechin et coscénariste des films de Noémie Lvovsky, Florence Seyvos poursuit en littérature une oeuvre très personnelle. Dans le décor d’une maison familiale aux portes closes et aux détails signifiants, l’auteure du Garçon incassable explore dans La Sainte famille quelques-uns des épisodes et des personnages (grand-tante, cousine, oncle) de l’enfance de Suzanne et son frère Thomas. Un livre tout à la fois doux et dérangeant qui scrute la cruauté et l’inconfort d’une enfance larguée entre silences et stridence.
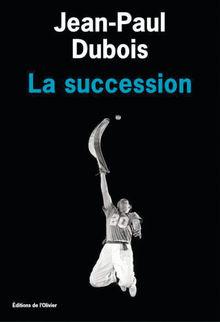
La Succession, par Jean-Paul Dubois, éd. de l’Olivier, 240 p.
Après cinq années de silence, et tandis que l’adaptation de son Cas Sneijder (2011) vient de sortir sur grand écran, le Prix Femina 2004 (pour Une vie française) vient remettre son réjouissant grain de sel dans la littérature contemporaine. Imbattable dès qu’il s’agit de faire preuve d’un humour des plus réjouissants tout en introduisant des personnages brisés ou perdus, Dubois s’offre ici la chronique d’une famille décimée par les suicides, dont le dernier représentant – joueur de pelote basque en Floride – cherche à donner un sens à l’héritage que lui a laissé son père.
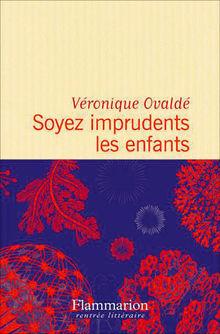
Soyez imprudents les enfants,par Véronique Ovaldé, éd. Flammarion, 400 p.
Editrice et romancière, particulièrement révélée par Ce que je sais de Vera Candida (2009), Véronique Ovaldé embarque ses lecteurs sur les traces d’une gamine espagnole qui, crevant d’ennui dans sa petite ville, éprouve un vif choc esthétique à la découverte du tableau d’un nu féminin signé Diaz Uribe, mystérieux artiste volatilisé depuis des lustres, et sur les traces duquel elle se lance – avec Paris pour première destination. Or, le mystérieux artiste n’est pas étranger à l’épique famille d’Atanasia, qui redécouvrira ainsi sa propre histoire tout en accédant à l’âge adulte.
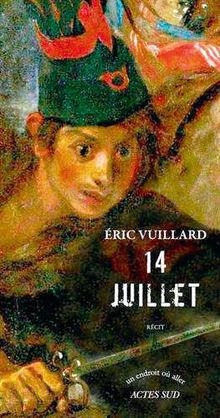
14 Juillet, par Eric Vuillard, éd. Actes Sud, 208 p.
Situé il y a deux ans dans le dernier carré du prix Femina pour Tristesse de la terre, Eric Vuillard a choisi de consacrer son dernier nouvel ouvrage, d’une élégance impeccable, aux journées entourant, en 1789, celle de la prise de la Bastille. En une vingtaine de courts et denses chapitres, il rend au peuple – foule bigarrée, sève, carburant humain de la capitale française sinon du pays tout entier – le rôle-titre de l’action en cours, tout en s’attachant avec puissance à retracer certaines trajectoires individuelles, épiques ou malheureuses.
Les Sorcières de la République, Par Chloé Delaume, éd. du Seuil, 358 p.
Depuis 2000, l’oeuvre de Chloé Delaume revendique haut et fort sa dimension expérimentale, un » work in progress » autofictionnel et féministe mâtiné de pop-culture. Autant de caractéristiques qui se déploient ici, dans une narration aux contours mieux balisés qu’ailleurs : en 2062, une mystérieuse Sibylle, conseillère des déesses putschistes de l’Olympe, est jugée » en direct live « . Elle fonda peu avant 2017 un Parti du Cercle bientôt appelé à remporter la présidentielle d’un Etat déliquescent, mal préparé à offrir le pouvoir aux femmes. Etrange, dérangeant mais, surtout, brillant.
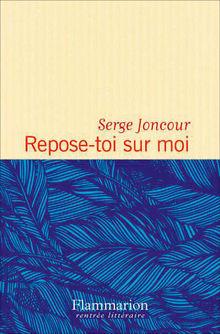
Repose-toi sur moi, par Serge Joncour, éd. Flammarion, 432 p.
Avec un titre qui promet presque une romance un peu mièvre, le dernier roman du productif auteur des » adaptés au cinéma » UV (2003)et L’Idole (2004) semble effectivement jouer avec les codes de la bergère et du chevalier, mais avec inversion des rôles. Deux voisins – une styliste le vent en poupe et un galérien des familles – seront irrémédiablement poussés l’un vers l’autre, dans un monde pourtant soumis à l’anxiété, aux dérèglements voire à l’impossibilité de faire confiance à quiconque. Simple, mais efficace.
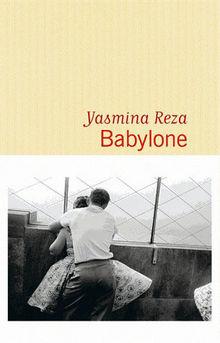
Babylone, par Yasmina Reza, éd. Flammarion, 219 p.
» Nous ne sommes pas prévenus de l’irrémédiable. » A 62 ans, Elisabeth ne l’avait jamais réalisé. Le jour où il se présente, il lui faudra donc faire face. Une fois encore, la dramaturge et romancière Yasmina Reza excelle en touchant du bout du doigt des images gênantes, des non-dits, lanon-consistance des personnes, ce jeu d’automates absurde et mortifère. Fouillant les conflits intérieurs jusqu’à la folie dans un polar qui flirte avec la psychanalyse, l’auteure d’Heureux les heureux sonde les jaillissements de la part obscure de notre moi.
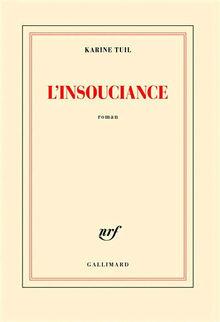
L’Insouciance, par Karine Tuil, éd. Gallimard, 526 p.
Un roman ambitieux – par l’épaisseur et par le souffle – qui plonge dans les eaux troubles de la guerre, de la finance, du journalisme et de la politique pour dresser l’inventaire sans concession des maux de notre époque. Habituée à ancrer ses histoires dans le réel (comme dans L’Invention de nos vies), Karine Tuil plonge ses quatre protagonistes dans le bain glacé de l’histoire récente (les émeutes de 2005 notamment) pour montrer comment la violence et les crispations identitaires ont colonisé tous les compartiments de la société, signant du même coup la fin de l’insouciance.
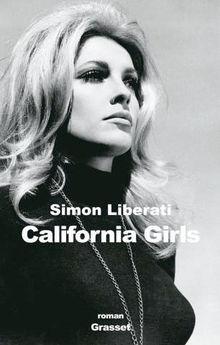
California Girls, par Simon Liberati, éd. Grasset, 336 p.
Par coïncidence également au menu du premier livre de l’Américaine Emma Cline, l’assassinat de Sharon Tate, femme de Roman Polanski, à Los Angeles en août 1969, inspire le Français Simon Liberati. Partant du fait divers, et se déroulant sur quelques heures seulement, le livre est aussi le roman d’une époque entre utopie hippie et hallucination hollywoodienne. Après le splendide Eva publié l’an dernier, Liberati met sa plume baroque et son talent obsessionnel au service de ces California Girls, nouvelles incarnations de cette féminité diabolique, trash et brûlée qu’il aime tant.

Crépuscule du tourment, par Léonora Miano, éd. Grasset, 280 p
Afrique Centrale, de nos jours. Dans une succession de monologues, quatre voix de femmes chantent le même homme (il est, pour l’une, le fils, pour l’autre le grand amour, le compagnon, ou le frère). Ecrivaine d’origine camerounaise, Léonora Miano met son écriture magnifique et une sensualité triomphante au service de questions universelles. Rythmé tel un chant ancestral, un roman sublime qui interroge le féminin et les fragilités du monde.
ÉTRANGERS
Judas, par Amos Oz, traduit de l’hébreu par Sylvie Cohen, éd. Gallimard, 352 p.
Il est, avec Salman Rushdie, l’autre grande tête d’affiche étrangère de la rentrée. A 77 ans, l’Israélien Amos Oz revient avec Judas, livre acclamé dans le monde entier. Désespéré de ne pas trouver l’argent nécessaire pour financer ses études, le jeune Shmuel Asch devient garçon de compagnie d’un septuagénaire, Gershom Wald dans la Jérusalem divisée de la fin des années 1950. Histoire d’amour malheureux, grand roman de désir et de trahison, réflexion sur les lignes de fracture entre judaïsme et christianisme, un ouvrage clé sur l’histoire d’Israël.
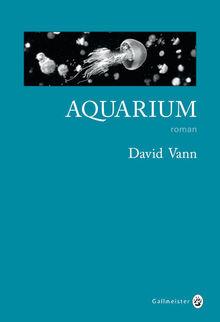
Aquarium, par David Vann, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Laura Derajinski, éd. Gallmeister, 280 p.
Une fois de plus, David Vann gratte jusqu’au sang la démangeaison des traumatismes de l’enfance, thème déjà présent dans le suffoquant Sukkwan Island. Caitlin, 12 ans, vit avec sa mère dans la banlieue de Seattle. Pour échapper à la solitude et à un quotidien terne, elle passe son temps à l’aquarium de la ville, fascinée par ces poissons aux formes et aux moeurs étranges. C’est là qu’elle rencontre un vieil homme affectueux. Pas vraiment un inconnu pour sa mère. Le passé douloureux resurgit d’un coup, libérant chez elle des torrents de haine et de violence. Un voyage à fleur de sentiment dans les eaux troubles du pardon.

Une Comédie des erreurs, par Nell Zink, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Charles Recoursé, éd. du Seuil, 304 p.
C’est ce qu’on appelle une jolie prise. Acclamée par Jonathan Franzen, comparée à Donna Tartt, Philip Roth ou John Irving aux Etats-Unis, Nell Zink était inexplicablement non traduite jusqu’ici. Injustice réparée avec Une comédie des erreurs, roman rocambolesque au démarrage fulgurant. Dans une petite université de la Virginie, une jeune lesbienne idéaliste tombe amoureuse de son professeur de poésie gay. Leur improbable mariage sera à l’origine d’une lignée dysfonctionnelle – l’occasion, pour la romancière, de tirer tous azimuts sur le mythe américain des sixties.

I Love Dick, Par Chris Kraus, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Alice Zeniter, éd. Flammarion, 288 p.
Paru en 1997 aux Etats-Unis, le I Love Dick de la New-Yorkaise Chris Kraus y a acquis le statut de livre culte. Son titre drôlement ambigu permet d’en douter : il y est pourtant moins question de sexe ( » dick « ) que d’une correspondance-performance triangulaire entamée entre une vidéaste (Chris Kraus herself), son mari éditeur, et… Dick, critique culturel anglais dont Chris s’est follement éprise au cours d’un dîner. Intello, inédit, postmoderne, I Love Dick brouille génialement les pistes de la fiction, de l’essai et de l’autobiographie autour de l’infatigable thème du discours amoureux.
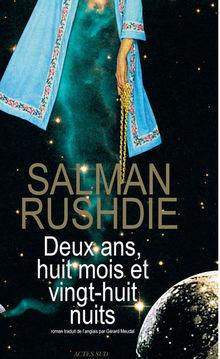
Deux ans, huit mois et vingt-huit nuits, par Salman Rushdie, traduit de l’anglais par Gérard Meudal, éd. Actes Sud, 320 p.
A bientôt 70 ans, Salman Rushdie n’a pas cessé d’écrire depuis 1988, année de parution de ses Versets Sataniques qui provoquèrent l’émission par l’ayatollah Khomeini d’une fatwa à son encontre. Dans ce douzième roman, dont le titre fait directement référence aux Mille et Une Nuits, il prend prétexte d’une dispute médiévale entre philosophe et théologien musulmans (Averroès contre Ghazali) pour imaginer comment Dunia, princesse djinn s’étant accouplée avec le rationaliste, découvre quelques siècles plus tard notre bas-monde plus que jamais divisé entre raison et obscurantisme.
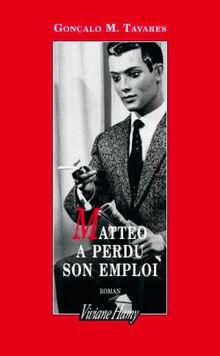
Matteo a perdu son emploi, par Gonçalo M. Tavares, traduit du portugais par Dominique Nédellec, éd. Viviane Hamy, 200 p.
C’est sous la forme d’une série de microcontes philosophiques, seulement liés les uns aux autres par un variable degré de connaissance entre chacun des protagonistes successifs (et présentés par ordre alphabétique de leur patronyme), que l’écrivain portugais, joueur et cérébral, a choisi cette fois de sidérer ses lecteurs. Après Jérusalem (2008) et son splendide Apprendre à prier à l’ère de la technique (2010), il interroge ici les concepts de civilisation, de folie, de propriété et de langage, sans jamais sombrer dans l’hermétisme.
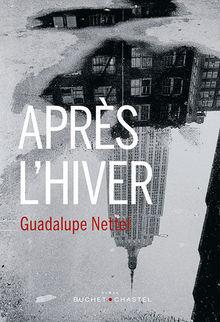
Après l’hiver, Par Guadalupe Nettel, traduit de l’espagnol par François Martin, éd. Buchet Chastel, 304 p.
Lauréate du prix Herralde en Espagne (comme Roberto Bolano ou Enrique Vila-Matas avant elle) pour ce troisième roman, la Mexicaine Guadalupe Nettel autorise son lecteur à découvrir l’intimité avant leur rencontre de ses deux personnages exilés en autant de capitales occidentales (New York et Paris), bientôt amenés à se fréquenter autour de Ménilmontant. Afin de le laisser seul juge, elle livre même par exemple les deux versions de leur rencontre, le tout avec beaucoup d’élégance et de style. Difficile de n’être pas convaincu.
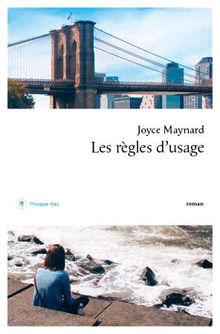
Les Règles d’usage, par Joyce Maynard, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Isabelle D. Philippe, éd. Philippe Rey, 480 p.
Dans le New York dévasté par les attentats du 11-Septembre, une jeune adolescente tente de se reconstruire après la mort de sa mère. Elle fera l’apprentissage de l’interdit, de l’autre qui est différent, de l’éveil de la sexualité avec, en filigrane, les images atroces qui hantent son esprit. On aime les romans de Joyce Maynard pour la magnifique note d’optimisme qu’elle parvient à glisser dans ses tragédies. L’ex-petite amie de Salinger montre une nouvelle fois ses subtilités d’analyse dans ce roman à la fois familial et d’initiation.
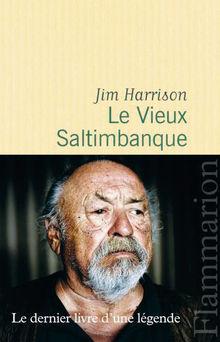
Le Vieux saltimbanque, par Jim Harrison, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Brice Matthieussent, éd. Flammarion, 144 p.
Terminé in extremis avant sa disparition en mars dernier, Le Vieux Saltimbanque est le dernier tour de piste de Jim Harrison, véritable pilier d’une littérature américaine qui va avoir du mal à se passer de ses morceaux de bravoure. Histoire de nous rappeler que sa vie, en marge de tout système, a toujours servi de terreau à son oeuvre et qu’elle a même souvent surpassé la fiction, l’auteur de Dalva se prête ici au jeu de l’autobiographie brute de décoffrage et ultratransparente, le tout raconté avec la distance de la troisième personne.
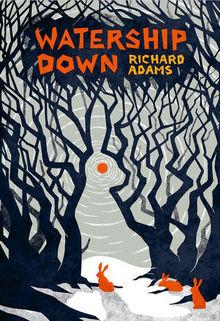
Watership Down, par Richard Adams, traduit de l’anglais par Pierre Clinquart & Monsieur Toussaint Louverture, éd. Monsieur Toussaint Louverture, 544 p.
Il était une fois un livre qui depuis sa première publication en 1972 s’est vendu à 50 millions d’exemplaires dans le monde mais auquel le public francophone n’avait pas encore succombé (en dehors d’une niche d’admirateurs dans les années 1970). Cette nouvelle traduction de Watership Down est une occasion de saluer une fois encore l’audace d’un éditeur, Monsieur Toussaint Louverture, qui se propose, en pleine rentrée littéraire, de réhabiliter les aventures d’une bande de lapins en quête d’une terre promise dans un roman de pure aventure, chaînon manquant entre l’Odyssée et Le Vent dans les saules.
PREMIERS ROMANS
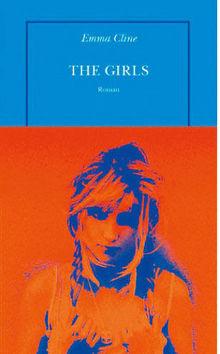
The Girls, par Emma Cline, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Jean Esch, éd. Quai Voltaire, 300 p.
Un premier roman atmosphérique cousu dans l’étoffe des souvenirs d’une femme cabossée relatant sa rencontre vénéneuse en 1969 avec la magnétique Suzanne, meneuse naturelle d’un gang de filles sauvages gravitant dans le giron d’un leader charismatique à la Charles Manson. D’une voix suave et organique, Emma Cline rembobine l’attraction irrésistible de ces rebelles sur la jeune fille de 14 ans, embourbée dans une adolescence californienne aussi molle que la volonté de sa mère dépressive. Un récit puissant sur l’obsession, le désir et le passage délicat entre les rives de l’enfance et de l’âge adulte, mouroir de nos tendres illusions.
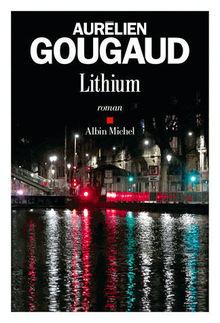
Lithium, par Aurélien Gougaud, éditions Albin Michel, 192 p.
Une semaine dans la vie déprimante de deux jeunes de 25 ans secoués par les trous d’air de leur époque. Il est commercial à Paris, à la Défense, ambitieux et vaguement en couple. Elle est animatrice radio, malmenée par son boss et décide de tout plaquer pour aller voir si l’herbe australienne est plus verte qu’en France. Un échantillon représentatif de cette jeunesse qui noie son désenchantement dans les soirées alcoolisées, le sexe sparadrap et la fréquentation frénétique des réseaux sociaux. Entre errances et soif de vivre, un premier roman tendrement ironique sur l’ultramoderne solitude.
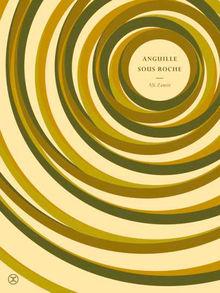
Anguille sous roche, par Ali Zamir, éd. le Tripode, 320 p.
On parle du premier livre d’Ali Zamir comme de la plus longue phrase de la rentrée littéraire et pour cause : elle dure les… 320 pages de son livre. Usant de la virgule comme d’autres du point final, le jeune Comorien de 27 ans raconte la noyade d’une femme, Anguille, » quelque part dans l’océan Indien » et dévide le fil de sa vie d’un seul souffle épatant. Après une rocambolesque histoire de refus de visa, l’auteur sera bientôt en France pour la défense de son livre, déjà remarqué un peu partout.

Petit pays, par Gaël Faye, éd. Grasset, 224 p.
Né, comme son personnage, en 1982 au Burundi, de parents franco-rwandais, Gaël Faye signe avec Petit Pays un premier roman que l’on devine très autobiographique, consacré à la perte d’innocence d’une jeunesse burundaise confrontée dès 1993 à une guerre civile entre Hutus et Tutsis, particulièrement affreuse. L’une des plus grandes qualités de ce texte tient à sa capacité à jouer de poésie et de légèreté, à valoriser l’expérience parfois cruelle des jeux d’enfants, tandis que la région entière se dirige à grands pas au bord du gouffre.
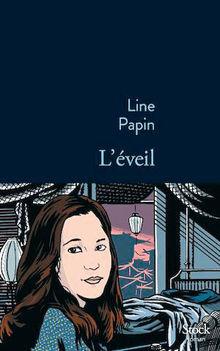
L’Eveil, par Line Papin, éd. Stock, 256 p.
Ça commence comme un roman de Duras : une fille d’ambassadeur est violemment ravie par les yeux (jaunes) d’un serveur français dans une fête d’expats riches à Hanoi. Raptée, hypnotisée, elle découvre avec lui la sexualité dans un grand bain sensoriel qui lui fait bientôt confondre le pays étranger et son amour, jusqu’à ce que l’ombre d’une autre histoire lui vole le premier rôle. Premier roman sensoriel comme une pluie d’été, L’Eveil est aussi celui de son auteure à la littérature : à 21 ans, Line Papin est la plus jeune des signatures de cette rentrée. Et l’une de ses jolies révélations.
POLARS

Brève histoire de sept meurtres, par Marlon James, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Valérie Malfoy, éd. Albin Michel, 750 p.
Jah Rastafari est grand : il a enfin donné un grand auteur jamaïcain à la littérature contemporaine anglo-saxonne. Après Donald Ray Pollock (lire ci-dessous), Albin Michel semble avoir mis la main sur » the next big thing « , à savoir Marlon James, auteur ici de son troisième roman, mais le premier en français, soit le récit monumental d’une poignée de personnages, gangsters rastas, agents de la CIA, politiques, barons de la drogue ou putes, de 1976 à nos jours. Avec l’ombre du grand Bob planant au-dessus de Kingston. Marlon James, Ellroy jamaïcain ? On en reparle bientôt.
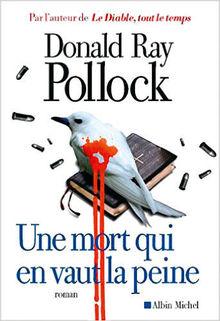
Une mort qui en vaut la peine, de Donald Ray Pollock, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Bruno Boudard, éd. Albin Michel, 576 p
.
Inutile de se précipiter chez son libraire, le nouveau Pollock ne sortira que le 6 octobre. Difficile toutefois d’ignorer le retour de l’auteur de Le Diable, tout le temps, polar au lyrisme biblique fiévreux qui a mis tout le monde d’accord – et K.O. – en 2012. Même thèmes – la violence, le mal, la religion, la rédemption…- mais servis cette fois dans un emballage plus burlesque ficelé par une fratrie de bouseux décidant de troquer la vie à la ferme contre celle de bandits de grand chemin, option pieds nickelés. Le parfum sudiste de Flannery O’Connor, la sauvagerie froide de Sam Peckinpah. Alléluia !
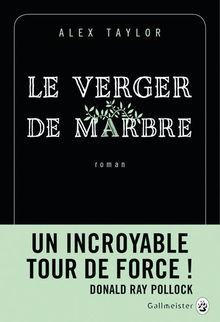
Le Verger de marbre, par Alex Taylor, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Anatole Pons, éd. Gallmeister, 288 p.- Là où les lumières se perdent par David Joy, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Fabrice Pointeau, éd. Sonatine, 320 p.
Le hasard vraiment ? Parmi les -rares – polars à nous sembler sortir du lot en cette rentrée, les deux exemples les plus frappants n’ont pas que leurs origines américaines en commun. Les nouveaux venus Alex Taylor et David Joy donnent corps à deux polars intenses, l’un au Kentucky, l’autre en Caroline du Nord, mais qui tous deux donnent, comme peu, une voix aux sans voix. Deux plongées vertigineuses dans une Amérique rurale, déglinguée et quart-mondiste qui n’a que la violence ou la drogue pour horizon, mais heureusement de vraies plumes pour la raconter. Une Amérique presque caricaturale, devenue cliché, mais qui continue pourtant à donner de grands livres.
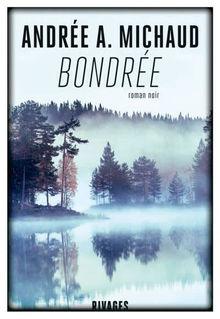
Bondrée, par Andrée A. Michaud, éd. Rivages, 330 p.
La fraîcheur, ces derniers temps, vient souvent du Québec. Longtemps délaissée par les éditeurs français, la Belle Province semble devenir une nouvelle terre de salut. La preuve avec l’arrivée chez Rivages de la romancière Andrée A. Michaud, déjà dix livres, dont ce Bondrée qui fait enfin la traversée de l’Atlantique, et qui illustre bien ce que peut être un » thriller littéraire « , terme revendiqué : soit le récit poétique, raffiné et riche en atmosphères de la disparition d’une jeune fille, puis d’une deuxième, à l’été 1967, et au Québec.
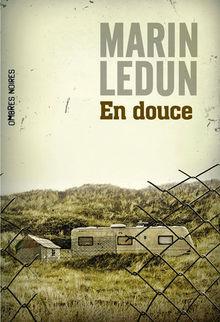
En douce, par Marin Ledun, éd. Ombres noires, 256 p.
Emilie, unijambiste gironde, a un compte à régler. Elle séduit donc un soir de fête dans le sud de la France celui qu’elle tient pour responsable de son handicap, lui tire une balle dans la jambe, l’attache et l’enferme dans son chenil. Ainsi commence En douce, le nouveau Marin Ledun (Les visages écrasés, L’homme qui a vu l’homme) qui, derrière ses faux airs de Misery, cacherait surtout selon l’auteur un roman à caractère social. On y a surtout vu un joli portrait de femme, bien de son époque, donc au bord du gouffre. Emilie devrait trouver une bonne audience en librairie, avant sans doute le cinéma.
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici