
Jean-Marie Guéhenno, ex-secrétaire général adjoint de l’ONU: « La complexité est la meilleure recette de la paix » (entretien)

Dans Le premier XXIe siècle, l’ancien secrétaire général adjoint en charge des opérations de maintien de la paix de l’Onu analyse les bienfaits et les dangers de l’émiettement du monde. La rivalité entre les « empires », états-Unis et Chine, l’inquiète. Et en se créant un ennemi, l’Occident s’exonère de faire son introspection pour s’améliorer. à l’Europe de résister.
En cette fin d’année, Le Vif a décidé de prendre le temps. D’enquêter, de raconter le monde, d’offrir à ses lecteurs des récits qu’ils ne liront pas ailleurs. Retrouvez tous les articles de notre premier mook ici.
Les huit années qu’il a passées à la direction des opérations de maintien de la paix de l’Organisation des nations unies lui ont appris la fragilité des sociétés humaines. « Dans les pays en guerre civile où se déploient la plupart des opérations de maintien de la paix, ce vernis [du respect instinctif des lois et du préjugé de confiance que nous témoignons à nos semblables] est parti et le « capital social » – cette richesse qui réside non dans les capacités individuelles de chacun des membres d’une communauté humaine mais dans les liens, implicites et explicites, qui les unissent – a disparu », diagnostique Jean-Marie Guéhenno, l’ancien secrétaire général adjoint des Nations unies auprès de Kofi Annan, dans son dernier livre Le Premier XXIe Siècle (1), précis de géopolitique à l’usage de la compréhension du nouvel « ordre » du monde.
L’idéologie de l’individu devient une idéologie du selfie. Ce monde-là n’est pas vivable.
Est-ce un enseignement qu’il a tiré de cette expérience onusienne? Pour le diplomate français, retrouver le sens du collectif est une préoccupation essentielle. La crise sanitaire qui « a montré que l’équilibre entre l’individu et le collectif est un facteur plus déterminant que le système politique » donnerait même raison à cet humaniste, pourvu qu’elle ne débouche pas sur des promesses sans lendemain.
Bio express
- 1949 Naissance le 30 octobre, à Paris.
- 1993 Publie La Fin de la démocratie (Flammarion, 192 p.).
- 1999L’Avenir de la liberté, la démocratie dans la mondialisation (Flammarion, 222 p.).
- 2000-2008 Secrétaire général adjoint au Département des opérations de maintien de la paix de l’ONU.
- 2012 Assistant de l’émissaire de l’ONU et de la Ligue arabe sur la crise en Syrie, Kofi Annan.
- 2014 Président-directeur général de l’ONG International Crisis Group.
« Nous avons confondu la faillite du système soviétique avec la victoire de la démocratie », écrivez-vous. Quelle a été la conséquence de cette erreur?
Au lieu de regarder ce qui devait être repensé dans nos démocraties, nous avons cédé au triomphalisme et nous avons été convaincus que c’était, comme le disait Francis Fukuyama (NDLR: chercheur en sciences politiques américain) « la fin de l’histoire » alors que celle-ci continuait. Avec l’Union soviétique, nous avions un adversaire commode qui nous permettait de nous définir. Une fois celui-ci disparu, nous aurions dû penser ce qui fait une société. Aujourd’hui, nous nous comportons de la même façon avec la Chine. C’est une habitude dangereuse.
Cette nouvelle donne a-t-elle eu un impact particulier pour l’Europe?
A partir du moment où la guerre froide était terminée, l’Europe perdait sa centralité stratégique. Elle aurait dû repenser sa relation avec le reste du monde. Elle ne l’a pas fait. Quand, par exemple, elle a construit l’euro, elle l’a pensé beaucoup plus comme un moyen d’enraciner l’Allemagne dans la construction européenne plutôt que comme un instrument pour peser sur les affaires du monde, au-delà de l’Europe.
Pourquoi, malgré l’échec du communisme, le projet d’un ordre multilatéral libéral a-t-il échoué?
Il a échoué parce qu’il a été trop noyé dans la globalisation. On s’est asservi à une logique économique. On a dit aux peuples: « Maintenant, vous êtes libres. Il n’y a plus de menace du communisme. » Dans le même mouvement, on leur a également signifié: « Vous devez respecter un certain nombre de principes de l’économie libérale. » Alors que la construction de l’Union européenne a été conçue dans l’optique d’une reprise de contrôle de son destin, un certain nombre de citoyens la voient aujourd’hui comme le symbole d’une perte de contrôle. L’Union européenne est considérée à leurs yeux comme le cheval de Troie d’une vision économique qui laisse peu de place à la politique. On a confondu cette vision avec ce qu’est une véritable démocratie. Aujourd’hui, les citoyens se rebellent contre cette simplification. Dans une société humaine, tout ne relève pas du marché.

Vous évoquez « l’idéologie de l’individu » qui a dominé le monde. En quoi a-t-elle atteint ses limites aujourd’hui?
L’individualisme a été un des moteurs de la transformation du monde depuis la révolution industrielle. D’une certaine manière, 1989 (NDLR: année de la chute du mur de Berlin) a été l’apogée de l’exaltation de la capacité individuelle. Mais dans le même temps, tout être humain éprouve le besoin de se retrouver dans quelque chose qui est plus grand que lui. Aujourd’hui, les individus sont désemparés par rapport à un monde qu’ils ne contrôlent pas, faute de sentiment d’appartenance collective. Ils sont eux-mêmes leur seule référence. L’idéologie de l’individu devient une idéologie du selfie. Ce monde-là n’est pas vivable. On a besoin de valeurs collectives dans lesquelles se retrouver. Le danger est, en l’absence de projet collectif, de rechercher des appartenances de groupe dans des passions identitaires.
Comment peut-on raviver la démocratie représentative et redonner goût à la politique sans verser dans les extrêmes?
Il faut partir du bas. Aujourd’hui, les légitimités lointaines ont du mal à s’affirmer. Je crois beaucoup aux institutions locales, à la démocratie de proximité. C’est une première réponse. Une deuxième est de comprendre que dans une société, il y a différents types de légitimité. La crise de la Covid a montré une légitimité du savoir et une légitimité démocratique. La légitimité démocratique est celle qui permet de décider quel risque on est prêt à prendre. Cette décision doit être collective parce qu’aucune vie n’est un absolu. La légitimité du savoir est celle qui permet de mesurer le risque. Or, on a tendance à mélanger ces types de légitimités. C’est aussi un danger pour la démocratie. Enfin, troisième réponse, pour que la démocratie vive, il faut reconnaître qu’il y a différents niveaux de responsabilité et les organiser entre eux. Les grandes idéologies du XXe siècle sont mortes. Et c’est peut-être une bonne chose parce qu’elles ont conduit à des malheurs épouvantables. Mais une société a besoin de projets. De ce point de vue, la question écologique est de nature à permettre une réinvention de la politique. Pour y arriver, le débat ne doit pas porter sur la question « Est-on ou pas écologiste? » mais bien sur celle du « Comment on l’est? ». Il faut sortir de la dichotomie entre ceux qui vous promettent l’enfer si on n’agit pas et ceux qui veulent absolument ignorer le risque. Les partis doivent proposer un éventail de réponses, dont une devra trancher la question des risques que l’on est prêt à prendre pour nous-mêmes et pour les générations futures. Ces questions ne sont pas scientifiques, elles sont politiques. Elles peuvent nourrir de vrais débats et réenchanter le champ de la politique.
L’Union européenne doit-elle arrêter son élargissement, voire son approfondissement, pour s’appliquer à bien faire fonctionner les institutions diverses qui la composent?
Une entité politique existe si elle est capable d’affirmer sa différence. La difficulté de l’Union européenne, qui est aussi sa grandeur, est qu’elle porte un projet universaliste. Le rêve de l’UE est de façon symbolique que le monde soit l’UE. Mais un projet politique doit avoir des frontières. On doit se diriger vers une Europe à géométrie variable. L’idée de l’Europe comme matrice d’un super Etat fédéral est morte. Les mémoires nationales de nos pays sont trop différentes. Il faut reconnaître ces différences et en faire une richesse plutôt qu’un obstacle. Il faut bâtir l’Europe sur ces différences. Cela signifie que l’Europe de la monnaie ne sera peut-être pas exactement comme l’Europe de la défense, qui ne sera pas forcément comme l’Europe du commerce. Je pense que cette façon de voir est plus réaliste. Il faut que l’Europe soit très politique sur certains sujets – cela ne pourra se faire qu’entre des Etats qui partagent une certaine vision des choses – et accepte de ne pas l’être sur d’autres. L’Europe ne doit pas avoir honte de juxtaposer différentes légitimités. Mais pour faire entendre sa voix, il faut qu’elle puisse exister dans les rapports de force, pas nécessairement militaires. L’Europe est, peut-être, une grande puissance économique ; elle est en tout cas une grande puissance normative. De ce point de vue, si elle s’organise intelligemment, elle peut peser. Elle doit peser. Il y a d’ailleurs une attente d’Europe dans beaucoup de pays du monde.

Vous mettez en garde contre l’utopie d’un gouvernement planétaire auquel vous préférez une multitude de communautés politiques variées. Quel rôle faut-il alors assigner aux Nations unies?
Je ne crois pas en la fin de l’histoire et en une forme parfaite d’institution politique qui devrait s’imposer au monde. Les institutions politiques sont le produit d’histoires particulières. Reconnaître cette diversité comme une richesse plutôt que comme un obstacle à l’universalisme est essentiel. Cela ne veut absolument pas dire que ces entités ne doivent pas communiquer entre elles. C’est là que les Nations unies ont un rôle crucial à jouer. On le voit en ce moment sur le climat. Il est essentiel de montrer une direction, de permettre aux Etats, dans toutes leurs diversités, de se parler. Même chose pour le domaine de la sécurité dans lequel j’ai été actif aux Nations unies, il est très important d’avoir des règles. Malheureusement, les règles fixées par la charte des Nations unies sont de plus en plus bafouées. Sortir de ce cadre entraînera le triomphe de la loi du plus fort et la foire d’empoigne du fait accompli, qui nous mèneront directement à la guerre. Cela étant, les Nations unies sont une organisation d’Etats. Aujourd’hui, les grandes entreprises de données sont certainement aussi puissantes que beaucoup d’Etats membres de l’ONU. C’est un grand défi. Les Nations unies sont au début d’une transformation dans laquelle il faudra trouver une place pour les acteurs non étatiques sans que ceux-ci tirent les ficelles qui nous manipuleraient.
La question écologique est de nature à permettre une réinvention de la politique.
La puissance de ces acteurs des nouvelles technologies contribue-t-elle à l’émiettement du monde?
Ces nouvelles technologies contribuent à la polarisation et à l’émiettement du monde. De plus en plus, celui-ci s’organise en communautés fermées sur elles-mêmes, une conséquence des algorithmes qui gèrent les plateformes. Mais je pense qu’il y a une sorte de fatigue de ce phénomène. Les gens se lassent de cette bagarre permanente. Donc si les systèmes, avec leur énorme capacité de manipulation des esprits, au lieu de fomenter la discorde favorisait une sorte d’harmonie artificielle, cela pourrait en séduire plus d’un. Au fond, la difficulté est de faire la différence entre les idées qui dérangent et celles qui tuent. En Europe, on poursuit à juste titre en justice les idéologies qui poussent à la haine, la promotion du nazisme… Il y a aussi les idées qui dérangent. Elles, on en a besoin. Je vis aux Etats-Unis. Avec le mouvement « woke » ou la cancel culture, certains s’en prennent de plus en plus à des idées qui dérangent alors qu’elles font partie de la vitalité d’une société. J’enseigne à l’université de Columbia. Je dis à mes étudiants que je suis là pour les mettre mal à l’aise. C’est ça, le rôle de l’enseignement: sortir l’élève de sa zone de confort. Cette vision risque malheureusement de devenir minoritaire. Apparaît alors « la tentation chinoise », l’idée de se servir de la puissance des médias pour endormir le citoyen dans un bonheur fabriqué sur mesure. Je n’en veux pas non plus. Il faut trouver le chemin étroit entre un monde dysfonctionnel où on s’enferme dans des préjugés et dans l’incommunicabilité et un monde tout aussi dysfonctionnel où le débat devient impossible parce qu’il faut tellement ménager les susceptibilités de chacun qu’on ne peut plus formuler d’idées qui sortent de la norme.
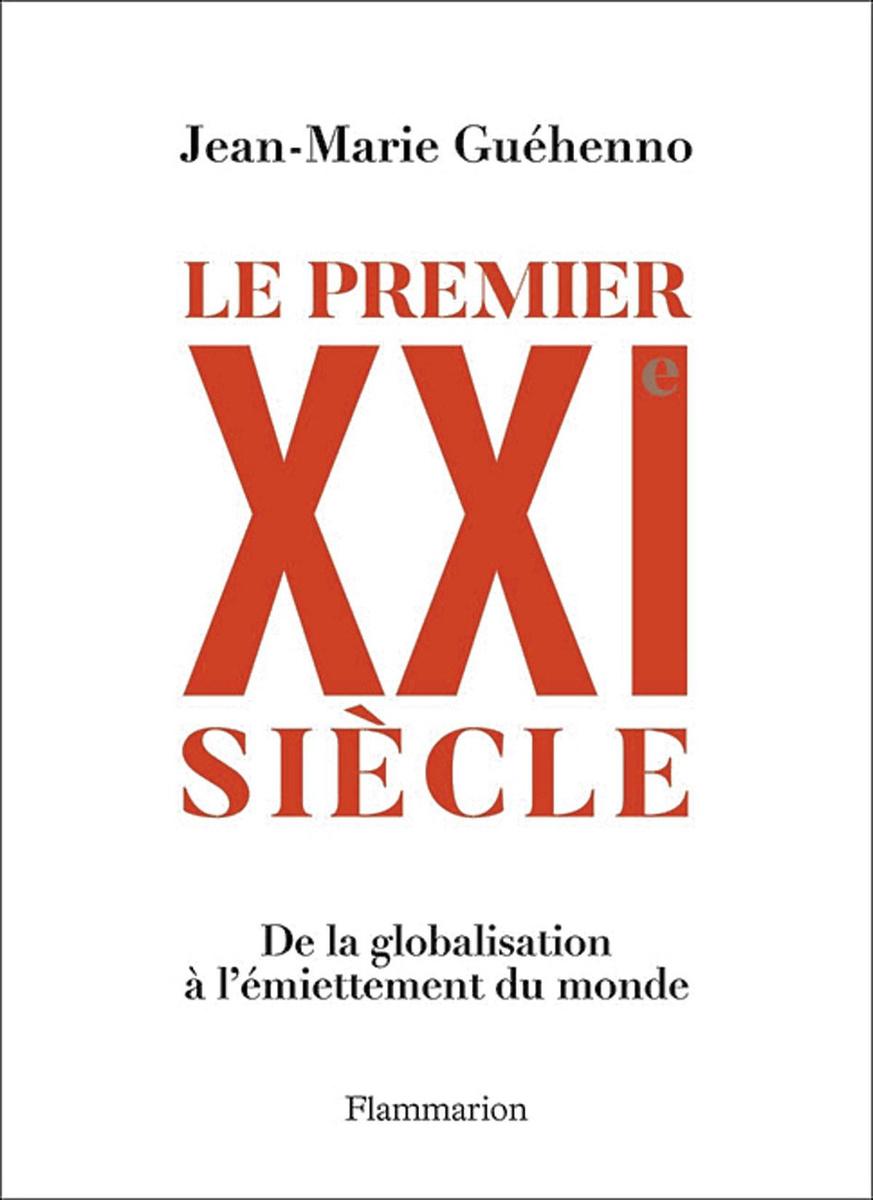
Comment analysez-vous le paradoxe autour de la Chine qui, en Occident, est tantôt perçue comme une menace, tantôt comme un modèle d’efficacité?
C’est toute notre ambivalence. D’un côté, la Chine nous fait peur par la démonstration qu’elle fait que l’on peut être une réussite économique sans être une réussite démocratique, c’est le moins que l’on puisse dire. D’un autre côté, au sein de nos sociétés un peu malades, au fond de nous-mêmes, nous rêvons d’une tranquillité à la chinoise. Par rapport à l’Union soviétique, nous savions bien, à l’époque, que le modèle occidental fonctionnait mieux économiquement et qu’il procurait plus de liberté, de diversité et de prospérité. On ne peut pas avoir les mêmes certitudes face à la Chine. D’où le malaise actuel.
Entre la confrontation et la guerre froide, vous envisagez une troisième voie avec une Chine qui s’occidentaliserait et un Occident qui se siniserait autour du culte de l’utilitarisme. Est-ce une issue plausible?
Ce qui m’inquiète est que la confrontation observée aujourd’hui est le reflet d’une double faiblesse, chinoise et occidentale. Des deux côtés, se forger un ennemi est une solution commode pour maintenir la cohérence de la société. C’est une pente nationaliste dangereuse. Aux Etats-Unis, qui sont dans une situation de polarisation extrême entre républicains et démocrates, le seul sujet sur lequel les Américains se retrouvent est l’hostilité à l’égard de la Chine. En Chine, si la croissance n’est pas celle des années passées dans les années à venir, se mobiliser contre l’ennemi occidental pourrait être une porte de sortie pour les dirigeants. Ce n’est pas rassurant pour l’avenir du monde. L’Europe a un rôle à jouer. Elle doit rester lucide sur ce que la Chine peut représenter comme menace. Elle ne doit pas se laisser embarquer dans une croisade totale contre elle. Et la première manière de répondre au défi chinois est de consolider nos institutions démocratiques en crise.
Le monde peut-il vivre sans perception d’un « centre du monde »?
Je le voudrais. L’idée qu’il y a une sorte de fin de l’histoire dont un certain système serait l’aboutissement n’est pas conforme à la diversité du monde. Tout le monde est en relation avec tout le monde. C’est la différence avec la période de la guerre froide. La Chine est dans une relation économique intense avec l’Amérique, avec l’Europe. Nous sommes dans un monde hyperconnecté qui ne cessera pas de l’être. Personne ne pense que la déglobalisation arrivera. La globalisation évoluera. Elle ne disparaîtra pas. Nous sommes liés les uns aux autres, qu’on le veuille ou non. C’est une nécessité. Mais en même temps, nous sommes très différents. Peut-il y avoir plusieurs empires qui cohabitent les uns avec les autres? Si le monde se consolide autour de grandes entités unidimensionnelles, il y aura de moins en moins de marge de manoeuvre entre ces entités, et le risque d’une confrontation augmentera. Si on veut donner de la souplesse au monde, il faut lui donner de la complexité. C’est la meilleure recette de la paix. La concentration du pouvoir dans quelques entités est dangereuse. Et la domination du monde par un empire me paraît impossible. Unité impériale impossible, coexistence de grands empires dangereuse, la solution est d’accepter la complexité d’entités multidimensionnelles…
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici