
Georges Ugeux: « La source d’espoir, c’est le mouvement des jeunes pour le climat »

Dans Wall Street à l’assaut de la démocratie, l’ancien patron de la Bourse de New York analyse comment les marchés financiers, le « culte de l’actionnaire » et l’attitude pusillanime des gouvernements accroissent les inégalités sociales. Pour éviter une révolution, il faut changer le système.
A-t-il viré sa cuti? Est-ce l’urgence du dérèglement du monde qui impose de nouvelles réponses? L’ancien vice-président exécutif de la Bourse de New York, le Belge Georges Ugeux, dénonce depuis quelques années les dérives des marchés financiers dont il a été l’un des plus puissants représentants jusqu’en 2003. En 2009, il publiait La Trahison de la finance (Odile Jacob, 336 p.). Il poursuit aujourd’hui ce travail de lanceur d’alerte avec Wall Street à l’assaut de la démocratie (1). Et il nourrit d’autres projets, notamment celui, prévu au printemps 2022, de livres sur l’économie pour les adolescents, tant il est convaincu que c’est en étant mieux éduqué que le citoyen pourra peser plus encore sur les décisions politiques qui le concernent. Aux jeunes, il adresse ce conseil: « Informez-vous, formez-vous avant de vous faire une opinion, et alors seulement, battez-vous pour celles qui vous sont chères. »
Bio express
- 1945: Naissance à Etterbeek, le 20 avril.
- Fin des années 1960: Doctorat en droit et licence en économie à l’université catholique de Louvain.
- 1970: Entre à la Société générale de Banque.
- 1985: Directeur général du département des fusions et acquisitions à la banque Morgan Stanley, à Londres.
- 1996-2003: Vice-président exécutif, international et recherche de la Bourse de New York.
- 2003: Fondateur et PDG de la banque d’affaires Galileo Global Advisors.
- 2010: Publie La Trahison de la finance (Odile Jacob, 220 p.).
- 2019: La Descente aux enfers de la finance(Odile Jacob, 336 p.).
Comment et pourquoi la déconnexion des marchés financiers s’est-elle creusée avec l’économie réelle? En quoi la crise sanitaire l’a-t-elle davantage démontré?
Depuis un certain temps, nous avons constaté que l’endettement des pays, les politiques des banques centrales et certains comportements des entreprises ont provoqué un effet de déséquilibre. La pandémie nous a permis de voir le problème en grandeur nature. Quand je dis cela, je suis très précis. Si une partie de l’argent que nous avons introduit dans le système a effectivement soutenu les économies et les personnes en difficulté, nous avons mis trop et trop vite. Le résultat est que l’argent est allé ailleurs, en réalité en Bourse. En plein milieu de la pandémie, nous avons observé des records du Dow Jones. Le phénomène est inquiétant parce que c’est l’argent du contribuable qui sert les entreprises et les actionnaires. Mais c’est une dette. Et les banques centrales ne savent plus sortir de ce système. Derrière cela, il existe un phénomène pernicieux: la contribution des entreprises au budget de l’Etat s’est réduite comme peau de chagrin parce que l’emprunt des sociétés a, grosso modo, diminué de 75% à travers le monde et que, au sein des pays de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), l’impôt des sociétés représente moins de 10% des recettes de l’Etat. Le deuxième phénomène à épingler est qu’en inversant les taux d’intérêt, on a littéralement exproprié l’épargne, les retraites, les compagnies d’assurance vie en faveur des émetteurs qui comprenaient le secteur public. On n’est jamais si bien servi que par soi-même…
La zone d’autonomie véritable des gouvernements s’est considérablement restreinte, faute de moyens.
Comment une partie de cet argent est-elle allée en Bourse?
C’est le phénomène de la transmission de la politique monétaire à l’économie réelle. Elle passe par une série de canaux. Considérez que ces canaux sont faits pour absorber cent milliards d’euros par mois. Si vous y injectez trois trillions d’euros, un phénomène de débordement se produit. Le surplus va ailleurs.
Le « quoi qu’il en coûte » d’Emmanuel Macron et des dirigeants européens était-il une erreur?
Il ne fallait surtout pas faire le « quoi qu’il en coûte ». Il fallait calibrer. Il faut bien se rendre compte que la banque centrale des Etats-Unis – la Federal Reserve – a injecté sur le marché en six semaines ce qu’elle avait mis dans les dix années qui ont suivi la crise de 2008 pour soutenir l’économie. Cela donne une idée.

Quelle conséquence cette explosion du déficit budgétaire et de l’endettement peut-elle avoir?
Les banques centrales n’ont pas une politique équilibrée entre les emprunteurs et les épargnants. Leur politique appauvrit les seconds. Dans les entreprises, tout est fait pour l’actionnaire. Les plus grandes d’entre elles voient leurs impôts diminuer, ce qui augmente les dividendes des actionnaires. C’est ainsi que vous creusez l’écart entre les riches et les pauvres.
Le monde politique peut-il agir ou est-il dépassé par ce phénomène?
Le politique est complice. On ne diminue pas les taux d’intérêt des emprunts d’Etat sans que ce soit à l’avantage des gouvernements. Et on ne diminue pas le taux d’impôt des sociétés si ce n’est parce que le gouvernement l’approuve et le Parlement le vote. Les gouvernements et les entreprises jouent dans la même pièce. Ils ont besoin l’un de l’autre. Je ne dois pas vous faire un dessin. Il vous arrive de percevoir cela de temps à autre.
Diriez-vous que les politiques sont sous la coupe des milieux financiers?
Assez largement pour le moment. La zone d’autonomie véritable des gouvernements s’est considérablement restreinte, faute de moyens. Depuis la pandémie, les interventions, politiques et budgétaires, des gouvernements ont porté sur 16 000 milliards d’euros. Imaginons que l’on n’ait eu besoin que de la moitié de ce montant et que les 8 000 milliards restants aient été investis dans la transition énergétique… Le problème est résolu. Mais ce n’est pas cela que l’on a fait. On n’emprunte pas pour investir.
N’ y a-t-il quand même pas une forte dimension consacrée à la transition énergétique dans le plan de relance européen?
C’est un effort louable qui va dans la bonne direction. Mais vous n’allez pas résoudre le problème des 50 000 milliards d’actifs des banques centrales par des moyens de 100 ou de 200 milliards.
Au-delà de la situation particulière liée à la crise sanitaire, la plus grande menace pour la démocratie est-elle l’idéologie du « culte de l’actionnaire »?
Oui, manifestement. L’indice des actions des entreprises a augmenté de 400% en dix ans. Cette hausse a été favorisée par cet argent des banques centrales mais aussi par le rachat d’actions par les entreprises. Tout cela est de nature à doper les cours boursiers. Les marchés financiers sont le carrefour de tous les intérêts particuliers. Il faut mieux s’organiser. Il faudrait, par exemple, que les stocks options soient liés non pas à la performance de l’entreprise mais au cours de la Bourse. Donc, il n’y a pas de sortie du système à l’horizon. C’est cela qui est inacceptable.
Comment pourrait-on néanmoins changer ce système?
Il faut prendre conscience de l’anomalie complète que ce système engendre en termes d’inégalités. Il faut donc changer notre manière de penser. On ne peut pas continuer à penser seulement à la performance, au retour sur investisement… Le rôle des marchés de capitaux doit être beaucoup plus orienté vers le financement des entreprises. On ne va pas résoudre les problèmes des pensions, de la santé, de la transition énergétique sans les marchés. Il ne faut pas tuer les marchés. Dire cela relève du populisme et ne sert à rien. La réalité est ailleurs. Il faut – c’est en train de se mettre en place très timidement – augmenter la taxation des entreprises à l’échelle mondiale de manière à ce que l’on ne se fasse pas de concurrence sur les impôts. Il faut arrêter d’urgence les interventions des banques centrales et augmenter les taux d’intérêt, petit à petit. Le problème est qu’elles ont une frousse bleue de se voir reprocher une éventuelle récession. Je n’y crois pas un seul instant parce que, même si les taux d’intérêt augmentaient d’un pour cent, personne n’en souffrirait. Mais c’est le dogme des banques centrales. Il faut aussi que les entreprises, si elles veulent racheter leurs actions, expliquent pourquoi elles n’ont pas besoin de fonds propres, pourquoi elles ne vont pas faire de croissance, etc. Il faut admettre des fluctuations de dividendes de telle sorte qu’un chef d’entreprise ne soit pas viré parce que les dividendes ne montent pas ou baissent alors même qu’il ne sera jamais licencié parce qu’il a mis cinq mille personnes à la porte. La connexion établie maintenant entre la rémunération des dirigeants et les cours boursiers est le plus grand cadeau fait aux riches par les gouvernements.
L’initiative de Joe Biden en faveur d’un impôt minimal des entreprises, qui a abouti le 8 octobre à un accord entre cent trente-six Etats sur une taxation de 15% à l’échelon mondial, était-elle opportune?
C’est un premier pas, encore trop timide. Le simple fait que l’on reconnaisse qu’il existe un problème planétaire, qu’il doit être réglé mondialement et qu’il n’est pas possible que les gouvernements doivent dépenser ce qui est nécessaire au bien-être de la population sans que les entreprises y contribuent, me paraît extrêmement sain. Cela va dans la bonne direction. L’ autre phénomène qui va dans la bonne direction, c’est le mouvement pour le climat, qui vient d’en bas et qui est porté par les jeunes. Quelle conséquence a-t-il? Il y a maintenant sept mille milliards d’actifs dans des fonds ESG (Environnement, Social et Gouvernance). Et il n’y en a que trois mille milliards dans les hedge funds. Une masse d’entrepreneurs veut donc investir utile. Et ils n’ont pas forcément moins à gagner, parce qu’on observe que les entreprises qui sont en ESG affichent, en général, de meilleures performances que l’ensemble du marché.
La prise de conscience de ces responsabilités sociales et environnementales est-elle réelle au sein des entreprises?
Elle est réelle parce qu’on les y a poussées. La prise de conscience vient du peuple, de ce mouvement des jeunes. Là se trouve la source d’espoir. Aux étudiants de la Sorbonne auxquels j’enseigne, je dis que s’ils laissent perdurer ce qui est en train de se passer, ils pourront faire une croix sur leur pension parce que l’on est occupé à la manger. Et quand 25 ou 50% du budget de l’Etat seront consacrés au remboursement des intérêts de la dette, il y aura une révolution.
Comment faire émerger ce « capitalisme solidaire » que vous appelez de vos voeux?
J’espère que chacun des joueurs dans la pièce fera sa part du travail. Je suis très inquiet du langage populiste qui consiste à dire que l’on va supprimer le capitalisme. Il y a un côté excessif et très général. Et plus vous généralisez, moins vous devez agir. Il faut, au contraire, prendre des mesures concrètes. Par exemple, une taxation des plus-values semblable à celle des revenus du travail, peut-être en augmentant l’une et en diminuant l’autre. Enormément de choses peuvent être faites. Mais, pour cela, il faut un changement de mentalité. On ne peut pas continuer à demander à la population de couvrir 80% des frais de l’Etat et permettre aux autres de partir, d’empocher des dividendes, de ne pas avoir de taxation, etc. Par rapport à ce phénomène-là, il y a une prise de conscience. Une fois que vous mettez tous les acteurs autour de la table, qu’ils acceptent le diagnostic – ce qui n’est pas encore le cas -, et que chacun apporte sa contribution, vous pouvez alors lancer un cercle vertueux.

L’Europe peut-elle être le creuset de ce sursaut?
Les Etats-Unis vivent encore beaucoup trop sur le principe de la « shareholder value » (NDLR: maximalisation de la valeur pour l’actionnaire) de Milton Friedman, en 1970, à l’école de Chicago. L’Europe a un système de valeurs différent et une capacité d’action. Mais elle doit prendre en compte un certain nombre de réalités spécifiquement européennes et, surtout, arriver à forger un consensus.
Comment jugez-vous les premiers mois de la présidence de Joe Biden?
La situation est pour le moment très compliquée. J’observe une grande césure entre les démocrates modérés et la gauche du parti. Pour celle-ci, la discipline budgétaire et financière n’est pas un sujet. Quand Elizabeth Warren affirme que l’Etat remboursera la dette des étudiants, elle ne se préoccupe pas du coût de mille milliards de dollars que cela représente. Je suis donc interpellé par cette forme de négligence par rapport aux finances publiques. L’héritage n’était pas bon. Mais ce n’est pas une raison pour l’alourdir. Deuxième source d’inquiétude, les Etats-Unis sont, pour le moment, obsédés par la Chine et ils en oublient de se comporter de manière plus ou moins décente avec le reste du monde.
S’il y a un moment où les Etats doivent intervenir, c’est lors d’une crise sanitaire. Mais ils doivent s’occuper de questions sanitaires.
Vous évoquez à plusieurs reprises dans votre livre le déficit de compétences sur l’économie et la finance des politiques. Comment y remédier?
C’est le gros problème, aujourd’hui, du système de l’élection. Entendons-nous bien, pour moi, il n’y a pas d’alternative. Ce que nous attendons des politiciens est extraordinairement régional et particulariste. Nous élisons donc des personnes qui sont bonnes dans ce domaine. Ensuite, on les propulse dans le grand bain et ils ne savent pas nager. Ils restent à l’extérieur de la piscine ; ils n’ont aucune chance. Il faudrait développer une éducation de la population de telle sorte que quand on lui ment ou qu’on lui raconte des fadaises, elle soit capable de s’en rendre compte. Dans ce cadre, le rôle de la presse est extraordinairement important. Mais, en règle générale, elle ne le joue pas. Qui détient la presse, par exemple, en France? Des chefs d’entreprise!
La rapidité de la mise au point des vaccins contre la Covid-19 est-elle le signe d’un partenariat privé-public réussi?
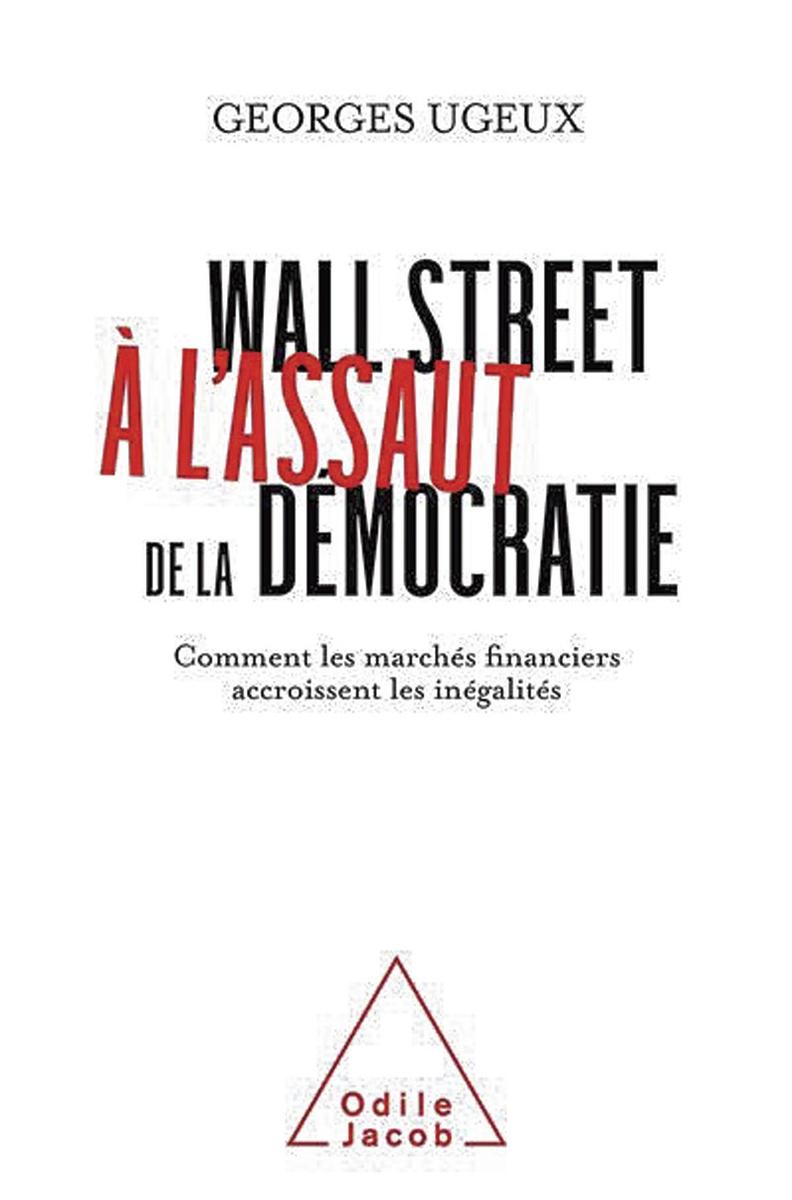
S’il y a un moment où les Etats doivent intervenir, c’est lors d’une crise sanitaire. Mais ils doivent s’occuper de questions sanitaires, pas faire le jeu de la politique monétaire. Il est extrêmement important que les interventions de l’Etat soient – j’ose à peine utiliser le terme – pures, qu’elles soient orientées dans une direction et qu’elles aillent dans cette direction. En revanche, quand je vois Pfizer et Moderna demander l’autorisation de vaccination des enfants de 5 à 11 ans alors que les deux tiers de la planète n’ont pas encore eu le premier vaccin, je ne peux m’empêcher de penser que c’est du « corporate profit » empreint d’un égoïsme absolument intolérable ou alors nous n’avons plus aucun sens de la solidarité. Or, par les contacts que j’ai, je sens une aspiration à cette solidarité. La crise sanitaire nous en a appris d’autres formes, et cela a un impact.
Avez-vous réalisé un cheminement sur votre rôle? Si oui, cela vous pose-t-il question sur votre passé dans le monde de la finance?
Je me suis toujours posé des questions, depuis ma jeunesse. Je suis un soixante-huitard. J’ai vu des choses horribles avec les Flamands pendant mai 1968. J’ai ressenti la haine, concrètement. Et c’est resté en moi. Même dans des situations ou des entreprises qui, parfois, avaient des comportements sujets à caution, j’ai toujours essayé de rester fidèle à moi-même et de rester honnête avec moi-même. Je ne dis pas que j’y ai réussi à 100% mais j’ai essayé. J’ai donc renoué, de manière plus structurée, avec des aspirations qui étaient en moi. Je trouve qu’un monde inéquitable est un monde injuste. Et j’ai une passion pour la justice. Dans le climat de collusion que nous connaissons, très peu de gens peuvent s’exprimer en ces termes. Ne demandez pas aux économistes des banques ou des Etats de le faire. En ce qui me concerne, que tel ou tel gouvernement, que tel ou tel Etat n’aime pas ce que je dis, ne changera rien à mes activités professionnelles. Alors, quand vous disposez de la connaissance et de la liberté, parler relève du devoir.
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici