
David Wengrow: « Nous avons tant à apprendre des organisations sociales des temps primitifs » (entretien)
Dans Au commencement était…, David Wengrow, professeur d’archéologie à l’University College de Londres, remet en question l’évolution linéaire de la société, des chasseurs-cueilleurs à la modernité, et déconstruit les mythes sur l’origine des inégalités.
Il parle lentement, solennellement, chuchote presque. Sans doute est-il éreinté par la tournée de promotion mondiale de son livre, qui n’en finit pas. Et puis, confesse-t-il espièglement, sa nuit fut courte et légèrement arrosée au Lieu-Dit, un chaleureux bistrot littéraire du 20e arrondissement de Paris, QG des sympathisants de la pensée critique et passage obligé de tout intellectuel en visite dans la capitale française. David Wengrow ne s’y est pas rendu les mains vides. Au commencement était… Une nouvelle histoire de l’humanité (1), coécrit avec le célèbre et regretté anthropologue américain David Graeber (décédé en 2020), est une fresque historique de plus de sept cents pages qui revisite de fond en comble l’histoire de l’humanité et, surtout, la déleste des mythes qui l’ont trop longtemps polluée. Organisation et structure sociales, rapports de domination, relations homme-femme, urbanisme, architecture, autant de domaines sur lesquels l’ouvrage jette un regard sinon tout à fait neuf, du moins à contre-courant. David Wengrow est convaincu que la société contemporaine a beaucoup à apprendre des expériences sociales du passé. Pour Le Vif, il revient sur ses principales thèses et leçons mais aussi sur leur genèse et leurs éventuelles limites.
Bio express
- 1972 Naissance, en Angleterre, le 25 juillet.
- 2001 Docteur en archéologie, à l’université d’Oxford.
- 2010 Publie un ouvrage remarqué, What Makes Civilization?: The Ancient Near East and the Future of the West (Oxford University Press).
- 2011 Participe activement au mouvement Occupy Wall Street et rencontre David Graeber.
- 2021 Publie Au commencement était… Une nouvelle histoire de l’humanité.
Pourriez-vous revenir sur votre première rencontre avec David Graeber, et sur l’origine de votre livre?
Nous avons fait connaissance en 2011, lors du mouvement Occupy Wall Street , à New York (NDLR: qui dénoncait pacifiquement les abus du capitalisme financier). Nous y étions actifs tous les deux. Très vite, le courant est passé entre nous. On a dîné ensemble, on a longuement discuté et on s’est échangé nos livres. David Graeber venait de sortir sa célèbre somme Dette. 5 000 ans d’histoire (éd. Les Liens qui libèrent). Pour ma part, j’avais publié What Makes Civilization? (Oxford University Press). Quelques semaines plus tard, il m’a envoyé un courriel qui m’a littéralement impressionné: il y faisait preuve d’une lecture acérée de mon livre, soulevait des points qui avaient échappé à mon attention, me posait des questions pertinentes. Par la suite, nous avons entretenu une abondante correspondance, à travers laquelle nous échangions sur nos idées, nos travaux, etc. Entre-temps, David a déménagé à Londres, où il a été nommé professeur au Goldsmiths College. Nous sommes devenus voisins et c’est ainsi que nous avons décidé d’écrire un petit pamphlet sur les inégalités. Au départ, l’idée était de faire le point sur l’histoire de l’humanité en mobilisant les dernières connaissances au carrefour de l’archéologie, mon domaine de compétence, et de l’anthropologie, le sien. Nous voulions déconstruire le mythe selon lequel les sociétés primitives étaient de petites communautés égalitaires – alors que la réalité est beaucoup plus complexe. Nous avions aussi mis la main sur des éléments et documents qui démontrent que des sociétés se sont organisées sans pouvoir centralisé ni hiérarchie. Ce sont des informations étayées par des données solides mais jusqu’alors uniquement connues de certains cercles scientifiques plutôt confidentiels. L’idée était de partager ces connaissances avec le grand public. Ainsi, avec le cumul d’une masse de données importantes, on s’est aperçus que notre projet de livre méritait davantage qu’un petit essai. Nous avons finalement brossé une fresque, une grande histoire de l’humanité.
Les sociétés de chasseurs-cueilleurs ne sont en aucun cas égalitaires. Elles sont beaucoup plus complexes et, surtout, plus intéressantes.
Plusieurs « nouvelles histoires de l’humanité » ont été publiées ces dernières années. On songe à celles de Jared Diamond ou Yuval Noah Harari, par exemple. En quoi se distingue la vôtre?
Les thèses que soutiennent les ouvrages que vous mentionnez sont tout simplement fausses. Le dire ainsi peut paraître un peu brutal mais, d’un point de vue scientifique, c’est une évidence. Ces travaux négligent à peu près 90% des découvertes récentes. Ce sont des livres qui s’appuient sur des données trop générales, qui partent dans tous les sens. En plus, leurs auteurs ne sont ni archéologues ni anthropologues. Harari est historien médiéviste ; Diamond est biologiste. David Graeber et moi avons jugé qu’il y avait un vide à combler. D’où notre démarche de redéfinir l’idée même d’une origine historique des inégalités. Il est par ailleurs interpellant de voir des travaux, qui se présentent comme scientifiques, s’appuyer encore sur le Discours sur l’origine et le fondement de l’inégalité parmi les hommes, de Jean-Jacques Rousseau, alors que celui-ci n’a jamais présenté son texte comme un travail scientifique mais plutôt comme une expérience de pensée.

L’une des principales critiques que vous adressez à ces auteurs porte sur la notion même d’égalité. La recherche de l’origine des inégalités serait une approche erronée pour documenter l’histoire de l’humanité.
« Quelle est l’origine de l’inégalité? »: si on réfléchit deux secondes à cette question, à la manière dont elle est posée, on s’aperçoit vite qu’elle implique un présupposé. Celui-ci consiste à suggérer que les sociétés primitives étaient égalitaires et qu’un événement quelconque nous aurait fait basculer dans une société inégalitaire. Il faut dépasser cette grille d’analyse. C’est un piège que de se lancer dans une enquête sur l’histoire de l’humanité en partant de ces fausses prémisses. Les sociétés de chasseurs-cueilleurs ne sont en aucun cas égalitaires. Elles sont beaucoup plus complexes, et, surtout, plus intéressantes. Il faut cesser de les considérer comme un bloc monolithique. Dans ces sociétés, il y a eu autant de communautés que de modes d’organisation. On y expérimentait beaucoup de choses, nettement plus que de nos jours. Au final, on recense une gamme d’expérimentations très variée, allant de sociétés fort hiérarchisées – comme dans l’antique cité chinoise de Shimao – à d’autres où l’on ne retrouve nulle trace d’un pouvoir centralisé basé sur la subordination. C’est précisément cette diversité qui doit nous fournir matière à réflexion aujourd’hui.
Sur quelles sources archéologiques vous êtes-vous appuyés pour cette étude?
Aujourd’hui, les sciences archéologiques sont très sophistiquées. Elles permettent de reconstituer, en détail, les mouvements de populations préhistoriques, leur régime alimentaire, ou encore leur rapport aux paysages. Une large gamme de techniques, y compris la génétique, fournit de précieuses informations – bien plus que de simples fouilles de sites archéologiques. Ces données permettent aussi de remonter très loin, jusqu’à 20 000 ou 30 000 ans en arrière, pour avancer des thèses très précises sur les sociétés humaines. Nous citons beaucoup de ces études, donc nous nous appuyons, par ailleurs, sur le travail de bon nombre de chercheurs. Ce livre est aussi le leur, à certains égards.
Le matriarcat primitif est une zone « interdite », quand on observe le traitement réservé aux chercheurs qui osent l’évoquer.
Votre critique de la notion d’égalité revêt un autre aspect: vous remettez en question son bien-fondé en tant que grille d’analyse de la société.
Comme chercheurs, notre travail est d’apporter le maximum de clarté à nos propos. Nous avons constaté que la manière dont on parle d’inégalité et d’égalité dans le débat public engendre de la confusion. On ne sait pas, en réalité, de quoi on discute exactement. Quand on critique vaguement les « inégalités » dans la société, auxquelles fait-on référence? Les inégalités devant la loi? De genre? De patrimoine? De revenus? En revanche, nous soulignons dans Au commencement était… Une nouvelle histoire de l’humanité qu’il existe deux conceptions radicalement différentes d’une société égalitaire. La première consiste à placer chacun sur un même pied. Dit simplement, le tout devient le même, vous et moi devons être les mêmes, s’habiller de la même façon, manger les mêmes produits, etc. Dans ce cas, je parlerais plutôt de similarité que d’égalité. Nous citons des exemples, étayés par des données archéologiques, en Mésopotamie et dans le sud de l’Asie. On y remarque l’obsession de la standardisation: la cité est composée de maisons construites à l’identique – architecture, matériaux, etc. De l’autre côté, on note une conception distincte de l’égalité, dans laquelle personne n’aurait le droit de dicter à son semblable sa manière d’agir ou de penser. L’individu y célèbre sa façon d’être dans la différence. Il ne s’agit en aucun cas d’une vision idéaliste ou d’une utopie. Des cités ont expérimenté ce mode de vie. Chaque maison, notamment, était un chef-d’oeuvre en soi.

Votre étude accorde une place considérable aux Amérindiens. En quoi leur rôle, tel que vous le décrivez, change-t-il la perception de l’histoire de l’humanité?
A vrai dire, quand nous avons commencé le travail, nous n’avions pas prévu de nous attarder sur ce pan de la civilisation. Ce n’est qu’au fur et à mesure de nos recherches que la question s’est imposée à nous. Cela a commencé quand on s’est dit que, plutôt que de se demander quelle est l’origine des inégalités, il serait plus intéressant de s’intéresser à… l’origine de cette question même des origines. Nous avons été frappés de découvrir que cela a démarré avec le concours lancé par l’ Académie de Dijon, auquel Jean-Jacques Rousseau avait participé avec son célèbre Discours. Il est en effet surprenant qu’un groupe d’intellectuels de l’ Ancien Régime en France, société extrêmement hiérarchisée, pose une question formulée ainsi, avec ce présupposé que les sociétés étaient égalitaires à un moment de notre histoire. Cela s’explique, notamment, par le fait que, quand les philosophes des Lumières parlaient d’égalité et de liberté, ils faisaient souvent référence, implicitement ou explicitement, aux Amérindiens. Ces philosophes étaient bien au fait de la littérature coloniale, émanant principalement des jésuites, à la faveur de laquelle commençaient à circuler des informations sur des sociétés qui fonctionnaient sans police, sans juges, sans prisons, et avec un rapport à l’argent différent de celui de l’Europe. Longtemps, les historiens ont accepté l’idée que nous avons emprunté aux Amérindiens des pratiques et produits – le tabac, entre autres. En revanche, ils avaient bien du mal à admettre que ces derniers ont également, de manière indirecte, exercé une influence culturelle sur l’Europe.
Vous consacrez un chapitre au matriarcat primitif. Pourquoi l’avoir intitulé « Zone de recherche interdite »?
Il est évident qu’il s’agit d’une zone « interdite », quand on observe le traitement réservé aux chercheurs qui osent évoquer l’hypothèse que les femmes, dans les sociétés préhistoriques, ont eu un statut supérieur à celui d’aujourd’hui. Nombre d’entre eux ont été violemment ostracisés. Le cas de l’archéologue lituano-américaine Marija Gimbutas est révélateur. Son seul tort était d’avoir soutenu la thèse selon laquelle, jusqu’à ce qu’ils soient envahis par des aryens aux moeurs patriarcales, les peuples cultivateurs avaient vénéré des déesses et qu’ils valorisaient les femmes et les hommes à égalité. Elle a été accusée d’avoir inventé ces thèses de toutes pièces et de militer pour des théories écoféministes. Je pense que beaucoup de ses détracteurs ne l’ont même pas lue, parce que son propos est nettement plus nuancé qu’ils ne le laissent entendre. Rappelons, d’ailleurs, que de récentes découvertes d’ ADN lui ont donné formellement raison.
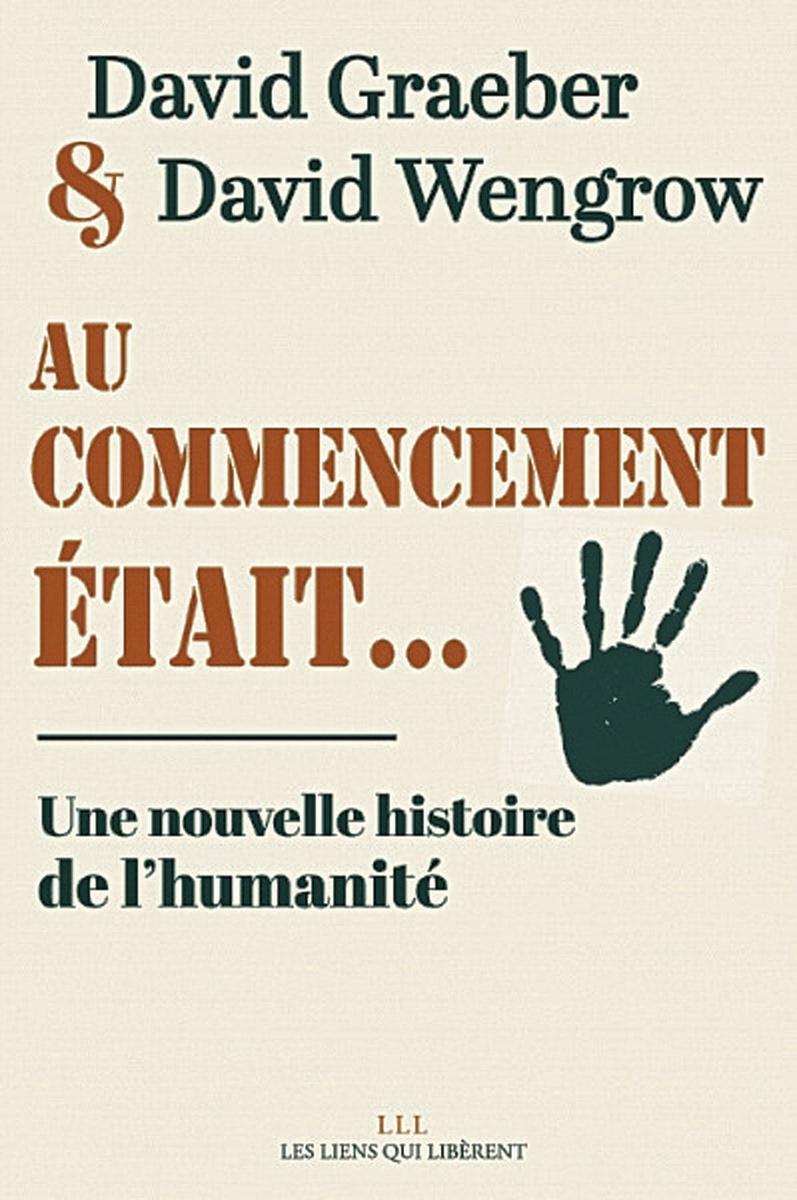
Vous êtes aussi connu, au même titre que David Graeber, pour votre sensibilité anarchisante. On pourrait vous objecter que votre ouvrage porte les traces de cet engagement et favorise une conception « anarchiste » de l’histoire de l’humanité.
En effet, cette critique nous a déjà été adressée. Mais si on avait voulu écrire une histoire de l’anarchisme, on l’aurait fait, comme s’y est d’ailleurs brillamment attelé l’anthropologue James C. Scott dans Zomia ou l’art de ne pas être gouverné (Le Seuil, 2013). Ce n’était pas notre objectif, en partie parce que l’anarchisme, en tant qu’ensemble d’idées, reste un courant assez récent, alors que notre livre retrace à peu près 30 000 ans d’histoire. Malheureusement, plusieurs commentateurs s’amusent à coller des étiquettes, à caser les chercheurs dans des catégories, et à créer ainsi une sorte d’ambiance de cour de récréation avec des interpellations du genre: « Toi, tu es ceci, toi, tu es cela. » Cette attitude m’ étonne, car notre rôle dans la société, en tant que chercheurs, est avant tout d’être des transmetteurs de savoirs vérifiés et argumentés.
Selon vous, quelles leçons peut-on tirer de cette étude à la lumière des enjeux contemporains?
J’ai déjà reçu plusieurs réactions de lecteurs. Ce qui m’a frappé, c’est leur diversité et leurs différents angles selon lesquels ils appréhendent le contenu de l’ouvrage. Chacun y perçoit un message différent. A vrai dire, j’en suis pleinement satisfait. Cela prouve que notre livre n’est pas dogmatique. C’est d’ailleurs ainsi que nous l’avions conçu, comme une sorte de boîte à outils où chacun peut puiser ce dont il a besoin. Les relations de genre, la notion de propriété privée, l’urbanisme, l’agriculture, la famille, sont un recensement, non exhaustif, des thèmes qu’on y retrouve et qui peuvent nous éclairer sur bien des enjeux contemporains. Mais une chose est sûre: nous avons tous énormément à apprendre des expériences sociales du passé.
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici