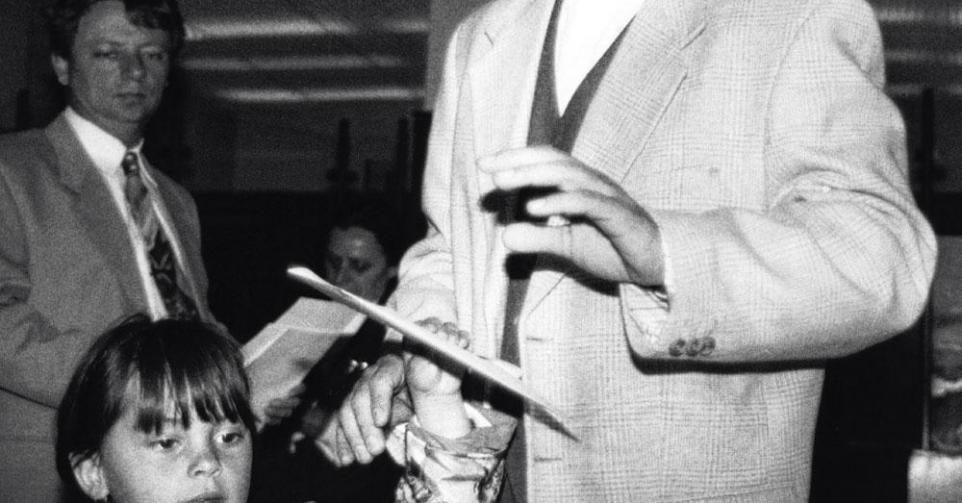
Marion Van Renterghem : « L’Europe de 2019 n’est pas loin de celle de 1939 »

En 1989, le mur de Berlin tombe et la démocratie libérale gagne tout le continent. Trente ans plus tard, le repli nationaliste ronge l’Union. La journaliste Marion Van Renterghem a parcouru l’Europe pour comprendre cette évolution.
Il y a trente ans, le monde basculait vers l’inconnu : le dernier des deux grands totalitarismes était vaincu et l’Europe se réunifiait. La démocratie libérale apparaissait comme un horizon indépassable. Aujourd’hui, l’Union européenne est secouée par une agitation nationaliste et populiste nourrie par la peur et le ressentiment. Des fissures apparaissent de toutes parts, entre les Etats membres fondateurs du projet européen et les derniers arrivés, entre le Nord et le Sud, entre les créditeurs et les débiteurs, entre les disciplinés et les endettés. Plus grave : alors que le monde n’est plus coupé en deux, les pays, eux, le sont, avec d’un côté les bienheureux du monde global, et de l’autre ceux qui n’ont pu suivre. Que se passe-t-il ? De Budapest à Londres, de Varsovie à Rome, Marion Van Renterghem a parcouru cette Europe d’humeur sombre. Grand reporter au journal Le Monde puis à Vanity Fair, auteure d’ Angela Merkel, l’ovni politique (Les Arènes/Le Monde, 2017), elle vient de publier Mon Europe, je t’aime moi non plus 1989-2019 (1).
Il y a trente ans, vous étiez « pleine d’espoir », écrivez-vous. N’idéalise-t-on pas le « bon vieux temps » ?
Rappelez-vous les événements exaltants de 1989 ! Il y a trente ans, Solidarnosc gagnait son combat contre le communisme en Pologne. Le rideau de fer entre la Hongrie et l’Autriche craquait. L’Union soviétique explosait. Le dramaturge et opposant tchèque Vaclav Havel devenait président. Les Baltes formaient une longue chaîne humaine entre Vilnius et Tallinn via Riga. Un étudiant tout seul arrêtait un char sur la place Tiananmen. L’Europe voyait la vie en rose : la social-démocratie avait le vent en poupe et Jacques Delors présidait la Commission européenne. L’arrivée d’Internet allait offrir le monde en accès libre. C’était excitant !
N’y avait-il pas, dès cette époque, des signes annonciateurs d’une remise en cause de la démocratie libérale et de l’Union européenne ?
C’est vrai, à l’Est, des résurgences identitaires sont nées de la disparition du bloc soviétique, comme l’avait prédit Samuel Huntington. A l’Ouest, le clivage gauche/droite commençait déjà à s’estomper pour laisser la place à une opposition entre Européens et souverainistes. Par la suite, nationalistes de gauche et de droite vont faire cause commune dans la détestation de l’Union, la vénération de Vladimir Poutine, la haine des élites, des élus et des médias. Et le Web a tissé ses fils sans qu’on comprenne ce qui allait nous tomber dessus.
Aujourd’hui, qu’est-ce qui vous inquiète ?
La marche arrière vers la case départ. L’Europe de 2019 n’est pas loin de celle de 1939, de » la défaite de la raison » analysée par Stefan Zweig avant son suicide dans son exil brésilien. Les clameurs nationales recouvrent les discours d’ouverture. A l’Est, mais aussi chez nous, la sympathie se développe pour les régimes autoritaires. Les Américains se détournent de l’Europe. La Russie de Poutine veut la détruire. Et la Chine a commencé à la racheter, morceaux par morceaux. Si l’Union disparaît, les nations qui la composent seront inexistantes dans le monde. Elles seront complètement absorbées. Soit on prend conscience de la nécessité de la renforcer, soit on cède aux marchands de peur qui font croire que le nationalisme répond aux défis actuels. Notre civilisation gréco-romano-judéo-chrétienne, socle de la démocratie, va disparaître si la solidarité entre Etats membres est remise en cause, si les pays européens se replient sur leurs égoïsmes.

Le Brexit est « l’événement qui solde ces trente ans », écrivez-vous. Que voulez-vous dire ?
Le Brexit m’obsède. C’est mon grand traumatisme. Quand j’ai appris, le matin du 24 juin 2016, le résultat du référendum britannique, je suis restée dans mon lit comme une momie. J’ai eu l’image du château de cartes avant l’effondrement. J’avais le sentiment que nos valeurs étaient en train de basculer. Le vote » leave » est le premier désastre démocratique du xxie siècle, suivi par les victoires électorales de Donald Trump, Jair Bolsonaro, Matteo Salvini… Pendant la campagne du référendum, tous les ingrédients du populisme ont été réunis et amplifiés à un niveau jamais atteint depuis la Seconde Guerre mondiale. Parmi les thèmes vendeurs exploités : le peuple contre les élites, la nation contre Bruxelles, la menace de l’immigration, la grandeur nationale… A cela s’ajoutent les suspicions d’ingérences étrangères : celle de la Russie de Poutine, celle de la société d’analyse de données Cambridge Analytica coprésidée par Steve Bannon, l’ancien conseiller stratégique de Donald Trump… Le mensonge a été érigé en stratégie politique. Nigel Farage et Boris Johnson, les plus ardents défenseurs du Brexit, ont poussé à l’extrême ce que Joseph Goebbels, chef de la propagande nazie, avait théorisé : » Plus le mensonge est gros, plus il passe. Plus souvent il est répété, plus le peuple le croit. » Et, comme par hasard, les Britanniques viennent de découvrir que Steve Bannon se vantait d’avoir conseillé Boris Johnson, leur possible futur Premier ministre…
Vous avez rencontré, en Italie, Benjamin Harnwell, un associé de Steve Bannon, qui tente de fédérer les droites nationalistes en Europe. Quelle est leur stratégie ?
Dans le grand projet de Bannon, Harnwell s’occupe du volet » éducation « . Selon la bonne vieille théorie gramscienne, la rupture avec le système politique existant passe par le remodelage du contexte culturel et intellectuel. Le monastère de Trisulti, près de Rome, hébergera une académie sous l’impulsion de Steve Bannon, sous la présidence du cardinal ultraconservateur Leo Burke et sous la direction de Benjamin Harnwell. Elle formera les étudiants à la pensée conservatrice au sein de l’Eglise et à la politique dite » populiste nationaliste « . L’objectif est de former les leaders ultraconservateurs de l’Europe de demain, les futurs Salvini, Orban, Kurz… Bannon navigue entre ses bureaux de Bruxelles et ceux de Rome, ville qui est, à ses yeux, le laboratoire du national-populisme. De là, il sillonne l’Union pour préparer le grand soir avec ses amis Matteo Salvini, Nigel Farage, Viktor Orban, Marine Le Pen…

Le projet d’une alliance européenne des nationalistes menace l’Union ?
Heureusement, au-delà de leur rejet commun de l’Union européenne et des migrants, les populistes et les nationalistes ne parviendront jamais à s’entendre. Leur bataille d’ego voue leur alliance de circonstance à l’échec. Il y a un fossé idéologique entre les dirigeants nationalistes polonais, qui sont des catholiques ultraconservateurs et antirusses, et un Matteo Salvini, tribun populiste à la Mussolini, un peu vulgaire et de moeurs légères. Salvini laisse filer le déficit budgétaire italien, alors que Nigel Farage, Boris Johnson et les nationalistes scandinaves sont des ultralibéraux peu enclins à la cannibalisation des finances de l’Etat. Le plus futé de tous est, à mon avis, le Hongrois Viktor Orban, inspiré par Poutine et Erdogan.
Pourquoi Orban ?
C’est un intellectuel. Il a théorisé et appliqué le concept de démocratie » illibérale « , en opposition aux vieilles démocraties libérales de l’Ouest rongées, selon lui, par le laxisme et la perte d’identité. Au début des années 1990, j’ai résidé un an à Budapest. A l’époque, Orban était mon héros. Avec ses cheveux longs, son air de crooner romantique, il était la coqueluche des jeunes libéraux libertaires en rupture avec le passé communiste. Il prônait le contraire de son idéologie actuelle : pas d’accents nationalistes, une volonté de parler vrai contre les démagogues. En 2006, je suis allée l’interviewer chez lui. De libéral de gauche, son parti, le Fidesz, virait conservateur de droite. Orban avait collé une carte de la Grande Hongrie sur son pare-brise.
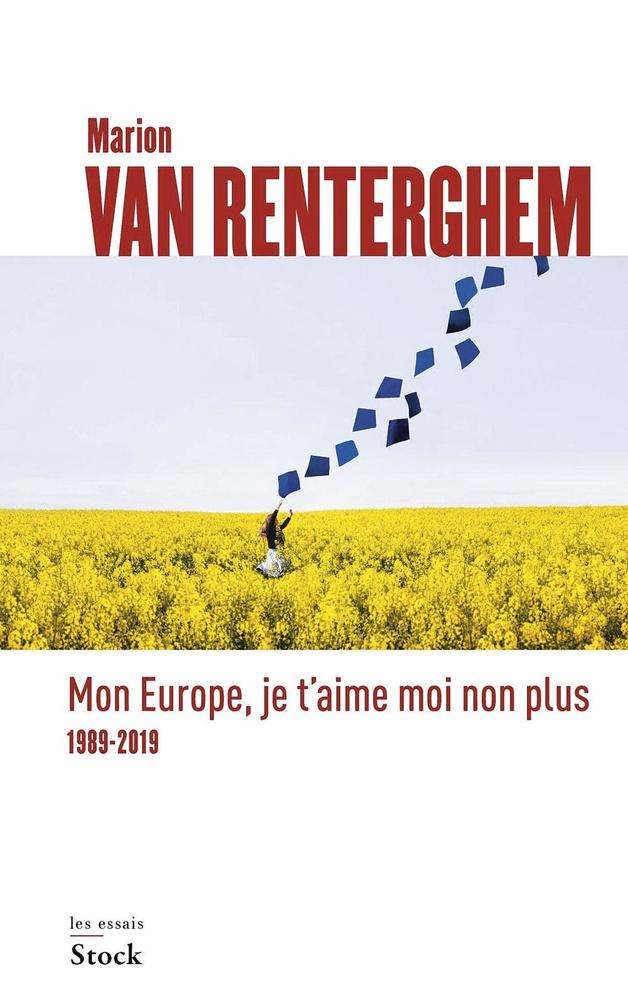
Tous les Hongrois n’adhèrent pas à sa conception de la démocratie. Les sociétés ne sont-elles pas, de plus en plus, coupées en deux ?
De fait, il y a deux Hongrie, deux Pologne, deux Allemagne, deux Grande-Bretagne, deux France, deux Etats-Unis… Londres est une planète à part au royaume du Brexit, avec sa City, son maire musulman libéral, ses habitués de l’Eurostar. De même, la polarisation de la société tchèque est totale : Prague a voté en masse à la présidentielle de 2018 pour l’académicien proeuropéen Jiri Drahos, rejeté par le reste du pays qui a donné la victoire au pro-Poutine Milos Zeman. Il y a les élites urbaines cosmopolites et les citoyens ancrés dans leurs périphéries et malmenés par la mondialisation. Les électeurs antisystème sont le terreau idéal des leaders populistes.
Comment voyez-vous l’avenir européen ?
Il y a tout de même des raisons d’espérer. Le chaos dans lequel les Britanniques sont plongés depuis qu’ils demandent le divorce a calmé les ardeurs des dirigeants nationalistes européens qui voulaient voir leur pays sortir de l’euro et de l’Union. Le projet de quitter le bateau n’est plus vendeur. Il fait peur aux citoyens. Les Européens réalisent qu’il y a des démocrates libéraux et d’autres illibéraux, des partis proeuropéens et des partis populistes. Emmanuel Macron a bien mis en évidence ce clivage lors de la campagne pour les élections européennes, mais les termes utilisés par le président français étaient mal choisis : les » progressistes » contre les » nationalistes « . Le premier est un mot fourre-tout, vide de sens, et le deuxième laisse entendre, à tort, que l’idée de nation n’appartiendrait qu’aux nationalistes, alors que l’Union européenne n’est pas la négation de la nation. Par ailleurs, on assiste à une prise de conscience européenne de la fragilité de l’Europe et de la démocratie. Jusqu’ici, seuls les antieuropéens se manifestaient avec une idéologie et un programme, tandis que les proeuropéens considéraient la paix entre les nations et la communauté européenne comme acquise. Ils ne prenaient pas la peine de soutenir l’Union européenne. Beaucoup comprennent à présent qu’elle fait notre force. De même qu’il y a un réveil sur la question climatique au moment où l’humanité est au bord du gouffre, il y a un réveil européen au moment où l’on prend conscience que l’Union est mortelle et qu’elle pourrait très bien disparaître.
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici