
Laisse béton
Confiez le jargon des annonces immobilières et une charge d’humour noir au romancier belge Bernard Quiriny, il vous délivre un roman atypique, semi-ouvert et rafraîchi. A saisir !
Sur les brochures immobilières, le ciel est toujours bleu et quelqu’un arrose ses fleurs sur son balcon. Au Mayerling, c’est une tout autre limonade. Alors qu’ils étaient venus chercher une promesse de sérénité vendue clé sur porte, ses habitants voient leur vie se dérégler. La très pieuse Mme Camy devient nymphomane, une odeur pestilentielle s’échappe du logement de Mme Meunier, quant à Mme Chopard, elle voit le fantôme de sa mère… Le Mayerling aurait-il décidé d’en finir avec ses habitants ? Aujourd’hui pigiste pour L’Opinion et Le Nouveau Magazine Littéraire, le romancier Bernard Quiriny ( L’Angoisse de la première phrase, Contes carnivores, Le Village évanoui, Histoires assassines…) a fait ses armes chez Chronic’art, où il développait déjà des idées originales – dont cette façon alternative d’envisager la critique littéraire : au résumé de l’intrigue et autres métaphores fumeuses, préférer situer un livre en indiquant dans quel rayon de sa bibliothèque on l’a rangé. Soit un jeu subtil d’affinités électives dont il demeure littéralement quelque chose : dans L’Affaire Mayerling, les deux narrateurs se piquent d’évoquer leur » bibliothèque immobilière » idéale – Perec, Marcel Aymé et J.G. Ballard y jouent les passe-murailles. C’est que l’écrivain belge s’y entend pour faire affleurer les choses. Détournant les codes du fantastique, il fait du genre littéraire un cheval de Troie pour la critique sociale. Pulvérisant le format long en une myriade de courts chapitres, distillant de brefs inserts techniques et documentaires, Quiriny régale à tous les étages. Entre deux apparitions spectrales, sociologie et humour noir se tapent des barres d’immeubles et de rire.
Après Le Village évanoui, L’Affaire Mayerling : dans vos livres, le fantastique habite souvent un lieu…
Dans Le Village évanoui, mon thème était la démondialisation. Je ne voulais pas tant parler d’un lieu que de la rupture avec les autres lieux. Pour L’Affaire Mayerling, ce qui a motivé le point de départ, c’était l’urbanisme contemporain et l’architecture invivable. J’avais pensé faire un périple où le narrateur et son copain auraient visité les plus grands saccages urbanistiques sur l’ensemble de la planète ; on aurait fait un petit passage par certains quartiers de Bruxelles… Ça aurait pu donner lieu à un roman itinérant. Puis, je me suis souvenu de Perec et de La Vie mode d’emploi, un incontournable quand vous pensez » roman + immeuble « … Et planter le roman dans un immeuble dont on fait tomber la façade, c’était une tentation irrésistible. C’est le roman d’un non-lieu finalement, parce que c’est un immeuble qui ressemble à tous les autres dans une ville qui ressemble à toutes les autres.
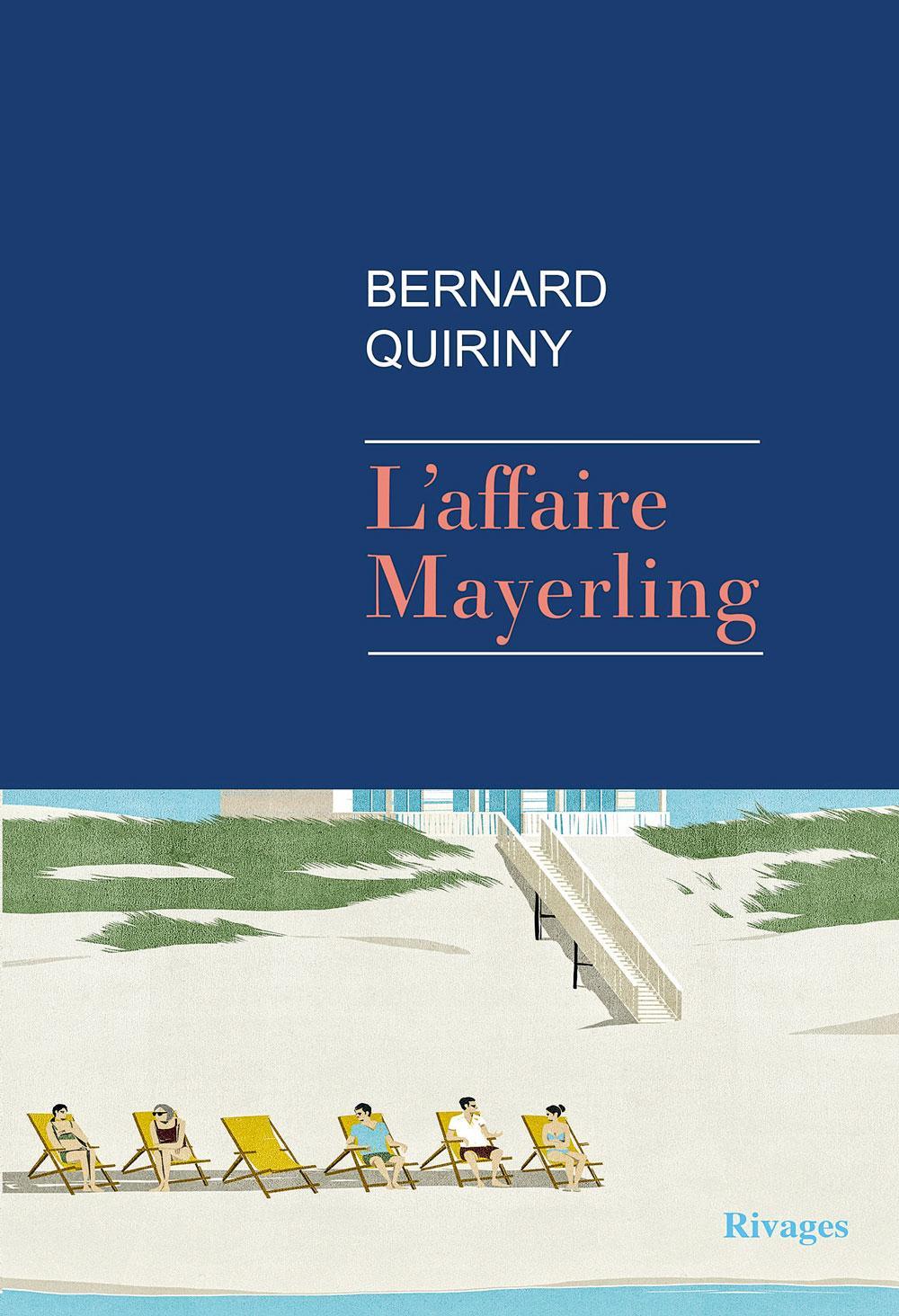
Vous posez les fondations en évoquant les strates de passé du Mayerling, ce bâtiment bourgeois, devenu asile, puis occupé durant la guerre…
Je trouvais qu’il y avait des choses marrantes à dire, tout un décor à planter sur les promoteurs, leur jargon, mais sans le vouloir, je n’ai pu m’empêcher de faire ces allusions au passé de l’immeuble. Dans tous les romans de maison hantée, vous avez ça : » A cet endroit-là, il y avait un cimetière indien « , etc. On n’échappe pas à une certaine mécanique romanesque, les romans sont des machines avec lesquelles on ne peut pas jouer tout à fait librement. Elles ont une série de contraintes internes qui sont propres au format et au sous-genre dans lequel on s’inscrit et, qu’on le veuille ou non, on est aimanté par ces techniques.
Le livre traite du cadre de vie mais aussi de la question du vivre-ensemble, cette utopie contemporaine souvent malmenée…
Une part importante de notre bien-être dépend de la qualité du décor dans lequel on vit. L’architecture, l’urbanisme et le cadre de vie peuvent rendre fous. Quand on parle du vivre-ensemble aujourd’hui, c’est un peu différent car on parle de communautés culturelles… Indépendamment de la question du livre, des communautés culturelles, la vie en ville, c’est pour moi un entassement généralisé. En appartement, vous vivez quand même avec quelqu’un au-dessus, en dessous, sur les côtés. Ça nécessite des êtres humains d’une qualité particulière. S’il n’y a pas un minimum de savoir-vivre et de bonne éducation, ça ne peut pas marcher. La capacité de résistance, de réserve dont est capable l’homme citadin me remplit d’admiration.
Dans le récit, tout n’est pas complètement bouclé : on ignore l’origine du mal, la motivation exacte des deux narrateurs… Pourquoi laisser cette part d’irrésolu ?
On a souvent l’impression que le dénouement d’un livre doit consister précisément à tout mettre en scène de façon à finir le paquet cadeau. Mais vous risquez alors de vous emmêler les pinceaux. Ça marche beaucoup mieux si vous laissez un peu de flou artistique, s’il reste quelques trous dans les murs et trois, quatre fenêtres ouvertes… Ça vous titille, vous gardez ça en mémoire. Le Village évanoui était typiquement un roman non fini, non bouclé, par exemple. Si je boucle le truc, vous serez forcément déçu.
Un peu comme dans les séries, dont Lost constitue un cas d’école ?
Lost est vraiment parti en vrille. Comme c’était hyper bien fait au début, j’ai suivi cette série avec passion. Tout le monde croyait qu’il y avait un plan génial, alors que pas du tout. Aux deux tiers, on a commencé à être déçu et à la fin, c’est devenu vraiment n’importe quoi. Dans un roman de 300 pages, l’intéressant, c’est que ça suscite une forme d’interrogation. Pouvoir lancer des idées paradoxales, au sens chestertonien du terme (NDLR : l’écrivain anglaisGilbert Keith Chesterton était surnommé » le prince du paradoxe « ), renverser la façon ordinaire de regarder les choses, c’est une bonne manière de réfléchir. Parfois, ça en dit plus long de regarder les choses comme elles ne sont pas…
Vous vous nourrissez des signes ? Pensez-vous par exemple que les livres nous choisissent ?
Je suis assez cartésien dans la vie ordinaire… Lorsqu’il s’agit de littérature, on ne va pas dire qu’une forme de magie est à l’oeuvre, mais disons que je ne crois pas au hasard. J’ai tendance à penser que si un livre est fait pour vous, vous finirez par tomber dessus. Le livre est au centre d’un labyrinthe de connexions possibles. Une raison honnête et honorable d’écrire des livres pour moi, c’est de les soumettre au lecteur afin qu’il repère des connexions que vous n’aviez pas imaginées. A la question » Pourquoi écrivez-vous ? « , je réponds : » Pour être amené vers les livres qui m’intéressent. »
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici